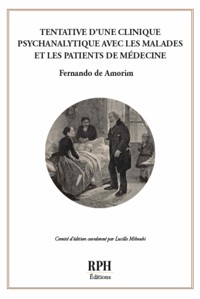Le transfert dans la clinique psychanalytique des malades organiques - Tome 1 E-Book
Fernando de Amorim
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans ce premier tome, Fernando de Amorim, à partir de sa lecture de l’œuvre freudienne, étudie le transfert, ses enjeux ainsi que ses particularités dans la conduite des cures avec les malades organiques. Il y définit et affine des concepts fondamentaux en psychanalyse, tels que la défense, le refoulement, la résistance et la censure. Le conflit intrapsychique est mis en évidence ainsi que les interventions des instances psychiques freudiennes : le Moi, le Ça et le Surmoi.
Au fil de son étude, est élaborée une stratégie clinique psychanalytique innovante pour le traitement de la maladie organique, stratégie au sein de laquelle s’associent médecins et psychanalystes au moyen de la clinique du partenariat. Si c’est le médecin qui soigne l’organisme, Amorim encourage néanmoins l’intervention du psychanalyste dans l’opération thérapeutique. En effet, le désir du psychanalyste compte, car c’est celui-ci qui poussera l’être en position de malade vers la position de patient, de psychanalysant, puis de sujet. C’est ce dont témoigne, dans le présent ouvrage, la clinique psychanalytique de l’auteur.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fernando de Amorim, psychanalyste, développe et revisite les concepts et les techniques freudo-lacaniens. Il est l’auteur de Le transfert dans la clinique psychanalytique des malades organiques (2000), Cartographie de la clinique avec le malade organique, corporel et psychique à l’usage des médecins, psychistes et psychanalystes en institution et en ville (2004), Projet pour une psychanalyse scientifique (2015). Le Manuel de psychanalyse du RPH-École de psychanalyse a vu le jour sous sa direction (2023).
Il enseigne et transmet la psychanalyse au sein de l’école du RPH. Il a créé la Consultation Publique de Psychanalyse (CPP), puis le Service d’Écoute Téléphonique d’Urgence (SETU ?).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
RPH
Paris 1996-1997
Première publication 2000
Édition 2025
ISBN : 978-2-38625-595-3
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Fernando de Amorim
LE TRANSFERT DANS LA CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DES MALADES ORGANIQUES
Tome 1 LE TRANSFERT CHEZ FREUD
Comité d’édition coordonné par Lucille Mihoubi
Sommaire
Avant-propos
Le transfert chez Freud
1. Le résistransfert et la transferésistance
2. La défense
3. La censure
4. Défense contre la sexualité
5. La névrose de défense
6. Le refoulement
7. L’inconscient à l’extérieur
8. Le messager du refoulé
9. Les transferts
10. La boussole
11. Les fantasmes du transfert
12. Nous y sommes
13. La maladie organique comme résistance
14. De l’impossibilité du filet symbolique
15. De pauvres changements
16. Il se sent coupable de quelque chose
17. Discussion
18. L’organisme malade n’est plus zone érogène
Références bibliographiques
AVANT-PROPOS
Dans le même temps où le RPH était créé, s’est tenu en 1996-1997 à l’hôpital franco-musulman de Bobigny en Île-de-France (93), aujourd’hui Hôpital Avicenne, un séminaire dirigé par Fernando de Amorim. Ce séminaire de psychanalyse sur le transfert chez Freud dans la clinique psychanalytique des malades organiques s’adressait à des psychologues des services de l’établissement hospitalier et à des étudiants en médecine et en psychologie, dont je faisais moi-même partie. C’est ici la première parution éditoriale. Le séminaire a été diffusé dès 1997 aux participants et aux membres du jeune RPH. C’était alors le premier séminaire de Amorim, il sera suivi d’une succession annuelle donnant lieu à publication.
Dans ce Tome 1, à partir d’une lecture approfondie des textes freudiens et d’exemples cliniques issus de sa pratique à l’hôpital avec des malades souffrant de maladie organique, Amorim retrace le concept du transfert chez Freud. Il reprend chaque concept fondamental comme les cinq résistances des organisations psychiques, la censure, la défense, le refoulement, et il les articule au transfert. Selon Freud, il est nécessaire qu’une censure se mette en place pour qu’existe la résistance. Amorim fait la distinction entre résistance et censure dans la mesure où la censure est une résistance spécifique. « La censure est utilisée par le patient pour montrer au psychanalyste qu’il ne suit pas le désir du psychanalyste dans ses efforts thérapeutiques. (…) La censure vise directement le désir du psychanalyste »1.
Le résumé de la démarche de Amorim, ce à quoi il travailla et travaille, est placé – comme par hasard ? – au mitan du présent recueil où sont consignés les actes du séminaire sur le transfert chez Freud :
« Il ne faut pas que nous lâchions notre tâche qui est d’écrire une théorie des malades organiques. Notre travail depuis plusieurs années consiste à ne pas succomber au chant des sirènes d’une lecture psychothérapeutique ou psychopharmacologique, voire psychosomatique de la clinique du malade organique. C’est un psychanalyste, soutenu par la psychanalyse, avec sa méthode et ses techniques qui pourra apporter quelques éléments effectifs à ces sujets. Notre clinique en est la preuve. Notre objectif majeur est que la clinique, donc le transfert, soit possible avec le malade organique. »2
Il est admirable de constater qu’à ce jour personne n’a pu surprendre Amorim à une quelconque dérogation à sa position de psychanalysant. C’est lui qui a fait du RPH ce qu’il est ; du diamant il a donné à cette école de psychanalyse la forme et la brillance. Il guide les cliniciens qui acceptent de le suivre et de respecter ses indications techniques et théoriques vers une psychanalyse française d’exception où nul compromis sociétal ou psychologique ne siège.
Il continue, grâce à une lecture toujours plus fine de l’appareil psychique et de ses organisations, d’élaborer la métapsychologie de la maladie organique. Il continue de tendre la main aux médecins, chirurgiens et spécialistes de toute obédience, afin de mettre en place une collaboration entre médecine et psychanalyse ; collaboration qu’il a nommée depuis clinique du partenariat. Une constatation s’impose : sans transfert aucune clinique quelle qu’elle soit n’est possible.
Ce Tome 1 présente les prémices de son enseignement et pourtant il comporte déjà beaucoup de sa pensée novatrice de la clinique avec les patients de maladies organiques. Depuis, Amorim, navigateur infatigable de la mer Œdipienne, poursuit son voyage en nous offrant chaque année un nouveau séminaire issu de ses recherches et de son enseignement toujours renouvelé. Qu’il en soit ici remercié.
Laure BaudimentParis, le 17 avril2024
1Infra, p. 28.
2 Infra, pp. 98-9.
LE TRANSFERT CHEZFREUD
1. LE RÉSISTRANSFERT ET LA TRANSFERÉSISTANCE
Notre orientation réside dans l’idée selon laquelle le sujet tombe malade parce qu’il résiste à quelque chose. Il se refuse au transfert vis-à-vis d’un objet. C’est ce que nous appelons le Résistransfert. D’un autre côté, la transferésristance est un phénomène dont Sigmund Freud nous a déjà donné les pistes cliniques. Il dit qu’une psychanalyse sérieuse déclenche le transfert ainsi que la résistance.
À l’hôpital, avant d’arriver à ce qui caractérise notre clinique, à savoir le transfert, nous devons dépasser le désert que constitue la résistance du médecin, de l’infirmière ou d’autres soignants, de l’entourage des patients. Une fois traversée cette foule de possibles résistants au discours de l’inconscient, nous trouverons tout ceci condensé dans la résistance du malade. Cette résistance inconsciente vise à ne pas permettre la présence du sujet en tant que sujet du désir. À propos de cette résistance aux idées du sujet, nous pouvons donner comme exemple le cas d’Élisabeth qui, une fois sa sœur bien aimée morte, est traversée par une pensée humaine telle que : « qu’il [le beau-frère] était devenu libre, et qu’elle [Élisabeth] pourrait l’épouser. »3. Sa conscience ne pouvait pas supporter un tel désir, aussi est-elle châtiée par des douleurs physiques.
Je ne sais pas comment s’effectue le passage de la pensée au déclenchement de la maladie organique. Mais ce dont nous pouvons témoigner c’est que si le sujet sort du registre de la maladie organique, du discours médical, et se trouve seul avec ses mots, il dit la même chose qu’Élisabeth : il dit de son désir que sa présence a été refusée par les instances du moi. Il y a de la mort, de l’amour, dans le discours du sujet atteint d’une maladie organique. C’est dommage que les psychistes ne sachent pas prêter le soin nécessaire, c’est-à-dire ne sachent quoi faire du point de vue technique.
3 Freud, S. & Breuer, J. (1895). Études sur l’hystérie, Paris, PUF, 1956, p. 124.
2. LA DÉFENSE
La difficulté de Freud à hypnotiser quelques patients l’a conduit, nous semble-t-il, à reconnaître l’existence du transfert et sa suite, c’est-à-dire la résistance. C’est l’indication que le sujet résiste à l’analyse qui nous fait dire que la psychanalyse n’est pas pour tout le monde. La similitude entre l’hypnose et la psychanalyse qui ne fonctionnent pas est qu’il y a plus de résistance que de transfert. Nous pouvons même dire que le moi résiste à donner son amour à l’objet. Freud dit : « Un sujet qui se méfie de l’hypnose, qu’il exprime ou non ce refus, ne peut être hypnotisé. »4 Comment contourner l’hypnose ? Comment contourner la résistance ? Ce sont les questions clés auxquelles le clinicien doit répondre quotidiennement dans l’exercice de sa clinique. Nous contournons la résistance après l’établissement du transfert.
Freud dit clairement qu’avant de s’occuper de la résistance du malade, il faut, par l’intermédiaire du travail psychique, « vaincre chez le malade une force psychique qui s’opposait à la prise de conscience (au retour du souvenir) des représentations pathogènes »5.
Ainsi, Freud nous rappelle que la notion de réaction de défense est une façon du sujet de se protéger des représentations ayant un caractère commun : « (…) elles étaient toutes pénibles, propres à figurer des affects de honte, de remords, de souffrance morale »6.
La défense est liée à « l’ignorance des hystériques »7 au fait que le sujet ne veut rien savoir. Dans ce cas, Freud démontre que la résistance peut être de l’ordre d’un « ne pas vouloir savoir ». C’est ici la dernière résistance (« résistance aux associations ») que nous pouvons rencontrer concernant la relation du moi au désir du sujet de l’inconscient8. Cependant, Freud nous indique que la résistance peut être, d’une part, de l’ordre du conscient, de la défense, et, d’autre part, de l’ordre de l’inconscient, donc de la résistance de l’inconscient, qui vise le principe de Nirvana.
Quand le patient ne veut rien d’autre que de la tranquillité et que le psychothérapeute lui offre ce qu’il demande en le laissant parler pendant 45 minutes très précisément, en faisant une séance par semaine, en restant carrément à la place du mort, j’ai beaucoup de mal à croire que l’esprit clinique soit au rendez-vous entre patient et psychothérapeute. Rencontres que, par leur manque de rigueur, nous pourrions qualifier de « sympa ». Freud n’hésite pas à parler d’insistance, de l’usage de moyens plus riches en vigueur9.
Il insiste quand le sujet résiste à l’association, c’est-à-dire lorsqu’il se défend de l’idée qui lui traverse l’esprit. Freud nous raconte l’histoire d’une jeune fille à la toux nerveuse10. Nous pouvons tirer deux enseignements de cette vignette clinique. Premièrement, c’est qu’il s’agit d’une défense. D’une défense car c’est une résistance relativement légère. Résistance qui cède la place à la mémorisation dès que Freud pose sa main sur le front de la jeune fille. Deuxièmement, c’est qu’il y a une résistance beaucoup plus consistante : une résistance de l’ordre de l’Inconscient. Ici, le sujet ne veut pas savoir. Dans ce cas, lui-même est ignorant de son désir. C’est justement cette résistance qui fait que la jeune fille interrompt l’analyse. Freud décrit le cas d’une patiente, une dame âgée, qui, faisant dans sa jeunesse la lecture d’un livre, était tombée sur une mention, au ton suffisamment respectueux, des processus sexuels. Freud utilise à ce moment-là la technique de la pression sur le front. La patiente se remémore donc avoir fondu en larmes et avoir jeté le livre au loin. Cette scène se passe avant sa première attaque d’angoisse.
La question est la suivante : s’agit-il d’une défense ou d’une résistance ? Jacques Lacan écrit dans le Livre II de son Séminaire : « (…) la résistance du sujet est liée au registre du moi, c’est un effet du moi »11. Il y a quelque temps, lors d’une conférence dans le XIIIe arrondissement, André Green, en faisant référence à la question de censure, se demandait d’où venait l’attaque. Il faut dire que la censure vise le champ de l’intersubjectivité, alors que la résistance est un processus intrapsychique. Il faut dire également que la censure du sujet est un effet de la relation réelle qu’il peut avoir avec le psychiste, donc, la censure part du sujet vers la personne du médecin, mais elle n’est pas du côté du médecin, sauf dans le cas où le médecin se perd dans la conduite du traitement. La résistance est du côté des instances psychiques, résistance du moi au désir qui vient du ça, résistance du surmoi au désir qui vient du ça. Ainsi, cette patiente de Freud résiste. Cependant, sa censure est revêtue d’une censure déclarée contre la personne du médecin, qu’était Freud, et contre n’importe quelle forme de thérapie commune. Nous pouvons dire que rien n’empêche que la censure vise l’objet refoulé, en voulant le détruire sans appel, comme le décrit Freud en faisant référence aux journaux étrangers censurés par les Russes12. La résistance vise uniquement à interdire le passage sans l’intention d’effacer le refoulé.
Dans un autre cas, Freud fait référence à la censure d’une patiente de ne pas se laisser faire, c’est-à-dire de se laisser hypnotiser profondément.
Nous pouvons remarquer que la tentation serait de dire qu’elle résiste. Mais non. Elle ne résiste pas, elle dit à Freud, dans son état de concentration (et donc pas dans une hypnose profonde), qu’elle n’accepte pas la façon freudienne. Freud, qui n’était pas né de la dernière pluie, accepte le vote de confiance de la patiente, vote maigrichon, certes, mais un vote quand même. Elle se laisse entrer dans un état de concentration. La patiente, écrit Freud, « se prêta avec tranquillité et de bonne grâce à mon procédé »13. Nous pouvons dire que dans cette expérience la censure n’est pas la résistance. Quand Freud suggère que la patiente aura accès à des souvenirs de son enfance et qu’elle les a, cela veut dire que la censure peut fondre comme neige au soleil. Et si la censure fond, c’est surtout grâce à la chaleur de l’amour de transfert.
De la résistance, ni le psychanalyste ni le moi du sujet ne sont au courant. C’est encore le transfert qui pourra faire en sorte que le sujet puisse découvrir son histoire refoulée. De la résistance il ne saura jamais rien. La résistance perd sa fonction dès que le refoulé n’occupe plus cette position. Cette patiente a eu la visite nocturne de sa bonne. Le lendemain, elle fait une attaque (stupeur, avec les membres rigides, la bouche ouverte et la langue pendante). Le moi résiste au souvenir de ce qui s’est passé pendant l’intrusion nocturne de la bonne. Le prix à payer pour l’ignorance est le symptôme. Ce sont les paroles de Freud, la communication de la vérité (que la bonne n’était pas partie pour se marier, mais avait été éloignée des enfants à cause de sa conduite) qui a provoqué le succès du traitement.
Freud parle d’une troisième patiente. Elle souffre d’obsessions et de phobies. II est intéressant de remarquer ici que Freud dit que cette dame était « franche et intelligente, et qu’elle opposait simplement une résistance consciente à peine perceptible »14. C’est là que nous pouvons profiter pour dire que la censure est la résistance consciente. Pouvons-nous soutenir cette hypothèse ? L’avenir proche nous le dira. Cette patiente « franche et intelligente » de Freud, quand celui-ci lui touche le front en lui demandant « Est-ce que vous avez vu quelque chose ou vous avez eu un souvenir ? », répond : « Rien du tout, mais tout à coup j’ai pensé à un mot ».
Quand la patiente de Freud dit « tout à coup j’ai pensé à un mot », cela veut dire que le refoulé a traversé la résistance du moi, mais la censure est tout aussi présente. C’est-à-dire que la patiente censure sa relation avec l’objet. Elle ne veut pas communiquer le peu qu’elle sait à Freud parce que le transfert tourne au vinaigre. Même son histoire, son secret avec sa sœur, est une affaire de censure car la résistance est basée sur le fait que la présence de cet homme réveille le fantasme incestueux. Quand la résistance disparaît momentanément, le refoulé est représenté par les mots « concierge », « chemise », « lit », « ville », « charrette ».
J’aimerais vous raconter une histoire : celle d’une jeune patiente qui a fait un passage à l’acte. Elle s’est jetée par la fenêtre et cassé les deux jambes. À ce moment bien précis, son psychanalyste a disparu. La patiente était à l’hôpital et lui, il a disparu. Il n’a pas pris contact, il savait que la fille était à l’hôpital. Lorsqu’il a appris que la fille était rentrée chez elle, il l’a appelée pour qu’elle puisse reprendre la cure. Alors, sans aucun doute, nous devons nous interroger vis-à-vis du désir de l’analyste.
J’aimerais aussi faire un rappel. Le séminaire porte sur le transfert, mais nous avons convenu, à partir du transfert, d’articuler la résistance, un concept fondamental, avec d’autres non moins importants comme la censure, la défense et le refoulement.
La censure vise l’extérieur, la personne du médecin, la défense et le refoulement vise l’appareil psychique.
Mon idée est de vous inviter à apaiser vos difficultés cliniques avec la théorie de Lacan parce que nous pouvons y trouver des solutions. Je ne connais pas une autre clinique en psychanalyse qui soit aussi consistante. La consistance que nous trouvons chez Lacan, c’est justement parce qu’il n’a jamais abandonné Freud. L’engagement de Lacan avec Freud a été, du début jusqu’à fin, sans faille ; même lorsque Lacan critique Freud, c’est une critique qui ne vise pas, par exemple, à détruire le signifiant freudien. C’est, au contraire, pour l’affiner ou l’actualiser, l’oxygéner. Vous trouverez toujours chez Lacan le souci d’être avec Freud. Je vous dis cela parce qu’aujourd’hui, j’ai été obligé d’argumenter avec quelqu’un venu faire un compte-rendu pour une revue de psychanalyse sur notre colloque : cette personne nous questionnait sur ce que nous avions avancé lors de ce colloque. À un moment donné, la conversation a mené à la question de la formation des étudiants. Les étudiants étaient, je l’avais signalé, tous en analyse. Ce n’étaient pas des étudiants qui venaient uniquement pour examiner, cataloguer, tester les malades. Ainsi, ce que nous gagnons, en suivant cette voie indiquée par Lacan, c’est justement d’être avec Freud, lire Freud dès le départ. J’avais un professeur de clinique qui m’avait dit que c’était une perte de temps de lire l’Esquisse pour une psychologie scientifique. II disait que c’était de la neurologie et que cela ne nous intéressait pas, sauf pour ceux qui voulaient choisir la voie de la neurologie. Or, quand nous voyons la lecture que fait Lacan de cette Esquisse, nous y trouvons des choses majeures. La lecture que je fais de cette Esquisse est, qu’à un moment donné, nous sommes en plein dans l’organisme et c’est à partir de l’Esquisse que Freud commence un processus qui va déboucher sur la lecture du corps, c’est-à-dire que l’organisme, accroché au symbolique, est traversé par le symbolique. Il y a des paroles dans la chair et c’est pour cela qu’elle peut être appelée corps.
La censure est une forme de résistance. Cette censure vise l’extérieur, elle vise la personne du médecin. La censure, la défense, sont à considérer comme des variantes de la résistance.
Essayons de raconter le roman de cette histoire de la résistance…
À un moment donné, cette partie du moi va viser la personne du médecin, c’est cela la censure et, à un autre moment, le sujet va avoir une relation directe avec quelque chose qui vient de l’inconscient.
L’inconscient est à l’extérieur, cela ne vous étonne-t-il pas ?
Un participant au séminaire : Si !
C’est bien ! Au moins il y a quelqu’un qui est étonné. Je vais essayer de défendre cette hypothèse-là. L’hypothèse que j’ai entendue, il y a une semaine, était de la bouche de Jacques-Alain Miller, justement celle de l’inconscient à l’extérieur.
L’inconscient, version « maison hantée », j’ai trouvé cela délicieux, surtout parce que j’ai eu affaire, par exemple, à quelqu’un qui, après avoir vu la série « Les frontières du réel » sur M6, a eu une peur énorme. C’est justement cela. Le sujet a peur, mais cette peur d’où vient-elle ? Elle vient de l’extérieur, sans interprétation, sans rien du tout. C’est une peur qui vient de l’extérieur. C’est cela la maison hantée du sujet. Le moi vise l’extérieur.
Un participant : Vous parlez de la personne du médecin ?
Un autre participant : Oui !
Je parle du discours du médecin. Tout cela se passe dans le registre du symbolique. C’est de cela que l’on doit tenir compte.
Un participant : Est-ce que vous voulez dire que le discours du médecin, à un moment donné, est dans la maison hantée ?
Oui, sans aucun doute. Et c’est ce qui fait que des patients ne peuvent plus venir voir un médecin parce que le discours de l’autre bouscule tout, la consistance, l’organisation du moi. Il en est de même, de façon beaucoup plus évidente, quand le sujet vient voir un psychanalyste et ne revient plus. Non à cause de l’incompétence du psychanalyste, mais de son silence. Silence qui fait que le sujet puisse s’entendre.
Un participant : Le discours du médecin est le discours de la maison.
Nous pouvons le dire comme cela, si le médecin sait parler, oui. Si c’est un médecin qui parle d’une position de consistance, une position symbolique, il a des effets dans le sens de la guérison ou de la mutilation imaginaire. Il faut que je puisse vous dire que le moi a cette disponibilité d’avaler les choses, le moi avale n’importe quoi. La question est qu’après, il ne sait pas quoi faire avec. Je parle du moi du névrosé. Le discours du médecin, qui est le discours de l’Autre, entre et provoque, à un moment donné, une situation conflictuelle. Ce ne sont pas uniquement les psychanalystes qui occupent la place de l’Autre, mais aussi les médecins. La place de l’Autre, c’est quand quelqu’un parle et que cela provoque des effets.
À un moment donné, il y a le discours de l’inconscient qui traverse le sujet (s), c’est pour cela qu’il devient barré ($). Il est traversé par le symbolique. Sans la barre, il n’a pas de corps.
On était dans la censure parce que le moi, qui refuse d’articuler quelque chose avec sa propre structure, renvoie vers l’autre : c’est l’autre qui est responsable. Le moi va arrêter d’investir son énergie, dans le sens freudien, vers la personne du médecin parce que ce dernier est un homme qui sait mettre en œuvre une stratégie clinique. C’est vrai que Lacan conseillait à ses élèves de ne pas répondre à la demande. Mais, c’est toujours important de savoir de quelle demande il s’agit et d’où elle vient pour savoir si nous devons ou non y répondre.
À un moment donné, la personne du médecin, qui est quelqu’un de très habile, ne peut pas répondre à cette demande directe, mais, par contre, il répond dans une autre situation. La grande peur d’un jeune médecin quand je donnais mes coordonnées personnelles à un patient était que le patient m’importune le week-end, tard le soir, etc.
Eh bien, hier, donc dimanche, à minuit, à 0h32 donc déjà ce matin, une patiente sans limite – je ne dis pas qu’elle est psychotique – m’appelle pour dire qu’elle a perdu un papier avec l’adresse de quelqu’un qu’elle devait aller voir aujourd’hui. Cette personne devait lui donner des habits. Donc, le sujet appelle avec cela. Elle vise quelque chose, elle fait appel à l’Autre, elle veut que l’Autre réponde dans le même circuit. Que fait l’Autre ? L’Autre dit : « Est-ce que cela peut attendre demain, à telle heure ? ». C’est l’heure de sa séance. Elle : « Oui, bien sûr ». L’analyste : « Donc, on va faire comme cela ! » Que se passe-t-il ici ? II faudrait aussi indiquer que c’est l’effet de la parole, de dire effectivement « On verra cela demain ». Mais, à partir du moment où nous engageons quelque chose, c’est là que l’effet du symbolique a lieu et soulage un peu cette personne.
Je vois le moi comme une pierre cassée en plusieurs morceaux qui affleurent pour moitié à la surface d’un lac par exemple et qui bouge au gré du vent, en rident la surface du lac de ma représentation.
Donc, nous avons la défense et le refoulement. À un moment donné, le discours de l’Autre est là parce que le moi mange n’importe quoi. Voyez, par exemple, ces personnes grosses, des gens qui ne savent pas trier ce qui doit être avalé ou non ; ce sont des gens qui n’ont pas cette disponibilité de limiter les choses. Ainsi, des femmes tombent toujours sur le même genre d’hommes, celui qui la tabasse et qui lui manque de respect, ou des hommes qui ont un penchant pour des femmes qui laissent toujours à désirer. Alors, le moi avale le discours de l’Autre. Il y a probablement un processus qui a pour fonction de faire en sorte que cela puisse être refoulé, que cela puisse disparaître de ce champ-là. Le discours de l’Autre est le discours de l’inconscient.
4Ibid., p. 215.
5Ibid., p. 216.
6Ibid.
7Ibid., p. 217.
8Ibid.
9Ibid., p. 217.
10Ibid., p. 220.
11 Lacan, J. (1954-55). Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1978, p. 156.
12 Freud, S. (1950). La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1956, p. 213.
13 Freud, S. & Breuer, J. (1895). Op. cit., p. 221.
14Ibid., p. 222.
3. LA CENSURE
Prenez cette patiente à laquelle Freud fait référence à la page 22415. Quand il pense abandonner le cas, la femme évoque « une grande croix noire qu’elle voyait penchée et bordée de ces mêmes lueurs lunaires qui avaient éclairé toutes les images qu’elle venait de voir ». Il y a dans cette expérience quelque chose de remarquable car la censure, habituellement, est dirigée vers la personne du médecin en tant que « répétition de prototypes infantiles vécus avec un sentiment d’actualité marqué »16. Ici, le sujet parle de toute sorte de fantasmes. C’est ainsi, il nous semble, parce qu’il n’y a pas la présence du médecin, donc le sujet du moi n’est pas responsable. Une fois réveillé de son « état de concentration »17, la résistance laisse la place à la censure vers l’objet extérieur, à savoir le médecin. Ainsi, nous pouvons entendre que la censure vise l’objet extérieur, mais que cet objet extérieur est le prototype de l’expérience existante dans l’inconscient (fantasmatique ou non).
Le problème dans l’hypnose est qu’une fois réveillé, le sujet n’est plus responsable de ce qu’il vient de dire sous hypnose. C’est-à-dire, sans objet extérieur dans la personne du médecin, la libido utilisée dans la censure, reprend le circuit du moi et, ainsi, cette libido peut servir à la résistance (qui vise à contenir les pulsions), jusqu’au prochain exercice de rencontre avec un objet qui mériterait qu’une partie de la libido parte à l’extérieur pour dissuader l’objet ressenti comme attaquant le moi par l’extérieur.
Freud dit à la page 225, qu’il avait beaucoup négligé « les questions de défense ou de résistance »18. Voilà l’argument qui vient soutenir notre idée que la censure vise l’objet extérieur et empêche le vrai travail analytique, à savoir la confrontation de la résistance avec le refoulé, dans lequel la position du psychanalyste est celle de témoin. Freud écrit : « Le procédé par pression n’est qu’un artifice comme un autre. Grâce à lui le moi qui aspire à se défendre (d’où vient l’attaque ? demandai-je) est attaqué à l’improviste ». Il nous semble que la traduction de Anne Berman évoque déjà une attaque de la part du procédé par la pression qui va dans le sens contraire de ce que Freud nous indique. Avec la traduction de Berman, il semble que l’attaque vienne du procédé.
Freud nous indique que le procédé de défense [Abwehr] est une procédure qui vise un objet extérieur. Cet objet peut être interprété par le moi comme objet d’attaque, sans que cela puisse être confirmé par l’objet (dans le cas, la personne du médecin), ou l’objet, au contraire d’être objet cause du désir, est objet d’interprétation sauvage, ce qui conséquemment fera que le moi se sente agressé.
La censure est donc une partie de la libido qui vise à détruire les traces du refoulé. La résistance vise à empêcher le refoulé de retourner. Quelquefois, la censure est nourrie par le médecin dans la relation analytique. Dans la suite de la phrase, Freud écrit : « Dans tous les cas sérieux, le moi refuse de renoncer à ses desseins et poursuit sa résistance »19. Ici, nous pouvons remarquer la dynamique de notre affaire, à savoir que le moi a abandonné la censure et que toute sa libido est concentrée dans la résistance, à faire résistance à la pulsion.
À ce moment du travail analytique, le psychanalyste est dans la position du mort, c’est-à-dire qu’il reçoit ce qui vient de la censure (la censure est de l’ordre de la conscience, mais vise à effacer pour de bon le matériel inconscient – opération difficile car la représentation est indestructible) et, ainsi, le moi pourra ne pas investir dans cette forme de résistance consciente parce qu’il ne se sent plus attaqué par l’analyste. La libido pourra alors viser la résistance proprement dite, c’est-à-dire la résistance qui vise à se protéger du moi. Et là, le psychanalyste pourra s’introduire dans la résistance de la partie du moi plongée dans l’inconscient et interroger le moi sur les motifs qui l’amènent à résister à ce point.
La défense est au rendez-vous quand, dans la règle fondamentale, le sujet sélectionne et critique ce qui lui passe par l’esprit. Si le sujet ne tient pas la « promesse »20 de dire ce qui lui traverse l’esprit, c’est parce qu’il est contraint à se protéger.
Au contraire de répéter la pression de la main, Freud stimule le sujet à respecter la règle autant de fois que nécessaire (et non aucune ou une uniquement). Quand le transfert est suffisamment installé, c’est-à-dire quand le psychanalyste n’a pas répondu à la censure, le sujet peut donner la réponse donnée par la patiente de Freud : « C’est seulement en voyant que je n’arrivais pas à le chasser que j’ai vu qu’il n’y avait rien à faire »21.
Freud nous apprend à travailler avec la résistance. Il le fait quand il dit à la patiente que ce qui l’empêche de parler ou de travailler pendant la séance est le piano ou l’horloge d’à côté. Il s’agit d’une idée venue de l’inconscient, le moi fait en sorte que cette idée puisse être chassée. Freud stimule le sujet à continuer à y penser. Freud nous indique que plus le patient prend son temps, plus il « réorganise son idée »22. Freud vise un moment bien particulier, mais il est intéressant de remarquer où le sujet prend son temps pour ne pas se confronter avec le désir.
Il est important de noter que Freud, lorsqu’il parle à cette époque de défense, de censure, vise toujours la présence du psychanalyste, donc le transfert est là pour quelque chose, même si « übertragung » n’est pas dit en toutes lettres. La diminution de la censure est une tâche qui concerne le psychanalyste et sa capacité à manier le transfert. La suppression majeure de la censure fait en sorte que le sujet soit dirigé, par le psychanalyste, à aller voir du côté de la résistance, de l’inconscient, pour rencontrer le fantasme inconscient, le désir inconscient. Le psychanalyste qui sait manier le transfert ne nourrit pas la censure. Il évite de nourrir la censure pour que le moi puisse trouver l’objet cause du désir sans continuer à coller sa recherche de l’objet à la personne du médecin. À partir de là, le psychanalyste ne sera plus l’objet qui nourrit le processus de la censure (il n’est pas là pour ça, même si le sujet le voit ainsi). Il sera, à partir de là, témoin de cette confrontation entre le moi et le désir inconscient. C’est grâce au silence du psychanalyste, silence qui consiste à faire en sorte que la censure puisse se transformer en résistance, que Freud nous dit que, lorsque la patiente dit qu’elle parlera parce que son médecin souhaite écouter tout23, cela veut dire que la censure a trouvé sa destinée, à savoir disparaître, ou comme dit Freud, le processus de défense consiste à transformer une « représentation puissante en une représentation faible »24. La destinée de la censure dans la cure est de disparaître au profit énergétique de la résistance. La disparition du moi ne fait pas partie de cette stratégie. Sans doute son dégonflage est dans la visée de la fin de la cure.
Comment entendre l’interprétation de Freud lorsqu’il écrit : « Le fait que les représentations pathogènes paraissent aussi peu importantes au moment de leur réapparition est l’indice d’une défense réussie »25 ?
Entendons ici que « défense réussie » vise le transfert du sujet vis-à-vis de quelqu’un. Ces représentations pathogènes paraissent avoir leur importance car il s’agit du reste de représentation. La solide représentation pathogène est dans le registre de l’inconscient. De ce fait, le sujet pourra parler sans « tout affect »26. À l’avenir, nous écouterons Freud parler de la censure du rêve. De quoi s’agit-il effectivement ? II s’agit du fait que le rêve est fait par quelqu’un, pour quelqu’un. Le rêve est un appel qui attend que celui à qui il est adressé puisse l’entendre, le déchiffrer. Le rêve vise toujours quelqu’un. Le rêve est la preuve de l’existence du transfert. Mais pour l’instant laissons cela de côté. Il nous semble important d’insister sur le fait que la censure vise la personne du médecin. Freud insiste sur cette question à la page 226. Quelquefois, la patiente nous indique d’où vient la censure : « C’est vrai, une idée m’est venue, mais il me semble bien que c’est moi qui ai volontairement voulu l’ajouter »27.
Freud indique sa position : « Dans tous ces cas, je me maintiens imperturbablement (…) »28. La « résistance persistante » est à mettre, selon Freud, du côté du patient29 ; la censure vise, dans la relation analytique, le psychanalyste. La résistance est intrapsychique, la censure est interpsychique. La censure peut être comprise par une première résistance à l’analyse (et donc à l’analyste). La résistance laisse place au souvenir quand l’analyse « fait des progrès », et le progrès, entre autres, est que le psychanalyste ne censure pas, en réponse à la censure du sujet ni ne nourrit la censure même du sujet : « Sachons bien d’abord que toute résistance psychique, et notamment toute résistance depuis longtemps constituée, ne peut être liquidée que lentement, pas à pas, et qu’il faut s’armer de patience »30.
Freud nous apprend que, pour rentrer dans la résistance du sujet, il faut le transformer en collaborateur, le faire s’intéresser à lui-même, c’est ainsi que nous pouvons « étouffer une résistance fondée sur l’affectivité »31. Freud nous indique que la défense doit être mise de notre côté. Cela veut dire que la défense doit se transformer en amour, en transfert. C’est ainsi que nous interprétons sa phrase : « (…) nous essayerons, après avoir deviné les motifs de cette défense, de ravaler ces derniers ou même de les remplacer par d’autres, plus puissants qu’eux »32.
Ainsi, Freud à la fin de la page 228, indique les conditions nécessaires et imaginaires (concernant le transfert, donc un transfert non analytique) pour nourrir la censure, à savoir : « (…) en professeur, en représentant d’une conception du monde, libre, élevée et mûrement réfléchie, enfin en confesseur qui, grâce à la persistance de sa sympathie et de son estime une fois l’aveu fait, donne une sorte d’absolution ». Ou encore : « (…) essayer de donner au patient assistance humaine, jusqu’au pont permis » (quelques élèves de Freud se sont perdus dans les limites de ces frontières).
C’est pour ces conditions préliminaires que la technique de l’insistance et de la pression n’a pas fonctionné. Freud donne raison à notre différenciation entre résistance et censure car il écrit : « Plus on a résolu d’énigmes de ce genre plus il deviendra peut-être facile d’en résoudre de nouvelles et plus vite aussi le travail vraiment curatif pourra être entrepris. »33. Freud laisse apparaître clairement que la fonction du psychiste n’est pas de corriger quoi que ce soit. Son travail est de laisser la possibilité à ce que la résistance puisse être dissoute, c’est-à-dire que la libido investie dans la manutention de la résistance puisse être investie ailleurs. De ce fait, la pulsion pourra se représenter (nous faisons ici référence à la clinique de la névrose). Freud nous dit que le transfert (« l’influence personnelle du médecin »34) peut aider à dépasser la résistance. Mais c’est possible lorsque le médecin a déjà fait ses preuves. Quand, au nom de la censure, le patient l’a reconnu digne de son amour, de son transfert.
N’oublions pas que la mise en place de la psychanalyse était une construction du désir de Freud. C’était par sa difficulté à hypnotiser les uns ou à provoquer la méthode cathartique chez les autres, qu’il a décidé de travailler à partir de son désir, à partir de « sa capacité »35