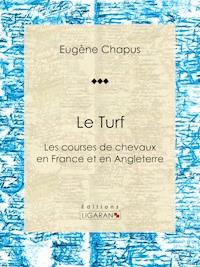
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans toute société il existe des classes d'hommes qui ont beaucoup d'heures à dépenser en loisirs. C'est pour ce monde privilégié que l'Angleterre maintient avec une sorte de culte religieux ses exercices de sport. Les arts et le sport ont cela de bon, qu'ils introduisent dans les relations un autre mobile que l'intérêt..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076202
©Ligaran 2015
Dans toute société il existe des classes d’hommes qui ont beaucoup d’heures à dépenser en loisirs. C’est pour ce monde privilégié que l’Angleterre maintient avec une sorte de culte religieux ses exercices de sport.
Les arts et le sport ont cela de bon, qu’ils introduisent dans les relations un autre mobile que l’intérêt. Si l’on bannissait le sport et les arts de la vie des nations, il n’y aurait plus dans la société que des malheureux condamnés à perpétuité aux galères des affaires. Ensuite toutes les organisations ne sont pas similaires. Il faut au courage, à l’adresse, à l’agilité, à la souplesse du corps, une application dont les heureux résultats se retrouvent dans les carrières sérieuses ou les conjonctures suprêmes de la vie. Telle est dans notre monde moderne, la raison d’être du sport, qui est la sphère sans limite ouverte à toutes les aptitudes humaines. Il embrasse la noble vénerie, les chasses, les courses, les grands exercices nautiques, le cheval, l’escrime, tous les travaux qui développent, grandissent et poétisent la force matérielle de l’homme. La pensée qui créa le sport est celle qui fonda ces jeux olympiques si chers aux belles époques de l’antiquité, mais modifiés selon les croyances, les inspirations, les besoins d’une autre civilisation. Le sport, de même que les arts, a son beau moral. Pour une imagination qui n’est que vulgaire, qu’est-ce que la chasse ? qu’est-ce que le tir au pigeon, l’une des plus humbles subdivisions du sport ? Des coups de fusil, des bêtes qu’on tue ou qu’on manque, pas autre chose. On ne comprend ni la poésie des champs, ni leurs harmonies, ni ces jouissances d’une locomotion hardie, ni ces poursuites ardentes, ni ce bonheur du succès, qui font d’une chasse une galerie mobile de paysages grandioses, une suite de sensations vives et de contrastes fébriles. À côté de l’élément matériel, à côté du coup de fusil, du galop du cheval, de la barrière franchie, de la barque qui lutte contre la vague tumultueuse de la mer, le sport a aussi son côté intelligent, artistique, qui appelle, qui saisit la méditation. Suivez le pigeon qui s’est élevé de sa cage et qui a échappé par miracle au coup de fusil. Il va tout étourdi se poser sur un arbre éloigné ou sur un toit qui lui sert d’observatoire. Quelques secondes lui ont suffi, il s’est orienté, il reprend son vol et regagne sans temps d’arrêt la ferme de Normandie ou de Picardie qui fut son nid. Eh bien ! n’est-ce pas là un miraculeux exemple de l’instinct et du sentiment du rapport des espaces qui fait rêver ?… Je vois sourire tous ceux qui ont l’honorable préjugé des occupations et des professions utiles.
Le sport n’appartient pas seulement aux habitudes aristocratiques ; il est florissant et très en vogue dans un pays où la république n’est pas une théorie, aux États-Unis. Dans les mœurs de ce pays industriel, commerçant, positif, utilitaire, une chose frappe : le culte brillant du sport ! Nulle part on ne s’occupe avec plus d’ardeur de chevaux de chasse, de boating, de steeple-chase et de courses. Les courses surtout ont pris chez les Américains, comme tout ce qui leur paraît favorable à la grandeur de leur nation, un essor si général, si puissant, que, reconnaissant la nécessité des races de chevaux nobles, ils consacrent à l’achat d’un étalon en Angleterre des sommes supérieures même à cent mille francs, ainsi qu’ils l’ont fait récemment pour le célèbre Priam.
La France, par sa position continentale, par l’antagonisme de ses voisins, par la guerre dont elle est sans cesse menacée, par l’essor de son industrie, par sa fortune, par ses habitudes chevaleresques, devrait plus que tout autre peuple être à la tête de progrès qui, bien étudiés, perdent leur écorce futile et répondent dans notre civilisation à des nécessités sérieuses.
De tous les exercices, de toutes les occupations qui constituent le sport, les courses de chevaux sont la plus importante, la plus féconde en grands résultats, la plus brillante. Cette partie intégrale du sport s’appelle le turf, d’un mot anglais qui signifie littéralement verdure, gazon, mais dont l’usage a élargi la signification. Il s’étend en effet, aujourd’hui, aux détails multiples qui se rattachent essentiellement aux courses, tels que l’entraînement, l’élevage, l’éducation du jockey, et à ceux qui se lient étroitement à l’amélioration des races chevalines, cette question d’économie politique, de force, de grandeur et de richesse.
Peu d’intérêts, parmi ceux qui éveillent notre émulation nationale, méritent une aussi belle place : les courses exercent une action directe sur la prospérité des peuples, sur leur gloire, sur leur avenir ; elles tiennent aux plus éminentes considérations d’ordre social ; c’est par elles, entre autres avantages, qu’un pays peut s’affranchir de l’étranger pour la remonte de la cavalerie et de l’artillerie de ses armées ainsi que pour ses besoins de luxe.
Avant l’Angleterre nous avons tenu en Europe le sceptre hippique : nos chroniques équestres remontent bien haut ! elles atteignent le prodigieux siècle de Charlemagne, de ce grand empereur qui, parfait écuyer, nous dit l’histoire, dressait lui-même ses chevaux de chasse et de bataille. Nous savons aussi que dès le Xe siècle Hugues Capet envoyait des chevaux en présent au roi Athelstan, dont il recherchait la sœur en mariage. Nous savons que Guillaume et ses soldats portèrent en Angleterre toutes les habitudes équestres de la civilisation plus avancée du royaume de France. En fouillant attentivement la poussière érudite de nos chroniques, nous trouvons des traces qui attestent du goût de la vieille France pour les exercices équestres.
L’histoire de Bayard et le fabliau breton de Merlin Barz parlent des courses de chevaux qui se faisaient à cette époque. La Normandie avait des courses de bague très célèbres et dont plusieurs chartes font mention. Aux Pyrénées, il existe des réunions équestres de ce genre dont l’origine est inconnue. La Bretagne, dans ses localités agrestes les plus arriérées, les plus primitives, célèbre encore les solennités de famille par des danses et des courses de chevaux qui sont des traditions du vieux temps. À Sémur, dans le département de la Côte-d’Or, il se fait annuellement des courses qui remontent, chose étrange, au règne de Charles V.
Enfin nous savons que Henri IV fit présent à Élisabeth de plusieurs chevaux français, tirés de son haras du Berry, qui excitèrent l’admiration de la cour d’Angleterre.
Mais ce sceptre de la France, qu’un concours de circonstances heureuses lui avait mis aux mains, lui échappa peu à peu, et cela devait être : nous en indiquerons les motifs.
Si les Anglais, posés depuis longtemps comme la grande nation équestre du monde, ont atteint la supériorité dont ils sont fiers, ils ne la doivent pas au désir de montrer de brillants haras peuplés de bons et beaux sujets exotiques dus à une importation qu’il faut s’occuper sans cesse de renouveler ; ils doivent cette prééminence à la pensée constante qu’ils ont eue d’améliorer les races indigènes à l’aide de principes fixes et d’institutions solides, à l’aide surtout des joutes de l’hippodrome, dont ils ont compris la puissante efficacité pour arriver au succès pratique. Il y a en effet un rapprochement perpétuel entre l’extension donnée aux courses et l’accroissement, l’amélioration de l’espèce chevaline.
L’enchaînement est rigoureux ; ainsi, pas de courses, pas de chevaux pur-sang, et, sans chevaux pur-sang, pas de progrès possible dans les races.
Cette corrélation ressortira dans toute sa force et dans toute sa lumière dès que nous aurons défini et étudié le cheval pur-sang dans son origine et dans ses diverses applications.
La première indication précise des tentatives fructueuses de l’Angleterre à ce sujet se trouve dans le tableau de Londres de William Fitz-Stephen, qui vivait du temps de Henri II. Il nous apprend qu’on conduisait au marché de Smithfield, à Londres, des chevaux pour la vente, et qu’afin de démontrer leur excellence, on les faisait courir ensemble et jouter de vitesse. L’écrivain donne une description animée et pittoresque du départ et de l’arrivée de ces luttes. Peu après, les landes d’Epsom, devenues depuis si célèbres, furent le terrain où les premiers amateurs de courses se livrèrent à ces exercices. Édouard III, Édouard IV et Henri VIII eurent des chevaux de renom dans leurs écuries. Ce dernier fit de grands efforts pour parvenir à l’amélioration des races de chevaux, et des courses furent établies à Chester et à Hamford ; mais alors la science du turf était dans son enfance. Les hippodromes n’étaient pas comme aujourd’hui tracés à l’avance. On lançait les concurrents à travers la campagne, et fort souvent le terrain le plus mauvais et le plus difficile était choisi de préférence à tout autre. Peut-être n’était-ce là qu’un reflet des chasses à travers les halliers et les buissons touffus qui se pratiquaient en Normandie, et qui passèrent en Angleterre avec la conquête. Ce qu’on recherchait dans ces courses n’était pas le cheval pur-sang ; la grande vitesse qu’on voulait obtenir alors était celle du cheval de guerre et de fatigue appelé à porter un cavalier armé de pied en cap, c’est-à-dire un poids de trois cents livres environ. Le prix consistait en une clochette de bois ornée de fleurs… Dans la suite, à cette clochette si simple on substitua une clochette d’argent qui était disputée le mardi gras de chaque année.
Les renseignements que nous trouvons sur le règne de Jacques Ier deviennent plus précis. Les courses se multiplient en Angleterre ; il y a des réunions à Garterley, dans le Yorkshire, à Croydon, à Enfield-Chace ; des paris fréquents ont lieu entre les propriétaires des de course, qui n’ont d’autres jockeys qu’eux-mêmes. L’art de l’entraînement se révèle. On surveille attentivement l’hygiène du cheval, on le soumet à des exercices réguliers qui le tiennent en haleine, sans se préoccuper toutefois encore de l’appropriation individuelle du poids qu’il doit porter, puisque les règlements imposaient un poids de cent quarante livres pour tous les chevaux indistinctement.
Les courses établies par Jacques Ier portaient la désignation de Bell’s races ; Jacques est le premier qui en Angleterre ait pressenti le parti qu’on pouvait tirer du sang arabe. Il fit l’achat, à très haut prix, d’un superbe cheval de cette race ; mais cet essai fut malheureux. Selon le duc de Newcastle, ce cheval n’avait aucune des qualités qu’on recherchait. On le laissa de côté, et pendant de longues années la race orientale fut délaissée, oubliée, presque méprisée.
Charles Ier imprima un grand mouvement aux exercices du turf. Il aimait les courses, montait brillamment à cheval ; mais les dissipations amoureuses de son règne le détournèrent des nobles et plus graves déduits de la course. Il fit cependant fleurir New-Market, et créa un hippodrome dans Hyde-Park.
Les guerres civiles furent un temps d’arrêt pour les courses. Cependant le rusé Cromwell, qui ne négligeait aucun moyen de pouvoir, eut un haras ; c’est à l’un de ses étalons, White Turk, qu’aboutissent les plus anciennes généalogies chevalines de l’Angleterre.
Le Protecteur eut aussi une jument célèbre connue sous le nom de la jument du Cercueil (Coffinmare), ainsi désignée parce qu’elle avait été cachée dans un caveau mortuaire à l’époque de la restauration.
Les courses prirent un nouvel élan avec cette restauration ; Charles II, qui les aimait, leur prêta son royal appui et rehaussa leur éclat par sa présence sur le turf ; il rétablit les solennités de New-Market instituées soixante et dix ans auparavant par Jacques Ier, et fit en même temps reconstruire dans cette résidence le palais en ruine de son grand-père. Ses chevaux couraient sous son propre nom, notamment à Burford, ce lieu si aimé de Georges IV et si souvent visité par lui.
L’importance des prix s’accrut. On se disputait des coupes d’or et d’argent d’une valeur de deux cents guinées.
Charles fit venir en Angleterre des étalons étrangers, dans le but d’améliorer les races indigènes. Cet exemple fut suivi par Guillaume III, qui augmenta à son tour la valeur des prix accordés au vainqueur.
La reine-Anne, voulant plaire à son époux Georges, prince de Danemark, fonda divers prix royaux dans plusieurs villes de la Grande-Bretagne.
Le Darley Arabian, qu’on appelle ainsi du nom de son propriétaire, appartient à cette époque. Ce cheval pur-sang venait d’Alep. Pendant longtemps on refusa de lui donner des juments, tant était grande la prévention qui régnait contre cette race. Mais enfin, quand quelques-uns de ses produits eurent déployé de hautes qualités, on reconnut tout ce qu’il valait, et ce fut dès lors au mélange du sang arabe qu’on demanda le progrès.
Georges Ier encouragea la reproduction à l’aide du sang arabe, et convertit les prix d’argenterie en autant de bourses royales. Son fils, suivant l’impulsion de ses prédécesseurs, fit importer à grands frais, à l’imitation de Darley, un grand nombre d’étalons du plus grand prix tirés de l’Orient. C’est sous son règne que parut Godolphin Arabian, la souche de la meilleure race anglaise et dont nous aurons occasion de reparler.
Le goût pour les courses de chevaux prit dès lors une vaste extension. C’est une phase nouvelle dans l’histoire du turf que celle qui commence à Georges II.
Éclipse appartient à cette époque. Il vint au monde dans la quatrième année du règne de Georges. Époque mémorable dans les annales du turf. Éclipse ! grandeur sans décadence ! renommée unique, sans égale, et à laquelle nous consacrerons la place que veut son illustration.
L’intérêt que montraient les populations anglaises pour les courses devint dès lors cette passion nationale qui prit un peu plus tard un si grand essor sous Georges IV.
Cependant, dès l’année 1750, la renommée avait transmis en France des relations attrayantes sur les belles luttes des hippodromes anglais… Quelques gentilshommes de la cour en virent plusieurs et en parlèrent à leur retour dans un tout petit cercle de jeunes seigneurs qui se sentirent piqués aussitôt d’une volonté d’imitation.
Au mois de novembre 1754, lord Pascool fit la gageure de se rendre de Fontainebleau à Paris en deux heures. C’est une distance de quatorze lieues, comme on sait. Cet incident fit grand bruit, Versailles et Paris s’en occupèrent : le roi ordonna à la maréchaussée de lever sur la route tous les obstacles qui pourraient causer au coureur le moindre arrêt. Lord Pascool partit de Fontainebleau à sept heures du matin et arriva à Paris à huit heures quarante-huit minutes. Il gagna ainsi de douze minutes.
On ne trouve rien de certain sur les courses qui purent se faire à partir de la gageure de lord Pas-cool jusqu’en 1776 ; mais à cette époque nous rencontrons des renseignements d’un caractère positif et presque officiel, et nous voyons la plaine des Sablons se métamorphoser en hippodrome et devenir le théâtre principal des courses. Les seigneurs de la cour, de même que leurs émules de la noblesse anglaise, trouvaient dans ces exercices des occasions de déployer le luxe de leur maison et d’appeler les regards sur eux-mêmes. On ne songeait pas précisément alors à l’amélioration des races chevalines et à la réhabilitation de ces chevaux de France qui, dans des temps antérieurs, avaient été les premiers de l’Europe ; on courait ou l’on faisait courir parce que les courses offraient à l’existence de la cour une diversion élégante et animée. Il était de cela comme de la chasse, comme du foyer de la Comédie-Italienne, des galeries et des coulisses de l’Opéra, des soupers, que sais-je encore ? Les salons du comte d’Artois étaient l’un des centres de ce monde fastueux et brillant des dernières années de la vieille monarchie. Autour de lui rayonnaient une foule de jeunes hommes vivant de la même vie que lui, et dans ce nombre beaucoup d’Anglais de distinction qui apportaient à Paris leur contingent de luxe, d’équipages et d’argent.
Ainsi s’explique le concours brillant de spectateurs qu’on voyait du 5 au 10 novembre 1776 dans la plaine des Sablons, et qui ne quittèrent Paris que pour se rendre à Fontainebleau, où se trouvait engagée une grande poule pour des chevaux de tout âge.
L’année suivante, il y eut à Fontainebleau une course de quarante chevaux ; on créa une nouvelle piste dans les bois de Vincennes, et la mode des paris prit un grand essor parmi les gentilshommes français.
En 1783, les courses étaient fréquentes et très suivies. Elles avaient lieu tour à tour dans la plaine des Sablons, à Vincennes et à Fontainebleau.
Ce fut aussi la grande période hippique de l’Angleterre. Georges, prince de Galles, qui devint plus tard roi, sportsman par excellence, habile cavalier, connaisseur judicieux, éleveur libéral, chasseur formidable, parieur passionné, domina toute sa cour, tout son siècle, par son goût irrésistible pour la vie équestre. C’est à lui qu’on pourrait justement appliquer l’épithète que Pindare adresse à Hiéron : « Amoureux des chevaux. » Fût-il né dans quelque obscure condition, ayant à lutter contre les vicissitudes d’une vie de labeur, il n’eût pas échappé à sa vocation et fût devenu un maquignon, un jockey, ou l’un des brillants bohémiens du turf de New-Market. Grâce à sa magnifique protection, son règne fut pour les courses une phase incomparable de richesses et d’illustrations.
Après la révolution de 1789, les courses trouvèrent leur place dans le travail de réorganisation générale dont s’occupa Napoléon ; on leur assigna des époques fixes et diverses localités.
Les premières qu’on établit furent celles de Paris, de Saint-Brieuc et du haras du Pin ; mais elles ne laissèrent aucune trace de leur influence. Les chevaux qui couraient étaient mal entraînés et mal montés.
Les règlements impériaux, inspirés par un patriotisme exclusif, s’éloignaient à dessein et autant que possible des théories et des pratiques anglaises, sur lesquelles ils auraient dû se modeler pour être réellement utiles. On s’aperçut bientôt de cette faute. La supériorité incontestable des races de chevaux anglais appela l’attention de tous les esprits sérieux et jaloux des intérêts de la France. Il fut donc naturel que le gouvernement de la Restauration, après les désastres des guerres de l’Empire, se fit un devoir de continuer en la perfectionnant l’œuvre commencée par le patriotisme de Napoléon.
Louis XVIII fit régulariser les courses. De nombreux établissements se fondèrent pour l’élevage des chevaux pur-sang. De cette époque date le haras de Meudon qui, sous la direction du duc de Guiche, inaugura sa réputation par les succès de Nell, l’un de ses produits. On vit figurer sur le programme des réunions du Champ de Mars les noms de Latitat, bon cheval français appartenant à M. le comte de Narbonne ; de Lilly, à M. Duplessis ; de Rainbow et de Tigresse, à M. Rieussec, qui avait fondé le haras de Viroflay en 1820 ; de Cérès, à M. Neveu ; de Lark, à M. Drake ; de Lucy, à M. le duc d’Escars. Snail, Tigris, Castham, sortirent du haras du Pin, que dirigeait M. de Bonneval. La renommée de lord Seymour commençait à poindre sur le turf, où les premiers rangs étaient occupés par MM. de Kergariou, de La Rocque, de La Bastide, de Vanteaux, et par M. de Royères, qui remportait de nombreux prix dans les hippodromes du Midi.
Un peu plus tard, Charles X complétait, par des mesures intelligentes et progressives, les heureux essais que son frère avait tentés. En 1827 parurent Vittoria et Sylvio, produits sur le turf par le duc de Guiche. Des succès répétés grandissaient la réputation de lord Seymour. Le prix royal était gagné par Lionnel, appartenant à ses écuries, et Dubica, qui était également à lui, remportait le prix du prince royal. En même temps brillaient Malvina, au comte d’Orsay ; Zéphir, à M. Crémieux.
La remonte de la maison royale et des quatre compagnies des gardes du corps, qui se faisait en France, et notamment dans le Merlerault, était un encouragement efficace ; sans doute, dès cette époque, on eût interdit l’importation de tous les chevaux étrangers, si nos ressources indigènes avaient rendu possible cette salutaire mesure. Elle était inévitable.
Les évènements de 1830 n’occasionnèrent qu’une courte halte dans la voie des améliorations. Félix Georgina, à M. de Rieussec, Églé, Clerino, Ernest, à lord Seymour, tous excellents chevaux, appartiennent à cette époque, et se firent remarquer sur le turf de France. Félix est le premier à qui, dans nos annales, revient l’honneur d’avoir parcouru deux fois la piste du Champ de Mars en quatre minutes cinquante secondes.
C’est au règne de Louis-Philippe que l’on doit l’ordonnance du 3 mars 1833, portant l’établissement d’un registre matricule, le Stud-Book français, destiné à constater la généalogie des chevaux et à recueillir l’historique des courses.
L’ère nouvelle du turf français date de 1833 ; elle correspond à l’apogée de la célébrité de lord Seymour, qui, soit avec Fra-Diavolo, soit avec Miss Annette, n’avait qu’à se montrer sur les hippodromes pour vaincre, mais qui brillait alors de son dernier éclat. L’astre quittait les régions du turf pour faire place à d’autres individualités : éclatants auxiliaires du duc d’Orléans, qui montaient à l’horizon et que nous apercevrons tout à l’heure.
Cette époque est signalée par la fondation de nombreux prix, duc au zèle de la Société d’encouragement, par l’arrêté important qui a considérablement élevé la valeur de ces prix et fait disparaître l’absurde faveur que les règlements antérieurs accordaient au demi-sang sur le pur-sang. Elle est signalée surtout par le patronage éclairé du duc d’Orléans, qui cherchait non seulement, dans l’amélioration de nos races chevalines, une gloire de plus pour le pays, mais un puissant agent d’influence personnelle sur la société nouvelle qu’on tâchait de reconstituer après la tourmente de 1830. Enfin l’essor du turf, à cette époque, résulte particulièrement de l’adoption en France, non seulement des théories anglaises, mais des habitudes et du concours auxiliaire des hommes pratiques de l’Angleterre. M. le comte de Cambis, qui remplissait, auprès du duc d’Orléans, la place du duc de Guiche auprès de Mgr le dauphin, était un disciple de l’école anglaise.
Sous l’influence de cette direction expérimentée, les erreurs traditionnelles, les préjugés commencent à perdre de leur ténacité. On acquiert de nouvelles notions sur l’art d’entraîner ; on s’identifie avec des idées justes et fécondes. Chantilly sort du sommeil léthargique où son veuvage des grandeurs aristocratiques des Condé l’avait plongé. Le sentiment hippique, sans se populariser encore, naît artificiellement peut-être, mais enfin il se montre dans une classe nombreuse, dans les régions supérieures du monde français. C’est en 1834 que les courses sont instituées sur des principes certains, et presque aussitôt la production de race pure s’augmente. L’action des types créés pour répondre au programme officiel se fait sentir sur les espèces propres au service et à la remonte.
Le luxe, le commerce, l’industrie prospèrent, l’aisance fait des progrès, l’effectif des troupes à cheval augmente ; partout les besoins de chevaux se multiplient pendant les années qui suivent cette nouvelle phase, mais les courses se fondent en même temps, les villes des départements tracent des hippodromes ; et voyez la conséquence : le tribut que nous payions à l’Allemagne et à l’Angleterre, soit pour le nombre, soit pour la qualité des chevaux, suit, d’année en année, une marche toujours décroissante. Les tableaux officiels de la douane l’attestent. En 1840, nous allions chercher hors du pays trente-quatre mille trente chevaux, au prix de onze millions trois cent soixante mille francs, et, en 1848, huit ans plus tard, nous ne demandons plus à l’étranger que seize mille cinq cent quatre-vingt-quatorze chevaux, pour lesquels nous dépensons cinq millions quatre cent cinquante francs.
C’est ainsi qu’en tout temps les joutes de l’hippodrome, habilement combinées avec les soins et la pratique, produisent inévitablement, comme le résultat d’une science exacte, l’amélioration dans les races chevalines.
Les courses sont la démonstration patente, et, par conséquent, impartiale et sûre des qualités du cheval de sang
De même que l’or, le pur-sang se fait connaître par des attributs qui lui sont propres. La symétrie des formes, la finesse du poil, mais surtout la vitesse, la force, la résistance, l’ardeur, le courage, telles sont les qualités qui caractérisent le pur-sang.
Le cheval commun est mou, lent, paresseux, lâche, sans fond, grossier ou disproportionné dans sa charpente. Lorsqu’une seule goutte de sang vil se mêle dans le cheval, elle se révèle à l’instant ou par l’infériorité de la taille ou par le manque de courage, et il faut deux ou trois générations pour effacer cette tache et pour en corriger les conséquences.
Si vous sciez l’os du premier, vous le trouvez compacte et serré, c’est de l’acier ; chez l’autre, il est poreux, c’est de l’éponge. Les chevaux intermédiaires, selon le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie du sang, manifestent une ou plusieurs des qualités prototypes, mais jamais ces qualités ne sont dans toute leur énergie ni dans leur ensemble. Le cheval pur-sang meurt à la peine : le courage ne lui fait jamais défaut. Attelez-le à une charrette, si vous voulez, et dites-lui de marcher, il gravira la montagne la plus escarpée, il s’enfoncera dans les sables ou dans la fange des marais. Si la difficulté contre laquelle il lutte dépasse sa puissance, il périra, mais sans s’arrêter. Si vous exigez de lui une traite longue, mais physiquement impossible, s’il n’atteint pas but, c’est qu’en chemin, épuisé, anéanti, il sera tombé pour ne plus se relever.
Le cheval, à cet état, est une base à l’aide de laquelle on obtient des produits variés en raison de l’élément avec lequel on le combine.
De là les désignations de demi-sang, de trois quarts de sang, par lesquelles s’expriment les convenances diverses qui ont présidé à l’accouplement ou au croisement.
La vitesse et le fond sont deux qualités qui, chez le cheval, impliquent toutes les autres et les résument. Pour courir longtemps et vite, il faut dépenser une très grande force musculaire. Cette puissance, dès que vous la possédez, vous pouvez en faire telle application que vous voulez. Or la course est précisément pour le cheval ce qu’est la pierre de touche pour le métal qu’on soumet à l’épreuve ; c’est là que les qualités qu’on lui suppose brillent, se confirment ou s’évanouissent.
Il est à remarquer que les races pures ont le privilège de se perpétuer sans dégénérer, tandis que, pour conserver chaque espèce de métis avec ses qualités propres, il faut renouveler sans cesse le croisement qui l’a produite. D’où résulte en principe la nécessité de conserver et de multiplier les races pures, afin d’obtenir les différentes espèces intermédiaires appropriées aux différents usages des civilisations modernes, et qui forment les degrés de la pyramide dont le cheval tout à fait commun est la base et le cheval pur-sang le sommet.
Deux systèmes sont en présence pour parvenir à ce but si désirable. Doit-on demander au sang arabe ou au sang anglais le principe régénérateur essentiel pour la perfection de nos races ?
Il y a des arguments en faveur de l’un et l’autre de ces systèmes. Beaucoup croient l’assimilation du cheval anglais avec le cheval de France plus facile par suite de l’homogénéité de climat, de nourriture, qu’offrent les deux pays. D’ailleurs, le pur-sang anglais, c’est le cheval arabe dans toute sa franchise, mais soumis à des conditions autres que celles qu’il trouvait au désert ; c’est le cheval arabe, mais modifié par le travail et par les soins, et en quelque sorte supérieur à lui-même.
Si les charmants contes orientaux des temps reculés exaltent la puissance et la vitesse des coursiers du désert, si l’imagination de quelques-uns accepte encore dans leur intégrité ces merveilleuses traditions, il est aujourd’hui parfaitement avéré que le cheval anglais bien dressé est plus beau, plus rapide et plus fort que les célèbres buveurs d’air des sables de l’Arabie et du Sahara. Le cheval anglais, tantôt dans les plaines brûlantes de l’Orient, tantôt sous les zones glacées de la Russie, a vaincu ses rivaux dans leurs propres pays. Qui ne sait que Recruit, cheval anglais d’une réputation médiocre, a battu à Calcutta, il y a quelques années, Pyramus, le meilleur cheval arabe de l’Inde ? La distance à parcourir était de deux milles, le poids à porter proportionnel à la hauteur de l’animal.
Il y a un exemple plus récent encore de la supériorité du cheval anglais sur ses compétiteurs : le 4 août 1825, une course de quarante-sept milles fut contestée entre deux chevaux cosaques choisis avec soin et deux chevaux anglais, Sharper et Mina, qui n’étaient pas même de pur-sang. D’abord les cosaques devancèrent leurs adversaires ; car, à peine étaient-ils partis, qu’une étrivière de Sharper s’était rompue ; il se déroba avec son cavalier, suivi de Mina. Ils firent une demi-lieue sur une colline, sans qu’on pût les retenir, et perdirent ainsi l’avantage. Cependant, arrivés au but qui marquait la première moitié de la carrière, les deux anglais étaient en bon état, ainsi que l’un des cosaques ; le second était tout à fait hors de combat. Au retour Mina boitait beaucoup, et on la fit cesser de courir. Sharper continua seul et arriva huit minutes avant son adversaire. Il avait fait tout le chemin en deux heures quarante-huit minutes : cinq lieues par heure pendant trois heures ; et il portait quarante-deux livres de plus que le cosaque.
Enfin, disent encore les partisans du sang anglais, recourir à l’Angleterre, c’est économiser tout le temps qu’il lui a fallu pour arriver au point où elle se trouve aujourd’hui, et profiter de ses succès sans passer par ses écoles ! Mais les opinions favorables au régénérateur arabe par voie immédiate affirment que, si le cheval de course anglais est doué de plus de vitesse, cette qualité est le résultat d’un déplacement de ses forces. Ils vantent la sobriété et le courage exceptionnel de l’arabe. Tout en croyant à la sincérité des récits des enfants du désert sur les hauts faits de leur race bien-aimée, à leur tour ils mettent en doute l’authenticité des relations que publient les Anglais à l’avantage de leurs produits.
Il semble que rien ne serait plus facile que de trouver la vérité et d’en finir avec cet antagonisme à l’aide de plusieurs grandes joutes entre des concurrents pris parmi les célébrités des deux pays, et où nous serions à la fois spectateurs et juges. Il ne s’agirait pas ici des limites d’un hippodrome ordinaire, mais de ces traites de longue haleine qui mettraient à une épreuve définitive les qualités de durée et de vitesse des deux races rivales.
Cependant la question, tout vivement débattue qu’elle est encore, n’en est pas moins résolue en faveur des races anglaises aux yeux d’un grand nombre de praticiens habiles, parmi lesquels nous rangeons les principaux membres de la Société d’encouragement de notre Jockey-Club ; mais le gouvernement, craignant d’adopter trop tôt une opinion à l’exclusion de l’autre, dans son ardeur pour le succès, a pris généreusement le parti de tenter simultanément des deux systèmes. Le haras du Pin et celui de Pompadour sont peuplés de magnifiques étalons et de belles poulinières. L’émulation est éveillée. Ce sont de riantes promesses, mais pour matérialiser le succès, pour l’assurer, il ne suffit pas qu’il y ait en France une liante pensée qui veuille obtenir au profit du pays les avantages considérables d’une vaste population chevaline dotée de qualités supérieures ; il faut à cette pensée des auxiliaires en dehors de son initiative. Une direction nouvelle dans les mœurs et les habitudes françaises serait un heureux symptôme ; nous avons besoin de revenir quelque peu à la grande existence de nos pères et de secouer ce scepticisme bourgeois et timide qui engourdit les âmes.
La société d’élite doit se reconstituer avec les éléments qui lui sont propres. Que les courses rivalisent entre elles, que les écuries se peuplent, que les équipages brillamment attelés de chevaux de France se montrent et se multiplient. Que la chasse s’élance des Ardennes aux Pyrénées. L’homme de la haute propriété doit, par son exemple, ses prédilections, ses libéralités, concourir à l’élan d’ensemble de cette renaissance. Les agitations du sport et du turf créent d’ailleurs une belle et virile jeunesse : elles retrempent l’âme et le corps, elles dissipent, par la variété même, les fatigues de la vie élégante et molle.
Ce ne sont plus les accords d’un orchestre de salon, d’opéra ou de bal en plein air qui vous appellent, c’est le bruit de la trompe éclatant et sonore que l’écho sylvestre fait ondoyer de vallée en vallée et qui vous convie au fond des bois ; c’est le hennissement du cheval qui paraît sur le champ de course, c’est le tumulte attachant de l’enceinte du pesage où se font les préparatifs du départ ; ce sont les acclamations de la foule assemblée qui borde l’ellipse de l’hippodrome ; ce sont les émotions de la lutte, ses péripéties, qui ne sont pas seulement un plaisir noble pour les yeux, mais qui pour le pays deviennent une richesse et une grandeur de plus.
Tous les peuples qui ont brillé sur la terre ont eu au moment de leur plus grand éclat de belles époques chevalines. L’antiquité a eu ses jeux olympiques qui, on le sait classiquement, au point de vue de la splendeur, du grandiose et de l’intérêt national, surpassaient de beaucoup les réunions contemporaines de New-Market, d’Epsom, d’Ascot et de Doncaster. Les courses de la Grèce étaient l’objet d’ardentes émulations, non seulement entre des individus, mais entre des populations ; elles avaient aussi leurs gentlemen jockeys, et des plus considérables, puisque dans le nombre figuraient Philippe, roi de Macédoine, et Hiéron, tyran de Syracuse : qu’on se rappelle la première ode de Pindare, où le poète chante le cheval Phérénice qui fit remporter à ce dernier monarque la palme olympique. Mais, chose plus étrange, ces courses avaient des luttes diverses pour des chevaux de tout âge, des prix pour les poulains, d’autres pour les juments à l’exclusion des mâles ; elles offraient ainsi une parfaite analogie avec les usages qui prévalent aujourd’hui sur le turf anglais.
Il y a dans nos mœurs une saillante anomalie, qui surprend les étrangers et dont ils cherchent la raison sans la trouver : nous sommes un peuple guerrier, brave, impétueux, et en général nous sommes mauvais cavaliers. Le cheval, cet ami, ce soutien, ce compagnon, cet agent de la fortune, de la gloire et des plaisirs de l’homme, naît, vit et meurt chez nous comme une chose, un objet de trafic et d’échange ; pas de soins, quelquefois pas d’affection réelle, non seulement pour l’espèce, mais pour le cheval en particulier. Nous avons peu d’inclination instinctive pour ces exercices où le courage est éprouvé non moins que les forces du corps, et qui sont si aimés, si populaires dans la Grande-Bretagne ! Ni les aventures de la course au clocher ou de la chasse au renard, ni la rapidité de la course plate, ni la grande poésie du sport en général n’ont le privilège de passionner le public, d’intéresser nos jeunes hommes comme acteurs. En dehors des occupations et des jouissances intellectuelles que quelques-uns recherchent, les autres renferment le cercle des plaisirs dans les limites circonscrites d’une salle basse de restaurateur, dans l’atmosphère énervante de musc et de gaz d’une avant-scène de théâtre, ou bien dans les quinconces de ces bals tapageurs où l’on ne voit que cohue, toilettes folles et ripailles vulgaires. La galanterie facile et ses occupations sont les passe-temps dans lesquels se complaît notre jeune monde.
C’est là qu’une révolution presque complète est nécessaire. Les mœurs y gagneraient à coup sûr. Le temps donné aux préoccupations de ce nouveau goût et aux intérêts qui s’y rattachent serait perdu pour l’intrigue et la mollesse, mais il y aurait bénéfice pour la vie élevée. Les relations entre gentilshommes, devenant plus nouées et plus fréquentes, produiraient plus d’aménité et de courtoisie générale. Le monde, qui en toute chose et en réalité obéit aux impulsions qui lui sont données d’en haut, finirait par s’intéresser à cette existence grandiose. Non seulement ainsi vous rendriez les jeunes gens cavaliers, c’est-à-dire forts, en leur inspirant l’amour du cheval ; mais, croyez-le bien, vous aurez élevé le niveau de leur caractère et épuré les habitudes qui les affaiblissent et quelquefois les dégradent, le jour où vous leur aurez appris à trouver un intérêt d’amusement et de passion en dehors des théâtres communs, des mauvais cabarets et des tumultes de la débauche.
Partout, dans la France ancienne, le goût du cheval et des habitudes équestres se trouve mêlé aux usages de la vie. Pouvait-il en être autrement chez une nation batailleuse, sans cesse aux prises avec les invasions et les conquêtes ? Aussi, tandis que dans les campagnes, à l’abri des tours féodales, nous trouvons les jeux de bagues, les grandes chasses, les courses à travers les champs, dans les villes s’organisaient les tournois de la chevalerie. Dès l’origine de la société française, société tout à la fois mystique et guerrière, les chevaux et ceux qui s’en occupaient furent placés sous l’invocation de deux illustres patrons : saint Éloi et saint Martin. C’est à l’église de Saint-Martin que Clovis donna son cheval de bataille. Dans les lieux où on avait consacré des chapelles à ces deux saints, les voyageurs et les hommes d’armes faisaient rougir la clef de la porte et en marquaient leur cheval à la cuisse afin de le préserver de tout maléfice.
Les races françaises se divisaient en plusieurs catégories :
Les roussins (de l’allemand Ross), ou destriers (de dexter, δεςιτερός, parce que les pages les conduisaient en main et à droite pendant la route). Ils étaient destinés aux litières, aux légères basternes, aux gens de basse condition qui les montaient ;
Les sommiers, qui transportaient les bagages de l’armée ;
Les palefrois (de l’allemand Prachtpferd), qui étaient pris parmi les races les plus précieuses, et qu’on entourait des soins les plus attentifs ; chacun rivalisait à qui aurait les plus beaux et les meilleurs : le palefroi était pour les guerriers et pour les dames la monture de pompe et de parade.
Enfin, la haquenée, petit cheval aux allures douces, allant ordinairement à l’amble, et qui servait pour les chevauchées.
La supériorité de nos races provenait de plusieurs causes que nous aurons occasion d’indiquer, mais principalement de ce que nos ancêtres se servaient continuellement de chevaux arabes pour les régénérer ; ils se les procuraient à l’aide des relations qu’ils avaient avec l’Espagne et de celles qu’ils établirent avec l’Orient par les croisades. Même au temps de Henri IV, nos exportations restaient au-dessous des demandes de nos voisins d’outre-Manche. On lit dans le livre de sir Edward Harwood, postérieur à ce règne, des lamentations sur la rareté des bons chevaux en Angleterre : « Nous n’en trouverions pas deux mille dans tout le royaume, dit-il, qui puissent être comparés aux chevaux français. »
Les armées, composées de nobles, étaient peu nombreuses. Leur recrutement était une redevance féodale : chaque fief devait tant d’hommes et tant de chevaux. Dans cette condition, le sol de la France pouvait suffire à ses besoins ; mais, dès que les armées régulières commencèrent à s’établir, on sentit la pénurie des chevaux. Ce fut sous Louis XIII. Ce moment marqua aussi la fin de la puissance féodale et les premières importations de chevaux étrangers qui se firent chez nous.
En même temps, les relations de province à province, les nécessités et le goût des voyages, les besoins de l’agriculture et du commerce s’étant multipliés, les chevaux devinrent peu à peu les seuls agents de transport et remplacèrent complètement les bœufs et les mulets dans les attelages de voyage.
Le poids énorme dont les chevaux étaient chargés, et les résistances qu’ils avaient à vaincre sur les routes, donnaient à leurs muscles, à leurs nerfs, à leur poitrail et à leurs reins, un accroissement d’ampleur pesante et de force qui nuisait aux facultés de la vitesse. Ainsi soumis au travail d’une traction pénible, la parfaite symétrie du cheval arabe fut troublée. En Angleterre, où l’on s’est occupé de bonne heure de l’amélioration de toutes les voies de communication, où la surface des routes est depuis longtemps aussi parfaitement plane que possible, le cheval primitif, le cheval de la Bible est devenu facilement cheval de course, tandis qu’en France, avec le pitoyable état de nos routes, il est devenu cheval de trait.
Ainsi, les routes, on peut le dire sans exagération, sont le symbole et le diagnostic de la civilisation chevaline d’un peuple. Sur de mauvaises routes, les chevaux perdent nécessairement leur légèreté, leur grâce, leur rapidité : alors il faut en demander à l’étranger pour les besoins du luxe et le service de l’armée ; les communications intérieures sont plus lentes, le commerce est moins actif, les relations moins multipliées ; les lumières qui ressortent de ces rapports manquent au pays ; la civilisation humaine ne se développe pas. Améliorez de plus en plus les routes et toutes les voies rurales en France ; faites en sorte, par exemple, que les chemins qui servent à l’exploitation des terres labourables ne nécessitent point de lourds et pénibles charrois ; alors nous aurons fait un pas immense vers les résultats que nous voulons atteindre, et nos efforts pour reconquérir l’ancienne suprématie de nos races chevalines ne seront pas infructueux.
Le cheval qui, dans sa conformation, présente la tête petite et haute, les naseaux ouverts et bien dilatés, les yeux à fleur de tête, le garrot sec et élevé, les fourreaux descendus, les reins courts, le poitrail ouvert, les hanches prononcées, la queue haute, les jambes sèches, les jarrets larges, les pieds petits, les sabots arrondis, la corne dure, le crin et le poil soyeux, les os d’acier, le cheval enfin dont les proportions et les formes offrent une symétrie complète, et dont l’aspect éveille en nous tout à la fois les idées de rapidité, de force, de souplesse, de résistance et de fond, celui-là est le cheval arabe dans son essence pure et primitive.
En Arabie, il s’est trouvé dans des conditions de nourriture, de climat et de soins qui, de temps immémorial, ont maintenu l’intégrité de ses attributs primordiaux.
Ainsi considéré, le cheval est un moteur ; il est la vapeur du désert ; mais il n’a pas la rigueur et la régularité d’une puissance mécanique et matérielle : c’est un moteur essentiellement modifiable en raison de l’intelligence, de l’action variée de la constitution atmosphérique, de l’alimentation et des travaux auxquels il est appliqué.
Dans le Nord, où la nourriture est plus abondante, le climat plus humide, le cheval, sous cette influence, s’est trouvé dans des conditions d’extension et d’accroissement corporel.
La destination qu’il a subie ensuite, c’est-à-dire les exercices auxquels on l’a assujetti sont venus subsidiairement déterminer une nouvelle transformation dans sa nature, et de là, un déplacement forcé dans l’harmonie, dans la pondération de ses qualités.
L’existence de la grande propriété en Angleterre, les habitudes de luxe qui en sont inséparables, la vie de château avec son mouvement, les émotions du turf et du sport, toutes ces choses ont concouru, depuis trois quarts de siècle, à élever la vitesse primitive du cheval arabe : sa taille a grandi, son compas s’est ouvert, et les luttes répétées de l’hippodrome et de l’entraînement usuel, quotidien, ont encore accru cette rapidité.
En France, nous venons de le dire, le cheval arabe reçut une autre destination. La division de la propriété, le mauvais état des routes, l’effacement progressif des habitudes nobles et princières, c’est-à-dire la suppression du cheval de chasse et de luxe, nous ont nécessairement fait le cheval lourd et pesant.
Ainsi donc, déterminer le travail auquel le cheval est astreint, c’est déterminer les conditions, les qualités du cheval.
La diversité des modifications physiologiques auxquelles les générations chevalines ont été soumises a produit diverses natures de dégénérescence, c’est-à-dire qu’elle a créé des moteurs, des races ou des types distincts. Cette théorie si simple est encore généralement incomprise ; les différences qu’on établit entre le sang et l’étoffe l’attestent.
Le cheval de sang est celui qui a le plus d’étoffe dans le sens de force et de vitesse, mais non, bien entendu, dans le sens d’épaisseur lymphatique. Tout cheval qui n’est pas pur-sang est un cheval dégénéré : cette dégénérescence est tantôt mince, molle ; tantôt étoffée, lourde, lymphatique, selon l’action de la cause qui l’a déterminée. Dans le Nord, où les herbages sont humides et savoureux, le type sera gros ; dans les climats chauds, il sera grêle. Mais du cheval pur-sang prototype de l’espèce, on obtient, à l’aide d’une hygiène et d’une alimentation appropriées au mode de travail, toutes les applications désirées. Ainsi, du cheval de course à la configuration la plus délicate en apparence, vous aurez, au bout de quelques générations, mais à la condition d’un travail spécial, un cheval de trait qui, dans cette nouvelle application de ses facultés, montrera plus de puissance qu’un cheval de sang moins pur.
Quand les races primitives sont combinées ensemble, il y a accouplement ; quand elles ont subi des modifications, il y a croisement.
La vitesse est ce que l’on demande au cheval de course. Pour l’obtenir, rien ne doit être changé au cheval pur-sang que les conditions du travail et du climat. Au désert, son élan couvrait seize pieds ; mais, sur le sol septentrional, il en embrasse vingt-quatre et même vingt-huit. En quatre bonds, il franchit plus de cent pieds. Il lui faut, à la vérité, le sable mat et compacte, la mousse élastique et molle, ou le gazon verdoyant ras et dru ; mais il parcourt les espaces avant que vous les avez conçus. Sa vitesse n’est pas un élan, c’est un vol : les arbres, les maisons, les haies, les spectateurs n’ont point pour lui de solution de continuité ; ce sont des lignes enrubannées ; lui, c’est une pensée : il ne court pas, il arrive !
Pour parvenir à ce degré de vitesse, la somme de force qui avait été départie à son espèce primitive a dû être intervertie : ainsi, le cheval façonné de cette sorte par l’éducation court cinq ou six minutes en déployant toute la puissance de sa prodigieuse vitesse ; mais on pourrait le faire courir pendant douze, quinze ou vingt heures, s’il le fallait, en modérant sa vitesse et en modifiant le travail de l’entraînement. En un mot, il renouvellerait au besoin les merveilles attribuées aux juments de Mahomet, qui, allant annoncer la nouvelle de la mort du prophète, coururent, disent les traditions, pendant soixante-douze heures.
Dans le cheval de chasse, il ne faut pas que la nature soit détournée vers un seul but, la vitesse. Il faut qu’elle se développe aussi dans la richesse du fond, dans l’élasticité de certaines parties de l’organisme. L’animal doit avoir le trot, le petit galop doux et nonchalant, s’enlever du train de derrière, franchir un mur, une barrière, un fossé profond, et retomber ferme sur ses jarrets.
Le cheval de course étant l’expression de la vitesse, le cheval de trait, celle du poids réuni à la force des reins et du poitrail, la multiplication de ces deux conditions donne pour produit le cheval à deux fins, qui peut porter et tirer. Souvent et mieux encore c’est à ce produit demi-sang, combiné avec l’élément primitif ou pur-sang, qu’on a recours pour obtenir le cheval de chasse, qui est alors trois quarts de sang. L’éducation fait le reste. Cette éducation du cheval de chasse dépend non moins de l’habileté de ceux qui la dirigent que de la nature du terrain où il est élevé.
La supériorité du cheval irlandais est due aux difficultés de terrain qu’il rencontre dès sa naissance. Là chaque pâturage est entouré, non pas seulement de haies comme en Angleterre, mais de murs et de fossés ; le pays est montueux, coupé à la fois de collines et de ruisseaux ; la terre, souvent imbibée d’eau et glissante. Les poulains d’un pâturage, séparés d’un autre pâturage par ces accidents multipliés du sol, et excités par la vue les uns des autres ou par des émanations que leur apporte le vent, s’accoutument ainsi de bonne heure à surmonter les obstacles qui les séparent lorsqu’ils veulent se réunir. Aux premiers hennissements d’appel qui frappent leurs oreilles, ils partent par troupe, bondissent, s’élancent et franchissent tout ce qui se trouve sur leur chemin.
Il en résulte que, pour le cheval irlandais, sauter est presque un acte d’instinct, et l’on peut affirmer que, depuis le cheval de charrette jusqu’au hunter, il n’en est pas un qui ne puisse sauter un obstacle. Ces avantages que la nature du pays offre aux Irlandais pour obtenir le cheval de chasse les ont décidés à se renfermer presque exclusivement dans le perfectionnement de cette variété chevaline. Leurs chevaux de course en effet sont mauvais ; la vitesse leur manque presque toujours, car ils sont généralement petits, et il est de principe qu’un grand cheval bat toujours un petit ; mais ils possèdent un fond si extraordinaire qu’on ne saurait leur opposer de rivaux à la chasse dans les localités montueuses et accidentées.
La conformation du hunter irlandais est caractéristique. Il est ramassé, il a le coffre ample, un peu irrégulier ; il est membru, fort en nerfs et net dans ses membres. Dans cette structure, qui n’offre pas la symétrie du cheval primitif, il trouve néanmoins la puissance de s’élever à une hauteur prodigieuse, et franchit jusqu’à un mur de six ou sept pieds.
Il y a une différence très saisissable entre la manière dont le cheval anglais et le cheval irlandais prennent leur élan. L’anglais s’appuie sur ses jarrets et s’élance de telle sorte que déjà il a franchi la moitié de la barrière, lorsque le corps s’est seulement allongé pour rendre son élan complet. Quand il a quitté terre, il porte ses hanches sous lui comme au galop, descend ensuite sur les jambes de devant, et quand elles touchent le sol, c’est alors seulement qu’il attire à lui ses jambes de derrière, en sorte que l’avant-main est seul à supporter le poids tout entier.
Le cheval irlandais, au contraire, part de ses quatre jambes à la fois ; quand il est parvenu à l’extrémité supérieure de l’objet à franchir, ses jambes de derrière sont entièrement retroussées sous lui ; il descend, les quatre jambes se posent sur le sol en même temps.
Cette supériorité du hunter irlandais est tellement avérée que l’Angleterre ne la lui dispute pas. Elle sait qu’en général les conditions matérielles du terrain lui manquent pour l’application spéciale à la chasse des qualités du demi-sang ou du trois-quarts, et elle se renferme à peu près dans la production sans rivale de ses chevaux de course. À l’Irlande, le cheval de chasse ; à l’Angleterre, le cheval pur-sang ; mais dans les deux contrées, sœurs jumelles, ce sont les mêmes principes d’élevage et d’entraînement, la même patience, les mêmes soins et le même amour du cheval.
De ce que nous avons dit sur la complète symétrie du pur-sang, il résulte avec évidence que de son application à la chasse on obtient des sujets supérieurs aux autres. Il importe dans ce cas qu’il contracte l’habitude d’un port élevé qui lui permette de dominer l’obstacle à franchir. Une bonne stature est de quinze à seize paumes. Plus basse, le cheval ne mesure pas l’obstacle ; plus élevée, il sera trop haut sur ses jambes et gauche dans ses mouvements.
La première qualité d’un hunter





























