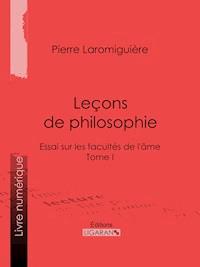
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "La philosophie, oubliant ce qu'elle devait à la parole, l'a quelquefois accusée d'être un obstacle au mouvement de la pensée et aux progrès de la raison. Aucune erreur ne semble plus naturelle, quand on songe aux imperfections et aux vices des langues; et cependant, aucune erreur ne saurait être plus éloignée de la vérité; car l'esprit humain est tout entier dans l'analyse, il est tout entier dans l'artifice du langage..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On ne jugera pas quelques leçons destinées particulièrement à des élèves, comme on juge un ouvrage composé pour le public.
Un cahier de professeur doit se faire remarquer par une grande clarté d’exposition, et par une extrême pureté de principes. Il n’impose pas les mêmes obligations qu’un livre. Il n’exige pas au même degré toutes les qualités de l’écrivain.
Si j’avais ambitionné le titre d’auteur, j’aurais dû, pour donner à la philosophie son véritable ornement, m’appliquer surtout à trouver des formes de style très concises et très sévères.
Des leçons pour la jeunesse ne veulent pas un discours si serré. Elles commandent des développements et même des répétitions ; elles permettent aussi quelques négligences et souffrent une sorte de familiarité.
Quoique je désire de faire assister, en quelque sorte, à nos entretiens, ceux qui liront cet écrit, j’ai retranché beaucoup de ces choses familières qu’on pouvait hasarder devant un auditoire accoutumé ; je demande grâce pour ce qui peut en rester dans quelques endroits.
Les amis de la philosophie qui nous ont honorés de leur présence ne trouveront pas ici toutes les leçons qu’ils ont entendues ; et celles que je publie sur les principes et les premiers développements de l’intelligence, recueillies comme à la volée, ou dictées sommairement et de mémoire, sont nécessairement incomplètes.
Cependant, j’espère que les omissions ne se feront pas sentir. Beaucoup de détails m’ont échappé : les idées essentielles sont en trop petit nombre pour que j’aie pu les oublier.
Si, malgré ce qui manque à ce travail, et malgré l’imperfection de ce qui en a été conservé, l’indulgence des bons esprits croyait y apercevoir quelques traces de la méthode ; si la critique, oubliant sa sévérité, trouvait qu’il peut contribuer à faire naître ou à fortifier le goût du vrai et de la simplicité qui en est inséparable, je serais trop récompensé sans doute ; mais je serais moins sensible à ces encouragements qu’au regret de ne pas les avoir mieux mérités.
Prononcé à l’ouverture du Cours de philosophie de la faculté des lettres de Paris, le 26 avril 1811.
La philosophie, oubliant ce qu’elle devait à la parole, l’a quelquefois accusée d’être un obstacle au mouvement de la pensée et aux progrès de la raison. Aucune erreur ne semble plus naturelle, quand on songe aux imperfections et aux vices des langues ; et cependant, aucune erreur ne saurait être plus éloignée de la vérité ; car si l’esprit humain est tout entier dans l’analyse, il est tout entier dans l’artifice du langage.
Ceux qui, dans les langues, ne voient que de simples moyens de communication, peuvent bien concevoir comment les sciences se transmettent d’un peuple à un autre peuple, ou d’une génération aux générations suivantes ; ils ignoreront toujours comment elles se forment et comment elles prennent sans cesse de nouveaux accroissements.
Ceux qui, remontant à l’origine des signes du langage, ont reconnu que ces signes nous étaient nécessaires à nous-mêmes, qu’ils nous servaient à noter les idées acquises, à les rendre distinctes et durables, ont fait plus que les premiers sans doute ; mais s’ils ont vu comment des matériaux sont fournis à la mémoire, ils ont oublié de se demander comment nous entrons en possession de ces matériaux.
Ceux-là seuls auront embrassé toute l’étendue de l’objet qui, dans les langues, trouveront à la fois des instruments de communication pour la pensée, des formules pour retenir des idées toujours prêtes à nous échapper et des méthodes propres à faire naître des idées nouvelles.
On comprendra sans peine que les langues sont autant de méthodes ; on s’assurera qu’elles sont de puissants moyens de découverte et d’invention, du moment qu’on ne confondra plus les sensations avec les idées.
Les sensations, il est vrai, appartiennent à l’âme, de même que les idées ; mais en nous modifiant intérieurement, en nous faisant éprouver le plaisir ou la douleur, elles ne peuvent immédiatement nous éclairer.
Pour que la lumière se montre, il faut que l’âme agisse sur les sensations qu’elle a reçues, et il faut qu’elle les rapporte au dehors. Par le sentiment de son action, elle commence à se connaître elle-même ; en rapportant ses sensations au dehors, elle commence à connaître les objets extérieurs : or, l’expérience atteste ce double pouvoir de notre âme.
Ce que l’expérience atteste encore, et la raison sera par conséquent forcée de l’admettre, c’est que l’âme, pour s’élever du sentiment de son action jusqu’à l’idée de sa propre substance, comme pour passer des sensations jusqu’à l’idée des objets extérieurs, a besoin de s’approprier ou de se créer des moyens qui paraissent les plus étrangers à l’âme, aux idées et aux sensations.
Ces moyens, qui le dirait ? ce sont des mouvements, des gestes, des sons et des figures.
Le mouvement des organes sollicité d’abord par la seule nature, mais bientôt devenu volontaire et libre, se porte sur les objets qui nous environnent ; il se dirige tour à tour sur les différentes qualités de ces objets, s’arrête sur celles qui intéressent le besoin ou la curiosité, les fait mieux sentir, et nous donne les premières idées les idées sensibles.
À un travail si nécessaire, mais en même temps si insuffisant pour mettre à découvert toutes les sources des connaissances humaines ; à une analyse si incomplète, et qui laisse à peine entrevoir quelques rayons de l’intelligence, succède le langage des gestes, le langage d’action. Ici, les analogies des signes et leurs contrastes nous font entrer dans un nouvel ordre d’idées. L’âme n’avait qu’un sentiment confus des rapports, elle en acquiert la perception distincte.
Enfin, par les sons et les figures, naît et se développe l’infinie variété des langues parlées et des langues écrites ; et dès lors on dirait que l’esprit ne connaît aucunes bornes, tant ses facultés ont gagné en puissance, tant elles ont étendu leur empire.
Ainsi commence, s’accroît et se perfectionne l’intelligence.
Ainsi l’homme, si souvent averti de sa faiblesse lorsqu’il veut se donner des sensations, peut tout pour se donner des idées, puisque c’est par des moyens qui lui sont naturels, ou par des ressources artificielles dont il dispose, qu’il les obtient. Une idée était cachée et comme perdue dans une sensation ; il se rend attentif, il dirige ses organes et la trouve. Plusieurs idées, un grand nombre d’idées étaient enveloppées dans une seule idée ; avec des signes qui sont en son pouvoir, il les dégage et s’en rend le maître.
Cet emploi des signes qui incessamment ajoute à nos connaissances, mais qui suppose des connaissances antérieures à tout signe ; ce procédé qui ouvre et facilite le passage des premières idées à de nouvelles idées, de celles-ci à d’autres encore, sans qu’on puisse marquer le terme d’un tel progrès ; cet artifice qui d’une vérité connue fera sortir mille vérités auparavant inconnues ; cette méthode qui, dans ce que nous savons, nous montre ce que nous ignorons ; cette langue enfin sans laquelle, réduit à l’instruction des sens, l’esprit de l’homme ne se serait jamais élevé au-dessus de l’expérience : tel est l’objet dont je me propose de vous entretenir.
Parce que la raison se présente d’abord sous des formes moins riantes que l’imagination, il ne faut pas croire qu’elle n’ait aussi quelque attrait. Peut-être que Locke, en écrivant son Essai sur l’entendement, n’éprouvait pas de moindres jouissances que Racine lorsqu’il composait ses admirables tragédies ; peut-être aussi plus d’un lecteur, en passant de Corneille à Bacon, a-t-il senti que la langue de la raison n’avait pas moins de richesse et moins de puissance que les accents des passions ; et celui qui tout à coup fut saisi d’un transport inconnu et d’une violente palpitation à l’ouverture d’un livre, était-il en présence d’un poète ou d’un philosophe ?
Mille expériences le prouvent ; la faculté de raisonner peut être une source de plaisirs aussi vifs que ceux qui nous viennent de la faculté ou plutôt de la capacité de sentir, et la réflexion n’est pas plus avare de récompenses que l’imagination.
Une philosophie inattentive, d’accord avec le préjugé, regarda longtemps la raison comme une acquisition tardive des progrès de l’âge. Elle n’avait pas vu que la faculté de raisonner peut se laisser deviner dès les premiers moments de notre existence. À peine l’enfant a respiré, qu’il sent des besoins et qu’il désire : or le désir, tel qu’il se manifeste aujourd’hui dans le plein développement de la vie, suppose l’action de toutes les facultés de l’âme. Nos premiers désirs furent donc l’action de ces mêmes facultés naissantes. Car, s’il est incontestable que les facultés du corps datent du moment de son organisation, il ne l’est pas moins que celles de l’âme datent du moment où elle fut créée, qu’elles entrent en action dès les premières impressions reçues, dès les premiers sentiments éprouvés. Ce n’est encore, il est vrai, qu’une ébauche tout à fait informe : rien n’est prononcé, rien n’est démêlé, rien ne saurait être distinctement perçu ; attention, comparaisons, raisonnements, tout est confondu, tout échappe, mais tout existe ; et lorsque ces facultés, fortifiées par l’exercice, se montreront dans toute leur puissance, elles pourront bien nous déguiser leur origine, elles ne changeront pas leur nature. Pascal proposant l’expérience du Puy-de-Dôme, d’après la pesanteur connue de l’air, ne raisonnera pas autrement que Pascal au berceau, lorsqu’il tendait les bras à sa nourrice, d’après le souvenir des soins qu’il en avait reçus.
Mais, alors qu’il raisonne et qu’il pense, l’enfant ne sait pas qu’il pense et qu’il raisonne. Il ignorera ce qui se passe au-dedans de lui, tout le temps qu’entraîné au dehors par la vivacité du besoin, sa pensée ne se sera pas repliée sur elle-même.
Si, par une fiction que des philosophes ont confondue avec la réalité, ou le réduisait à un état purement sensitif ; si ou le supposait privé de toute activité, et de celle qu’il exerce hors de lui, et de celle qu’il exerce sur lui-même, il continuerait sans doute à voir, à entendre ; il sentirait par tous ses organes et par toutes les parties de son corps ; mais, dans l’impuissance absolue de diriger ses sens, de donner son attention, et d’agir sur lui-même, il n’acquerrait aucune connaissance ; son âme, réduite à de pures sensations qu’elle ne pourrait ni démêler, ni comparer, ni réunir, ni diviser, serait privée de toute idée, et ne prendrait jamais son rang parmi les intelligences.
Puisqu’il en est ainsi, qu’il nous soit permis de rectifier deux énoncés célèbres, que la faveur dont ils jouissent n’empêche pas d’être des causes toujours subsistantes d’erreur et de divisions.
On répète, d’après Aristote, Gassendi et Locke, que toutes nos idées viennent des sens. Assurément il n’est pas dans mon intention de ressusciter les archétypes éternels de Platon, ou les idées innées de Descartes, ou les perceptions de la monade de Leibnitz. Mais enfin, pourquoi redire sans cesse que les idées viennent des sens, quand il est démontré que, des sens il ne peut nous venir que des sensations ? Pourquoi cette expression si négligée, si inexacte, viennent, par laquelle on semble nous ramener aux simulacres d’Épicure ou de Lucrèce, en nous laissant croire que les idées, avant d’être dans l’âme, résidaient dans les sens ou dans les objets extérieurs ? Pourquoi ne pas dire avec plus d’exactitude, non que toutes nos idées, mais que nos premières idées viennent des sens ou plutôt des sensations ; et chercher ensuite à expliquer comment, après avoir acquis ces premières idées, ces idées sensibles, nous nous élevons aux idées intellectuelles, et aux idées morales ? Pourquoi, en plaçant la source des idées dans les sens, ne pas dire du moins qu’ils devaient être considérés dans un état actif, et non dans un état purement passif ? car, encore une fois, par la simple vue, par l’ouïe, par les impressions que les objets font sur nos sens, nous ne recevons que des sensations ; c’est par le regard, c’est par l’auscultation, c’est par l’action de nos organes, que nous acquérons nos premières idées.
Il ne fallait donc pas avancer que nous apprenons à voir et à entendre ; et cependant, depuis Berkeley, on ne se lasse pas de reproduire cette proposition dans les mêmes termes ; aussi ne se lassera-t-on pas de la nier, tout le temps que la vérité qu’on a voulu présenter ne sera pas autrement et mieux exprimée. Nous apprenons à regarder ; nous apprenons à écouter. Si l’on s’était ainsi énoncé, tout le monde se fût à l’instant rendu à l’évidence ; mais en soutenant, sans aucune restriction, que tout s’apprend, on se trompait soi-même, et on trompait les autres par le seul effet d’une expression fausse. Nous n’apprenons pas à avoir chaud, à avoir froid ; nous n’apprenons pas à recevoir les impressions que les objets font sur nos sens nous apprenons à régler nos sens, à diriger nos organes ; nous n’apprenons pas à sentir, nous apprenons à penser.
Puisque nous apprenons à penser, il doit y avoir un art de penser ; et puisque nous n’apprenons pas à sentir, il ne peut y avoir un art de sentir. Il est vrai qu’en conduisant bien nos facultés, nous mettons de l’ordre dans nos sensations, nous les rendons plus nettes, plus vives et plus sûres ; mais c’est précisément dans le bon emploi de nos facultés, c’est dans cet art d’ordonner les sensations que consiste l’art de penser.
Les lois de la pensée et les règles du raisonnement sont dans toute pensée juste, dans tout raisonnement exact. Il semble donc qu’il ne pouvait pas être difficile de découvrir ces règles et ces lois ; et néanmoins, après des tentatives sans cesse renouvelées, à peine les connaissons-nous aujourd’hui. Quelle peut être la cause d’une ignorance qui semble si peu naturelle ? Comment se fait-il que la théorie de l’art de raisonner soit encore si imparfaite, quand l’art de raisonner se montre avec tant de perfection dans les chefs-d’œuvre du génie ? L’étonnement cesse en voyant combien les recherches ont été mal dirigées. Au lieu d’observer la nature, qui nous donne les premières leçons ; au lieu d’étudier les grands poètes et les grands orateurs qui l’avaient prise pour modèle, on s’obstinait à interroger une philosophie, qui, toute entière à des questions qui n’intéressent ni nos besoins ni nos plaisirs, ne pouvait que se perdre dans de vaines curiosités.
Depuis Aristote, le nombre des logiques est incalculable ; mais presque toutes s’arrêtent avec celle du philosophe grec. Comme on ne doutait pas qu’il n’eût atteint la perfection, on ne pouvait que répéter ce qu’il avait enseigné.
Il est vrai que dans tous les temps il s’est rencontré de ces esprits qui portent impatiemment le joug de l’autorité, et qui, pleins de confiance en leurs propres forces, ne veulent recevoir la loi que d’eux-mêmes. Tels furent principalement Bacon et Descartes. Ces grands hommes, étonnés du peu de fruit qu’ils avaient retiré de l’art du syllogisme, de cet art qui promet tant et qui tient si peu, finirent par le décrier comme une invention aussi futile qu’ingénieuse ; mais, quoique Descartes l’ait comparé à l’art trompeur de Raimond-Lulle, et que Bacon ait fort bien vu, ce que tout le monde aurait dû voir, que le syllogisme ne va pas au fond des choses, ni l’un ni l’autre n’en a montré le vice radical.
Aristote, dont la doctrine a eu tant de fortunes diverses, mais dont le génie étonne encore après deux mille ans ; Aristote a plutôt donné la théorie d’un certain nombre de formes du raisonnement, qu’il n’a donné celle du raisonnement. On pouvait encore lui reprocher d’avoir laissé dans sa logique une lacune qui la rend incomplète. Après avoir très bien fait sentir la nécessité des idées moyennes pour découvrir les rapports entre les idées trop éloignées, il a oublié de nous dire où il fallait prendre ces idées moyennes ; et, chose singulière ! personne n’a songé à remplir cette lacune ; à peine même s’est-on avisé qu’elle existât, malgré la difficulté si souvent éprouvée de lier les vérités inconnues aux vérités que l’on connaissait.
Hobbes, qu’on ne peut trop blâmer pour les principes de sa philosophie, mais à qui l’on ne peut refuser une grande force de déduction ;
Mallebranche, qui pénètre si avant dans tous les sujets, et qui sait faire parler à la métaphysique la plus abstraite une langue toujours riche, toujours naturelle, quelquefois sublime ;
Leibnitz, qu’un désir insatiable de savoir portait à tout approfondir, à tout agrandir, jusque-là même qu’il a inventé de nouvelles formes de syllogisme ;
Locke, dont l’esprit plus circonspect mettait très peu du sien dans l’étude de la nature, et qui, par cette raison, l’a mieux connue que les autres ;
Tous, laissent quelque chose à désirer quand ils traitent du raisonnement.
Hobbes et Leibnitz ne le distinguent pas du syllogisme. Mallebranche n’a pas mieux vu que les autres philosophes la nature du rapport sur lequel il se fonde ; et Locke s’est mépris en regardant comme frivole pour l’homme, ce qui le serait en effet pour des intelligences supérieures.
Il était réservé à un Français du dix-huitième siècle, à Condillac, de nous apprendre ce que nous faisons quand nous pensons et quand nous raisonnons ; comme, un siècle auparavant, il avait été réservé à un autre Français, à Descartes, d’apprendre à toute l’Europe à penser et à raisonner.
Et d’abord, en rendant à Descartes une si éclatante justice, nous ne faisons que répéter les acclamations de ses plus illustres contemporains. Les savants de toutes les nations, anglais, allemands, italiens, français, tous n’eurent qu’une voix. L’admiration fut même portée à l’excès, quand Mallebranche, en cela l’interprète des premiers esprits de son temps, ne craignit pas d’avancer, dans sa Recherche de la Vérité, que, pendant les trente années qui avaient suivi la publication des œuvres de Descartes, il avait été découvert plus de vérités que dans tous les siècles qui l’avaient précédée.
Qu’on ne dise pas que c’est à Bacon qu’est due la révolution qui se fit alors. Bacon, il est vrai, s’est moins trompé que Descartes sur l’origine de nos connaissances ; il a mieux fait connaître les vices des fausses méthodes qu’on suivait depuis des siècles, et il l’a précédé de plusieurs années ; mais, à ces titres il fallait joindre l’ascendant d’une grande renommée pour opérer une révolution ; et Bacon, qui plus tard devait avoir dans les sciences un nom si imposant, était à peine connu quand la philosophie de Descartes retentissait partout, agitait tous les esprits, et imprimait aux sciences l’heureuse direction qu’elles suivent depuis cette époque.
Parler ainsi, dans une école française, d’un philosophe qui a tant illustré la France, ce n’est pas céder à un mouvement d’orgueil national, c’est se sauver de l’ingratitude.
Nous ne serons pas ingrats non plus envers Condillac ; et nous aimons à reconnaître que nous lui devons, sur la manière dont se développe la pensée et sur la nature du raisonnement, des idées plus exactes que celles que nous aurions pu emprunter des autres philosophes.
Si en effet, dans le produit de nos facultés, ils avaient distingué ce qui appartient à la nature et ce qui vient de l’art, ils auraient pu voir ce que Condillac a le premier si bien vu, non pas que la pensée ne puisse exister sans le langage, et qu’en ce sens elle dépende du langage, comme on le dit quelquefois en croyant exposer fidèlement sa doctrine, mais que l’art de penser dépend du langage ; deux choses qu’il ne faut pas confondre.
Sans doute la pensée précède la parole, et même tout langage d’action. L’enfant, comme nous l’avons observé, pense dès qu’il éprouve des besoins, et ce n’est pas en un jour qu’il apprend à parler ; mais, s’il est manifeste que la pensée précède la parole, il ne l’est pas moins que l’emploi de quelques signes devance l’art de penser. Comment, sans le secours des signes, l’art pourrait-il se trouver dans la pensée, quand ses parties, existant simultanément, forment un tout indivisible ? Comment, dans le plus simple des jugements, serait-il possible de démêler le sujet, l’attribut, le rapport qui les unit, ou l’opposition qui les sépare, si toutes ces choses ne se montraient successivement à l’esprit ? Et comment se montreraient-elles successivement, si la succession des signes ne les détachait les unes des autres ? Or, les signes, en se succédant, sont nécessairement distribués dans un certain ordre ; il faut donc que les parties de la pensée soient distribuées et se succèdent dans ce même ordre ; alors il y a de l’art dans la pensée, qui, naturellement, existe sans aucune division, sans aucune succession, sans aucun art.
La pensée, existant antérieurement à tout signe et indépendamment de tout langage, est donc réduite en art par le moyen du langage et l’on voit tout de suite que l’art de penser sera porté à un degré plus ou moins grand de perfection, suivant que l’art de parler sera lui-même plus ou moins parfait, c’est-à-dire, suivant qu’il sera plus ou moins propre à développer les parties de la pensée dans un ordre que l’esprit puisse facilement saisir.
Ainsi, autant il est sûr que les langues ne font pas la pensée, autant il est incontestable qu’elles sont nécessaires pour la décomposer, ou pour l’analyser, ou pour la développer, et par conséquent qu’elles sont des moyens de développement, des moyens d’analyse ; mais c’est trop peu dire : toutes les langues obéissant aux règles de la grammaire, à quelques règles de grammaire du moins, il ne suffit pas de les regarder comme de simples moyens d’analyse ; ce serait ne les apprécier qu’à demi. Elles sont de vraies méthodes d’analyse, elles sont des méthodes analytiques : vérité fondamentale, qui donne la possibilité d’apprécier la bonté relative de toutes les langues, et de discerner, soit parmi les langues qui appartiennent aux différents peuples, soit parmi les langues propres aux différents écrivains chez un même peuple soit encore parmi les langues diverses que le génie a créées pour l’avancement des sciences, celles qui, décomposant la pensée dans l’ordre le mieux approprié à la nature de l’entendement, pourraient donner à ses facultés une facilité inattendue et des forces incalculables.
Mais il ne suffit pas de cette belle découverte, qui n’avait si longtemps échappé qu’à cause de son extrême simplicité ; il faut trouver en quoi consiste cette manière particulière de penser, à laquelle nous avons donné le nom de raisonnement. Après être remonté à l’origine de l’art de penser, il faut remonter à l’origine de l’art de raisonner ; il faut voir le raisonnement en lui-même, dans son essence qui ne varie pas, et le séparer de ce qui semble en être inséparable et qui varie.
On peut considérer le raisonnement dans l’esprit, ou dans le discours.
Si vous le considérez dans l’esprit, et antérieurement à l’époque où nous avons commencé à faire usage de quelques signes, antérieurement à cette habitude devenue dès longtemps une seconde nature, par laquelle la pensée est aujourd’hui une parole intérieure, le raisonnement est la simple perception, ou plutôt le simple sentiment de l’identité entre plusieurs jugements ou rapports, quelle que soit d’ailleurs la nature des objets qui ont donné lieu à ces rapports. Dans le discours, c’est l’expression d’une suite de jugements renfermés les uns dans les autres ; – c’est la manifestation d’un rapport qui était caché dans un autre rapport ; – c’est le passage du connu à l’inconnu, – ou la liaison d’un principe à sa conséquence ; et, si l’on me permet de varier encore cette définition, je dirai : Le raisonnement est une synonymie continuelle d’expressions diverses c’est une substitution de plusieurs mots à un seul, ou d’un seul à plusieurs c’est une composition qui appelle une décomposition dont elle a besoin pour éclairer toutes les parties de son objet ; ou une décomposition qui, à son tour, appelle une composition pour soulager la mémoire, et pour faciliter l’action de l’esprit ; – c’est un enchaînement de vérités liées par la plus étroite analogie c’est enfin une succession plus ou moins prolongée de propositions toutes identiques.
Le raisonnement, quand on l’exprime, est inséparable de ses formes quoiqu’il en diffère essentiellement. Les formes changent, le raisonnement est toujours un, toujours le même ; puisque, soit qu’on le considère dans l’esprit indépendamment de tout langage, soit qu’on le considère dans le discours, il n’est jamais que le rapport d’identité, tantôt senti confusément, tantôt aperçu d’une manière distincte.
À l’instant où cette identité serait altérée par la diversité des expressions, diversité toujours obligée pour que nos discours ne soient pas frivoles, à l’instant même le raisonnement commencerait à perdre de sa rectitude ; et l’on peut déjà entrevoir quelle connaissance il faut de la langue avec laquelle on raisonne, pour être assuré de ne pas s’égarer, et quelle attention il faut sur soi-même pour ne jamais perdre le sentiment de l’unité, quand toutes les expressions tendent à nous en distraire.
Ceci nous conduit à une remarque particulière sur les langues.
Nous écarterons tous les rapports qui peuvent intéresser la grammaire et la philosophie, pour ne garder que le seul rapport qui doit nous donner la langue que nous cherchons.
Si vous avez égard à la multitude des sons émis et modifiés par l’organe vocal, vous compterez autant de langues que de nations.
Si, changeant de point de vue, et négligeant toute cette diversité d’accents et d’articulations, vous considérez la parole comme pouvant s’appliquer aux divers objets de nos connaissances, vous verrez sortir de cette nouvelle considération une nouvelle classe de langues aussi nombreuse ou même plus nombreuse que la première. D’un côté, vous aurez les langues française, anglaise, italienne, allemande, etc. ; de l’autre, vous trouverez toutes les langues des arts et des sciences, les langues de la morale, de la chimie, de l’astronomie, etc ; en un mot, on aura d’autant plus de langues que l’on comptera plus de peuples, qu’on sera plus avancé dans la civilisation, et que les idées acquises seront plus multipliées.
Mais, outre cette quantité innombrable d’idiomes dont chacun sert de communication à tous les individus d’une même contrée, outre les langues plus ou moins savantes qui se partagent entre elles les vocabulaires des nations, il existe chez tous les peuples une langue toujours présente, et qui toujours semble se cacher. Dans tous les pays et dans tous les siècles, les bons esprits en ont eu le sentiment, quoiqu’ils n’aient pas su la remarquer. Parce qu’on en avait le sentiment, on se conformait à ses règles dans la pratique, toutes les fois que la pensée était bien dirigée. Parce qu’on ne l’avait pas clairement aperçue, on ne pouvait en avoir développé la théorie.
Cette langue est distincte de toutes les autres ; et cependant elle les pénètre toutes pour leur communiquer la vie. Privées de son secours, la langue historique et la langue descriptive ne fourniraient que de vains ornements pour la mémoire, ou, pour l’imagination, des tableaux bizarres et sans ordonnance.
Rarement on la parle seule et dans toute sa pureté ; toujours on la trouve mêlée à la langue des grands poètes, des grands orateurs et des grands historiens.
Les philosophes, tout en la réclamant comme leur propriété, l’ont souvent méconnue ; tandis que ceux qui ne se paraient d’aucun titre, et qui n’avaient que le simple bon sens, ont su en faire un heureux emploi.
Les mathématiciens, dans leurs recherches sur la grandeur abstraite, l’ont pressentie de bonne heure, s’en sont emparés pour ne plus s’en dessaisir, et lui ont fait faire des prodiges.
Ennemie des fausses analogies, des liaisons faibles, de tout rapport vague ou incertain, elle repousse tout ce qui est arbitraire, obscur ou mal déterminé.
Amie de l’ordre et des successions régulières, le moindre écart la contraint, la gêne dans ses développements.
Sert-elle d’interprète au génie : alors, facile et sûre dans sa marche rapide, chacun de ses mouvements est marqué par une découverte, et la vérité qu’elle vient de trouver promet toujours une vérité nouvelle.
Éminemment analytique, elle n’admet les idées qu’autant qu’elles portent l’empreinte de cette science qui constate leur réalité en montrant leur origine. Ainsi éprouvées, elle les adopte, les accompagne dans toutes leurs transformations, et ne les abandonne jamais, alors même qu’elle semble les perdre de vue.
Lorsqu’elle se fait entendre, tout est vrai, tout est distinct, tout devient lumineux.
La lumière ! voilà surtout son caractère. Pour peu que cette lumière vacille, la langue hésite : la lumière vient-elle à manquer, la langue s’arrête.
Son nom doit rappeler l’opération de l’esprit qui rapproche les idées, qui les combine de toutes les manières, et qui n’en laisse échapper aucun rapport, afin de saisir le seul rapport qui l’intéresse, le rapport qui fait briller l’évidence en nous donnant la certitude. Nous l’appellerons la langue du raisonnement.
Cette langue, on le pense bien, exige un travail soutenu ; elle exige une habitude d’autant plus longue, que les langues vulgaires, dont elle est l’emploi le plus parfait, sont elles-mêmes plus éloignées de la perfection.
Des langues où manque si souvent l’analogie, et qui ne sont que des débris de langues plus ou moins polies, plus ou moins barbares, ne doivent-elles pas sans cesse gêner le raisonnement, qui n’est au fond que l’analogie ? Des langues qu’on fait servir à tant de sophismes, à tant d’équivoques, à tant de jeux de mots, pourront-elles, sans l’attention la plus scrupuleuse, être ramenées à cette sévérité que demande la raison ? Comment ne pas s’égarer dans une route mal tracée et toute remplie de fausses indications ? Et cependant, si l’on s’écarte de la ligne qui mène à la vérité, le sol fuit, tout appui manque, et l’on tombe nécessairement.
L’unique moyen de se former un raisonnement exact, consiste donc à corriger et à épurer sans cesse la langue. Avec des expressions qui ne seraient qu’à peu près celles dont nous avons besoin, le raisonnement ne serait qu’à peu près juste ; c’est-à-dire que, ne saisissant jamais aucun rapport précis, et l’identité nous échappant toujours, nous croirions voir la vérité où elle n’est pas, et nous ne saurions pas la voir où elle est.
Ceux qui, par une volonté ferme et par un fréquent exercice, ont enfin contracté l’habitude d’une langue bien faite, ne sont pas ainsi exposés à tomber d’erreurs en erreurs, ou à flotter éternellement dans l’incertitude des opinions les plus opposées. Une sorte d’instinct leur fait démêler le vrai du faux, avec autant de sûreté que de promptitude ; la facilité est devenue la compagne inséparable de la justesse ; et ils raisonnent naturellement bien, alors même qu’ils ne pensent pas à raisonner. Comme le sentiment de l’analogie ne les abandonne jamais, ils passent sans effort d’une idée à une autre idée ; les pensées et les expressions qui sont actuellement dans leur esprit se lient aux pensées et aux expressions dont elles dérivent, et aux pensées et aux expressions qu’elles vont engendrer.
Or, si nos pensées et nos expressions nous ramenaient toujours à celles qui les précèdent, et nous conduisaient toujours à celles qui les suivent, qui ne voit combien serait diminuée la difficulté d’apprendre les sciences et d’en retenir les différentes parties, puisque d’un seul regard de l’esprit, d’un seul acte d’attention, on pourrait saisir toute entière la plus longue série de déductions, la plus longue chaîne de vérités ?
On commence à voir en quoi consiste la langue du raisonnement ; on le concevra mieux si nous nous aidons de quelque exemple qui montre cette langue en action.
J’ai près de moi, messieurs, l’exemple qui peut le mieux nous convenir. En vous le présentant, j’aurai l’avantage de vous faire connaître le plan du cours de philosophie, tel qu’il a été arrêté par les hommes éclairés qui composent le conseil de l’université.
Voici le texte du programme qu’on nous donne à remplir :
« Le professeur de philosophie approfondira les principales questions de la logique, de la métaphysique et de la morale ;
Il s’attachera principalement à montrer l’origine et les développements successifs de nos idées ;
Il indiquera les causes principales de nos erreurs ;
Il fera connaître la nature et les avantages de la méthode philosophique. » Tels sont les objets que l’on impose à notre méditation. Ils occupèrent les sages dès la plus haute antiquité, et ils continueront de les occuper, tout le temps que les hommes conserveront quelque sentiment de la dignité de leur nature. La Grèce, depuis Thalès jusqu’au moment où elle perdit son existence politique, n’honora pas moins ses philosophes que ses plus illustres guerriers ; et les siècles modernes prononcent avec autant d’admiration que de reconnaissance les noms de ceux qui, depuis le renouvellement des lettres, ont consacré leur génie à l’étude de l’homme et au perfectionnement de la raison.
On sent l’impossibilité de développer en un moment des vérités qui devront nous occuper pendant des années ; et je dois à ceux de mes auditeurs qui permettront au professeur de leur donner le nom d’élèves, de leur dire que, si quelqu’un d’entre eux n’avait pas compris tout ce que nous avons exposé jusqu’ici, ou laissait échapper quelqu’une des réflexions que nous allons ajouter, il devrait bien se garder d’en accuser son intelligence. Un premier discours peut ne pas se suffire à lui-même, surtout si l’on avait eu le dessein d’exciter la curiosité plutôt que de la satisfaire.
« Le professeur approfondira les principales questions de la logique, de la métaphysique et de la morale. »
Approfondir une question, c’est en pénétrer toutes les parties, c’est éclairer celles qui sont les plus reculées et les plus obscures ; c’est, en un mot, la traiter de manière qu’elle ne laisse rien à désirer. Or, le désir de l’esprit ne sera jamais satisfait tant qu’il restera quelques idées dont on n’aura pas rendu raison ; et, comme la raison d’une idée ne peut se trouver que dans une ou plusieurs idées antérieurement connues, jusqu’à ce qu’on arrive à une idée connue par elle-même et indépendamment de toute autre, il s’ensuit qu’on n’aura jamais complètement résolu une question, tant qu’on ne sera pas remonté à une idée fondamentale qui n’ait sa raison dans aucune autre, et qui elle-même soit la raison de toutes celles qui entrent dans la solution que l’on cherche.
Approfondir une question, un système, une science, c’est donc remonter à l’origine des idées, ou, si l’on aime mieux, c’est remonter aux idées qui sont l’origine de toutes les autres, et les poursuivre dans toutes les formes qu’elles peuvent revêtir, sous lesquelles elles peuvent se cacher. Tel est le sens du mot approfondir.
Fidèles à cette acception, ou du moins pénétrés de la nécessité de ne jamais nous en écarter, nous retirerons peut-être quelque fruit de l’étude, trop souvent stérile, de la philosophie.
Parmi le grand nombre d’idées qui sont l’objet des sciences métaphysiques et morales, il en est quelques-unes qu’on dirait appartenir à des facultés inconnues, et qui semblent se cacher dans la profondeur de notre être. Aliment des esprits présomptueux, des imaginations ardentes, et d’une curiosité qui ne s’éteint jamais, elles se sont toujours montrées, et elles se montreront éternellement rebelles à toute philosophie qui ne saura pas les observer dans leur origine, et au moment de leur naissance.
Malgré les difficultés que présente leur analyse, difficultés grandes, trop grandes, je le crains, pour le professeur, mais dont vous devrez ne jamais vous apercevoir si, au moment où il les exposera, elles se sont évanouies devant lui et pour lui, nous ne passerons sous silence, ni celles qui, toujours présentes à nous-mêmes, ont une origine qui se perd dans les commencements de notre existence ; ni celles qui, par leur universalité, entrent dans toutes nos conceptions ; ni celles aussi qui, par les divisions des sectes et des écoles, ont acquis une grande célébrité.
Il est un ordre d’idées et de vérités qui se placent au-dessus de toutes les autres. Sans elles la morale est privée d’appui, le crime ne connaît plus de frein, et la consolation manque à la vertu malheureuse. La philosophie serait indigne de son nom, si elle n’employait toutes ses ressources pour rendre leur évidence égale à leur certitude.
Nous devrons chercher la solution de ces grandes et belles questions, non dans les conséquences rigoureusement déduites de quelques définitions arbitraires et convenues, mais en remontant, autant qu’il sera en nous, à leurs vrais principes, aux idées mêmes qui les ont fait naître.
« Le professeur s’attachera spécialement à montrer l’origine et les développements successifs des idées. »
Le second article ne prescrit donc que ce qui a été prescrit par le premier ; mais il le dit d’une manière plus précise et plus lumineuse. Le premier article, mal entendu, pouvait nous égarer. En voulant nous enfoncer dans les profondeurs de la métaphysique, nous aurions pu nous perdre dans les profondeurs des ténèbres. Nous sommes avertis de porter notre attention sur les idées qui, placées à l’origine des sciences, sont la source de toute lumière. Il fallait donc remettre devant notre esprit ce passage de Mallebranche : « La méthode qui examine les choses, en les considérant dans leur naissance, a plus d’ordre et de lumière, et les fait connaître plus à fond que les autres. » Il fallait nous rappeler ces paroles remarquables d’Aristote : Optime ilium veritatem rei perspicere qui à principio res orientes ac nascentes inspexerit.
« Le troisième article veut que nous cherchions à indiquer les principales causes de nos erreurs. »
Jamais la philosophie ne s’est montrée aussi éloquente que lorsqu’elle a tracé le tableau de la faiblesse et des égarements de l’esprit humain. Qui n’a pas lu les beaux chapitres de Mallebranche sur les illusions des sens, sur les visions de l’imagination, sur les fausses abstractions de l’esprit, sur les couleurs infidèles dont nos passions teignent les objets pour nous empêcher de les voir dans toute leur vérité ? Qui n’a pas admiré Bacon faisant le dénombrement et comme le déplorable inventaire de toutes les causes de nos erreurs ? On pouvait néanmoins s’épargner ces savantes recherches et ces longues énumérations. Si les pensées de ces grands hommes s’étaient dirigées plus particulièrement sur l’influence des langues, ils n’auraient pas tardé à s’instruire du bien et du mal qu’elles peuvent nous faire. Alors, en ramenant à une cause unique tous les désordres de la faculté de penser, il serait devenu plus facile de les prévenir ou d’en arrêter les suites funestes. Qui ne voit, en effet, qu’il n’y a rien qui ne puisse être pour l’homme une cause d’égarement ? Assigner un trop grand nombre de ces causes, c’est moins éclairer l’esprit que l’embarrasser ; les réduire toutes à une seule, et prouver que cette cause unique les comprend toutes, c’est l’avertir qu’il n’a qu’un seul danger à craindre ; c’est lui inspirer de la confiance et lui donner du courage.
Mais enfin, puisqu’il est reconnu qu’il n’y a pas d’autre moyen de trouver la vérité que de remonter à l’origine de nos connaissances, et de les suivre dans leurs développements, il ne l’est pas moins que, si l’on tombe dans l’erreur, ce ne peut être que pour avoir négligé ce précepte : ainsi, le troisième article rentre dans le second, comme le second rentre dans le premier.
« On nous impose enfin le devoir de faire connaître la nature et les avantages de la méthode philosophique. »
Cette expression, méthode philosophique, ne peut manquer de surprendre ceux qui ont le plus réfléchi sur la méthode, et qui, blessés d’une distinction moins réelle qu’apparente entre les diverses méthodes indiquées dans les ouvrages des philosophes, ont été conduits, par la justesse même de leur esprit, à prononcer qu’il n’y a qu’une seule méthode : mais, quelque fondée que soit une telle opinion, il n’en était pas moins nécessaire de démêler dans cette marche de l’esprit, toujours la même, une différence prise dans la nature de l’objet sur lequel on opère.
Pour rendre ceci plus sensible, qu’on me permette de choisir deux exemples dans Boileau. Pourquoi, traitant du raisonnement, ne pourrai-je pas citer un poète qui a été surnommé le poète de la raison ?
Quand Boileau nous dit :
l’oreille attentive jouit de l’harmonie des sons qu’elle entend ; l’imagination est arrêtée devant le tableau qu’on lui montre, tandis que la réflexion admire la savante méthode qui en a disposé les parties avec tant de goût.
Cette méthode si belle et si pure n’est pas toutefois la méthode philosophique ; l’art qui décrit ou qui peint se distingue de l’art qui prouve et qui démontre ; et ce n’est pas la langue du raisonnement que Boileau fait parler à la poésie dans les beaux vers que vous venez d’entendre ; mais quand nous lisons dans son Art poétique ;
on sent tout de suite la liaison de deux jugements ; on sent même leur identité : qui ne sent en effet qu’en ne disant pas tout ce qu’il faut dire pour être entendus, nous sommes nécessairement mal entendus, nous manquons de clarté, en un mot, nous sommes obscurs ?
Penser, parler, écrire, c’est aller, ou bien d’une idée à une idée différente, d’un objet à un autre objet ; ou bien, s’arrêtant à un seul objet, à une seule idée, c’est considérer cet objet, cette idée, sous différents points de vue successifs, sans jamais se laisser distraire par rien qui leur soit étranger. Quand Boileau nous présente successivement des roseaux, un fleuve, une urne, il fait passer notre esprit par une suite d’images différentes : mais quand, après avoir dit qu’une pensée n’est pas suffisamment développée, il ajoute qu’elle est obscure, il n’ajoute rien de nouveau que l’expression, puisque l’idée énoncée d’abord reparaît sous une forme nouvelle. Or, cette dernière manière de procéder appartient à la méthode philosophique, et la précédente à la méthode descriptive. Celle-ci réunit en tableaux des images empruntées aux divers objets de la nature : celle-là, bornée à un seul objet, en montre successivement toutes les formes, et les réunit en système.
Celui qui ignore le secret de la méthode philosophique pourra nous charmer quelque temps, s’il possède à un haut degré le talent de décrire ; mais, ne connaissant pas toutes les sources du beau, il n’en présentera jamais que des modèles partiels ; et on finira par le délaisser, pour se livrer sans réserve aux jouissances complètes que nous donne, dans les productions d’Homère, de Virgile, de Boileau, de Racine, de Pascal ou de Montesquieu, l’alliance de la langue de l’imagination et de la langue de la raison.
La méthode philosophique, nécessaire partout, et jusque dans les ouvrages de pur agrément, pour en varier les détails et pour établir l’unité de but, ou d’intérêt, ou d’action, est surtout indispensable dans les sciences pour assurer leurs progrès, en conservant l’unité d’idée. Toute science est une suite de raisonnements. Une suite de raisonnements est une suite de propositions identiques. – Une suite de propositions identiques est une suite de propositions dans chacune desquelles une même idée se montre sous différentes expressions. – Une suite de propositions où la même idée reparaît sous des expressions toujours nouvelles, doit être nécessairement une suite dans laquelle de nouveaux points de vue d’une même idée se montrent successivement. – Mais une telle suite met à découvert l’origine et la succession des points de vue de cette idée : par conséquent, la méthode philosophique qui procède toujours par une suite de raisonnements, est la méthode même qui nous montre l’origine et les développements successifs des idées.
Maintenant, on le voit, les quatre questions qu’on nous donne à résoudre se réduisent à une question unique, envisagée sous quatre points de vue : traiter de la méthode philosophique, c’est remonter à l’origine de nos connaissances ; c’est découvrir la source commune de toutes nos erreurs ; c’est approfondir les principes des sciences.
Telle est la langue du raisonnement. En passant d’une proposition à d’autres propositions, elle nous fait toujours sentir l’ordre qui les enchaîne, la liaison qui les rapproche, l’identité qui les confond, et, pour tout dire, l’unité d’objet sur lequel elles reposent.
En nous donnant ainsi l’exemple et le précepte, on ne nous dit pas seulement ce que nous avons à faire, on nous le montre.
Il fallait en effet pouvoir ramener l’objet entier du cours à une idée fondamentale ; sans quoi, nous aurions cru voir l’obligation de vous enseigner plusieurs sciences quand nous devions ne vous en enseigner qu’une. Il fallait que cette idée fondamentale fût l’idée même de la méthode, puisque le cours est principalement destiné à une école normale, c’est-à-dire, à une école de méthode.
Ce n’est que du moment où l’art vient aider la nature, que l’esprit acquiert le sentiment de sa force.
Privé de toute méthode, il reste immobile et plongé dans les ténèbres.
Livré à une mauvaise méthode, chacun de ses pas est une chute, et il est plus à plaindre de son savoir qu’il ne l’était de son ignorance.
Mais si la bonne méthode lui prête son appui, tout change. L’esprit se dégage des ténèbres qui l’enveloppaient : attiré par l’impression toujours croissante du jour qu’il a entrevu, il s’élève insensiblement ; il monte de vérité en vérité ; et, conduit par l’analogie jusqu’à la source de la lumière, il goûte enfin le plaisir inexprimable de se reposer au sein de l’évidence.
Pourquoi voyons-nous le soleil changer tous les jours le moment et le lieu de son lever ? D’où viennent les couleurs de cet arc brillant qui se peint au milieu des airs ? Comment se fait-il qu’agité sans cesse, l’Océan se soulève, et retombe alternativement sur lui-même ? Quelle est la cause du mouvement ? Où se cache l’origine des êtres ? Sur quel fondement reposent les sociétés ? Quels sont les principes qui servent d’appui à la morale ? Qui nous dira la raison de l’existence du mal sur la terre ? Pourquoi y a-t-il une terre ? Pourquoi y a-t-il quelque chose ?
Telles sont quelques-unes des innombrables questions que notre curiosité adresse incessamment à toute la nature ; curiosité mille et mille fois trompée dans son attente, mais quelquefois aussi récompensée par des révélations sublimes.
Il ne suffit donc pas à l’homme de connaître ce qui est ; il se sent tourmenté du besoin de connaître la raison de ce qui est.
Et comme il ne peut ainsi connaître sans posséder une intelligence qui l’associe, en quelque sorte, aux desseins de la création, il aspire surtout à découvrir la raison de cette intelligence.
Condamné à ignorer comment elle se forme, il ne consentirait jamais à lui donner une confiance entière ; et alors même qu’elle pourrait lui dire le secret de l’univers, mais en se taisant sur le secret de sa propre nature, il ne craindrait pas de l’accuser, plus jaloux d’être admis à cet unique mystère, qu’ambitieux de pénétrer tous les autres.
Aussi les philosophes n’ont-ils rien négligé pour nous apprendre une chose si ardemment désirée. Théories, systèmes, hypothèses, moyens pris dans l’expérience, moyens cherchés hors de l’expérience ; tout semble avoir été épuisé.
Mais ceux qui ont fait de l’évidence la règle de leurs jugements, ceux qu’une sage réserve tient en garde contre l’autorité des noms, contre les séductions du talent, contre les prestiges de l’imagination ; ceux-là se sont toujours refusés à des interprétations qui n’étaient qu’ingénieuses.
Les difficultés naissaient des difficultés, parce qu’on manquait des données nécessaires. À peine avait-on remarqué les causes de nos idées ; et leurs origines, une seule exceptée, étaient totalement inconnues.
Nous essaierons de porter la lumière sur ces causes inaperçues, de mettre à découvert ces origines cachées. Si les idées naissent et se développent sous nos yeux, il nous sera facile d’observer la manière dont se forme l’intelligence de l’homme, d’apprendre en quoi consiste sa nature, de déterminer les conditions de sa possibilité, d’assigner la raison de son existence, de voir combien ses limites s’étendent au-delà des limites des perceptions sensibles ; et le problème fondamental de la philosophie sera résolu.





























