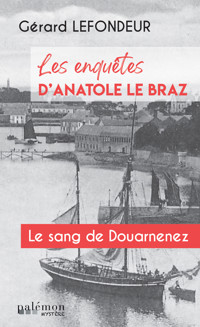Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Légendes
- Sprache: Französisch
Yann Kardec, dernier membre de l’Ordre des Sentinelles, dont l’origine remonte aux Templiers, poursuit sa quête périlleuse : retrouver la Clé des Mondes, restaurer les Frontières qui nous séparent et sauver l’humanité… Diane Da’Naãn, la plus ancienne ennemie de sa famille, se dresse à nouveau en travers de sa route alors que, partout, les créatures de l’Autre Monde font des ravages. Gilles de Rais, doté des formidables pouvoirs conférés par Diane, parviendra-t-il à éliminer Yann Kardec avant que sa quête ne s’accomplisse ? Tandis que les secrets des Kardec sont enfin révélés, une terrible confrontation finale attend Yann. Celle qui scellera sa destinée. Et c’est en Bretagne, là où tout a commencé, que tout s’achèvera…
Le dernier et palpitant volet de la trilogie Légendes réunit tous les personnages clés de la saga familiale. Ce thriller fantastique, plébiscité par les critiques et les lecteurs, s’achève dans un final époustouflant !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur, photographe, éditeur et réalisateur de documentaires (Alan Stivell, Tri Yann, Dan ar Braz…), Gérard Lefondeur fut également dirigeant dans l’industrie du disque. Passionné depuis toujours par le cinéma et la littérature fantastique, il se consacre désormais entièrement à l’écriture. Légendes est son premier roman dont Palémon réédite une nouvelle version en trois volumes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN. Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Avant-propos
Vous tenez entre vos mains le dernier volume de ma trilogie « Légendes ».
Chacun des volumes est la suite du précédent, et, dans ce dernier volume, le destin de mon héros et de ses proches s’accomplit…
Il est toujours difficile, pour un auteur, de dire « au revoir » à ses personnages, et tout particulièrement à son personnage principal. C’est celui dans lequel, même s’il s’agit d’une fiction, on met le plus de soi-même. Enfin, en ce qui me concerne pour Yann Kardec, c’est le cas. Il y a un peu de l’enfant que j’ai été, du jeune homme que je fus, en lui. Et dans les personnages de son père, mais surtout de son grand-père, il y a énormément de mes aînés, aujourd’hui disparus. Partis pour l’Autre Monde…
On dit que dans la fiction, il y a toujours une part de réalité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans mon thriller fantastique, c’est réellement le cas. Je ne prétends pas que les dragons de Lumière existent, je ne dis pas avoir croisé des Lavandières de Nuit ou une Dame Blanche (quoique…), mais je crois sincèrement que derrière le voile se dissimulent bien plus de choses que ne peut en concevoir l’esprit humain. Et tout particulièrement en certains endroits, certaines régions, comme la Bretagne.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire Légendes, et notamment ce dernier volume, que j’en ai pris à l’écrire, pour vous.
Tout ce qui doit être révélé le sera, dans ce troisième et dernier tome.
Il est difficile de fermer l’histoire mais il n’est pas impossible d’en ouvrir, à nouveau, la porte.
Alors, peut-être que cela n’est qu’un au revoir et non un adieu…
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Gérard LefondeurSeptembre 2022
Prologue
La Bête avait fait irruption dans notre monde.
Créature maudite autrefois connue sous les traits du maréchal de France Gilles de Rais, ancien compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, et désormais inféodé à Diane Da’Naãn, l’ennemie des Kardec depuis des siècles.
C’était ce monstre assoiffé de sang, dépourvu de mansuétude, dépourvu de toute humanité, un des premiers tueurs en série de l’histoire, susceptible de changer de forme pour devenir un lycanthrope, un croque-mitaine, une créature de cauchemar, qu’elle avait lâché sur le monde des hommes.
Un de ses atouts majeurs. Mais il n’était pas le seul. Depuis que les frontières entre les Mondes avaient commencé à s’estomper, d’autres créatures et une partie de l’armée de Diane avaient fait irruption dans le nôtre.
Les Sidhes noirs, les plus terribles de ses guerriers, avaient affronté Yann Kardec lors de sa confrontation avec la Chasse sauvage.
Ce combat épique, grâce aux alliés que Yann possédait dans l’Autre Monde, avait finalement tourné en sa faveur.
Mais il ne s’agissait que d’une bataille.
La guerre, elle, ne faisait que commencer.
La rencontre de Yann Kardec avec celui qui était devenu la Bête, revenu sur le lieu de ses crimes à notre époque, autrefois appelé le Gévaudan, fut brève, violente et terrible.
Et, en dépit du fait que Manaãn Mac Lir s’était interposé pour protéger Yann, la force inouïe de la Bête déboucha malheureusement sur une conclusion rapide.
La dernière Sentinelle, le dernier héritier des Kardec, gisait, à terre…
Le seul défenseur du monde des hommes désormais incapable de mener à bien sa mission et de restaurer l’harmonie entre les Mondes ; la Clé disparue, l’offensive de l’Autre Monde se poursuivit dangereusement.
Partout…
PREMIÈRE PARTIE
Monstres sans frontières…
Si l’équilibre entre les Mondes venait à disparaître, si plus aucune Sentinelle n’était en mesure de le rétablir, il adviendrait alors que toutes les créatures tapies au plus profond des ombres de nos peurs les plus anciennes se dresseraient à nouveau devant nous en pleine lumière…
Chapitre 1
Cimetière du Père-Lachaise, Paris, 2 h 30 du matin
S’il y avait bien une chose que Roger Sébillot détestait, c’était de faire sa ronde les soirs de pleine lune. Cela pouvait paraître étrange car, après tout, lorsqu’on faisait partie de l’équipe de gardiennage de nuit d’un cimetière, c’était tout de même mieux d’y voir quasi comme en plein jour plutôt que d’évoluer dans l’espèce de fog londonien qui baignait parfois la capitale, et particulièrement l’un de ses cimetières, surtout en hiver. Surtout la nuit…
Mais, pour le gardien, lorsque le ciel parisien était à peu près dégagé, et malgré les lumières de la ville qui encerclaient ce royaume des tombes et leurs occupants, en dépit des bruits lointains de la circulation, réduits à cette heure, la lueur de la lune, cette façon qu’avait l’astre mort de rendre tout visible d’une façon inquiétante le mettait mal à l’aise.
Le Père-Lachaise était depuis longtemps l’un des endroits les plus célèbres de la capitale.
Situé sur l’une des sept collines de Paris, tout d’abord appelé Mont-L’Évêque, cet immense terrain de plus de quarante hectares prit ensuite le nom de Mont-aux-Vignes ; ce nom venait des cultures qui le recouvraient. On en tirait, au Moyen Âge, un vin estimé dans les tavernes parisiennes. Puis, au XIIIe siècle, un riche commerçant racheta tout le domaine. Il décida de se faire construire une superbe bâtisse, une folie, dont le nom resta d’ailleurs à l’une des rues qui bordaient le cimetière, portant le nom de son propriétaire : la rue de la Folie-Régnault. Et puis, au fil des siècles, le domaine devint successivement la propriété des jésuites, puis retomba en friche, dans le silence et l’oubli, jusqu’à ce que la saturation des cimetières parisiens lui donne, en quelque sorte, une nouvelle vie.
Celle d’accueillir les morts.
Il avait auparavant acquis un nouveau nom, lié aux quelques heures que le jeune Louis XIV avait passées sur ses hauteurs à assister aux combats se déroulant durant la Fronde. On l’appela alors le Mont-Louis. La transformation du domaine en cimetière se fit sous l’impulsion de Bonaparte. Alors consul, il avait décrété que chacun avait droit à une sépulture, quelle que soit sa religion, sa race, réglant ainsi le sort des excommuniés, mais aussi des pauvres et des comédiens, qui finissaient souvent dans les charniers des fosses communes…
Cet afflux de nouveaux habitants des cimetières provoqua des embouteillages, et des crises de logement. Les cimetières parisiens débordèrent rapidement de cadavres à enterrer et il fallut pourvoir à cette affluence imprévue de prétendants à une tombe décente. Il fut confié à Alexandre-Théodore Brongniart, architecte néo-classique et inspecteur général en chef des travaux publics de Paris, la mission de dessiner les plans d’un cimetière assez peu ordinaire, suivant les critères de l’époque.
Il se lança donc dans la conception d’un vaste jardin à l’anglaise, traversé d’allées accidentées, peuplées d’essences d’arbres et de plantes les plus variées, et bordées de sépultures très ornementées et sculptées. Le cimetière vit le jour en 1804. Et il prit le nom de Père-Lachaise.
Symbole cruel de cette nouvelle naissance, ce fut une fillette de cinq ans qui y fut inhumée la première, fille d’un porte-sonnette du faubourg Saint-Antoine. Destiné à l’origine aux Parisiens des « beaux quartiers », sous forme de concession perpétuelle, il n’eut pas leur faveur, car ils n’avaient pas goût à se faire enterrer sur des hauteurs et, qui plus est, dans l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, à l’époque.
Les bobos n’avaient pas encore fait leur domaine des arrondissements environnants et le Père-Lachaise demeura pendant deux siècles une enclave particulière, cernée de quartiers populaires, voire mal famés. Il ne compta au début que treize tombes et puis sa population grandit lentement, sans querelles de voisinage, pour atteindre à peine huit cent trente âmes en 1817.
Une petite opération de marketing s’imposait…
Il fut alors décidé, afin de donner envie aux Parisiens qui allaient passer l’arme à gauche d’être en noble compagnie, d’y transférer les restes d’Héloïse et d’Abélard, puis de Molière et de La Fontaine. Opération réussie, car elle entraîna un véritable boom du logement et, treize ans plus tard, en 1830, le Père-Lachaise comptait plus de treize mille tombes.
Cinq agrandissements et vingt ans plus tard, leur nombre était de soixante-dix mille… Le cimetière était peuplé d’oiseaux, de chats, de plus de cinq mille arbres et visité par plus de deux millions de personnes. Mais le gardien de nuit Roger Sébillot se fichait pas mal de l’histoire du Père-Lachaise.
Sa mission à lui n’était pas de faire le guide touristique pour ceux qui cherchaient désormais à voir la tombe de Chopin, de Molière, de Delacroix ou de La Fontaine. Elle était plutôt de veiller sur les cinglés qui, trop souvent, tentaient de se laisser enfermer dans le cimetière ou d’en escalader les murs, pour aller évoquer les fantômes de Jim Morrison, chanteur des Doors, ou d’Oscar Wilde, tapette gothique aux yeux d’Yves Sébillot, qui passait allègrement à côté de l’immense talent poétique de l’auteur. Selon lui, il n’attirait que les corbeaux habillés en noir arborant crucifix et teints de vampires. Les pires étaient les illuminés exaltés qui s’imaginaient qu’en allant nuitamment pratiquer leurs rituels sur la tombe d’Allan Kardec, fondateur du spiritisme, ils allaient invoquer son esprit et, du même coup ceux de leurs proches ou de n’importe quel macchabée susceptible de leur apporter une vision de la vie après la mort.
À côté de ces cinglés, les fans d’Édith Piaf ou de Marie Trintignant étaient pour lui des gens sympathiques, bien qu’un peu pathétiques, car ils pratiquaient rarement l’escalade nocturne, l’enfermement volontaire après fermeture des portes et jamais, à sa connaissance, messes noires et autres conneries du même genre.
Il ne fallait pas oublier les tarés des groupuscules néonazis, qui rêvaient secrètement de profaner les monuments à la mémoire des déportés juifs.
Bref, vous l’aurez compris, Roger Sébillot n’aimait pas trop son job.
Et surtout les nuits de pleine lune, comme celle-ci…
Il n’était pas le seul à patrouiller dans le cimetière. Encore heureux, et tout bonnement impossible. Trop grand, trop d’allées, trop d’arbres, de mausolées. Trop d’endroits où se planquer. L’équipe de surveillance était donc assez importante.
Et, comme chacun de ses collègues, il avait son secteur. Pas toujours le même, ils avaient mis en place des roulements et le chef d’équipe distribuait les zones chaque soir, mais comme Roger n’était pas loin de la retraite et qu’il avait quelques problèmes d’arthrite, il héritait souvent de la partie la moins étendue, la plus calme, la moins exposée à la faune nocturne qui tentait sa chance.
Pas toutes les nuits, mais presque.
De la faune, de la vraie, il y en avait aussi dans le cimetière.
Des chats, depuis le début, des lézards, des fouines, des hérissons, des écureuils, des papillons, toutes sortes de coléoptères. Il y avait même une colonie d’abeilles qui avait ruché dans la tête de bronze de la statue de Casimir Périer.
Cette faune-là, Roger la trouvait plutôt sympa.
Mais il y en avait une autre, qu’il aimait beaucoup moins : les chauves-souris, les chouettes hulottes, les éperviers. Et les corneilles noires, qui ressemblaient un peu trop à des corbeaux, et qui avaient la fâcheuse habitude de se percher sur les croix, le jour, et d’y rester, la nuit, pour y dormir, le bec enfoui sous leur aile. Ou, lorsque la lune était pleine, l’observaient pendant qu’il faisait sa ronde. Elles le dévisageaient, sans la moindre vergogne, sans la moindre crainte, lorsqu’il passait devant elles.
Il faisait des moulinets avec les bras pour les faire s’envoler – ce qui les laissait de marbre – ayant conscience d’être un peu ridicule, limite trouillard, mais peu nombreux seraient ceux qui aimeraient patrouiller la nuit dans un cimetière en croisant de grands oiseaux noirs, perchés sur des croix centenaires, vous fixant de leurs yeux d’encre dans lesquels dansent des rayons de lune…
Chapitre 2
Cimetière du Père-Lachaise, Paris, 3 heures du matin
Les bruits de la ville s’étaient peu à peu estompés.
Il ne demeurait que le cri aigu des ambulances et des bagnoles de flic, qui récupéraient les éclopés des batailles à la sortie trop arrosée des bars branchés de la rue Oberkampf, ou embarquaient, pour la énième fois, les vendeurs de came approvisionnant, avec une discrétion souvent approximative, ceux qui fréquentaient ces mêmes bars.
Mélange de rockers à la petite semaine, de bourgeoises cougars, chasseuses solitaires venues chercher de la chair fraîche, et de simples pochetrons qui avaient toujours été là, bien avant que le quartier ne soit tendance, et qui faisaient partie du décor, lui donnant une touche de couleur locale.
Cette nuit-là, Roger patrouillait dans son lieu préféré. Il avait échappé au secteur est, au chemin de Lesseps, là où se trouvait la tombe de ce chanteur dont il n’avait jamais écouté la moindre chanson : Jim Morrison, mais dont il avait entendu dire en revanche que c’était un camé de première. Et que c’était ça qui l’avait tué.
Bref, il atteignait le secteur le plus paisible. Vers le centre du Père-Lachaise, non loin de l’enclos où se trouvaient les tombes de Molière et de La Fontaine. Peu de chance d’y découvrir de futurs pensionnaires de la Comédie française, ou des mômes qui rêvaient d’y rentrer, en train de déclamer des vers à la con après avoir franchi les grilles d’enceinte qui délimitaient les deux sépultures, réunies côte à côte. Pas les groupies de Morrison, en résumé…
Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage… C’était à peu près tout ce qui lui restait de La Fontaine, qu’il avait appris à l’école, comme tout le monde. Quant à Molière, il lui évoquait des pièces qu’il avait vues, plus jeune, à la télé, dans lesquelles des mecs couraient partout, habillés comme des gonzesses, avec des perruques et des manches en dentelles, avec tout de même quelques soubrettes aux décolletés pigeonnants qui avaient l’air bien délurées, ce qui l’intéressait – presque seulement – à l’époque.
Le théâtre : un truc de pédés ou d’intellos.
Et pour Roger, c’était blanc bonnet et bonnet blanc…
Pourtant, même s’il n’avait jamais constaté la moindre visite nocturne interdite sur ces deux tombes, il y avait beau dire, il ne les aimait pas. Elles ressemblaient trop à des trucs anciens plutôt qu’à des tombes.
Il passait toujours en premier devant celle de La Fontaine. Un monument rectangulaire, assez haut, sorte de présentoir de pierre, au sommet duquel se tenait le caveau proprement dit dans lequel reposait le corps du poète, son nom gravé sur les côtés, un peu noirci. Un monument funéraire en forme de X, couronné d’une sorte de toit, en pierre triangulaire.
Celui-là, ça allait encore…
Mais la tombe de Molière, il ne l’aimait vraiment pas et il était infoutu de dire précisément pourquoi. Elle n’était pas beaucoup plus haute ni plus grande que celle de l’autre, là, « Maître Renard, etc. », mais elle avait quelque chose qui lui déplaisait profondément.
Un côté étrange.
Quatre piliers de pierre massifs, carrés, légèrement plus fins en haut qu’en bas, qui supportaient la tombe proprement dite, de forme rectangulaire. Comme celle de son collègue qui faisait des vers, lui aussi.
Enfin, pensait Roger, ils avaient arrêté d’en faire depuis un sacré bout de temps et les vers, les autres, les vrais, ceux qui les avaient bouffés, n’avaient plus rien à se mettre sous la dent depuis des siècles.
Sa forme d’humour était loin d’être fine, mais ça l’aidait souvent à faire son boulot et à passer le plus tranquillement possible devant tous ces vieux monuments sinistres, ces grilles pointues, ces arbustes qui prenaient la nuit des aspects différents de ceux qu’ils avaient le jour et toutes ces croix, souvent rouillées quand elles étaient en ferraille, recouvertes de moisissures lorsqu’elles étaient de pierre.
Et, en quelque matériau qu’elles soient, trop souvent surplombées par ces foutues corneilles, qui le fixaient avec insolence et dont il ne savait jamais vraiment, la nuit, si elles faisaient partie de la déco ou s’il s’agissait de vraies bestioles, qui allaient lui décoller sous le nez, dans un battement de leurs grandes ailes et venir lui frôler le visage avant de ficher le camp.
Il y avait une chose, plus que tout le reste, qu’il n’aimait pas dans la tombe de Molière.
C’était qu’on ne voyait pas ce qui pouvait se tenir dessus ni ce qui pourrait, éventuellement, se dissimuler dessous, entre les quatre piliers massifs qui soutenaient la grande tombe.
Oh, bien sûr, tout ça était proprement entretenu, bordé de graviers qui séparaient l’espace entre « Maître Corbeau » et L’Avare, ce film nul avec de Funès (vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que Molière lui fasse penser à Louis Jouvet ou à Michel Bouquet…). Il y avait aussi de petits buissons de buis, bien taillés, et des grilles, à hauteur d’homme, surmontées de pointes forgées et tarabiscotées, comme entourées par de petites lianes de lierre, ou un truc du genre. Et jamais de corneilles.
Bref, ce n’était pas la tombe du comte Dracula et de Frankenstein réunis. Mais, il n’empêche, elles lui foutaient la trouille. Comme si celle de La Fontaine avait l’air bien peinarde et aidait celle de Molière à cacher son jeu…
Si tu continues comme ça, avec ce genre de pensées à la con, se disait Roger en approchant de l’enclos, il va être temps de raccrocher les gants et de songer à un gardiennage de nuit plus pépère, mon gars.
Mais, après vingt ans passés au Père-Lachaise et à moins de cinq ans de la retraite, il se voyait mal aller donner des tours de clé dans les mouchards de locaux industriels ou rester le cul assis dans une baraque de chantier pour empêcher des manouches de venir faire le plein en tuyaux de cuivre et autres objets qui se fourguaient maintenant aussi bien que de la came de contrebande.
En plus, avec les manouches, ça ne rigolait pas. C’était un coup à se prendre une balle et à ne jamais atteindre la retraite ; oubliés le Quinté et les discussions au comptoir avec les potes. Même s’il n’en avait pas beaucoup…
Non, en fin de compte, les macchabées, il allait se les coltiner jusqu’au bout, enfin tant qu’il pourrait. Avec un peu de chance, si son dos continuait à lui jouer des tours, il arriverait peut-être même à passer les deux dernières années en invalidité, à taux plein.
Ces pensées légères, bien que peu motivantes sur le plan de la santé, lui redonnèrent le sourire.
Mais il pressa quand même le pas, histoire de ne pas trop traîner devant l’enclos des deux « perruqués ».
Chapitre 3
Cimetière du Père-Lachaise, Paris, 03 h 05
La lune illuminait la pierre blanche de cette lumière si particulière qu’elle donnait à toutes choses. À la fois claire et blafarde. Le genre de lumière qui vous fait croire qu’on distingue tout, alors qu’en fait elle ne vous montre que ce qu’elle veut bien vous laisser voir.
Et vous laisse juste deviner le reste.
Roger Sébillot passait devant la tombe de Maître Renard quand il entendit le bruit.
Ce n’était pas très sonore, seulement une sorte de grattement : comme un animal qui ferait ses griffes sur un objet dur. Un chat, sûrement…
Quoi d’autre ?
Pas un rat, il n’y en avait presque pas dans le cimetière, à cause des chats, des chouettes qui en faisaient leur plat préféré. Les rats avaient certainement pigé qu’il ne faisait pas bon venir poser sa tente au Père-Lachaise. Il valait mieux se planquer dans les caves, les égouts, ou se balader tranquillement dans les rues vides, en longeant les caniveaux, lorsque tout le monde roupillait, sur le coup de trois heures du matin.
Ou même, désormais, en plein jour : vive Paris…
Le bruit reprit.
Roger s’arrêta et sortit sa Maglite de son étui.
Ce qui ne lui arrivait pas souvent. D’une part parce que le cimetière était loin d’être plongé dans l’obscurité, même les soirs où la pleine lune ne brillait pas, et d’autre part parce que lorsqu’il lui arrivait de tomber sur des visiteurs nocturnes indésirables, en général, ils se barraient en courant dès qu’ils l’entendaient arriver.
Le plus souvent, il les apercevait suffisamment à l’avance pour sortir son walkie-talkie et prévenir ses collègues qu’il y avait de la cueillette à faire. C’était ainsi qu’ils appelaient le ramassage des cinglés qui hantaient le cimetière, la nuit.
La cueillette.
Il ne savait pas d’où ce terme venait, mais lui qui ne craignait pas grand-chose se sentit étrangement inquiet. Et il n’aimait pas ça. L’inquiétude, c’est mauvais pour la santé…
Un chat, sûrement. Oui, mais alors un balèze.
Parce que si c’était un greffier qui faisait ses griffes sur la pierre, soit il avait besoin de les raccourcir un max, soit il avait de sacrées pattes…
Roger sentit un filet de sueur couler le long de son dos. On était en mai, il ne faisait pas si chaud que ça. En plus, elle avait une odeur déplaisante, cette sueur, un peu aigre.
Tu serais pas en train d’avoir les jetons, comme un abruti de débutant, des fois, hein, mon Roger ? Ça faitun bail que tu fais ce job, tu t’es bien fait une petite flippette de temps en temps, surtout au début, mais maintenant t’es chez toi ici, tu les connais tous, ces macchabées. Y en a aucun qui est sorti de sa putain de tombe pour te courir après…
Alors, tu peux me dire ce qui te prend ?
Avec son petit monologue, Roger se bottait les fesses à sa façon. S’il commençait à tomber dans ce genre de piège – entendre des trucs qui n’existaient pas, trouver autre chose qu’une explication simple – il ne tarderait pas, c’était garanti sur facture, à voir des choses qui n’existaient pas. Comme de donner aux ombres qui s’étendaient entre les tombes des formes qui n’étaient celles de simples ombres, ou confondre le bruit du vent dans les arbres avec des voix, des murmures.
C’était arrivé à un de ses collègues, quelques années plus tôt. Un type droit dans ses bottes, peur de rien, la tête sur les épaules.
Et puis, d’un coup, sans prévenir, il avait pété un câble. Enfin, non, pire encore. Ils les avaient pétés presque tous, en même temps, en l’espace de deux semaines à peine. Il voyait des machins qui le guettaient, derrière les tombes. Les croix de fer forgé tendaient leurs extrémités vers lui, elles passaient par-dessus les grilles des enclos pour lui déchirer le visage. Et les statues – ce n’était pas ça qui manquait, les statues, au Père-Lachaise – descendaient de leur piédestal et marchaient doucement vers lui, leurs bras et leurs doigts de marbre, ou de toute autre caillasse à la noix, tendus pour le saisir à la gorge.
Pour le tuer.
Un matin, juste avant le changement d’équipe, le collègue ne s’était pas présenté au PC. Là où ils se retrouvaient, après le dernier quart, quand la cueillette était terminée et que les flics étaient venus embarquer, gentiment en général, ceux qu’ils avaient ramassés. Les barjots du Père-Lachaise étaient rarement violents, même si, de temps en temps, ils étaient tellement dans leur délire qu’il fallait se mettre à plusieurs pour les choper.
Les rondes de nuit terminées, Roger et les autres prenaient leur café tous ensemble, avant de rentrer chez eux. C’était une sorte de rituel. Mais, ce jour-là, le collègue en question n’était pas là. Alors, après avoir vainement essayé de l’appeler sur le canal de son walkie, ils étaient tous sortis dans le petit matin blême pour le chercher. Ils avaient exploré méticuleusement le cimetière, l’appelant à tour de rôle. Ils y avaient passé plus d’une heure.
Et puis, ils avaient fini par le trouver, recroquevillé, près de la tombe d’Édith Piaf, les genoux serrés contre la poitrine, les bras ceinturant ses jambes, dodelinant de la tête, balançant le buste, le teint livide, les joues couvertes de larmes et de morve.
Le plus flippant n’était pas de voir ce costaud qu’ils connaissaient tous, qui avait toujours à la bouche une bonne blague qui les faisait marrer, transformé en fillette pleurnicharde. Non, le plus flippant, vraiment, c’était la petite comptine qu’il fredonnait, de sa voix grave de catcheur, un boulot qu’il avait fait avant de se péter une épaule et de se retrouver à faire du gardiennage. Une vraie comptine de môme.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot…
C’était tout ce qu’il savait dire, en boucle, et il avait continué de chantonner lorsqu’il leur avait fallu se mettre à trois pour le relever, tandis qu’il les regardait, les yeux vides, sans avoir l’air de savoir qui ils étaient.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot…
Il s’appelait Pierre ; Roger s’en souvenait comme si c’était hier.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot…
Sur le coup, le rapport entre la comptine et le prénom de son collègue ne l’avait pas frappé.
Mais maintenant qu’il se tenait devant la tombe de Molière, après avoir allumé sa lampe torche, l’air revint dans sa tête ; il se souvint des yeux hagards de Pierre, que l’équipe ne revit jamais plus.
Aucun d’eux n’avait d’abord pris le temps d’aller le voir, au fond de la clinique psychiatrique où il avait échoué, passant le plus clair de son temps à fredonner toujours cette même comptine. Malgré tout, environ trois mois après, l’un d’entre eux avait fait l’effort de lui rendre visite. Personne n’a envie de passer du temps chez les dingues. Il paraît que ça ne s’attrape pas, mais c’est le genre d’endroit qui donne quand même une assez bonne idée de la faible pellicule de glace sur laquelle nous dansons la majeure partie de notre vie, tous autant que nous sommes. Avec, par moments, une assez bonne vue sur la fragilité de sa résistance et sur les fonds sombres, boueux, emplis de présences avides et mystérieuses, qui se dissimulent en chacun de nous. Le concept était un peu compliqué pour Roger, mais le ressenti, non.
Le lendemain, en commençant son service, le collègue qui avait pris sur lui d’aller faire un tour au royaume aseptisé de la folie presque ordinaire était arrivé, blanc comme un linge et bien secoué.
— Pierre est mort, avait-il lâché.
— De quoi ? avait demandé un peu bêtement Roger, dont la finesse n’était pas non plus une vertu cardinale.
— Il s’est tué, qu’ils m’ont dit. J’ai parlé à un infirmier qui avait l’air un peu plus bavard que les autres, tout le monde avait l’air sous le coup de ce qui s’était passé là-dedans, ils avaient jamais vu ça…
— Bon, ben, accouche ! avait relancé Roger, sans pitié. Comment qu’il a pu se tuer dans un asile alors qu’il devait être shooté aux médocs ?
Le collègue avait alors regardé Roger droit dans les yeux, comme s’il s’apprêtait à lui en coller une. Celui-ci avait même failli esquisser un petit pas en arrière, juste au cas où…
— T’es un curieux, toi, hein ? avait répondu l’autre en retroussant un peu la lèvre supérieure. Je vais te le dire de quoi il est mort. Il s’est arraché la carotide. Avec ses propres doigts, dans sa chambre et, apparemment, vu le sang qui tapissait les murs, d’après ce que l’infirmier m’a dit, il s’y est pas trop mal pris, même si ça a pas dû se faire tout seul. Et le gars qui partageait sa piaule n’a pas prononcé un mot depuis…
Roger frissonna. Il avait été un peu trop curieux effectivement, son collègue n’avait pas tort…
Et se remémorer cet épisode maintenant n’était pas une très bonne idée non plus…
Dans le cimetière, la lune brillait toujours, claire et blafarde.
Le faisceau de sa lampe balaya d’abord la partie de la tombe que Roger aimait le moins… L’espace vide, au pied du monument, entre les quatre piliers de pierre.
Rien.
La sueur aigre courait toujours le long de son dos comme une petite rigole glacée, mais il se sentit soulagé.
Et puis le grattement revint, plus fort, plus net.
Encore plus fort. Et accompagné d’une sorte de râle, rauque, comme de l’air aspiré par une brèche entre des pierres moussues, à l’entrée d’une caverne.
Aucun chat, même version XL, ne pouvait faire ce genre de bruit.
Roger releva doucement la Maglite, remontant son faisceau sur les colonnes de pierre, vers la tombe elle-même, vers le sommet.
Cette foutue lune. Elle vous montrait juste ce qu’elle voulait. Mais elle vous cachait le reste…
Roger connaissait cette fichue tombe par cœur, mais quelque chose était bizarre ce soir-là. Le sommet était plus haut que d’habitude. Normalement, il était plat. Pas comme celui de la tombe de La Fontaine, qui ressemblait à un chapiteau. Non, juste plat et entouré sur ses quatre coins de petites excroissances sculptées dans la pierre. Mais, ce soir-là, quelque chose ne collait pas.
La lumière vive de la torche de Roger Sébillot dépassa les coins ouvragés de la tombe. Au-dessus, elle aurait dû normalement éclairer les arbres qui bordaient l’enclos.
Mais ce n’est pas ce qu’elle éclaira.
Et ce qui se tenait dans le faisceau de la lampe n’avait rien d’un chat, d’une chouette, d’une corneille ou de quoi que ce soit de connu…
Même pas d’un de ces dingues qui se laissaient enfermer la nuit dans le cimetière.
Malheureusement…
Chapitre 4
Il vit d’abord une masse rougeâtre et grisâtre à la fois. Avec un os, qui dépassait…
Une partie de son cerveau refusa de voir le reste, mais la lune et la Maglite lui donnèrent un coup de main involontaire. La masse rouge et grise ne faisait pas partie de cette chose qui se tenait au sommet de la tombe de Molière, elle était juste tenue par elle.
Et elle ressemblait sacrément à un fémur humain…
Il y avait de petits trucs blancs et gras qui couraient sur toute la surface. Roger comprit alors ce que c’était et aussi le sens de ce qu’il avait pris pour un grattement. Ce n’était pas un grattement. C’était le bruit de dents acérées, pointues et jaunâtres, qu’il voyait très clairement, un peu trop même, qui étaient en train de bouffer ce que cette créature tenait entre ses doigts griffus aux ongles noirs, longs et ébréchés.
Un fémur humain, oui, c’était bien ça.
Mais en pleine décomposition.
Roger Sébillot ne se mit pas à chanter Au clair de la lune, mon ami Pierrot…
Il sentit juste un filet d’urine couler le long de sa jambe gauche, en écho à la rigole de sueur aigre et glacée qui inondait son dos, sous son uniforme de gardien du cimetière. Sa lampe torche tomba à terre et il baissa les yeux, seulement un instant, pour la voir rouler sur les pavés, et éclairer le massif de buis, derrière les grilles.
Il porta doucement la main vers sa ceinture, vers l’étui dans lequel reposait son talkie-walkie.
Mais il savait que ça ne servirait à rien, qu’il n’aurait pas le temps de finir son geste, encore moins de prévenir les autres, et aucune chance que ça attende qu’ils rappliquent…
Au moment où il relevait les yeux, la goule fit un bond gracieux et aérien, presque élégant, malgré son aspect répugnant, ses hardes pleines de terre, sa face couverte du sang et de la pourriture de son festin. Elle décolla sans effort du sommet de la tombe de Molière, franchit la distance qui la séparait de la grille pointue…
Maître Renard, par l’odeur alléchée, comme tu as de grandes dents…, pensa Roger qui n’avait jamais été très bon ni en poésie ni en contes et qui, pour tout dire, n’avait jamais été très bon en rien. Il eut tout de même le temps de se dire que, comme dernière réflexion, il aurait pu trouver quelque chose d’un peu moins con.
… Et la goule retomba sur lui, l’écrasant de tout son poids, bien plus lourd que son saut agile ne le laissait supposer, le submergeant de son odeur fétide de mort et de putréfaction.
Roger Sébillot ne connaissait rien aux légendes ni, a fortiori, aux goules. Il ignorait que cette créature était issue des mythologies mésopotamiennes et arabes. Il n’avait pas la moindre idée de son évocation dans les Mille et Une Nuits, créatures diaboliques, filles du puissant démon Iblis. Elles étaient les croque-mitaines maghrébins, en quelque sorte, version femelle, qui avaient terrorisé des générations d’enfants en Afrique du Nord.
Aujourd’hui, les Portes entre les Mondes s’ouvraient, et peu importaient les noms ou les origines mythiques de leurs provenances. Dans l’Autre Monde, ces créatures terrifiantes existaient toutes et elles se fichaient pas mal des appellations que nous leur avions données et des lieux où elles étaient censées apparaître.
La lune n’était pas regardante, et Diane Da’Naãn non plus…
Lorsque la goule déchiqueta la gorge de Roger Sébillot, lui arrachant tout ce qu’il y avait dedans avant de s’attaquer au reste, il eut une dernière pensée pour Pierre, le collègue chanteur de comptines, qu’il avait pris pour une femmelette.
Devant la mort, nous en sommes tous.
Au moins, Pierre avait choisi sa fin…
Et la dernière chose qu’il comprit avant de mourir, dans une explosion de souffrance insoutenable et de panique absolue, fut que, visiblement, ce truc-là ne bouffait pas que des macchabées…
Chapitre 5
Second Mesa, territoire des Indiens hopis, Nouveau-Mexique, 20 mai, 12 h 30
Les « katchina »sont les âmes des premiers enfants indigènes, dramatiquement noyés dans une rivière à l’époque des migrations ancestrales. […] le mythe rapporte que, quand les ancêtres des Indiens actuels se furent enfin fixés dans leur village, les katchinas venaient chaque année leur rendre visite et qu’en partant, elles emportaient les enfants. Les indigènes, désespérés de perdre leur progéniture, obtinrent des katchinas qu’elles restassent dans l’au-delà, en échange de la promesse de les représenter chaque année au moyen de masques et de danses. Claude Lévi-Strauss
Ils étaient dix, tous âgés d’une soixantaine d’années.
Ils venaient des quatre coins des États-Unis, mais se connaissaient tous. Des enseignants en retraite qui avaient, comme beaucoup d’Américains depuis de nombreuses années, décidé de vendre ce qu’ils avaient, ou de le mettre en location, et d’investir dans de splendides camping-cars, parfaitement aménagés.
Et, depuis, ils sillonnaient le pays, réalisant leur Hippie Dream ; celui qu’ils avaient caressé pendant leur jeunesse, qui avait dormi au fond d’eux durant toute une vie de travail, de partage avec leurs étudiants.
Beaucoup avaient abandonné leur rêve, celui du Summer of Love, mais pas eux. Ils l’avaient juste mis en attente : pour plus tard… Ils étaient quatre couples et deux solitaires. Arrivé à la soixantaine, on laisse parfois l’autre au bord du chemin. Soit parce que nos routes se séparent, soit parce que la vie nous le prend.
C’était le cas de Jenny, qui avait perdu son mari à l’orée de la cinquantaine et qui ne l’avait jamais vraiment remplacé, malgré de rares amants de passage.
Et aussi de William, que sa femme avait plaqué pour un autre et qui ne s’en était toujours pas remis. William avait tout vendu : la maison, les meubles, tout ce qu’il avait, et il s’était acheté un magnifique Winnebago Via, construit sur la base d’un châssis de Mercedes utilitaire.
Un bijou à plus de cent cinquante mille dollars. Le prix de sa maison et de tout ce qu’il y avait dedans ; avec l’argent qu’il avait mis de côté, il avait de quoi voir venir jusqu’à ce qu’il casse sa pipe : le plus tard possible…
Jenny avait des moyens plus modestes, mais l’assurance vie de son mari lui avait permis de s’offrir un Damon Daybreak d’occasion, qui coûtait cinq fois moins cher. Il était cependant en parfait état et taillait bien la route. Et, après tout, c’était tout ce qui comptait.
William se la racontait un peu avec son Winnebago ; les autres l’appelaient son Girls Catcher, un attrape-filles, aussi parce qu’il avait accroché au rétroviseur un de ces talismans des Indiens ojibwés fait d’un cercle de saule et dans lequel était tressé un filet, semblable à une toile d’araignée, duquel pendaient des cordes de cuir, ornées de plumes et d’anneaux de corne et de bois.
Dreamcatcher était le vrai nom de cet objet symbolique, attrapeur de mauvais rêves, selon les légendes amérindiennes. Un objet dont Stephen King avait fait l’un de ses romans les plus bâclés – certes, il y en avait peu –, et Hollywood un film qui l’était encore plus.
Mais force était de constater que William n’attrapait pas beaucoup de filles avec son Winnebago.
Pourtant, il était plutôt bien conservé : sportif, le teint toujours hâlé, le cheveu encore fourni ; pas très grand, mais une belle gueule et beaucoup de charisme. Les autres, sa bande, comme il les appelait, se foutaient un peu de lui à cause de ce manque de conquêtes, mais gentiment.
Pas la peine d’avoir une merveille pareille, qui t’a coûté aussi cher, si t’es même pas fichu d’attraper une squaw avec !
Il fallait croire que depuis que Matilda, sa superbe métisse latino-américaine – qu’il connaissait depuis le collège – l’avait largué pour un type qui avait vingt ans de moins qu’elle, le cœur n’y était plus vraiment.
Même si William était toujours largement capable de plaire – parfois, il emmenait une nana dans son attrape-filles –, ça n’allait jamais bien loin. Et ça ne durait pas bien longtemps non plus. Quand il se retrouvait au lit avec une fille, c’était Matilda qu’il revoyait. Ce qui n’aidait pas des masses, même en prenant une petite pilule bleue.
Alors, avoir à nouveau une relation suivie avec une femme n’était pas près d’arriver…
William et les autres avaient tous quitté Phoenix, Arizona, à l’aube. La température était idéale et l’air embaumait cette senteur de désert, de cactus, d’aventure ; cette odeur du sud-ouest des États-Unis, à nulle autre pareille. Ils s’étaient tous rejoints la veille dans la capitale de l’État et avaient dormi dans le même motel ; ce n’était pas le plus confortable, mais l’un des plus authentiques et anciens de l’Arizona.
Les quatre autres couples avaient déjà parcouru ensemble un bon tronçon de l’ancienne route 66, avant de retrouver Jenny et William, à Phoenix.
Il y avait John et Barbra, tous les deux aussi rondouillards que joviaux, qui avaient plaqué leurs enfants et leur baraque dans le Maine pour prendre la route, non sans susciter la désapprobation de toute leur descendance. Il faut dire que les mômes d’aujourd’hui étaient devenus plus chiants et, d’une certaine manière, finalement, plus vieux dans leur tête que leurs parents, moins insouciants. C’était l’époque qui voulait ça, sans doute…
Il y avait Alan et Kathleen, à l’apparence un peu coincée ; ils avaient longtemps habité Los Angeles, mais on les aurait davantage pris pour des mormons ou, pire, des bourgeois de Washington D.C. Cependant, dès qu’ils retrouvaient les autres et qu’ils avaient quelques margaritas dans le nez, le masque tombait rapidement et ils se lâchaient, drôles et bons vivants.
Il y avait aussi Mildred et Henry, les Anglais de la bande, qui avaient longtemps enseigné ; lui, les sciences humaines, elle, l’histoire des précivilisations, avant d’émigrer vers le Nouveau Monde où ils avaient brillamment occupé chacun une chaire à Harvard. Leurs matières n’étaient pas forcément ce que les étudiants inscrits venaient chercher dans cette prestigieuse université, mais le job payait très bien et leur avait permis d’amasser un beau pécule pour pouvoir vivre une retraite dorée.
Et, enfin, il y avait Joey et Charles, les dandys de la bande, mais capables d’enchaîner infatigablement les kilomètres à pied, équipés en North Face des pieds à la tête, sans jamais se plaindre, laissant souvent le restant du groupe à la ramasse. Ils avaient été mariés, tous les deux, avec des femmes. Et puis, à l’orée de la quarantaine, alors qu’ils enseignaient l’histoire de l’art – pour Joey – et la littérature – pour Charles –, ils avaient fait un coming out simultané et mutuel qui les avait jetés dans les bras l’un de l’autre. Un véritable coup de foudre, sincère, passionné, pas juste une expérience pour goûter à d’autres plaisirs.
Ils avaient divorcé de leurs épouses, vivaient ensemble depuis vingt-trois ans sans un nuage (à part dans leur thé) et avaient cette liberté alliée à cette classe qu’ont souvent les gays qui ont assumé leur sexualité, mais aussi leur amour. Sans oublier un sens de l’humour qui aurait presque paru inhérent au folklore homo, s’il n’avait pas été inné chez ces deux-là. À côté des deux compères, Woody Allen avait l’air chiant.
Le reste de la bande les appelait les Brokeback Gentlemen, en référence au film qui avait défrayé la chronique, mais aussi parce qu’ils avaient fait l’amour pour la première fois sous une tente, lors d’une randonnée en plein Colorado…
William ouvrait souvent la route, au volant de son Winnebago. Il aimait ça, c’était son côté « chef de bande ». Les autres s’en amusaient et le laissaient faire.
Le superbe équipement hi-fi qui ornait le tableau de bord, et les enceintes Bose réparties un peu partout dans l’habitacle balançaient Neil Young à fond la caisse lorsqu’ils arrivèrent en vue de Second Mesa.
Old man take a look at my life, I’m a lot like you were1…
Old Man, titre extrait de l’album Harvest de Neil, était sans doute l’une des chansons préférées de William. Pas juste pour la mélodie, simple, mais « addictive », qui n’avait pas pris une ride en quarante ans. William aimait aussi cette chanson parce que, lorsqu’il avait vingt ans, en 1971, elle lui faisait penser à son père ; sauf que maintenant le vieil homme, c’était lui. Alors elle lui rappelait désormais son fils.
Le seul enfant qu’ils aient eu ensemble, avant que Matilda ne se tire…
Il aimait tellement Neil, ses chansons, son talent de vous dévoiler vos petites fêlures de l’âme, du cœur, entre deux solos de guitare à tomber sur le cul…
I need someone to love me, the whole day through. Ah, one look in my eyes and you can tell that’s true2…
Presque à chaque fois qu’il entendait ces mots, ça lui serrait le cœur.
Quand l’émotion était trop forte, il changeait de CD dans le chargeur et s’envoyait Like a hurricane et ses fantastiques riffs, histoire de chasser les idées noires…
Le dreamcatcher accroché au rétroviseur n’attrapait pas tous les mauvais rêves, mais la musique en renvoyait quelques-uns dans les limbes du souvenir. Et ce n’était déjà pas si mal.
William chassa ces quelques pensées maussades et se concentra sur la route.
Le soleil de mai brillait. Il était à peine midi. Il allait faire un temps formidable.
Et tous ses potes le suivaient, libres, dans leur camping-car.
L’heure n’était pas à la nostalgie ou à la tristesse, mais au plaisir de savourer tous les petits moments de bonheur : la seule façon de vivre pleinement sa vie, lorsqu’on sait qu’on a bien plus de kilomètres au compteur que ceux qu’il vous reste à parcourir…
Au bout de la route, bien droite, comme dans les films, se profilait la silhouette impressionnante et irréelle des Corn Rocks : les deux rochers géants et jumeaux, accolés l’un à l’autre à Second Mesa, l’enclave de la réserve des Indiens hopis, dans le territoire navajo. Ils ressemblaient à deux jambes massives, aux pieds invisibles plantés dans le sol, coupés en dessous des genoux.
Deux géants de pierre, dont la croyance hopi voulait que, s’ils venaient à s’effondrer, le monde des hommes chute en même temps qu’eux.
Une terre sacrée, un lieu de sépulture. Un lieu magique empli de forces anciennes, primitives. Des forces qui nous dépassaient…
Et, surtout, un endroit formidable pour faire une belle randonnée, se dit William qui ne voulait pas laisser les idées sombres reprendre le dessus.
Le Winnebago passa sur un nid-de-poule que William n’avait pas vu sur la route.
Le grand véhicule fit une petite embardée ; rien de bien méchant, mais, derrière, ça klaxonna joyeusement. Le reste de la bande se fichait de lui ; loin de le froisser, cette complicité le mit en joie. Le petit attrape-rêve accroché au rétro continua à se balancer frénétiquement bien que le camping-car ait repris paisiblement sa trajectoire. Il devait avoir attrapé dans son filet un sacré mauvais rêve. Il continuait de bouger, comme si la route était complètement défoncée, ce qui n’était pas le cas. Bizarre…
William n’y prêta pas davantage attention ; il avait reporté son regard sur les deux grandes roches jumelles. Solo de guitare de Neil Young. William gratta des cordes imaginaires de la main droite, tandis que la gauche tenait le volant.
Même l’attrape-rêve gigotait au rythme de la musique ; il dansait toujours la gigue au bout de sa lanière de cuir. William en sourit, mais il n’était pas totalement serein. On ne laisse pas toujours nos intuitions se frayer un chemin ; souvent, on a tort.
Allez, au diable les pensées à la noix ! Profite, old man ; la vie est belle… Ça va être une putain de belle journée pour nous tous !
Oui. Bien sûr. Mais, ce serait aussi leur dernière…
Car, douze heures plus tard, ils seraient tous morts.
1. Vieil homme, jette un œil à ma vie, elle ressemble beaucoup à la tienne.
2. J’ai besoin que quelqu’un m’aime, tout le temps. Regarde-moi dans les yeux et tu verras que c’est vrai.
Chapitre 6
Second Mesa, territoire des Indiens hopis, Nouveau-Mexique, 20 mai, 23 h 30
En randonneurs expérimentés, bien équipés et en très bonne forme pour des soixantenaires, ils avaient marché tout l’après-midi avant d’établir le campement.
La journée avait été douce, comme souvent dans cette partie du Nouveau-Mexique au printemps. Les neiges d’hiver avaient laissé la place à la végétation naissante ; l’air était un peu frais, mais le soleil les avait accompagnés durant toute la marche.
Ils avaient garé leurs camping-cars sur le parking de la réserve, à l’entrée du chemin de randonnée. La Navajo Tribal Police et les Hopi Rangers patrouillaient régulièrement dans cet endroit. Il n’y avait rien à craindre. Ils étaient sans charge excessive : tentes dernier modèle, sacs de couchage poids plume, chauds et confortables et de quoi manger, faire réchauffer la nourriture et boire.
Le camping sauvage n’était pas vraiment autorisé dans la réserve, mais ils en avaient déjà fait ailleurs et ils n’étaient pas les seuls. Les États-Unis restaient plutôt tolérants à cet égard, du moins dans certains États, et tout particulièrement ceux du sud-ouest. Et puis, la probabilité qu’une patrouille de rangers vienne jusqu’à leur campement était vraiment très mince… Ils avaient gardé ce petit côté contestataire, hérité de leur jeunesse. Certes, ce n’était pas une grande transgression que de dormir quasi à la belle étoile, ou d’allumer un feu de camp, mais ça conservait un côté jouissif et excitant qui leur plaisait.
Et puis, on ne les mettrait pas en prison pour si peu ; au pire, ils devraient replier les tentes et repartir avec les rangers jusqu’au parking. À condition qu’ils arrivent à les trouver dans le petit arroyo où William, qui avait minutieusement préparé la balade, avait prévu de les faire bivouaquer.
Juste au pied des deux rochers géants, qui les dominaient maintenant de toute leur taille. Les Corn Rocks.