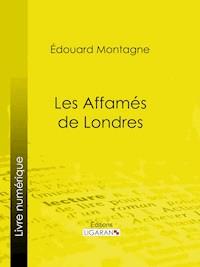
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Vers 1811, Mac Allan, qui se trouvait alors dans les environs de la vingtième année, absolument libre et seul au monde par la mort déjà ancienne de tous ses parents, riche d'ailleurs d'une de ces fortunes qui ne sont que l'aisance de l'autre côté du détroit, mais qui seraient chez nous l'opulence dans ses limites les plus étendues, ayant résolu, ses études terminées, de parcourir l'Europe, partit pour la France et se rendit d'abord à Paris."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MONSIEUR EDMOND DUVAL
DIRECTEUR DU MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS
Je dédie ce volume comme un témoignage de haute estime et de bonne amitié.
ÉDOUARD MONTAGNE.
Vers 1811, Mac Allan, qui se trouvait alors dans les environs de la vingtième année, absolument libre et seul au monde par la mort déjà ancienne de tous ses parents, riche d’ailleurs d’une de ces fortunes qui ne sont que l’aisance de l’autre côté du détroit, mais qui seraient chez nous l’opulence dans ses limites les plus étendues, ayant résolu, ses études terminées, de parcourir l’Europe, partit pour la France et se rendit d’abord à Paris.
À peine arrivé dans cette ville, autant pour accomplir une commission dont on l’avait chargé que pour se mettre en relations avec un de ses honorables compatriotes, vieil ami de son père, sir Edward, tel était son prénom, se fit conduire au faubourg Saint-Honoré, dans la demeure qu’y occupait un ancien homme d’État anglais, lord Patrice Wellinster.
Ayant sollicité la faveur d’un entretien, il fut de prime abord introduit dans un petit salon où le valet, qui lui servait de guide, le pria d’attendre quelques minutes.
L’insulaire, chez lequel il se trouvait, en sa qualité de vieillard archimillionnaire, de plus méthodique et réglé, s’était étendu dans un fauteuil, après l’absorption d’une copieuse tasse de thé, recommandant à ses gens qu’on le laissât dormir une heure.
Or son sommeil ne durait que depuis quarante-cinq minutes, et personne dans l’hôtel n’aurait osé se risquer à réveiller une seigneurie si bien endormie avant l’expiration du délai qu’elle avait elle-même fixé pour sa sieste.
Pour n’avoir point la fatigue, ni l’ennui de revenir, le jeune visiteur déclara en souriant qu’il préférait attendre et, dès qu’il fut seul, il se remit à feuilleter un recueil qu’il trouva sur un guéridon, espérant ainsi tromper le temps.
Il tourna et retourna pendant quelques instants l’objet élégant dans ses mains : c’était une simple réunion d’études, car à côté de dessins supérieurement crayonnés, on en trouvait la reproduction naïve et souvent incorrecte. Il était évident qu’un maître avait d’abord tracé son modèle en marge, puis qu’un élève avait essayé aussi habilement que possible de le copier.
L’Irlandais, – sir Edward Mac Allan était Irlandais, – malgré la simplicité du sujet, mais en sa qualité d’artiste amateur, s’intéressa suffisamment à ce travail pour prolonger son examen. À quelques traits maniérés, à une certaine afféterie des contours et au soigné des ombres, il reconnut même que le professeur, ici, devait être une femme :
– Ce n’est pas la main d’un homme qui a dessiné cela, se disait-il.
Comme il achevait ces mots, se les adressant tout bas à lui-même, une porte s’ouvrit en face et donna passage à une grande jeune fille d’une admirable beauté :
– Pardon ! monsieur, dit-elle en excellent français, et non sans rougir un peu, j’ignorais qu’il y eût quelqu’un dans ce salon.
– C’est moi, miss, répondit en anglais, tout en fermant l’album, le jeune homme enchanté de cette gracieuse apparition, et qui, malgré la pureté du français parlé par la jeune fille, avait reconnu à l’accent révélateur qu’il était devant une de ses compatriotes, c’est moi, miss, qui vous prie d’agréer mes excuses pour la surprise que vous a sans doute causée ma présence.
En parlant, le jeune homme ne cessait de tourner et de retourner l’album qu’il songeait d’autant moins à remettre en place que toutes ses pensées, tous ses regards, se portaient avec admiration sur la nouvelle venue.
C’était, nous l’avons dit, une élégante personne dans tout l’éclat de la jeunesse et d’une incomparable beauté. À son aspect, Mac Allan avait senti s’embraser toutes ces flammes secrètes qui couvent sans cesse au fond des cœurs de vingt ans.
La jeune fille cependant restait gênée dans l’embrasure de la porte et semblait même vouloir quitter la place :
– Je vous supplie, miss, reprit l’habitant de la verte Erinn, de ne prendre garde à ma présence dans ce salon où j’attends lord Wellinster.
– Ah oui ! dit avec une singulière intonation la belle enfant, mylord prétend dormir après son déjeuner, et son sommeil est assez exigeant pour ne point vouloir être interrompu.
Puis, se décidant à pénétrer dans la pièce, après cet aveu qui rompait la glace, elle continua :
– J’ignorais trouver quelqu’un dans ce salon, mais, – et elle sourit avec une malicieuse intention, – j’y venais reprendre une chose qui s’y trouve bien certainement.
Et elle feignit, tout en regardant Mac Allan, de chercher sur le guéridon l’album qu’il n’avait pas encore cessé de manipuler.
La pantomime était assez claire, assez explicative pour être saisie facilement, mais l’Irlandais, tout à son admiration, ne l’avait pas même aperçue :
– J’étais pourtant certaine, murmura la demoiselle toujours souriante, et affectant de se parler à elle-même, que ce recueil était là ce matin.
Cette fois l’évaporé ne pouvait plus se dispenser de comprendre :
– Oh ! pardon, miss, s’écria-t-il tout à coup, voici qui fait l’objet de vos recherches, et veuillez plaindre ma maladresse sans vous attarder à la blâmer.
– C’est l’heure où miss Oratia, la petite-fille de mylord, prend sa leçon, reprit la jeune maîtresse avec le même accent singulier et dur qu’elle avait eu en parlant de lord Wellinster, et je vous serai fort obligée de vouloir bien me rendre cet album sur lequel elle travaille sous ma direction.
L’occasion semblait trop belle de retenir quelques instants encore la charmante enfant pour que Mac Allan la laissât échapper.
– Ces délicieux dessins, dit-il, ces charmants modèles sont donc de votre main, miss ?
– Oui, sir, répondit la jeune fille.
Et, sur un ton dont l’amertume et l’orgueil contenu sont impossibles à rendre, elle ajouta :
– Ne suis-je pas l’institutrice de miss Oratia ?
Cette nuance n’échappa pas plus à Mac Allan que les fois précédentes.
Mais il s’obstinait à garder l’album dans ses mains, comprenant que s’il se décidait à le rendre c’en était fait de l’entretien commencé avec sa charmante interlocutrice. Celle-ci n’ayant plus de prétexte plausible pour demeurer, ne manquerait point de se retirer :
– Encore un mot, miss, dit-il en lui tendant enfin l’objet qu’elle convoitait du coin de l’œil et qui lui valait un aussi délicieux tête-à-tête, lord Wellinster, si je ne me trompe, est de pure race irlandaise…
– Oui, interrompit avec une certaine vivacité la jeune fille, pendant qu’un éclair traversait sa prunelle ardente, il est de pure race irlandaise.
Et elle ajouta sur un ton qui souleva au fond du cœur de Mac Allan tout un monde de pensées patriotiques :
– Quoique complètement rallié à la cause de l’Angleterre.
– Et vous, miss, continua le jeune homme sans s’expliquer l’étrangeté de sa demande et l’intérêt grandissant qu’il attachait à cet entretien, seriez-vous la compatriote de mylord ?
– Je suis en effet sa compatriote, Irlandaise d’un des comtés du nord, de la paroisse de Sméthead, dont mon père était le pasteur.
Mac Allan retint à peine un cri d’étonnement :
– Vous êtes, s’écria-t-il, la fille du docteur O’Pearl.
– Vous connaissiez mon père, sir ? s’écria à son tour la jeune fille en avançant d’un pas vers son interlocuteur.
– Et vous aussi, Jenny, je vous connais, dit gaiement Mac Allan, en saisissant les mains de la belle Irlandaise, pendant que celle-ci, dans sa surprise, ne songeait pas à les retirer.
Jenny fixa longuement le visage du jeune compatriote que le ciel plaçait sur sa route, puis comme si sa mémoire s’éclairait tout à coup d’une lumière intense et inattendue :
– Et moi aussi, dit-elle à son tour, je vous connais maintenant ; vous êtes sir Edward Mac Allan.
Les deux jeunes gens se connaissaient en effet depuis leur plus tendre enfance. Le presbytère du père de Jenny et le château des Mac Allan étaient voisins, le père du jeune homme et celui de la jeune fille avaient passé toute leur vie côte à côte, se fréquentant assidûment, s’aimant de tout leur cœur.
Edward et Jenny avaient ainsi grandi l’un près de l’autre, partageant les mêmes jeux et persuadés qu’ils ne se quitteraient jamais dans la vie. Ils avaient couru par les mêmes chemins, avec cette innocence insouciante et cette amitié sans calcul ni réserve de l’enfance, et leur première douleur avait été celle que leur causa leur séparation.
Le père de Mac Allan mourut en effet. Edward avait douze ans au moment où ce malheur vint le frapper, et son tuteur, un parent éloigné, domicilié à Dublin, l’appela auprès de lui et le contraignit à venir.
Jenny, qui touchait à sa huitième année, donna les marques d’un véritable désespoir, quand son ami lui confia, qu’obligé de partir, ils ne se verraient plus jamais. Le père de la jeune fille dut intervenir sérieusement, calmer d’un côté la profonde douleur de son enfant, relever de l’autre le courage d’Edward. Car, si celui-ci moins ardent et moins expansif que son amie ne jetait pas les mêmes cris de douleur, ne versait pas les mêmes pleurs amers, il n’en était pas moins profondément atteint par le coup qui les frappait tous deux.
Les adieux de ces enfants, ainsi séparés par les hasards cruels de la vie furent déchirants. Ils se promirent de correspondre souvent par lettres, et pendant longtemps ils se tinrent parole.
Puis l’âcreté de leurs regrets s’étant un peu calmée, leur correspondance devint moins régulière, moins suivie ; enfin la mobilité de sentiments inhérente à leur âge, de nouvelles amitiés qui se nouèrent autour d’eux, les exigences des travaux de leur éducation, les amenèrent à cesser complètement de s’écrire.
Mais ils songeaient encore et souvent l’un à l’autre ; car les impressions du premier âge ont une puissance telle qu’elles ne s’effacent jamais de l’esprit, et qu’à la moindre occasion favorable on est fort surpris de les retrouver avec toute leur vigueur d’autrefois, doublée de ce charme inexprimable que donne le souvenir.
Ainsi Mac Allan et Jenny, en se retrouvant chez lord Wellinster, firent-ils sans le moindre effort, et avec une délicieuse émotion un retour de huit ans en arrière. Ils se retrouvaient jeunes gens et se voyaient encore enfants, tels qu’ils s’étaient quittés, après la mort de Mac Allan, le père.
Un instant ils s’oublièrent dans ces ravissants souvenirs. Puis le sentiment de leur situation présente leur revenant tout à coup, leurs mains se séparèrent, ils s’éloignèrent l’un de l’autre en rougissant, sans cesser de se sourire encore.
Sur les instances d’Edward, Jenny lui raconta les années écoulées depuis leur séparation.
Le docteur O’Pearl, dont l’instruction s’étendait à toutes les branches de la science, n’avait voulu confier à personne qu’à lui-même le soin d’élever son unique enfant. Déjà veuf, se sentant malade, sachant qu’il ne laisserait à sa fille aucune fortune, il résolut du moins de la rendre forte pour la lutte, c’est-à-dire instruite, c’est-à-dire en état de pourvoir à son éducation par ses propres ressources.
C’est ainsi que Jenny put devenir une grande musicienne, un dessinateur habile, qu’elle apprit le français, l’allemand, l’italien, et qu’on la citait déjà, malgré son extrême jeunesse, pour le parti qu’elle avait retiré des leçons paternelles.
À cette époque, la maladie qui minait le docteur s’aggrava tout à coup ; en quelques semaines il fut enlevé à l’amour de sa fille, non sans avoir eu le temps d’assurer son avenir, car le jour même où son âme allait retourner au foyer qui l’avait produite, une lettre de lord Wellinster, autrefois son ami le plus intime, lui proposait d’attacher Jenny comme institutrice à la personne de sa petite-fille, miss Oratia, alors âgée de sept ou huit ans.
Voilà pourquoi l’enfant partit pour la France, et pourquoi depuis plus d’un an elle habitait l’hôtel de son noble protecteur.
À partir de ce moment aussi, Mac Allan, qui pensait, au début de ses rapports avec le riche Anglais, ne lui rendre qu’une de ces visites que la politesse impose à de communes relations, devint un des habitués les plus fervents de l’hôtel du faubourg Saint-Honoré.
Lord Wellinster, malgré quelques travers inhérents à son âge plus qu’à son caractère, était un aimable vieillard et il se plaisait beaucoup dans la société de son jeune compatriote. Il avait appris l’histoire des vieilles amitiés d’Edward et de Jenny, et avec cette liberté qu’autorisent les mœurs anglaises, il voyait, sans en être autrement préoccupé, leur liaison s’établir sur des bases nouvelles.
La famille de lord Wellinster se composait d’un fils unique que nous appellerons sir Patrice pour le distinguer de son père. C’était un grand seigneur anglais, dans toute l’acception du mot, plein de morgue et de roideur, voyageur intrépide, viveur émérite et même débauché, mais plein de cette loyauté et de ce courage inaltérables qui distinguent à un si haut degré les membres des grandes familles d’Angleterre.
Resté veuf de très bonne heure, il venait d’atteindre la trentaine, et c’était de son enfant que la jeune Irlandaise avait à former le cœur, à développer les sentiments.
Quand Jenny fut venue d’Irlande à Paris, sir Patrice, nouvellement arrivé d’un voyage en Russie, se préparait à partir pour les Indes, car son immense désir des aventures, tenu en bride par la riche alliance qu’on l’avait à peu près forcé à contracter très jeune, se donnait un libre cours depuis la mort de sa femme. Il avait fort détesté celle-ci, à cause de la contrainte que lui imposait un mariage qu’il n’avait point souhaité, et il n’aimait guère mieux l’enfant qui en était issue.
Aussi laissait-il lord Wellinster agir comme il l’entendait à l’égard d’Oratia. On lui parla de l’institutrice irlandaise qui allait prendre en main la direction de son cerveau, il la vit et ne parut plus s’en occuper, jusqu’au jour, au moins, où la merveilleuse beauté de Jenny, son élégance et le charme qu’elle répandait autour d’elle, frappèrent à la fois sa pensée et ses yeux du même effet magique.
Une profonde passion pour la jeune fille se glissa dans son cœur ; sous divers prétextes, il retarda son départ pour les Indes. Lord Wellinster, heureux de sentir son fils auprès de lui, ne chercha pas ailleurs que dans son profond amour filial la raison de tant d’esprit casanier succédant à tant d’humeur voyageuse.
Que se passa-t-il entre Patrice et la jeune Irlandaise ? Nous l’apprendrons plus tard, sans doute ; mais après avoir paru renoncer complètement à son voyage aux Indes, après être resté pendant une dizaine de mois le modèle des fils et l’exemple des pères, toujours près du vieillard et de la jeune fille, les entourant d’affection, ne les quittant jamais, surtout quand la jeune institutrice comptait comme partie intégrale du cercle de la famille, il fut atteint de nouveau de sa manie des voyages.
Un soir, il déclara très nettement à son père que son départ aux Indes allait s’accomplir sans délai.
Il s’embarquait le surlendemain au Havre, gagnait Liverpool, et voguait trois jours après de cette ville vers Calcutta.
Mac Allan apprit de ces détails tout ce que lord Wellinster en savait lui-même et tout ce que Jenny consentit à lui en apprendre ; peu de chose en réalité. Son amitié pour la jeune fille s’était d’ailleurs rapidement et profondément transformée en un ardent amour, et Jenny semblait, sans essayer de s’en défendre, près de glisser sur la même pente. Elle avait même, au milieu de ses demi-confidences, appris à son compatriote qu’elle ne se trouvait point heureuse dans l’hôtel de son vieux bienfaiteur :
– Maintenant que vous voici près de moi, disait-elle un jour à Mac Allan, il me semble que je n’ai plus rien à souhaiter, que je n’ai point quitté la maison de mon père. Je respire et j’existe parce que je sens à mes côtés un cœur qui m’aime, une volonté qui saurait me défendre au besoin.
Et un éclair, dont la signification semblait inexplicable, passa dans les yeux noirs de l’institutrice.
– Chère Jenny ! répondit le jeune homme en prenant ses mains dans les siennes, est-ce que, de loin ou de près, vous ne pouvez pas toujours compter sur moi, sur mon dévouement, sur mon…
Mac Allan s’arrêta. Cet amour dont il allait dévoiler l’étendue, qu’il s’avouait à peine à lui-même, son amie d’enfance le comprendrait-elle ? Et, si elle le comprenait, serait-elle disposée à le partager !
– Oui, Edward, reprit Jenny, je sais combien vous m’êtes dévoué, combien vous m’aimez. Mais vous ne resterez pas constamment à Paris ; vous partirez, vous irez où vous appellent aujourd’hui vos goûts et votre volonté, où vous appelleront plus tard vos devoirs d’homme et l’intérêt de votre avenir. Oh ! que je voudrais pouvoir ne plus vous quitter !
Ces paroles, qui pouvaient sembler à la fois les plus innocentes, aussi bien que les plus audacieuses du monde, enflammaient, en l’irritant, l’amour du jeune Irlandais :
– Dites un mot, Jenny, répondit-il en cédant tout à coup à un premier mouvement dont il ne put maîtriser l’impétuosité, dites un mot et nous vivrons toujours, toujours ensemble !
Avec un charme inexprimable où se cachait la plus astucieuse des habiletés, la jeune fille regarda Mac Allan, en souriant tristement :
– Quel mot voulez-vous que je dise, Edward ? murmura-t-elle.
Des scènes de ce genre se renouvelaient chaque jour. Mac Allan sentait sa passion grandir et graduellement envahir tout son être ; il était d’ailleurs revenu sur ses premiers doutes et croyait s’apercevoir qu’un amour, aussi ardent que le sien, s’allumait peu à peu dans le cœur de la jeune fille.
– Est-elle à même d’apprécier ce qui se passe en elle ? se demandait-il. L’ennui qu’elle éprouve chez lord Wellinster, la crainte qu’elle ressent de me voir partir et de la laisser seule chez ces étrangers, tout cela ne vient-il de sa passion peut-être inconsciente pour ma propre personne.
Et après avoir réfléchi quelques instants, Mac Allan ajoutait en lui-même :
– Après tout, nous sommes libres, elle et moi ; seuls au monde ; sa passion repose sur ma foi d’honnête homme. Qu’ai-je à craindre pour elle ? qu’ai-je à craindre pour moi ? Ne serais-je pas insensé de repousser le bonheur qui s’offre à nous ? Je veux lui communiquer mes sentiments, l’éclairer sur les siens. Dieu nous a certainement créés l’un pour l’autre, et le cri de mon amour, celui de ma conscience, se trouvent unanimes à me tracer ma conduite.
Puis, comme pour se donner un nouveau courage ou se procurer une excitation nouvelle, le jeune et amoureux irlandais se répétait encore :
– Son père et le mien, qui sont réunis, qui nous voient, m’approuveraient, j’en suis certain, et béniraient notre union.
Sur la pente où se laissait glisser Mac Allan, il était évident qu’il devait arriver au but final et fatal qu’il semblait rechercher dans son ardeur fiévreuse.
Au milieu d’une scène de passion violente, où les trésors d’amour accumulés dans son âme débordèrent à son insu, il apprit à la jeune fille tout ce qu’il éprouvait pour elle et tout ce qu’il espérait d’elle ; celle-ci, paraissant enfin lire au fond de sa conscience avoua à l’heureux Irlandais qu’elle partageait non seulement la vivacité de ses sentiments, mais que les aveux, exprimés par sa bouche remplissaient son cœur de la joie la plus ardente et la plus pure.
C’était une demande en mariage précise et nette avec acceptation bien franchement exprimée.
Mac Allan, selon son opinion, largement partagée par le monde, était un honnête homme ; il n’avait aucun compte à rendre de ses actions, si ce n’est à lord Wellinster qui lui parut devoir être admis à la confidence de ses amours et de ses projets.
En attendant, il écrivit à son intendant, en Irlande, de vouloir bien réunir les pièces nécessaires à la conclusion de son mariage, tant en son nom qu’en celui de sa chère compatriote et fiancée.
Les deux jeunes gens sollicitèrent aussi, pour la forme, un semblant de consentement auprès de quelques parents éloignés qui, n’ayant point à le refuser, s’empressèrent de l’accorder avec sollicitude.
Tout allait être prêt et lord Wellinster prévenu, quand celui-ci reçut la nouvelle du retour de son fils à Londres. Le voyageur déclarait n’avoir pu dépasser le cap de Bonne-Espérance, à la pensée de placer de nouvelles et plus grandes distances entre son père, sa fille et lui. Arrivé de la veille il s’empressait de le prévenir, ne voulant point le surprendre inopinément dans une dizaine de jours.
Lord Wellinster reçut cette lettre à table où par hasard Mac Allan se trouvait convié, ainsi que miss Oratia. Jenny versait le thé, suivant le désir du vieillard qui la laissait volontiers s’acquitter de cette délicate fonction :
– Bonnes nouvelles ! mes amis, s’écria le noble lord après avoir déchiffré la missive de son rejeton.
Et se penchant vers sa petite-fille, au front de laquelle il mit un joyeux baiser :
– C’est votre père qui revient, mon enfant. Il n’a pu se résoudre à une séparation aussi longue que celle qu’il avait fixée d’abord et dans une semaine au plus tard nous le reverrons ici.
Miss Oratia, une charmante enfant, se mit à battre ses petites mains l’une contre l’autre.
Mac Allan, de son côté, apprit cette nouvelle avec une politesse assez voisine de l’indifférence, car elle ne pouvait exercer aucune influence apparente sur sa vie. Mais, devant la joie du grand-père et celle de l’enfant, il crut devoir les féliciter du bonheur qui s’extasiait sur leur visage, sans cesser toutefois de tremper philosophiquement une tartine de pain beurré dans sa tasse de thé.
Pour Jenny, placée derrière les deux hommes, elle dut à cette circonstance de pouvoir cacher le brusque mouvement dont elle fut remuée, lors de l’annonce du retour de sir Patrice, ainsi que la soudaine pâleur qui gagna ses joues.
Un instant elle ferma les yeux, puis, sentant ses jambes se dérober sous elle, elle fut obligée de s’appuyer au fauteuil du vieillard.
Celui-ci devina plutôt qu’il ne sentit ce mouvement et se retourna ; la jeune fille avait déjà repris son empire sur elle-même, et quand Mac Allan, imitant son hôte, porta les yeux du côté de Jenny, il trouva des traits encore déplacés, mais souriant déjà, et un regard plein d’éloquentes et suaves caresses.
Néanmoins la secousse avait été assez forte pour n’avoir point complètement échappé à lord Wellinster :
– Ne vous fatiguez pas ainsi, miss Jenny, lui dit le bon vieillard. Pourquoi rester debout et ne pas prendre place à côté de votre élève ?
– Venez, miss, appuya la jeune fille très affectionnée à sa belle institutrice.
Malgré tout son courage, malgré l’empire qu’elle paraissait posséder sur elle-même, Jenny accepta le secours qu’on lui offrait. Elle s’assit, se versa une tasse de thé, en avala quelques gorgées et se retrouva plus vaillante et plus fraîche que naguère.
Mais à partir de ce moment, son impatience de quitter l’hôtel se manifesta chaque jour sous une forme qui variait de l’agitation jusqu’à la terreur. N’osant pas insister au-delà de certaines limites auprès de son fiancé, elle employait des moyens détournés pour engager celui-ci à ne plus différer son départ, à prendre ou à lui laisser prendre un parti décisif.
L’Irlandais, dominé par son amour, attendant loyalement cependant, et patiemment aussi, la conclusion désormais inévitable de son mariage, ne comprenait rien au sentiment d’inquiétude, à la hâte fébrile que témoignait Jenny et dont il lui fallait bien parfois s’apercevoir.
Quoique vivement contrarié de perdre Jenny, de la voir abandonner l’œuvre qu’elle avait parfaitement commencée, de l’éducation de miss Oratia, l’excellent Wellinster, mis au courant des projets des deux amoureux en avait approuvé complètement et de la façon la plus gracieuse les jolis rêves dorés.
– Dans quelques jours, leur disait-il le surlendemain, sir Patrice sera de retour. Jenny pourra quitter son élève et la laisser à la garde de son père et de son aïeul, qui verront de se pourvoir ailleurs d’une autre institutrice.
Et comme le digne homme professait la plus grande estime pour le savoir et l’habileté de l’Irlandaise, il ajouta :
– Nous aurons de la peine à vous remplacer Jenny, mais la certitude de votre bonheur nous sera une consolation bien douce.
Jenny écoutait ces consolations bienveillantes avec une impatience contenue. Elle comptait les jours avec une ardeur fiévreuse, parlait sans cesse des courriers d’Irlande qui n’arrivaient pas, et quand il devint évident pour elle que les formalités exigées par la loi française ne pourraient être remplies avant le retour de sir Patrice, elle éprouva comme un violent accès de désespoir.
Dès lors son parti fut arrêté.
Elle prit la résolution de brusquer le dénouement que Mac Allan semblait attendre avec tant de calme et de patient amour. Obéissant à des raisons qu’elle connaissait seule et qui seront révélées au lecteur quand il en sera temps, elle s’enfuit un soir de chez son protecteur.
En rentrant chez lui, dans un petit appartement meublé qu’il occupait vers le milieu de la rue de Provence, Mac Allan trouva la jeune fille installée chez lui, pleurant, la figure cachée dans les mains.
– Vous ! s’écria l’Irlandais voyant Jenny assise sur un canapé, vous Jenny ? Vous ici, et à cette heure ?
– Oui, Edward, répondit la jeune fille en montrant son visage baigné de larmes. Est-ce que vous refuseriez à votre amie un asile qui soit pour elle un refuge ?
– Vous refuser asile ! reprit Mac Allan sur un ton qui ne laissait aucun doute à propos des sentiments qu’il éprouvait, vous êtes la maîtresse ici, comme vous l’êtes de moi-même.
Au ton dont ces paroles furent prononcées, la jeune fille, quel que fut son projet, comprit qu’elle était sûre de remporter la victoire :
– Je vous ai dit cent fois, Edward, combien la vie que je mène à l’hôtel Wellinster m’était lourde et pénible. Aujourd’hui le fardeau a dépassé mes forces, je l’ai quitté pour toujours, et n’ayant à Paris qu’un seul ami, je me suis réfugiée chez lui. Ai-je bien, ai-je mal fait ?
Aveuglé par sa passion, Mac Allan ne comprit pas tout ce qu’il y avait d’étrange dans la conduite de la jeune fille ; il ne vit que la douleur dont témoignait son attitude.
– Vous ne pouvez mal agir, Jenny, répondit-il. Aussi bien, dans les termes où nous sommes, quel défenseur plus zélé trouveriez-vous ? Ce logis est le vôtre, usez-en à votre fantaisie.
La situation ne laissait pourtant pas que d’être assez embarrassante. Mac Allan était logé comme le sont les jeunes gens de passage à Paris ; de plus il avait à lutter contre l’ardeur de son amour, que la démarche pleine de confiance de Jenny et la douleur qu’elle semblait ressentir venaient d’accroître jusqu’aux plus extrêmes limites.
Quelques jours après, sir Patrice Wellinster arrivait de Londres et se rendait d’abord chez son père.
Les premiers moments d’effusion passés, le jeune homme demanda sa fille ; on la lui amena, et comme malgré les caresses qu’elle lui prodiguait, sir Patrice s’aperçut que miss Oratia avait dans les traits quelque chose de triste et de contraint, il s’enquit de la cause :
– Ah ! vous ne savez pas la nouvelle, lui dit lord Wellinster ; Oratia est triste parce que son institutrice, miss Jenny, nous a subitement abandonnés.
– Miss Jenny vous a quittés ! s’écria le nouveau venu dont la voix s’altéra sensiblement, tandis qu’il essayait en vain de cacher une douloureuse surprise.
– Oui, reprit le vieillard se trompant à l’expression du visage de son fils, et je comprends tout l’ennui que vous cause, pour votre chère petite, cette nouvelle inattendue. Quand nous serons seuls, je vous raconterai ce petit roman.
– Mais, c’est plus qu’un ennui, mon père, dit le jeune Wellinster en essayant de reprendre son empire sur lui-même, c’est une véritable catastrophe pour ma fille. Jamais nous ne remplacerons miss Jenny.
– Je suis tout à fait de votre avis, Patrice ; mais que voulez-vous ! miss Jenny était jeune, et les jeunes gens !…
À part lui, et comme s’il n’avait pu s’habituer complètement au départ de l’Irlandaise, lord Wellinster ajouta, assez haut pour que son fils l’entendît :
– Celle-ci cependant m’a trompé. Et Mac Allan. Qui l’aurait dit ?
Miss Oratia partie, l’Anglais entreprit de raconter à son fils l’aventure singulière et passablement scandaleuse dont, pendant son absence, l’hôtel avait été le théâtre.
Quelques instants après avoir reçu cette confidence, sir Patrice ayant réfléchi sur sa conduite et s’étant fixé à lui-même le parti qu’il avait à prendre, se présentait au logis d’Edward :
– Sir Mac Allan est parti depuis quelques jours, lui répondit un personnage qui tenait à la fois du concierge et du maître d’hôtel.
– Seul ? demanda l’Anglais.
– Non certes, reprit son interlocuteur, mais avec une jeune fille, sa compatriote, qu’il doit épouser.
– Et… savez-vous quelle route ils ont prise ?
– Je le sais parfaitement. Nos amoureux doivent être en ce moment à Genève, sur le point de procéder à la cérémonie nuptiale.
Le soir même, sir Patrice Wellinster se mettait en route pour la Suisse.
Sir Patrice avait probablement de sérieuses raisons d’atteindre Mac Allan et Jenny puisqu’il n’avait pas hésité à se lancer à leur poursuite.
Arrivé à Genève, l’Anglais descendit précisément dans l’hôtel où les deux jeunes gens avaient passé quelques jours, mais ils s’étaient déjà remis en route pour l’Allemagne, au dire de l’hôtelier, et ils devaient visiter ce pays sans suivre d’itinéraire bien déterminé.
Sans hésiter, en s’informant auprès des maîtres de postes et dans les principaux hôtels qu’il trouvait sur sa route, l’Anglais se remit aisément à leur poursuite. Il eut de leurs nouvelles à Mayence, faillit les rejoindre à Cologne, et n’arriva devant Trèves que le lendemain même de leur départ de cette ville.
Au dire de l’aubergiste allemand qui les avait logés et qui logea de même sir Patrice, les deux jeunes gens, après une pointe poussée jusqu’en Hollande, devaient gagner l’Italie en repassant par la Suisse.
Tout autre que sir Patrice eût abandonné cette chasse qui durait depuis plus de trois mois ; mais nous l’avons dit, le fils de lord Wellinster ne détestait pas courir le monde. De plus, et par moments, il devenait le plus enragé gentleman qu’on pût imaginer. Il se jura à lui-même qu’il finirait par atteindre les fugitifs, et, plutôt que de les poursuivre en Hollande, il alla les attendre au passage du mont Cenis.
Malheureusement pour lui, la saison déjà avancée, et d’autres raisons encore poussèrent Mac Allan, une fois de retour à Genève, à préférer prendre la voie de mer pour se rendre en Italie.
Les deux jeunes gens rentrèrent en France en suivant la vallée du Rhône, gagnèrent Marseille où ils s’embarquèrent pour Naples, visitèrent Rome, Florence, Pise, et prirent leurs quartiers d’hiver à Livourne où, plus heureux que sir Patrice, nous les retrouvons dix mois, environ, après les avoir perdus de vue, installés dans une maison de la magnifique rue qui se nomme aujourd’hui Victor-Emmanuel, et qui constitue à peu près, à elle seule, la Marseille italienne.
Mac Allan et Jenny n’étaient pas encore mariés.
Dans les premières heures d’ivresse, ils s’étaient contentés d’être heureux, de s’aimer, de compter l’un sur l’autre d’une manière absolue et, inconnus au milieu des pays qu’ils traversaient, ils avaient, au jour le jour, remis sans cesse au lendemain le soin de régulariser leur union.
Mais à Naples, un soir, dans une maison qu’ils avaient louée sur les bords du golfe, Jenny rêvait, seule, à son enfance écoulée le long des verts chemins de l’Irlande, en compagnie de Mac Allan, qu’une visite obligée avait contraint de rester en ville.
Tout à coup, il se passa dans son être une chose étrange et inconnue.
Elle crut percevoir, elle perçut une sensation, dont rien jusqu’alors ne lui avait donné l’idée. Un tressaillement cruel, à la fois, et délicieux parcourut son corps de la tête aux pieds ; elle essaya de se soulever et retomba sur son siège, pâle, indécise, se demandant de quelle nature était l’émotion qu’elle éprouvait ?
– Mon Dieu ! murmura-t-elle, parlant bas, et portant involontairement les deux mains sur son cœur, pour essayer d’en comprimer les battements.
Dans les profondeurs du ciel presque noir, à force d’être bleu, brillaient des étoiles sans nombre. Jenny les yeux levés vers cet infini resplendissant, crut le voir s’entrouvrir et son regard plongeant dans des sphères supérieures et inconnues :
– Mon Dieu ! murmura-t-elle de nouveau, m’auriez-vous pardonnée ? Touché de mon amour pour Edward, voudriez-vous me refaire digne de lui par la maternité ?
Elle attendit un instant, cherchant encore avec anxiété à se rendre compte de la sensation fugitive autant qu’inconnue qu’elle venait d’éprouver, attendant qu’elle se renouvelât et n’osant point cependant l’espérer.
Au bout de quelques instants ; le même frisson délicieux parcourut et ébranla son être tout entier :
– Mac Allan ! Edward ! s’écria la jeune femme, se soulevant et courant se précipiter dans les bras de l’Irlandais qui venait d’arriver à ses côtés.
– Quoi donc, ma chère Jenny ? dit le jeune homme. Qu’y a-t-il ?
– Il y a, balbutia Jenny, rougissant de cette pudeur qui n’abandonne la femme qu’au dernier soir de la vie, il y a… que Dieu a béni nos amours. Dans quelques mois tu seras père.
Mac Allan frémit de la joie qu’éprouve une créature humaine à se savoir continuée dans la vie, et cette nouvelle arrivait à son heure pour effacer en lui de détestables impressions.
Jenny, qu’il aimait avec passion, et dont il se croyait aimé de même, semblait, par sa tristesse, aussi bien que par son inégalité de caractère, lui cacher certain mystère qu’il s’acharnait à vouloir pénétrer. Sans avoir précisément à se plaindre de sa jeune femme, l’Irlandais avait pu constater qu’elle nourrissait, en dehors de leurs amours, une préoccupation inexplicable, étrange, indéfinie : au fond de l’âme de Jenny, il avait surpris le remords.
Aussi accepta-t-il comme un heureux augure la prochaine maternité de son amie. Il y vit un motif nouveau de revenir à la raison et au sentiment des convenances, en légitimant une union à laquelle il n’allait plus manquer bientôt aucun élément de bonheur.
D’un mutuel accord, les deux jeunes gens décidèrent qu’ils se marieraient à Livourne, ville dont les communications restaient fréquentes avec l’Angleterre et qui, par le temps de blocus continental qui régnait alors, leur offrait l’avantage de posséder dans ses murs un agent consulaire de la Grande-Bretagne.
Mac Allan écrivit dans ce sens en Irlande, puis les deux jeunes gens, après avoir visité Rome, se rendirent à Livourne, en traversant Florence et Pise.
C’est là que nous les retrouvons, une fois de plus, quatre ou cinq jours après la délivrance de Jenny, qui mit au monde un délicieux poupon ; elle exigea qu’on lui donnât le nom de son père.
Tout était prêt pour la cérémonie du mariage. On n’attendait, pour y procéder, que les relevailles de la jeune femme.
Un jour que la malade s’étant assoupie, Mac Allan se trouvait dans un petit salon de son appartement, un jeune garçon, qui leur servait de domestique, vint lui remettre une carte de visite :
– Sir Patrice Wellinster ! lut l’Irlandais. Et se précipitant vers la porte, croyant qu’il s’agissait de lord Wellinster ; qu’il entre, et au plus tôt, cria-t-il.
Sir Patrice, ayant suivi son guide, parut dans l’embrasure de la porte ; il avait entendu la réponse de Mac Allan et saisi sa méprise.
– Pardon, sir Mac Allan, fit l’Anglais en s’avançant, vous comptiez voir le père, quand c’est le fils qui se présente, n’est-il pas vrai ?
Au ton dont ces paroles furent prononcées, à l’attitude du jeune homme, l’Irlandais comprit qu’il se trouvait en présence d’une provocation, et qu’une explication n’allait pas tarder à suivre :
– Tout ce qui porte le nom que vous venez de prononcer a le droit d’être reçu dans ce logis avec empressement, répondit-il. Que Votre Seigneurie veuille bien accepter un siège.
Sir Patrice n’avait jamais aperçu son adversaire. Il fut frappé doublement par la noblesse et l’énergie de son visage et par le ton digne, calme, posé avec lequel il s’exprimait. Par malheur, depuis six mois au moins qu’il courait après sir Edward, il se déclarait à bout de patience :
– Mac Allan, reprit-il, doit deviner ce qui peut amener chez lui le fils de lord Wellinster.
Ces mots affectaient de si près l’intention d’une grossièreté que, sans la ressemblance extraordinaire existant entre le père et le fils, l’Irlandais n’eût pas cru à l’identité de son interlocuteur :
– Mac Allan n’a pas appris à deviner, dit-il avec hauteur.
– Il sait du moins écouter, répliqua l’Anglais, et Wellinster le lui apprendra ; il s’agit, sir Edward, de nous couper la gorge.
Mac Allan était le plus courageux des hommes, mais il se trouvait si surpris par cette idée de bataille qu’on venait d’exprimer devant lui qu’il crût un instant rêver :
– Nous couper la gorge ? murmura-t-il. Vous et moi, sir Wellinster ? Et pourquoi ?
Ce fut le tour de sir Patrice de témoigner de son étonnement :
– Pourquoi ? dit-il. Avez-vous donc oublié ce qui s’est passé à l’hôtel de mon père ?
Mac Allan vit dans ces paroles une allusion à l’enlèvement de Jenny :
– Je n’ai rien oublié, mylord, reprit-il doucement, et la preuve c’est que je suis disposé à remplir mon devoir, à présenter à votre honorable père et à vous-même toutes les excuses possibles pour le trouble momentané que Jenny et moi avons pu jeter dans votre famille, surtout pour la façon rapide dont nous avons fui, malgré toute la bienveillance que daignait nous témoigner milord Wellinster. Mais notre conduite sera pleinement justifiée dans quelques jours.
– Il ne s’agit point de cela ! interrompit sir Patrice.
– Et de quoi s’agit-il alors ? demanda Mac Allan que la colère commençait à envahir.
– Allons ! s’écria l’Anglais un instant interdit par la placidité de son compatriote, est-ce que vous ne sauriez rien de sa conduite passée ?
– À votre tour, milord, que voulez-vous que je sache ? demanda sir Edward.
Patrice s’était assez avancé pour ne plus pouvoir reculer. D’ailleurs la passion qui l’avait entraîné vers l’institutrice de sa fille s’était accrue par le fait de l’éloignement et lui montait au cerveau en gerbes de sang. Il continua avec une sourde rage et presque sans réfléchir à l’infamie de sa conduite :
– Ce que je veux que vous sachiez, c’est qu’avant vous j’aimais miss Jenny, qu’elle m’a aimé avant de vous aimer, que je vous hais, et que vous aurez ma vie, si je suis assez maladroit pour ne pouvoir vous débarrasser de la vôtre.
– Vous avez menti ! s’écria Mac Allan blême de colère et de douleur.
L’Anglais resta froid devant cette insulte.
– Au fait, dit-il, elle est bien capable de vous avoir trompé comme elle m’a trompé moi-même. Tenez !
Puis ouvrant à la hâte un portefeuille, sir Patrice jeta sur une table, à portée de la main d’Edward, une liasse de lettres.
Mac Allan resta un moment anéanti sous le coup qui venait de l’atteindre, puis il prit les lettres que lui tendait sir Patrice, en parcourut fiévreusement deux ou trois, et put se convaincre de l’immense malheur sous lequel il se sentait plier, de l’indigne tromperie dont il était l’innocente victime.
– Et mon fils ? se demanda-t-il avec une sorte d’hésitation.
Cette pensée, loin de le calmer, lui mit au cœur le désir d’une implacable vengeance.
– Milord, dit-il à sir Patrice, en l’enveloppant d’un regard plein d’une haine désormais insatiable, vous avez raison, l’un de nous doit disparaître et peut-être les deux. Aussi ce sera un duel à mort, n’est-ce pas ?
– Telle est bien ma pensée, répondit l’Anglais.
– À partir de ce moment nous ne nous quittons plus ; il faut que dans une heure au plus tard la question soit vidée.
– J’ai dans ma voiture les armes nécessaires, reprit sir Patrice. On m’avait si bien parlé de votre bravoure, sir, que j’ai pensé pouvoir abréger les préparatifs d’un combat. Nos témoins, si vous n’y voyez point d’obstacle, seront les quatre premiers soldats que nous rencontrerons.
Sir Patrice, maintenant certain de se battre, avait retrouvé son calme et sa courtoisie de grand seigneur.
– J’approuve, dit Mac Allan, toutes vos combinaisons et je me déclare prêt à vous suivre.
Et l’Irlandais se dressa en effet pour donner à ses paroles la sanction qu’elles attendaient.
À la porte, au moment où il allait quitter l’appartement, il s’arrêta pâle, anxieux, semblant se demander s’il ne retournerait pas en arrière, s’il ne reverrait pas encore une fois, avant de partir, sa femme indigne et son enfant innocent.
Le regard de l’Anglais qui le suivait de son œil clair, ironique et provocateur, lisant jusqu’au fond de son âme pour y surprendre toutes ses pensées, toutes ses douleurs, lui fit subitement abandonner son projet.
– Non, non ! murmura-t-il après quelques secondes, marchons, je les tuerais tous les deux.
Et bravant sir Patrice en passant devant lui, il s’élança le premier dans l’escalier.
Il fut fait suivant la volonté de l’Anglais.
Dans la rue se promenaient des sous-officiers de la garnison française séjournant alors à Livourne ; sir Patrice s’approcha d’eux, leur exposa sa demande et les pria de s’adjoindre quelques-uns de leurs camarades.
Une heure après, tout était convenu entre les témoins des adversaires :
– Messieurs, leur avait dit l’Anglais, sir Edward Mac Allan, que voilà, appartient à une bonne famille d’Irlande ; moi-même je suis fils d’un lord du même pays, et mon nom est sir Patrice Wellinster. Un outrage sanglant, une de ces injures qu’on ne peut pardonner, ont été infligés par l’un de nous à l’autre ; il faut donc que l’un de nous disparaisse, que ce soit ou l’innocent ou le coupable. Je vous offre ma parole d’honneur, et mon compatriote est prêt à m’imiter, que le service que vous allez nous rendre n’a rien que de très honorable.
Mac Allan fit signe qu’il approuvait de tous points les paroles de l’Anglais.
Les quatre sous-officiers n’en demandaient pas davantage.
Arrivés sur le lieu du combat, situé un peu en dehors de la porte Médicis, les témoins jetèrent au-dessus de leur tête une pièce de monnaie pour décider à qui appartiendrait le choix des armes. Le sort favorisa sir Patrice.
– L’épée, dit-il.
Il fut convenu que le combat ne cesserait que par l’incapacité de l’un des combattants. Si cependant, et pour en finir, après avoir duré un quart d’heure, le combat à l’épée ne fournissait pas de résultat décisif, celui qui se trouverait le premier fatigué aurait le droit de réclamer les pistolets.
Mac Allan attaqua l’Anglais en homme qui veut en finir vite à tout prix. Sir Patrice, tireur consommé, se défendit un instant avec une évidente supériorité, que doublait encore un sang-froid prodigieux.
Il savait que le plus sérieux danger qu’on puisse courir sur le terrain vient non pas tant de la science de l’adversaire, que de la résolution où il est de se faire tuer pourvu qu’il tue.
À la fin, le jeu de Mac Allan devint si fatigant pour sir Patrice que celui-ci résolut d’en finir.
Après une ou deux feintes habiles, et jugeant le moment propice, il allongea le bras ; une sensation de brûlure dans l’épaule le força de reculer. Le fer de l’Irlandais venait de l’atteindre cruellement, mais il avait au moins la satisfaction d’avoir touché lui-même son adversaire à la poitrine.
– Arrêtez-vous, messieurs, prononça l’un des témoins.
Un moment de repos devenait en effet nécessaire aux combattants ; aussitôt que l’Anglais voulut reprendre l’assaut, son bras engourdi, sous l’influence de sa blessure lui fit comprendre que le combat ne pouvait être continué à l’épée.
Il s’en ouvrit à l’un de ses témoins qui lui-même discuta le fait avec ceux qui assistaient l’Irlandais.
– Sir Wellinster peut-il au moins tenir un pistolet ? demanda Mac Allan d’un air ironique, dès qu’il fut mis au courant de l’accident.
– Certes ! répondit l’Anglais en se redressant de toute sa taille.
– Eh bien ! continuons avec les armes à feu.
On mesura vingt-cinq pas, puis on convint que les adversaires marchant l’un sur l’autre tireraient à volonté leurs deux coups, – ils tenaient une arme dans chaque main. – S’ils arrivaient à se toucher, si même la vie de l’un d’eux tombait complètement à la merci de l’autre, les témoins ne devaient point même essayer de s’interposer.
Au signal convenu, Mac Allan marcha lentement vers son compatriote.
Ce fut un moment rempli d’angoisses, ainsi qu’un émouvant spectacle pour les assistants. L’Anglais, sans quitter sa place, ajustait le jeune homme avec la plus froide attention.
Malgré leur bravoure ordinaire, les quatre témoins ne purent s’empêcher de frémir à la vue de ces hommes intrépides, dont l’un certainement allait mourir bientôt.
Mac Allan avançait toujours, les mains tendues en avant. Il était à quinze pas de son ennemi quand celui-ci tira. Une secousse à la tête le contraignit à s’arrêter ; il se secoua ainsi qu’un chien mouillé, comprit qu’il n’avait été qu’effleuré, ajusta de nouveau et tira à son tour.
L’Anglais ne parut point sourciller, donc il n’était point atteint :
– Vous êtes blessé ? voulut dire un des témoins en s’adressant à l’Irlandais.
– Restez à vos places, messieurs, répondit vivement celui-ci. Ce ne peut être grave, car je ne sens qu’une très légère douleur.
Ce n’était rien en effet. La balle de sir Wellinster n’avait que très légèrement frôlé sa tempe.
Jetant au loin son pistolet inutile, l’Irlandais reprit sa marche vers sir Patrice. Une terrible et suprême résolution se lisait dans ses yeux.
L’Anglais comprit qu’il fallait tuer vite et sûrement pour conserver la vie. Il tira son second coup au moment où son adversaire élevait la main pour faire feu.
Mac Allan laissa tomber son dernier pistolet ; un mince filet de sang s’échappait d’une grave blessure qu’il venait de recevoir à l’avant-bras droit.
Sir Patrice crut le voir chanceler, et, par un mouvement machinal allait s’élancer pour le retenir, avant qu’il ne s’affaissât sur le sol :
– Demeurez, milord ! s’écria le blessé d’une voix terrible. Demeurez où vous êtes. Il me reste une balle à tirer, la bonne, si vous voulez me le permettre ?
Et dans un effort suprême, il ramassa son arme de la main gauche, puis d’un pas mal assuré, lent, sans cesser d’être régulier, et témoignant d’une indicible force de volonté, il continua à marcher sur son ennemi.
Une joie immense éclatait dans ses yeux, une féroce et sanguinaire satisfaction se trahissait sous la pâleur de ses joues et dans la contraction de ses lèvres.
Sir Patrice croisa les bras sur la poitrine ; froid et calme, il regarda la mort s’avancer.
Les témoins frémissaient de terreur instinctive. L’un d’eux se cacha le visage dans les mains pour échapper au sanglant dénouement qui n’allait pas tarder à se produire. Un autre, plus épouvanté encore, ne put s’empêcher de s’écrier :
– Ne le tuez pas, monsieur !
Mais, lui, devenu bestialement sanguinaire, lança sur eux son regard implacable : on eût dit l’ange de la Justice accomplissant sa terrible mission avec l’impassible et froide volonté du destin.
Quand il fut assez près de sire Patrice, quand le canon de son arme put toucher son visage, lentement il éleva la main et le lui posa sur le front.
Sir Patrice resta inflexiblement debout, attachant sur Mac Allan un fier regard de défi.
Tout à coup celui-ci sentit sa vue s’obscurcir, sa vie l’abandonner, son bras prêt à retomber dans une impuissance fatale. À peine eut-il le temps de presser la détente. Le coup partit ; les deux hommes tombèrent à la fois, l’un mort et la tête fracassée, l’autre évanoui et perdant son sang par sa dernière blessure.
Quinze jours plus tard, l’irlandais, suffisamment guéri, s’embarquait sur un navire se rendant à Marseille.
Il n’avait pas revu Jenny ; il avait même refusé de la revoir. Mais quelques heures avant de partir, il avait réclamé par l’intermédiaire de la police livournaise l’enfant qui portait légalement son nom, et qui lui appartenait à l’exclusion de sa mère ; puis, ayant tiré de son portefeuille quelques billets de banque, il écrivit la lettre suivante :





























