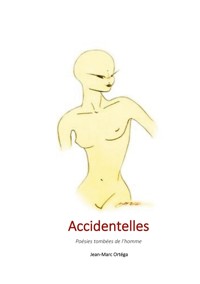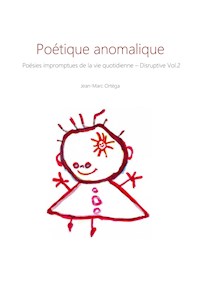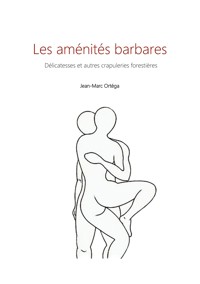
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Ce recueil réunit, tout au long d'une centaine d'aventures, trois personnages: une belle ingénue, un sincère maladroit et la forêt majestueuse. Fidèle à ma recherche sur le spontané et l'exercice du naturel, je n'ai opéré ici aucune censure. Par conséquent, ces trois complices font l'objet de multiples historiettes poétiques parfois douces à l'âme, parfois incongrues, parfois romanesques, parfois carrément inconvenantes, voire ignominieuses. J'ai voulu exposer ici de bons gros morceaux de vie, des épisodes accidentels que j'ai réellement vécus dans la vraie vie ou réellement vécus dans mon imagination. Ce qui revient au même. À travers ces contes de faits, j'ai tenté de partager quelque chose d'intime, de magnifique, quelque chose de délicat et fragile : la manifestation permanente et affriolante de la plus belle énergie de l'univers qui soit : l'amour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A So.
Aux écrivains de la littérature absurde, influencés par le surréalisme. Eugène Ionesco, Jean Genêt, Arthur Adamov, André Breton, Raymond Queneau, Guillaume Apollinaire, Dorothea Tanning, Christian Bobin…
L’humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie.« Une histoire modèle » - Raymond Queneau
Lorsque je récite un poème, ce n’est pas pour être applaudi mais pour sentir des corps d’hommes et de femmes, je dis des corps, trembler et virer à l’unisson du mien, virer comme on vire, de l’obtuse contemplation du bouddha assis, cuisses installées et sexe gratuit, à l’âme, c’est-à-dire à la matérialisation corporelle et réelle d’un être intégral de poésie.« L'Ombilic des Limbes » - « Le Pèse-nerfs » - Antonin Artaud
Il entre dans le bus scolaire et se fait rejeter. Aucun autre enfant ne souhaite lui céder une place à son côté… Sauf une petite fille. Confrontée à sa naïveté et à ses innocentes réflexions, elle lui dit :— Es-tu stupide ou quoi ?— Maman dit que n’est stupide que la stupidité.— Je suis Jenny.— Je suis Forrest, Forrest Gump. Il dira : Elle était mon amie la plus particulière.« Forrest Gump » - Réalisateur : Robert Zemeckis - 1994
Déclaration liminaire
La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Si vous voyez de la poésie dans les lignes qui suivent, et que cela vous procure quelques frétillements hérissés ou une douce joie au cœur, sachez que cette poésie n’est pas dans mes mots. Elle est uniquement dans vos yeux. Dans votre regard. Je décline toute responsabilité. Jean-Marc O.
Avant-propos
Ce recueil réunit, tout au long d’une centaine d’aventures, trois personnages : une belle ingénue, un sincère maladroit et la forêt majestueuse.
Fidèle à ma recherche sur le spontané et l’exercice du naturel, je n’ai opéré ici aucune censure. Par conséquent, ces trois complices font l’objet de multiples historiettes poétiques parfois douce à l’âme, parfois incongrues, parfois romanesques, parfois carrément inconvenantes, voire ignominieuses.
J’ai voulu exposer ici de bons gros morceaux de vie, des épisodes accidentels que j’ai réellement vécus dans la vraie vie, ou réellement vécus dans mon imagination. Ce qui revient au même.
À travers ces contes de faits, j’ai tenté de partager quelque chose d’intime, de magnifique, quelque chose de délicat et fragile : la tendresse de la vie comme la tendreté des corps.
J’ai remarqué qu’il y a en toutes circonstances, et dans chaque être humain ou animal, ou végétal, une sensibilité à fleur de peau. Magique.
C’est une question de regard.
Que voit-on ? Comment regarde-t-on ? Je crois que le poète voit derrière la peau, au-dessous des mots, entre l’écorce et l’arbre, sous les feuilles, au travers des apparences, le pétillement continu de la vie, la manifestation permanente et affriolante de la plus belle énergie de l’univers qui soit : l’amour.
L’amour est partout, la délicatesse est dans les sourires offerts comme dans les maladresses sincèrement ratées.
En les créant et en les regardant vivre, ces trois personnages m’ont touché.
Ils ont remué de belles choses en moi, aussi je souhaite, pareillement, que ces évocations poétiques produisent en vous, au fil des pages, quelque émoi.
Jean-Marc
Table
1 Harangue déboisée
2 Mon ami des villes
3 Saignant ou à point
4 Divagations champêtres
5 Tendre balade forestière
6 Petite crise d’irréel
7 Comment dire je t’aime ?
8 Déjeuner dominical
9 Les petits papiers
10 Silence !
11 Une vie en pointillés
12 Ivrognerie forestière
13 La poésie infuse
14 L’expérience de la forêt
15 De vrais mensonges
16 Maladresse émotionnée
17 Insolite rencontre
18 Le petites aventures
19 Des chants désespérés
20 Être ou ne plus être ?
21 Capucine
22 Errance et déambulation
23 Féroces démangeaisons
24 Mésaventures des bois
25 Réflexe urbain
26 Les petites choses
27 Effeuiller les bosquets
28 Coup de chaud
29 Sur les bancs verts de l’école
30 Ecoute l’arbre
31 Heureux égarement
32 Enfumage
33 Inénarrable
34 Somnifère céleste
35 Re-garder le silence
36 C’est arrivé la nuit
37 Salutation élémentaire
38 Worthington
39 Sshhh, sshhh !
40 Cœur rouillé
41 Sang-froid et désir ardent
42 Télescopage forestier
43 Forêt-psy
44 Timidité spontanée
45 Derrière la magie
46 Perturbations des sens
47 Boule à neige
48 Tout est elle
49 Mourir pour rien
50 Rêver la ville
51 Secret de composition
52 L’ascension du chêne
53 Après l’orage
54 Trop c’est trop
55 Pelotonnage
56 Mes yeux ont rétréci
57 Côte à côte
58 Pérégrinations d'une goutte
59 La chute du déchu
60 Insomnie glacée
61 T’offrir le chant d’un oiseau
62 Les hommes chutent
63 Insouciance
64 Une vie dissolue
65 Magique ressuscitation
66 Trempés jusqu’aux os
67 Le calme après la forêt
68 Après la dispute
69 Rupture douloureuse
70 Se lever
71 Résistance syntagmatique
72 La liberté en marche
73 Réelle rêverie
74 La voix qui parle
75 Si je savais…
76 La vérité ment
77 Y retourner
78 Flânerie loufoque
79 De temps en temps
80 Amer enchantement
81 Embrouilles entre chien et loup
82 Un chasseur sachant chasser…
83 Balade mélancolie
84 Stratégie drague
85 Ma lune souffre
86 Danser dans le lumineux
87 Quand ça miaule dans la forêt
88 Disparition
89 Désir foudroyé
90 La princesse endormie
91 Nuit blanche
92 En chagrin dans le terrier
93 Ennui râpeux
94 Affectueuse taquinerie
95 Amour délavé
96 Ravissement
97 Balade au clair de bois
98 Oh, le joli conte de fée
99 C’est pas ses mots
100 Innocence et fraîcheur
Harangue déboisée
Nous marchons côte à côte dans le petit sentier du dimanche matin.
C’est notre rituel. La flânerie en forêt.
Pour moi, c’est là où l’aiguillon de ma muse est le plus pressant.
Tout ce vert et cette fraîcheur… mmm… La fraîcheur de l’instant présent, légèrement aromatisée d’effluves jasminées, les jonquilles lumineuses, les jacinthes des bois aux épis bleutés nonchalants, sans compter les roses sauvages avec qui j’entretiens un lien particulier.
Les corolles des pétales de rose m’ont toujours offert, au creux de leur calice, un abri pour mon âme inquiète.
Cette belle nature sensible, un festin pour les sens, m’inspire terriblement.
Alors, prenant mon amie à témoin, je me lance dans une diatribe véhémente contre les rats des villes que sont, à mes yeux, mes concitoyens urbains.
— Je vais te dire Jésunette les citadins sont radins de la sève de vie ce sont des pingres de l’amour y z’aiment pas la vie ils aiment le goudron le bitume le béton se shooter aux gaz toxiques des pots d’échappement contempler la laideur des immeubles fissurés et noirâtres s’entasser et se frotter dans les embouteillages de voitures et de corps et manger vite-vite de gentils petits animaux transformés en cadavre dans des fast-food où règnent des odeurs nauséabondes d’huile rance surchauffée et de viande avariée cramée le tout en rotant en pétant et en rouspétant ils sont gris ils puent ils sont tristes ils sont agressifs ils sont vulgaires ils ne se rendent même pas compte qu’il se précipitent bêtement tout droit vers l’abîme du non-sens de leur vie. Arff, pfiou, pfiou …Euh, tu vois ce que je veux dire ?
Me voyant devenir cramoisi de peau, et m’étouffer en faisant de curieuses onomatopées chevrotantes, histoire de reprendre mon souffle et, juste avant d’atteindre le pathétique de situation après lequel mon honneur sera définitivement bafoué, la voilà qui me questionne :
— Rhôlala, mais la virgule tu la mets où ?
Entre tremblement et bêlement de bovidé de la famille des caprins, je lui réponds :
— Huuu, Huuu… bêééé, bêééé… la virgule ? Connais pas. C’est quoi t’est-ce ?
— Pas grave. Ben, à part ça, j’ai pas tout compris. ‘scuse. Et puis, c’est dur ce que tu me demandes. Tu me dis : Tu vois ce que je veux dire ? Bah non, je ne vois pas. Quand tes paroles sortent de ta bouche, je ne les vois pas. Donc, je ne vois pas du tout ni ce que tu dis, ni ce que tu veux dire. Par contre, j’ai bien tout entendu… Et j’ai rien compris.
— Bon, c’est pas grave. Regarde, c’est simple…
— Heu, quand tu me dis regarde, tu veux peut-être me dire écoute ? C’est ça ? J’ai tout bon ?
— Oui, c’est très bien. T’es trop forte ! Merci de me corriger. Voilà, il y a une vérité… et donc si tu entends bien ce que tu vois, tu ne peux que constater qu’on est poètes tous les deux. N’est-ce pas ?
— Bô, toi oui, mais moi je suis plutôt une pouêt-pouêt, hihihi !…
— Ah mais non, stop ! C’est sérieux la poésie, bon sang !
— Oh, pardon. Je te demande l’absolution de mon péché de bêtise, l’abolition de ma remarque stupide, ta grâce et la rémission de mon impureté sacrilège. Siouplez M’sieur le poète en chef. T’es d’ac ?
— Bon, ça va, c’est bon, arrête de pleurer… ou de rire… du coup, je ne sais jamais avec toi si tu ris ou si tu pleures. Bref, concentrons-nous ! Juste, je t’explique. Il y a le mouvement. Il y a la vie. Et la matière poétique, c’est le mouvement de la vie. On pourrait croire que tout poète a l’imagination délirante, qu’il est enfiévré de fantasmatique, capable de rêver le monde avec des mots… mais pas du tout. C’est le contraire. Pour un poète, la poésie est le chemin le plus direct qui lui permet de faire l’expérience ultime, l’expérience fondamentale du réel. Le vrai réel ! Tu me suis ?
— Bah oui, je te suis, je suis juste derrière toi… mais là, avance parce que je vais te tamponner si tu t’arrêtes. J’aime bien, mais quand même… aïe !
— Aïe ! … Merci, c’est gentil… Et je vais même plus loin, ma petite Jésunette : à part la poésie, tout est illusion. Ben oui, Madame, tout est illusion !
— Moi, être Mademoiselle.
— Euh oui, Mademoiselle. Pardon...
— Moi, pas être Mademoiselle pardon, moi être Mademoiselle Jésunette...
— Ouf, ouf… attends, je respire. Tu lâches rien, toi ! Bon, je m’applique. Je respire. Je me centralise… ça y est. Donc, le drame, je vais te dire innocente Jésunette, c’est que les mots sont éphémères. Ils ne sont que la trace d’une brève rencontre entre une émotion qui volète comme un papillon et le monde invisible de l’esprit. T’as déjà réussi à attraper des papillons-mots, toi ? Et tu l’as vu le monde invisible, toi ?
— Ouaf, ouaf, comme dirait mon chien. Ah ben que non, quand je regarde l’invisible, j’y vois du rien. Mon chien pareil. Et puis moi j’attrape pas les papillons. Respect. Liberté. Amour. Ni les mots. Déjà que je ne les vois pas, alors pour les attraper… Peux pas, c’est que du vent.
— Ouiiii, c’est ça ! C’est exactement ça. Merci ma douce amie, tu es géniale ! Les mots, c’est du vent. Le monde de l’esprit, c’est du vent. La poésie, c’est du vent… formidable !
— Le vent est formidable ?
— Oui, le vent est formidable. Alors, vive le vent !
— Tu veux dire : vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère ... ?
— Ouiiii, re-ouiiii, c’est exactement ça ! Tu as raison. Vive le vent, à bas la poésie et les prises de tête. Vive le vent dans la tête, vive le vent !
Et nous voilà partis, bras dessus bras dessous, en trottinant gaiement sur le chemin et en chantant à tue-tête d’une double voix éraillée mais tellement heureuse :
— Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.
C’est ça la magie.
C’est ça mon rituel du dimanche matin, dans les bois, avec Jésunette.
Elles me soignent et me guérissent. Elle et la forêt.
En moins de dix minutes, ma douce amie a le don de me souffler dans la tête et de faire disparaître les moutons de poussière de mes tourments, les débris de mes complications et les sacs de nœuds de mes discours alambiqués.
En fait, tout ce que je mets en place inconsciemment lorsque je la rejoins à l’orée des bois.
Je me demande pourquoi je fais ça.
Pourquoi je me sens à tel point paniqué en sa présence que j’éprouve le besoin de parler, parler, parler.
Occuper la relation par des discours pseudo-mystico-spirituels.
Est-ce une fuite ?
Quelque chose serait-il à ce point si gênant que… ?
De quoi ai-je peur ?
D’elle ?
De son amitié ?
De mon amitié pour elle…
Et si c’était autre chose… ?
Mais quoi ?
Je vois pas.
Non, je vous assure, je ne vois pas.
Mais alors là, pas du tout...
Mon ami des villes
J’ai un ami des villes et un ami des champs.
Ce jour-là, j’ai embarqué mon ami des villes pour une balade en forêt.
Pas très habitué, il a frôlé l’overdose.
Trop de vert. Trop d’air pur. Trop de beauté.
Il a failli en claquer.
Arrivé au pied d’un chêne du temps passé, il lève les yeux vers son immensité et, comme pris d’une illumination, le voilà qui tourne sur lui-même, s’enroule en spirale tout en sautillant autour de moi. Ses yeux sont devenus blancs.
Puis, il se laisse glisser, s’allonge dans l’herbe et observe, le regard au ras du sol, les paquets de mousses, les petits brins vert tendre, et les tapis de fleurs.
Il les touche, il les palpe.
Il les renifle bruyamment, capte par insufflation leurs subtiles fragrances, et colle ses yeux tout contre les peaux vertes des plantes, presque front contre front, comme s’il voulait voir au fond de leur être.
Il les lèche bruyamment, peut-être pour que l’élixir des sucs descendent au fond de sa gorge et empapillonne son âme.
Il ferme les yeux et se frotte le ventre.
Puis, quand un bruissement tinte dans un buisson, aussitôt le voilà qui se redresse comme un suricate à l’arrêt.
Sa tête fait trois tours sur elle-même comme dans le film l’exorciste, mais dans sa version rose-bébé-ça-fait-pas-peur.
Possédé, oui, mais par un gentil petit angelot espiègle déguisé en bisounours.
Quand il voit l’oiseau, qui était caché dans les herbes emmêlées, s’envoler vivement, il sursaute sous l’effet d’une heureuse surprise et sourit béatement.
Il salive de plaisir, bave un peu quand même, puis le montre d’un doigt boudiné d’enfant émerveillé.
Il suit sa course gracieuse dans le ciel d’azur, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, pétillants.
Je crois qu’il envie le bel oiseau.
Sa liberté. Sa légèreté.
La grâce innocente avec laquelle il plane dans les courants d’air parfumés de la forêt. Si belle.
C’est la première fois qu’il erre dans le bois.
Auparavant, il n’était jamais sorti de son appartement étriqué.
De sa vie rabougrie, comme un bonsaï desséché.
Trop stressé. Trop de choses à faire. Pas le temps.
Et maintenant, le voilà comme le sous-préfet au champ d’Alphonse Daudet.
Il découvre pour la première fois les chants obsédants et mélodieux des oiseaux. Les tiu-tiu-tiu de la sittelle qui répondent aux ti-tu-ti-tu de la mésange charbonnière, ou aux piuy-piuy des bouvreuils… mais celui qui le faire rire le plus, on ne sait pas pourquoi, mais on s’en doute, c’est le chant du bruant : zizi-zizi-zizi… ces conversations sont tellement joyeuses.
Et les couleurs de leurs plumes, soyeuses, souples. Toutes huilées au toucher.
Il les trouvait déjà belles ces plumes, et magnifiques ces chants, sans ne les avoir jamais ni vu, ni vraiment écouté.
Il avait entendu parler des hautes herbes qui vous caressent le mollet, et des petits sourires des écureuils, leur ricanement tressautant, espiègle et moqueur, sans les avoir jamais connu.
Et le visage apaisé de la forêt quand il fait nuit.
Il le connaissait déjà quand il était dans son lit, les yeux fermés, le cœur ouvert, son imagination en liberté.
Il a déjà sauté dans ses rêves par-dessus les petits ruisseaux et les flaques, miroirs de ciel, sur le chemin.
Il a déjà, dans ses songes, enjambé des arbres tombés à terre, mais il n’a jamais eu l’idée d’aller les ramasser, ni de les relever.
Qui prend soin de ces pauvres arbres qui tombent ? Vous n’iriez pas ramasser un être qui tombe par terre, vous ? Il me lance un sourire, celui d’un enfant débordé par une joie inconnue, et me dit dans les yeux : regarde, vois comme c’est beau ! C’est merveilleux.
En fait, je m’aperçois qu’il ne parle pas, mais je lis sur ses lèvres, et dans ses pupilles dilatées, cette extase, cet émerveillement.
Alors je me tais.
Juste je l’écoute.
J’écoute son bonheur.
Et les oiseaux dans la forêt, comme moi, se taisent pour laisser parler les mots de l’homme-enfant.
Il me dit qu’il sait maintenant comment voler.
Il me dit qu’il sait maintenant comment rêver.
Il sait les parfums et les peaux douces à caresser.
Son regard fier me dit qu’il sait aussi comment marcher dans la forêt.
Il me dit qu’il sait parler aux oiseaux et écouter le vent.
Il me dit qu’il n’est plus mort.
Qu’il est ressuscité. Alléluia !
Il étend largement ses bras et tourne sur lui-même tel un derviche transcendé par la grâce divine, le visage tourné vers le ciel, les yeux redevenus blancs, puis transparents… Il tourne, il tourne, il tourne… Puis il se fige, redresse la tête et plonge son regard dans le mien.
Il m’offre alors le plus beau sourire que personne ne m’a jamais adressé dans ma vie.
Très ému, je lui tends alors la main…
Et juste au moment de le toucher…
Hop, le visage heureux, il s’envole et disparaît loin là-haut, au-delà des tendres frondaisons.
Je l’aimais bien mon ami des villes.
Saignant ou à point
Très haut, au-dessus des arbres, un nuage passe dans le ciel. Bi-ploup, bi-ploup, tranquille. Il gratte au passage la cime du plus grand, un séquoia centenaire, et y laisse accrochés quelques lambeaux de coton blanc.
Sous la frondaison épaisse et protectrice, un gai pinson, habituellement très joyeux, est aujourd’hui tout craintif, un peu tremblotant.
Il rentre la tête dans les épaules et les épaules sous les ailes, en se dissimulant au mieux. Il observe, tout en bas, un chasseur qui passe.
Moi aussi je le vois arriver.
Nous sommes là, avec Jésunette, sagement assis en lotus, au pied d’un grand chêne avec lequel nous méditons.
Quand le dit chasseur passe près de moi, je lui souris.
Il ne me rend pas mon sourire, il le garde. Et fait la gueule.
Son visage souffre d’un rictus amer, comme s’il avait avalé quelque chose qui lui donnait des aigreurs.
Il avance d’un pas militaire en martelant le chemin, écrasant les petites herbes tendres et brutalisant les cailloux qu’ont rien fait de mal.
Même de loin, je peux sentir son haleine chargée de vin rouge à l’ail et son odeur corporelle indiquant une hygiène douteuse à forte tendance crasseuse.
Sa joue est lardée d’une grande cicatrice oblique, sans doute faite par un animal résistant à sa barbarie.
Un tatouage sombre lui mange une grande partie du cou.
Bien que dissimulé sous un col roulé miteux, j’arrive à entrevoir et à déchiffrer un étonnant : pardon maman.
C’est étrange.
Je me dis qu’il avait peut-être une mère végétarienne… En tout cas, sa panoplie de chasseur est au complet : tenue camouflage de guerre, le pas titubant, les yeux vitreux injectés de sang, les crocs jaunes sortis et le nez rouge bulbeux.
Venant de cueillir une fleur pour ma co-baladeuse, je me retrouve face à l’ogre et à son fusil menaçant.
Une étincelle s’allume dans ma tête. Je ne sais pas ce qu’il me prend mais, espièglement, je tends la fleur vers son visage… et je fais : Pan !
Bizarrement, il sursaute.
Furieux, sans doute contre son enfant intérieur qui s’est laissé amuser et charmer un court instant, il grogne, me bouscule et s’enfuit en écrasant de pauvres petits buissons innocents.
Mystère de l’inconscient. Association d’idée, un souvenir me revient.
Paris, dîner romantique, au restaurant.
A la table d’à côté :
— Comment vous la voulez votre entrecôte : à point, bleue, bien cuite ?
— Non, saignante. J’aime quand il y a du sang. Si ça ne saigne pas, on ne voit pas que c’est une bête qui a été tuée, massacrée, égorgée et dépecée. C’est moins drôle ! Ha ha ha !
Un rire gras accompagne la blague.
C’est alors qu’il s’est pris une volée de bois vert, quelques noms d’oiseaux, une grosse claque à cinq doigts, et un verre d’eau en plein visage.
Non, ce n’était pas moi.
Ma douce et pacifique compagne, au visage d’ange, a été plus rapide.
Quand le nez du monsieur s’est mis à saigner abondamment, ma petite amie ne put s’empêcher de l’imiter en disant d’une voix rocailleuse :
— Moi, je l’aime saignant, mon voisin de table. J’aime quand il y a du sang. Si ça ne saigne pas, on ne voit pas que c’est une bête. C’est moins drôle !
Vexé, le monsieur a d’abord glapi, puis grogné, nous a bousculé, et s’est enfui en piétinant le joli parterre de fleurs du jardin du restaurant !
Ayant instantanément retrouvé douceur et sourire, mon amie Jésunette me demande de sa petite voix de flûte :
— Donc, tu me disais que tu es inquiet car tu trouves que les nuages ont un peu grossi ces temps-ci… ?
Divagations champêtres
La grand’ rue des bois s’ouvre à moi, vaste, bien plus vaste que mon petit terrier d’appartement.
Le sol est doux et tiède sous mes pieds.
J’ai l’impression de marcher sur du duvet.
La terre est meuble et ça me change du bitume noir, enchewing-gumé et puant des rues des villes.
Alors, marchant pieds nus, je sens sous mes plantes la douce chaleur que la terre du sentier a emmagasinée tout au long de cette belle journée d’été ensoleillée.
Ça me remonte en bouffée tièdes le long des jambes et en petites vaguelettes de bien-être, jusque sur le sommet de mon crâne.
Tous mes chakras papillotent.
Les bruits se taisent à mon passage, puis reprennent dans mon dos.
C’est un peu comme si je transportais autour de moi une aura de silence qui crée son passage dans les bruissements de la forêt, effaçant toute perturbation pour imprégner chaque chose d’une plate sérénité.
Mes doigts sont moites et mon souffle est chaud.
Ma tête est vide et mes jambes semblent être animées de manière autonome.
Elles vont où elles veulent, me portent vers quelque chose d’inconnu, dotées semble-t-il d’une intention libre.
Je leur fais confiance. Je laisse aller, je suis mes pas.
J’ai entendu dire que mettre ses pas dans les pas de son père permet de ne pas laisser de traces de soi, ni sur le sol, ni dans la vie.
C’est très différent quand on marche dans la neige. On laisse des traces.
Je pense aussitôt aux chats qui posent les pattes arrière dans les traces des pattes avant lorsqu’ils marchent.
Alors, du coup, je me dis que suivre ses propres pas permettraient de laisser une double trace : celle de mes pas et celle de moi-même.
Ce n’est pas toujours vrai. Parfois certaines personnes marchent à côté de leurs pompes. Ces propos pourraient le faire croire, mais ce n’est pas mon cas.
Je marche dans mes pompes, sur mes pieds, là où mes pas et mes propos me portent. En toute confiance, libre et serein.
J’ai lâché prise depuis longtemps : mes pieds ont gagné leur indépendance et mon esprit divague librement.
Un cours d’eau équipé d’une petite cascade vient à ma rencontre et se met en travers de mon chemin.
L’opportunité d’une coupe de fraîcheur clignote. Attirante, obsédante.
Je m’approche donc.
Voyant un tas de pierres moussues surplombant l’eau vive, j’entreprends de l’escalader pour accéder à l’exquis élixir.
Je suis maintenant en équilibre insolite.
Un genou appuyé sur un rocher, une main me retenant à une branche basse couverte de vert-de-gris, sentant un agréable pourri forestier.
Je me penche vers l’eau fraîche qui chante sans complexe.
J’ai l’impression qu’elle fait comme si je n’étais pas là.
Je recueille une coupe de rivière des bois dans le creux de ma paume.
Je la porte à ma bouche et la boit goulûment, presque avec urgence.
J’ai conscience que ma vie dépend de cette rasade d’eau fraîche des forêts… Ce qui est le cas.
Mais ça passe de travers.
Je manque de m’étouffer. Je tousse, je crachote… J’ai fait une fausse route.
Les vieux, à la cacochymie avancée, adorent faire ça à l’hospice pour affoler les soignants. Ça les distraie. S’ennuient tellement… Non, on ne peut pas dire : ils s’ennuient, car ils n’existent plus.
Manquant d’air et de foi, je prends alors de grandes goulées d’air, avec avidité.
J’inspire fort en faisant de grands huuu, huuu, comme si ma vie en dépendait… Ce qui est toujours le cas.
Dès que j’ai rétabli un certain équilibre air et eau, je recommence.
La main en coupe, je prélève de l’eau, claire et fraîche, et la porte à ma bouche.
L’eau éclabousse l’émail blanc de mes dents et coule sur mon menton.
Je m’éponge d’un revers de manche négligeant le vent qui me fouette le visage et semble me dire : ça suffit maintenant.
À nouveau je recueille l’eau précieuse et vivifiante du ruisseau devenu torrent, comme s’il n’était pas content.
Encore et encore.
J’ai bien le pressentiment que l’eau est sacrée, qu’il ne faut pas la gâcher.
Aussi, dès que je suis rassasié, je cesse de prélever l’eau de la forêt.
Je la laisse aller, courir à travers les creux et les bosses de son lit.
Constatant que j’ai cessé de l’importuner, la voilà maintenant calmée.
Elle glisse tranquillement entre les berges verdoyantes vers son destin.
Je crois qu’elle a envie de retrouver sa mère et la mère de sa mère.
Sa grand-mère, la grande mer.
Elle a sans doute aussi d’autres bouches assoiffées à satisfaire.
Elle a d’autres fleurs des champs à irriguer, d’autres oiseaux à abreuver.
Et elle a surtout tout le petit peuple de la forêt à enchanter de son chant mélodieux… Ayant pris conscience de ces belles choses qui font la vie dans la forêt, je reprends la grand’rue des bois qui s’ouvre à moi.
Bien rafraîchi.
Bien sûr, chez moi, je peux aussi marcher sur le sentier moelleux de ma moquette, couleur terre, qui va du séjour à la salle de bains.
Je peux aussi prendre, dans la coupe de mes mains, l’eau du robinet et m’en rassasier en fermant les yeux pour me faire croire que...
Mais ici, dans cette immense forêt, l’herbe est tellement plus verte, l’eau est tellement plus transparente, les oiseaux sont tellement plus chantants… Mais surtout, dans cette forêt, c’est tellement plus vaste que mon terrier d’appartement.
Tendre balade forestière
Nous nous baladons dans la forêt.
C’est une forêt que je ne connais pas mais qu’elle m’a gentiment proposé de découvrir.
Je ne te dis rien, m’a-t-elle dit.
Déjà, j’ai trouvé ça bizarre. Elle me dit qu’elle ne me dit pas…
— C’est-à-dire ?
— Il n’y a rien à dire. On peut y aller les yeux fermés. Suis-moi.
Forêt inconnue, pas parler, les yeux fermés… J’ai confiance, je ferme les yeux et marche.
— Euh, quand je dis : les yeux fermés, c’est une façon de parler. Si tu ne regardes pas où tu vas, si tu te bouches les yeux, tu vas tomber, te briser, te disloquer, t’écraser, te fracasser, te fracturer, te rompre les os… tous les os… même l’os du zizi… hihihi !
J’admire son vocabulaire, tout en étant un peu embarrassé par l’allusion intime. En général, je ne comprends pas tout ce qu’elle dit.
Un minois charmant et une certaine tendance à dire de manière douce des choses épouvantables, ou d’une grande beauté d’âme... ou gênantes.
Ça dépend du vent.
— Mais, tu m’as dit…
— Chuuut, tu ne dis rien, je ne dis rien, il n’y a rien à dire. Suis-moi.
Une fois qu’elle m’a réglé, nous voilà partis.
Elle est en éclaireur.
Silencieuse.
Moi, je marche dans l’ombre de son silence, discret et un peu inquiet.
Parfois je ris sous cape, comme si je chuchotai, pour conjurer ma peur d’affronter la forêt mystérieuse.
Aussitôt, elle se retourne, me toise l’air mi-interrogatif, mi-amusé, mi-reproche :
— Heu, j’te fais rire ? ! C’est mon slogan écrit au dos de mon manteau qui te fait marrer : les pattes de lapin ça porte bonheur… mais pas aux lapins !
— Non, non… juste je tousse. J’aime bien tousser.
Elle se racle un peu la gorge, genre j’ai des doutes, puis la voilà qui reprend sa marche d’un pas vaillant.
Je la vois laisser courir ses longs doigts fins sur le tronc des arbres écaillés et grenus, minutieusement travaillés, sans doute par les elfes du bois.
Elle en palpe le moindre creux, la plus petite fissure, et les bosses et les écorchures, avec une tendre attention.
Je me dis qu’elle joue à l’infirmière de la forêt.
Parfois, elle colle son nez contre le tronc de l’arbre et scrute le moindre petit détail en louchant, en respirant par petites bouffées, et en se servant de ses yeux comme de deux loupes bleues.
Je sens qu’elle fait ça avec un réel intérêt pour cet arbre qu’elle regarde dans les yeux avec une sincère curiosité et une grande empathie. Avec amour.
Puis, quand elle a bien exploré, elle remercie : elle caresse lentement le vieux tronc poussiéreux et rugueux qui semble réagir en frémissant, paraissant dire dans sa langue de bois : je vous en prie, tout le plaisir est pour moi.
Je note un autre détail étrange : sous ses pieds menus, aucune feuille morte ne craque, ni ne se casse en petits morceaux de bras cassés de feuilles.
Sa petite bouche minuscule fredonne un air mélancolique inaudible, mais que sûrement les oiseaux entendent.
Je les sens et je les vois se regrouper sur les branches alentour.
Ils sont curieux de cette étrange créature pâlichonne, suivie par un drôle d’humain craintif et pataud.
Parfois elle trébuche, j’imagine qu’elle le fait volontairement comme pour attirer mon attention.
En effet, aussitôt mon cœur se serre un peu, tel un poing crispé, et je tends fébrilement mes bras en avant tout en me précipitant vers elle comme pour tenter de rattraper une soucoupe de porcelaine en train de se jeter dans la gueule de loup d’un sol briseur de tasse.
Etrangement, feignant de chuter, elle tourne vers moi son joli visage.
De porcelaine. Bien sûr.
Dans le regard instable de ses yeux bleus métalliques tremblote une petite lueur tendre et intimidée. Ses beaux yeux, pleins de ce que nous sommes, me font un petit sourire en coin.
Elle m’a testé, ça a marché.
Et ça la fait rire doucement. Gentiment.
Tout en marchant, le plus discrètement possible pour la laisser libre, je me fais des petits films : des lèvres pleines de sang qui se frôlent, qui se posent sur les peaux échauffées, des baisers délicats, puis des bouches chaudes et humides qui s’embrassent à en perdre le souffle, des renversades sur l’herbe et des entremélages coquins sur la mousse du sous-bois…
Un peu grisé par mes pensées polissonnes, je souris béatement, en marmonnant, en transpirant abondamment et en bavant un peu…
Et c’est alors que je m’aperçois qu’elle s’est arrêtée et que, depuis un bon moment, elle me regarde d’un petit air ironique et amusé.
— Tu fais quoi, là ?
— Ben, je marche dans la forêt, tient !
— Ça a l’air de te faire un sacré effet, tu es tout rouge !
— C’est que j’ai chaud. Pouh, fait chaud là, non ? !
— En plein hiver ? Il fait -5° sous zéro, je te signale.
— Ah bon ? Zou séro ? Pas fait gaffe.
Elle n’est pas dupe, elle me connaît.
Elle reprend la balade, moi en remorque.
Tout confus, vexé d’avoir été pris en flagrant délit de sentiments éhontés, j’essaie de rétablir un minimum de tenue.
Balade avec Jésunette, tenue correcte exigée !
Même dans la forêt.
Surtout dans la forêt.
C’est chez elle.
Elle marche, tranquille, en prenant tout le temps.
Du coup, je me rend compte qu’il n’en reste pas pour moi, c’est pourquoi je suis toujours obligé de me précipiter après elle, comme si elle courait et que je n’arrivais pas à la suivre.
Je suis déjà bien chamboulé quand une légère brise me parvient, pleine de son odeur de chair tendre, de sa senteur de fleurs, de sa fraîcheur innocente.
J’hume avec délice cette air délicatement parfumé d’elle.
Je sais reconnaître quand ça sent la forêt, ou quand ça sent la terre après la pluie et, bien sûr, quand ça sent elle.
Alors je suis là, le nez en l’air, les yeux fermés… sourire aux lèvres… C’est alors que je me tamponne un arbre.
Ah non, ce n’est pas un arbre, c’est elle !
Mince, pas pu freiner.
— À quoi tu joues ? À colin-maillard ?
— Ben non, je marche dans la forêt, tient ! (J’ai l’impression de me répéter)
— Les yeux fermés ? !
— Et bien sache que les yeux fermés ou les yeux ouverts, la forêt est la forêt.
— Tu as eu de la chance de me tamponner moi au lieu de tamponner un arbre.
— Ah mais oui, tout à fait d’accord : je préfère nettement te tamponner toi. J’adore ça d’ailleurs…
— Hum, hum… et si nous reprenions notre balade matinale ?
— Ah oui, oui. Bô oui… t’as raison. Promenade. Forêt. Pas tamponner. J’ai compris.
Je la vois se retourner un peu rapidement et reprendre sa marche d’un pas plus pressé que tout à l’heure.
Je l’entends même discrètement se racler la gorge.
Quelque chose se serait-il passé ? Quelque chose qui l’aurait touché ? Serait-elle émue ? Je me dis que cette fille est un vrai bac à sable.
Avec elle, je retrouve mon âme d’enfant et je m’y amuse terriblement.
Je chasse d’un petit geste de la main une mouche curieuse, mes réflexions et mes interrogations.
Et je prends la résolution de rester bien concentré sur notre balade.
Ma conscience littéraire me signale que je viens de faire un petit zeugma pas à piquer des hannetons… Mon esprit part si vite dans l’ailleurs… Je me sermonne et me reprogramme. Respirer. Concentré. Balade. Tranquille.
Je respire un bon air calme.
Inspiration. Activation des bons sentiments.
Expiration. Épilation des pensées beurks.
Je prends conscience qu’en dehors de la forêt, l’air n’est pas le même.
C’est l’air des villes, l’air des voitures, l’air des gens qui parlent fort… Ici, j’en profite et je renifle à plein nez l’air du dedans.
Il contient des effluves boisés, des senteurs entêtantes et herbeuses, et aussi son doux parfum, celui de la peau de rose de Jésunette… Subjugué par cette émanation jésunistique, je renifle fort et ma poitrine se soulève comme si j’avais des petits spasmes… Elle choisit ce moment pour s’inquiéter :
— T’es enrhumé ?
— Beuh, non. Pourquoi tu dis ça ?
— Ben, rien. C’est juste que j’entends renifler très fort derrière moi, dans mon dos. J’ai même cru que c’était un sanglier.
— Un sanglier ? ! Un gros sanglier monstrueux avec des cornes pointues et des crocs tranchants ? dis-je, pris d’un début de panique.
— Pououh ! Bon, laisse tomber. Allez, renifle et suis-moi.
Et nous reprîmes la jolie balade, elle respirant la douce odeur de la mère-forêt, moi la respirant.
Pas la forêt.
Elle.
Puis, j’ai une sensation bizarre.
J’ai l’impression que la forêt s’est transformée.
Maintenant, elle est pleine de nous.
La lumière a changé, le silence a changé, le chemin n’est pas le même que celui que j’ai parcouru tout au début de notre balade.
Je sens que nous aussi nous avons changé.
La forêt nous a changé.
Comme un petit animal qui, se sentant en sécurité, pointe son museau, il y a quelque chose d’intime qui se manifeste en moi.