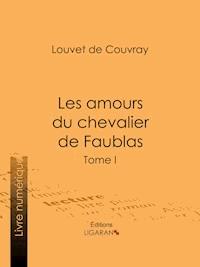
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "On m'a dit que mes aïeux, considérés dans leur province, y avaient toujours joui d'une fortune honnête et d'un rang distingué. Mon père, le baron de Faublas, me transmit leur antique noblesse sans altération ; ma mère mourut trop tôt. je n'avais pas seize ans, quand ma soeur, plus jeune que mois de dix-huit mois, fut mise au couvent à Paris."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il y a peu de proportion entre la justice et la curiosité des hommes. La plupart ont tant d’ardeur pour les fictions, et si peu d’amour pour la vérité, qu’on est presque toujours sûr de parler d’un objet nouveau quand on rappelle un souvenir qu’il faudrait honorer, une action, une vie qui mériteraient des hommages. On sait ce qu’il est indifférent de savoir ; on ignore ce qu’il conviendrait d’admirer. C’est ainsi qu’en mettant sous les yeux d’un public distrait cette belle édition d’un livre qu’il a déjà tant de fois parcouru, nous n’avons la prétention d’apprendre à personne ce que c’est que le CHEVALIER DE FAUBLAS, une idole de boudoir, un héros de bonne compagnie, libertin quelquefois sensible, toujours spirituel et Français ; mais nous craignons d’avoir à instruire un grand nombre de lecteurs, si un grand nombre de lecteurs affronte cette courte préface, de ce que fut l’auteur de ce brillant et frivole ouvrage. Étrange différence entre la vie de l’écrivain et celle du héros ! l’une est toute voluptueuse, l’autre semée de combats, de périls, et de souffrances. Et quelle imagination a tissu les fils légers de ces riantes fictions ? celle d’un homme de probité et de mœurs rigides ; membre illustré de cette Convention si funeste ; député de la Gironde ; le premier agresseur de Robespierre ; un martyr enfin de la cause de la liberté.
Jean-Baptiste Louvet de Couvray était né à Paris dans l’année 1764. Sa jeunesse, consacrée à l’étude, n’offrit rien de remarquable. Destiné à la profession d’avocat, mais rebuté par une occupation peu conforme à ses goûts, il se livra à la littérature. Son début fut ce même roman de Faublas, dont la première partie fut publiée en 1787. Un style vif et piquant, beaucoup de vérité dans une vaste série d’évènements, des détails rendus avec grâce, firent de cette production un livre à la mode.
Ce n’est pas que Louvet dépeigne toujours avec une rigoureuse exactitude la société qu’il met en scène ; ses personnages sont plutôt conçus qu’étudiés ; mais le monde qu’il se crée n’est pas hors de la nature ; les passions qu’il fait agir, sont les nôtres ; et il est doux quelquefois d’oublier une affligeante réalité, pour parcourir, sans contrainte, les champs de l’imagination. Le marquis de Lauraguais donne aux aventures de Faublas une origine historique. Selon lui, ce personnage vivait sous Louis XIV, et s’appelait l’abbé de Choisi. Étant prêtre et faisant sa cour à madame de Maintenon pour en obtenir quelque bénéfice, il lui dédia une traduction qu’il fit de l’imitation de Jésus-Christ, avec cette épigraphe saintement plaisante : Concupiscit rex decorum tuum, et qu’on ne peut traduire, dit-il, un peu décemment qu’ainsi : Tes charmes ont excité la concupiscence du roi. Ce même abbé de Choisi publia ses Mémoires sous le nom d’une femme, la comtesse des Barres, et il avait joué ce rôle de femme auprès de plus d’une marquise de B ***, et de plus d’une comtesse de Lignole.
Quoi qu’il en soit, Louvet vécut longtemps à la campagne près d’une femme à laquelle, depuis la plus tendre enfance, il était passionnément attaché. Un hymen forcé les avait en vain séparés ; libres après six ans d’absence, ils s’étaient réunis pour ne plus se quitter. Heureux par ses affections et sa philosophie, Louvet poursuivait son ouvrage dont les premiers fruits suffisaient à ses besoins : éloigné du monde, il se croyait à l’abri de ses orages. Mais la révolution avait éclaté : avec la bastille tombait le joug qui pesait sur la France. Louvet reçut la cocarde tricolore des mains de cette Lodoïska, que nous connaîtrons plus tard, et dont il a attaché le nom au plus pathétique épisode de son ouvrage. Cet acte de liberté devint la cause d’une persécution que Louvet eut à subir de la part de quelques gentilshommes du voisinage. Il se rendit à Paris.
Une brochure qu’il publia contre M. Mounier, de l’assemblée constituante, après l’affaire d’octobre 1789, lui valut l’entrée au club des jacobins. Ce club n’était ouvert, alors, qu’au patriotisme et aux talents. Louvet, lancé dans la carrière politique, fit paraître Émilie de Varmont et les Amours du curé Sévin, roman qui avait pour but de prouver la nécessité du divorce, et du mariage des prêtres. Ce livre obtint quelque vogue dans sa nouveauté, bien qu’on y reconnût à peine la plume de son auteur. Il composa, à la même époque, trois comédies : une seule fut représentée ; elle avait pour but de tourner en ridicule les troupes rassemblées à Coblentz.
Exempt d’ambition, Louvet ne paraissait que rarement dans les assemblées populaires. Persuadé que la force des choses amènerait les réformes qu’on avait droit d’attendre, il restait dans les rangs obscurs de la révolution dont il s’imposait toutes les charges, avec une entière abnégation de ses propres intérêts. Toutefois dès qu’il apprit qu’un parti conspirait contre la constitution jurée, et que parmi les mandataires du peuple plusieurs s’étaient vendus au pouvoir, il se crut obligé de descendre à son tour dans la lice. Le 25 décembre 1791, il se présenta à la barre de l’assemblée législative, à la tête d’une députation de la section des Lombards, pour provoquer un décret contre les princes émigrés et la guerre contre les souverains qui s’armaient en leur faveur.
« Nous vous demanderons, dit l’orateur aux députés de la France, qu’entre nous et les rois Dieu soit appelé pour juge, et qu’il décide enfin s’il fit le monde pour quelques hommes, ou s’il ne voulut pas que les hommes appartinssent au monde. Nous vous demanderons un fléau terrible, mais indispensable ; nous demanderons la guerre ! Se pourrait-il que la coalition des tyrans fût universelle ? Prompts comme la foudre que des milliers de nos citoyens se précipitent sur la féodalité, et ne s’arrêtent qu’où finira la servitude ; qu’on dépose la déclaration des droits dans les chaumières ; que l’homme, en tous lieux, instruit et délivré, reprenne le sentiment de sa dignité première ; que le genre humain se relève et respire. »
Louvet devint plus assidu au club dont il faisait partie ; il parla avec beaucoup de force lorsqu’on discuta la question de la guerre contre l’Autriche. Robespierre le combattit. La réplique de Louvet accabla son antagoniste, qui lui voua depuis une haine implacable. Les ministres qui tous voulaient la guerre, furent charmés d’avoir trouvé dans Louvet un puissant auxiliaire. Pour lui témoigner leur reconnaissance et leur estime, ils le désignèrent pour le département de la justice. Effrayée de cette résolution, la faction ennemie employa toutes ses ressources pour la combattre. On n’épargna ni les menaces ni les calomnies, et le portefeuille fut confié à un homme nul. Cette faiblesse du gouvernement enhardit des adversaires qu’il avait cru calmer par une condescendance. On sait jusqu’à quel point ils poussèrent depuis leur audace.
Lié d’une étroite amitié avec le ministre Rolland, dont l’hôtel était le rendez-vous des partisans d’une sage liberté, Louvet devint l’âme de ses conseils. Ce vertueux citoyen le chargea de rédiger la Sentinelle, journal-affiche qu’il destinait à neutraliser les funestes doctrines des démagogues. Louvet en s’acquittant de cette tâche n’observa pas toujours les principes d’une rigoureuse justice, et son excès de zèle pour la liberté lui fit perdre l’ambassade de Constantinople, que Dumouriez, alors tout-puissant, lui destinait. Ses amis crurent réparer cette disgrâce en lui offrant la place de commissaire à Saint-Domingue ; mais il la refusa, pour ne pas quitter sa patrie au moment où elle était en proie aux plus épouvantables convulsions.
Louis XVI était dans les fers, et la Montagne s’élevait sur les débris de la royauté : la Convention, à peine formée, était déjà en butte à de violentes attaques. Ceux de ses membres qui professaient des opinions honorables, voyaient planer sur leurs têtes le fer des terroristes. Louvet, que le département du Loiret avait spontanément choisi pour le représenter, méritait l’honneur d’une proscription spéciale. Il n’avait vu, dans la journée du 10 août, que le salut de la France ; mais son erreur ne dura pas longtemps. Il entrevit bientôt qu’un grand amour pour la république pouvait servir de masque à d’ambitieux projets. Persuadé, d’ailleurs, que les fureurs révolutionnaires ne tendaient à rien moins qu’à faire regretter l’ancien ordre des choses, il déclara une guerre à mort à la faction des cordeliers. En vain lui fit-elle des offres de rapprochement, pouvait-il en exister entre une âme si généreuse et cette horde de bourreaux ? Un rapport de Rolland à la Convention lui fournit l’occasion de faire éclater son indignation. Robespierre, qu’on y désignait comme aspirant à la dictature, se leva pour se justifier. « Quoi, disait-il, il suffirait, pour nous interdire la parole, que quelques intrigants abusassent de votre confiance et de l’immense autorité dont vous êtes investis ! Quoi ! lorsqu’ici il n’est pas un seul homme qui osât m’accuser en face en articulant des faits positifs contre moi ; lorsqu’il n’en est pas un qui osât monter à cette tribune, et ouvrît avec moi une discussion calme et sérieuse…
Louvet (l’interrompant) : Je demande la parole pour accuser Robespierre !
Aussitôt il s’élance à la tribune, et en commençant son discours, il trace aux yeux de l’assemblée la marche suivie aux jacobins pour attaquer les meilleurs patriotes. Il fait remarquer que l’empire de la parole y est exercé par un individu que prônent sans cesse quelques orateurs fougueux. Revenant ensuite sur la journée du 10 août, il reproche à Robespierre de s’en être attribué les profits ; d’avoir accusé les représentants d’être d’intelligence avec l’ennemi, la veille même des assassinats de septembre, et d’avoir fait fermer les portes de Paris, au mépris d’un décret contraire. Il déclare que le but des conjurés était d’obtenir une coalition entre les municipalités, et leur réunion avec celle de la capitale qui devait être le centre de l’autorité commune, afin de renverser le gouvernement.
« C’est dans le cours de ces manœuvres, poursuit-il, qu’on désignait tous les ministres comme des traîtres ; un seul était excepté, un seul et toujours le même. Puisses-tu, Danton, te justifier aux yeux de la postérité de cette flétrissante exception ! C’est alors qu’on vit reparaître sur la scène un homme unique jusqu’ici dans les fastes du crime. Eh ! ne croyez pas nous donner le change en désavouant aujourd’hui cet enfant perdu de l’assassinat ; s’il n’appartenait pas à une faction, comment se ferait-il que ce monstre sortît vivant du sépulcre où lui-même s’était condamné ?… pourquoi le produisîtes-vous dans cette assemblée électorale que vous dominiez par l’intrigue et par la terreur, vous qui me fîtes insulter pour avoir demandé la parole contre Marat ?… Dieux ! J’ai prononcé son nom ! cet être fut désigné comme candidat dans un discours où Robespierre venait de calomnier Priestley.
Robespierre ! je t’accuse d’avoir longtemps calomnié les plus purs patriotes, à une époque où tes calomnies étaient de véritables proscriptions ; je t’accuse d’avoir, autant qu’il était en toi, méconnu, avili, persécuté les représentants de la nation ; d’avoir souffert que devant toi on te désignât comme le seul homme vertueux de la France qui pût sauver le peuple, et de l’avoir fait entendre toi-même ; je t’accuse d’avoir tyrannisé par tous les moyens l’assemblée électorale ; je t’accuse enfin d’avoir évidemment marché au pouvoir suprême ; je t’accuse : et, pour te confondre, ta conduite parlera plus haut que moi. »
Robespierre crut toucher à sa dernière heure. Si Péthion, Guadet et Vergniaud eussent répondu aux fréquentes interpellations de Louvet, le monstre eût été étouffé. Mais lorsqu’après huit jours, Robespierre vint balbutier pour sa défense quelques phrases banales, les Girondins se levèrent avec la Montagne pour empêcher Louvet de répliquer : Ils pensèrent qu’un ordre du jour flétrirait assez Robespierre ; comme si le déshonneur était un obstacle au crime ! Leur erreur du moins fut vertueuse ; ils ne purent croire à tant de perversité, que le jour où ils en tombèrent les victimes.
Louvet, réduit au silence, fit imprimer son discours, sous ce titre : À Maximilien Robespierre et ses royalistes. Dans cette brochure, il développa les intrigues et les projets du parti d’Orléans et du club des Cordeliers, qui tendaient, dit-on, au même but. Pour leur porter une atteinte non moins sensible, il demanda l’expulsion hors du territoire de la famille qui avait régné. Cette hostilité s’adressait directement au duc d’Orléans, le seul de ces princes qui n’eût pas quitté la France, et qui, membre de la Convention, espérait monter sur le trône.
Louvet, lorsque Louis XVI fut mis en jugement, insista avec force pour la question de l’appel au peuple et protesta que, si elle ne passait pas, aucune puissance humaine ne pourrait le contraindre à voter. Quoique son opinion fût peu favorable au monarque, son cœur cherchait à concilier les devoirs du représentant et les droits de l’humanité. Il était convaincu qu’en investissant la nation de la souveraineté, on ferait disparaître l’influence des partis, et dans cette grande circonstance, en réveillant chez tous les citoyens le sentiment de leurs forces et de leur dignité, on écraserait les factieux.
L’appel au peuple ayant été rejeté, il fallut appliquer la peine. « Représentants, dit Louvet, après avoir renouvelé son opinion, vous allez prononcer un jugement irréparable ; puisse le génie tutélaire de ma patrie détourner les maux qu’on lui prépare ! puisse sa main toute-puissante vous retirer de l’abyme ou quelques ambitieux auront contribué à vous précipiter ! puisse sa main vengeresse écraser les nouveaux tyrans qu’on nous garde ! Les dangers de la république deviennent immenses et pressants. Mais son salut est encore dans vos mains. Gardez de passer vos pouvoirs ; rendez hommage aux droits de ceux qui vous ont envoyés ; et si, pour avoir rempli vos devoirs, vous devez tomber sous le poignard, vous tomberez du moins dignes de regret, dignes d’estime. Le temps, les hommes, les circonstances peuvent changer. Mais les principes ne changent jamais ; je ne changerai pas plus que les principes. »
La voix de Louvet fut une de celles qui ne comptèrent pas pour la mort.
L’appel nominal était à peine terminé, qu’on remit au président deux lettres dont Garan-Coulon demanda la lecture. Mais Danton s’étant levé, empêcha ce représentant de motiver son opinion. Le fougueux Louvet lance sur lui des regards terribles, et s’écrie : « Tu n’es pas encore roi, Danton ! quel est ton privilège pour étouffer nos voix ? »
Louvet se prononça avec la même force en faveur du sursis. Son courage et son éloquence semblaient s’accroître avec les dangers. Ce fut à son sang-froid et surtout à sa prévoyance active, que les Girondins durent leur salut dans la journée du 10 mars. On sait qu’à cette époque, le général Dumouriez, battu à Nerwinde, cherchait à sauver sa tête en négociant au-dehors avec Cobourg, au-dedans avec la faction d’Orléans. Robespierre, Danton et Marat étaient, chacun avec des vues différentes d’ambition personnelle, les principaux agents de ce parti, et Louvet n’a jamais douté que, vendus aux puissances, mais en même temps tous prêts à s’emparer de l’autorité, si l’occasion devenait favorable, ils dirigeaient leurs crimes d’après ce double intérêt. C’est ainsi qu’il en avait parlé aux Girondins, mais aucun d’eux n’osait faire de cette hypothèse la base de sa conduite politique. Aussi disait-il souvent : Ces hommes courent à l’échafaud ; il faudrait promptement me séparer d’eux, si leur cause n’était pas celle du devoir et de la vertu.
Le hasard vint enfin dessiller leurs yeux. Un ami de Guadet, récemment sorti des prisons d’Autriche, lui apprit que le général Cobourg se flattait que vingt-deux têtes tomberaient avant peu dans la convention. Le représentant rit d’abord de cette étrange prophétie ; mais quel fut son étonnement, lorsque huit jours après le maire Pache se présenta à la barre de l’assemblée pour demander au nom des sections de Paris la proscription de vingt-deux membres. Une telle coïncidence de nombre frappa vivement les Girondins ; sur-le-champ ils dénoncèrent Marat, et obtinrent contre lui un décret d’accusation. Si cette mesure fut illusoire, il n’en resta pas moins démontré combien était juste la pensée de Louvet.
Les dangers dont il était de plus en plus menacé, ajoutaient à sa véhémence ordinaire. Dans les séances du 20 avril et 19 mai 1793, il s’éleva contre la commune de Paris, et la dénonça comme ayant établi une correspondance factieuse avec les quarante-quatre mille communes de la république ; comme employant les deniers destinés à l’approvisionnement de la ville à faire colporter ses arrêtés ; et comme se livrant à de scandaleuses orgies, dans lesquelles plusieurs Municipaux avaient forcé les épouses et les filles des suspects à danser devant eux, et leur avaient jeté ensuite les restes de leur table. Plus tard il embrassa la défense des pères de famille que l’infâme Léonard Bourdon avait fait arrêter à Orléans.
De si généreux efforts ne purent arrêter les progrès de La Montagne ; trop peu de patriotes avaient l’intrépidité de Louvet ; trop peu de Girondins savaient, comme lui, affronter et combattre les conspirateurs autrement que par des discours. Les clameurs des tribunes étouffaient leurs voix éloquentes, et Robespierre avait pour lui les ordres du jour d’un centre toujours officieux et toujours servile. L’issue du combat ne fut pas longtemps douteuse : Louvet, compris dans une nouvelle liste de proscription, portée le 31 mai à la convention par la municipalité de Paris, fut décrété d’accusation le 2 juin. Pendant quinze jours il demeura caché dans la capitale, incertain du parti qu’il devait prendre ; informé enfin que plusieurs de ses collègues dirigeaient à Caen l’insurrection qui y avait éclaté, il n’hésita pas à s’y rendre lui-même. Mais dans la Normandie, comme partout, La Montagne avait ses agents, et l’armée d’Évreux promptement désorganisée, attesta leur présence dans ses rangs. Le général Wimpfen, qui la commandait, profita de cette circonstance pour offrir aux proscrits l’appui de l’Angleterre. Leur réponse fut telle qu’on devait l’attendre ; ils préfèrent un noble exil à des secours qu’il eût fallu acheter par une trahison.
Louvet suivit en Bretagne le bataillon du Finistère qu’on venait de licencier. Sous cette égide, il échappa aux dangers dont les tyrans environnent ses pas. Mais contraint de continuer sa route, avec ses seuls compagnons d’infortune ; il revêtit comme eux le costume de Volontaires et s’engagea dans les sentiers les plus impraticables. Un seul trait, puisé dans les récits de Louvet, peindra les fatigues et les tourments de cette marche. « Il était huit heures, et il y en avait trente et une que, depuis notre demi-couchée à Roternheim, nous nous traînions de piège en piège, de faux pas en faux pas. Nous tombions de fatigue, de sommeil et de faim. Nous étions couchés dans l’eau ; car l’orage était si fort que, malgré de grands arbres, la pluie tombait sur nous par torrents. Il paraissait impossible que le plus robuste résistât à une telle situation. Je l’avoue, l’heure du découragement était venue ; Riouffe et Girey-Dupré, dont l’inépuisable gaieté s’était soutenue jusqu’alors, ne nous donnaient plus que des sourires. Le bouillant Cussy accusait la nature ; Salles se dépitait ; Buzot paraissait accablé ; Barbaroux même sentait sa grande âme affaiblie ; moi je voyais dans mon espingole notre dernière ressource. Péthion seul, et c’est ainsi que je l’ai vu dans toute cette route, Péthion, inaltérable, bravait tous les besoins, gardait un front calme au milieu de ces nouveaux périls et souriait aux intempéries d’un ciel ennemi. »
Louvet, après avoir rejoint à Quimper, sa fidèle Lodoïska dut se résoudre à une plus longue séparation. Il ne restait plus d’asile sûr dans la Bretagne, et les députés firent voile vers la Gironde, où ils espéraient trouver de nombreux partisans. Les gouffres de l’océan furent moins impitoyables que cette terre, objet de tous leurs vœux. À peine en avaient-ils touché le sol, qu’une légion d’ennemis fondit sur leurs traces. C’est dans les Mémoires même de Louvet qu’il faut chercher ce tableau déchirant. On y verra des hommes vertueux lutter péniblement contre des dangers de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes, affaiblis par de longues fatigues, exténués par de dures privations, chercher vainement une place où ils pussent reposer leurs têtes ; on verra le pays dont ils ont illustré le nom, refuser un appui à leur misère, et ne leur présenter, au lieu d’un refuge inviolable, que des poignards menaçants. Ils avaient compté sur des amis ! en est-il pour les infortunés ? pas une porte ne s’ouvre pour les recevoir ; les citoyens dont ils allaient toucher les foyers, s’effrayant d’autant plus qu’ils avaient professé les mêmes opinions, regardaient la seule présence de ces proscrits comme un crime dont il eut fallu se purifier, et attendaient en frémissant le moment de leur départ.
Mais Louvet reconnut aussi que les grands cœurs s’élèvent et s’épurent au milieu de ces adversités qui enfantent la corruption chez la plupart de hommes. Les âmes fortes ne calculent ni l’étendue des périls, ni les difficultés qui les environnent ; elles n’envisagent que la grandeur d’une entreprise ou la gloire d’un sacrifice ; pour agir elles n’attendent point d’impulsions étrangères, et s’élèvent sans effort au plus haut degré de l’héroïsme. Telle parut Charlotte Corday lorsqu’elle se prépara à délivrer son pays ; telle, dans la Gironde, madame Bonquey déroba les proscrits à la rage de leurs oppresseurs ; mais cette femme dont l’hospitalité était le seul crime, tomba bientôt sous le glaive des bourreaux.
Les députés, désormais sans appui, se séparèrent pour échapper aux recherches et se dirent un adieu qui devait être éternel. Plus à plaindre dans leur isolement, ils sentirent s’affaiblir cette puissance de l’âme, qui fait supporter avec calme et même avec quelque orgueil, d’injustes persécutions. Pour eux plus d’illusion de bonheur public et de liberté ; la tyrannie les enveloppe, les resserre, les menace ; la vie ne se présente à eux que comme un douloureux supplice.
Louvet est encore capable d’une résolution : irrité, et non abattu par le poids des outrages, il repousse d’indignes terreurs, et jure de s’y soustraire. Au moment de commencer cette grande entreprise, il écrivait : « Je vous l’ai dit cent fois : il y a des extrémités au-delà desquelles on ne doit pas traîner la vie. Cent fois je vous ai prévenus que, lorsque j’en serai à ce point de détresse, au lieu de me tirer un coup de pistolet, je me mettrai sur la route de Paris. Mille à parier contre un que je n’arriverai pas, je le sais ; mais mon devoir est de le tenter. Ce n’est qu’ainsi qu’il m’est permis de me donner la mort ; ma famille, mes amis de vingt ans ont encore sur moi cet empire. Il faut que mes amis sachent qu’abandonné du monde entier ; je leur ai donné ce témoignage d’estime de ne pas désespérer d’eux, et de tenter un dernier effort pour m’aller reposer dans leurs bras. Il faut surtout que Lodoïska voye qu’en tombant j’avais encore le visage tourné vers elle !
« Je pars. Vous allez jouir d’un spectacle digne de quelqu’attention ; vous allez contempler un homme, un homme seul aux prises avec la fortune et devant un monde d’ennemis. »
Il suffit de se rappeler le temps où Louvet conçut une idée si hardie, pour apprécier les justes motifs de crainte qui auraient dû l’en détourner. Toutefois il parvint à l’accomplir, et arriva sain et sauf au milieu de la capitale. Mille fois il avait cru toucher à sa dernière heure, son imperturbable sang-froid lui fit surmonter tous les obstacles. Là, il apprend, sans verser de larmes, la fin tragique de madame Rolland ; ailleurs, l’apologie de Marat n’excite ni son indignation ni sa colère ; plus loin un voyageur, en s’adressant à lui, chante une romance de Faublas ; un geste, un mot pouvaient le trahir : et le couteau fatal était incessamment sur sa tête.
« Au reste, ajoute-t-il lui-même, il faut avoir été proscrit pour savoir comme il est difficile et gênant d’avoir, à chaque instant du jour, ses pas à mesurer, son haleine à ne pousser que doucement, un éternuement à étouffer, un rire, un cri, le moindre bruit à réprimer. Cette contrainte, si petite en apparence, devient douleur, péril et tourment par sa continuité. »
Louvet avait rejoint Lodoïska, mais ses cruelles épreuves n’étaient point à leur terme : à Paris comme dans la Gironde, il tenta tour-à-tour, et tour-à-tour éprouva la constance de ses amis ; comme dans la Gironde, il fut forcé de reconnaître que le malheur porte avec lui le sceau de la réprobation, et que, semblable à un fléau contagieux, il éloigne tout de ses approches.
Le JURA lui offrait d’impénétrables cavernes, Louvet courut s’y réfugier. « De l’antre profond où je m’étais jeté, sur les âpres montagnes qui de ce côté limitent la France, je voyais, je touchais, pour ainsi dire, l’antique Helvétie. Au premier bruit, à la moindre alarme, je pouvais me précipiter sur le territoire neutre, puis ayant vu passer l’ennemi, remonter à ma retraite, et rentrer en même temps dans ma patrie. »
C’est dans cet asile que Louvet, pressé par le besoin de soulager son cœur, entreprit de raconter, avec cette vivacité d’expression qu’il sut répandre dans tous ses écrits, les détails de sa fuite et de ses périls. Son ouvrage, dicté pour l’histoire, produisit à sa naissance beaucoup de sensation ; il fut traduit dans presque toutes les langues de l’Europe.
Mais le 9 thermidor vint rendre Louvet à sa patrie. Non pas à ses fonctions : tous les jacobins de la Convention n’étaient pas encore abattus, et les complaisants ministres de Robespierre n’avaient pas tous secoué leurs terreurs. La demande de Louvet, de reprendre sa place dans l’assemblée, fut longtemps écartée. Mais l’opinion qui règne sur les républiques, comme sur les monarchies, l’emporta enfin sur les considérations de la haine et de la peur. Le 8 mars 1795, Marie-Joseph Chénier, qu’une amitié sincère unissait depuis longtemps à Louvet, réclama de nouveau le rappel des proscrits du 31 mai. Son discours fut digne des hommes dont il revendiquait les droits.
« Ils ont fui, dites-vous ? ils se sont cachés ? ils ont enseveli leur existence au fond des cavernes, comme autrefois les martyrs des Cevennes ? Voilà donc leur crime ! Eh ! plût aux destinées de la république que ce crime eût été celui de tous, dans un temps où les talents célèbres, où les vertus courageuses ne pouvaient espérer une longue impunité ! pourquoi ne s’est-il pas trouvé de cavernes assez profondes pour conserver à la patrie les méditations de Condorcet, l’éloquence Vergniaud ? les nombreux successeurs de Barneweldt et de Sidney n’avaient pas besoin de chercher la gloire sur l’échafaud. Quand la surface de la terre était soumise au pouvoir arbitraire, pourquoi n’ont-ils pas poursuivi la liberté dans la profondeur des abymes ? Et pourquoi le 10 thermidor, après le supplice des triumvirs, une terre hospitalière et libérale, n’a-t-elle pas rendu au jour purifié cette colonie souterraine d’orateurs patriotes, de philosophes républicains, dont la sagesse et l’énergie auraient si puissamment servi l’État dans la prochaine et dernière lutte de l’égalité contre les privilèges, de la liberté contre les rois ? »
À peine rentré dans la Convention, Louvet prit la parole pour adresser un touchant hommage à la mémoire de ses amis morts sur l’échafaud, et deux jours après il demanda qu’on décrétât que tous ceux qui avaient pris les armes contre La Montagne, avaient bien mérité de la patrie. Le 22 mars, il embrassa la défense des proscrits contre leurs anciens oppresseurs, et notamment contre Robert Lindet et Lecointre.
Cependant, le retour de la Convention à des principes plus modérés, avait réveillé l’espoir des contre-révolutionnaires ; ce parti qui ne devait un reste d’existence qu’aux crimes de jacobins, renouvela ses efforts contre les républicains, et précipita dans l’enceinte de la représentation nationale une multitude forcenée. Cette scène d’horreurs s’ouvrit par l’assassinat du généreux Féraud. Louvet qui dans cette journée avait montré son courage ordinaire, se chargea d’exprimer les regrets de la Convention. Il pleurait un ami, un martyr de la liberté ; son triomphe fut celui de l’éloquence : tous les cœurs furent attendris, tous les yeux se remplirent de larmes au souvenir de cet évènement.
Entrée à la commission chargée de présenter les lois organiques de la constitution, il s’opposa à la création d’un comité unique de gouvernement, et soutint la nécessité d’une loi contre les provocateurs. Sa constance lui mérita la haine des contre-révolutionnaires. Ces anarchistes qui, sous le règne de La Montagne, n’avaient pas trouvé assez de bassesses pour se faire oublier, fiers alors par l’absence du danger, se montraient escortés d’assassins, vieux compagnons de Marat, et haranguaient la populace, du haut de ces mêmes bornes on les avaient précédés Hébert et Henriot. Louvet eut plusieurs fois l’honneur de s’entendre insulter par eux. Un jour, poursuivi dans les rues par une troupe de gens armés de bâtons, qui le menaçaient en chantant derrière lui le réveil du peuple, il les conduisit sans se déconcerter jusqu’à sa demeure, ouvrit sa porte, se retourna vers la foule, et ne rentra dans sa maison qu’après leur avoir adressé ce vers de la Marseillaise : « Que veut cette horde d’esclaves ? »
Louvet menacé par les terroristes de 1795, comme il l’avait été par ceux de 1793, demeura fidèle aux principes d’éternelle justice qui réprouvent les instruments de toutes les tyrannies. Il vota avec véhémence pour que les députés, accusés de complicité dans les excès du 1er prairial, ne fussent pas traduits devant une des commissions militaires, dont l’existence lui paraissait aussi barbare, aussi attentatoire à la liberté que celle des tribunaux révolutionnaires. Le 19 juin il fut élu président de la Convention et le 3 juillet membre du comité de salut public.
Devenu membre du conseil des cinq-cents lors de l’organisation constitutionnelle de l’an 3, Louvet s’y montra plus ardemment attaché à la cause de la liberté attaquée dans les conseils par une faction puissante, composée d’hommes de tous les partis. Mécontent du directoire dont l’inhabileté, la faiblesse et les divisions n’étaient guère moins alarmantes que l’audace de ses ennemis, il prévit les malheurs que les violences du 18 fructidor allaient attirer sur sa patrie. Il fut poursuivi, accusé devant les tribunaux par d’infâmes libellistes qui n’étaient dignes d’apprécier ni la noblesse de son âme, ni la bonté de son cœur, ni la droiture de ses sentiments. Louvet, calomnié par Isidore Langlois, se vit condamné comme calomniateur. Cet intervertissement de tous les principes fit sur lui une impression profonde. La chaleur d’un combat polémique avait altéré sa santé ; son âme ne s’était agrandie à l’école du malheur qu’aux dépens de son tempérament délicat. Contraint d’abandonner ses travaux, il ne pouvait plus prouver son amour pour la patrie, en combattant la réaction qui désolait la république. Sorti du corps législatif le 20 mai 1797, il transporta à l’hôtel de Sens, faubourg Saint-Germain, le beau magasin de librairie qu’il avait formé depuis trois ans au Palais-Royal. Le gouvernement l’avait nommé consul à Palerme, et ses amis espéraient beaucoup du ciel qui l’attendait. Cette illusion ne dura pas longtemps ; Louvet se voyait mourir avec une indifférence vraiment stoïque, mais désolante pour ceux qui l’entouraient. Deux jours encore avant sa mort, il s’applaudissait de finir avant la république.
Le 5 août 1797, il rendit le dernier soupir.
Voici le portrait que nous a laissé de lui madame Rolland, dont le beau caractère était fait pour l’apprécier.
« Louvet est petit, fluet, la vue basse et l’habit négligé ; il ne paraît rien au vulgaire, qui ne remarque pas la noblesse de son front, et le feu dont s’animent ses yeux à l’expression d’une grande vérité. Les gens de lettres connaissent ses jolis romans ; la politique lui doit des objets plus graves. Il est impossible de réunir plus d’esprit à moins de prétentions et plus de bonhomie ; courageux comme un lion, doux comme un enfant, homme sensible, bon citoyen, écrivain vigoureux, il peut faire trembler Catilina à la tribune et souper chez Bachaumont. »
Après avoir partagé ses périls et ses disgrâces, sa femme qui lui prodigua de si douces consolations, Lodoïska ne put se résoudre à supporter la perte de l’homme qu’elle avait tant aimé. Elle s’empoisonna. Sa famille avertie de ce funeste évènement, la força de prendre un antidote qui, en prolongeant son existence de quelques années, étendit le cours de ses regrets.
Louvet a été peut-être celui de tous les membres de nos assemblées délibérantes qui soit resté le plus invariablement attaché à ses principes. Les temps et les circonstances n’eurent aucune influence sur lui, dans le cours de cette révolution où l’on vit tant de fois changer, s’évanouir, et reparaître pour s’éclipser encore, les mille nuances de l’opinion. Aussi l’a-t-on jugé démagogue sous la Constituante, modéré durant la Terreur, et républicain exagéré dans le conseil des cinq-cents. Qu’on examine sa conduite : toujours ennemi de l’arbitraire, quel que fût la forme qu’il empruntât, il l’attaqua sans relâche. Inaccessible à la corruption, comme à la menace, inébranlable dans ses devoirs, il sacrifia la fortune aux intérêts du peuple, défendit la liberté au péril de ses jours, et la défendit encore lorsque, victime de l’anarchie, il eut payé par une proscription impitoyable l’honneur d’un si beau dévouement. « Puisque même en un pays que je croyais prêt à se régénérer, disait-il en mourant, les gens de bien sont si lâches et les méchants si furieux, il est clair que toute agrégation d’hommes, improprement appelée PEUPLE par des insensés tels que moi, n’est réellement qu’un imbécile troupeau, trop heureux de ramper sous un maître. »
Il nous semble, à ses derniers moments, entendre le vertueux Brutus s’écrier avec douleur : Vertu ! tu n’es qu’un vain nom !
Paris, 16 février 1821.
Ils parurent, pour la première fois, en 1786.
À M. BR ***, fils.
Notre amitié naquit, pour ainsi dire, dans ton berceau ; elle fut l’instinct de notre premier âge, et l’amusement de notre adolescence : nourrie par l’habitude, fortifiée par la réflexion, elle fait le charme de notre jeunesse. Ton indulgence a toujours encouragé mes faibles talents ; ce fut toi qui, le premier, m’invitas à les essayer ; c’est toi qui naguères m’as pressé de descendre dans la vaste carrière où se sont égarés avant moi tant de jeunes gens présomptueux. Peut-être comme eux je m’y serai trop tôt montré ; mais enfin je t’ai cru, j’ai écrit, je te dédie mon premier ouvrage.
La critique ne manquera pas de dire, que très heureusement pour les lecteurs, la mode de ces longs discours complimenteurs, toujours placés à la tête d’un livre somnifère, est depuis longtemps passée. Je répondrai qu’il ne s’agit pas ici d’un fade éloge, donné, pour de bonnes raisons, à quelque riche ennobli, ou à quelque petit commis protecteur. Je répondrai que si l’usage des épîtres dédicatoires n’avait pas existé depuis longtemps, il m’eût fallu l’inventer aujourd’hui pour toi.
Ô mon ami ! ta respectable mère, ton père bienfaisant m’ont rendu des services qu’on ne paie point avec de l’or ; des services que jamais je ne pourrais acquitter, quand même je deviendrais aussi riche que je le suis peu. Ton père et ta mère m’ont sauvé la vie : dis-leur que j’aime la vie à cause d’eux. Ils se sont efforcés de me donner un état, qu’on croit noble et libre : dis-leur que l’espérance de devenir un jour avec toi l’appui de leur vieillesse respectée, anima mon courage dans les cruelles épreuves qu’il m’a fallu subir, et me soutiendra toujours dans mes travaux. Ils se sont réunis à toi pour m’engager à cultiver les lettres : dis-leur que si le chevalier de Faublas ne meurt pas en naissant, j’oserai le leur présenter, lorsque mûri par l’âge, instruit par l’expérience, devenu moins frivole et plus réservé, ce jeune homme me paraîtra digne d’eux.
Quant à toi, j’espère que cet hommage public, rendu par la reconnaissance à la bienfaisance et à l’amitié, te flattera d’autant plus, qu’il ne fut point mendié, et que peut-être il n’était pas attendu.
Je suis ton ami,
LOUVET.
Cet ouvrage fut publié, pour la première fois, au printemps de 1786.
À M. TOUSTAING.
Monsieur,
Votre nom, destiné à plusieurs sortes de gloire, est en même temps consigné dans les fastes de la littérature et dans les annales de l’histoire. On devrait donc le lire à la tête d’un ouvrage plus recommandable que celui-ci ; mais je serais trop ingrat si je ne vous offrais point un hommage et des remerciements publics. Que ne m’a-t-il été possible de suivre vos conseils ! FAUBLAS, pour la seconde fois soumis à votre censure, vous aurait, avec bien d’autres obligations, celle de se montrer déjà beaucoup plus formé. Vous paraissez croire, et vous voulez bien me dire que je pourrais, avec quelque succès, embrasser un genre plus sérieux, et que je devrais consacrer à la morale et à la philosophie mes dispositions, que vous appelez mes talents. Quelquefois je vous ai vu sourire aux espiègleries de mon Chevalier ; plus souvent je vous ai entendu m’exprimer sans détour le regret que vous aviez de le trouver toujours si peu raisonnable. J’ai eu l’honneur de vous observer qu’il pourrait, comme tant d’autres enfants de bonne maison, complètement réparer, par les actions exemplaires de l’âge mûr, les erreurs peut-être excusables de son printemps. Ici j’ajouterai, que pour corriger les écarts du jeune homme, l’historien fidèle attend impatiemment que l’heure du héros soit venue ; et si cet aveu ne suffit pas pour m’obtenir grâce auprès des gens sévères, je citerai ma justification imprimée longtemps avant que je fusse né pour commettre la faute. Dans un conte philosophique, écrit avec la facilité prodigieuse et l’inimitable naturel qui caractérisent les ouvrages de ce génie universel, presque toujours supérieur à son sujet, Voltaire m’a dit : « Monseigneur, vous avez rêvé tout cela ; nos idées ne dépendent pas plus de nous dans le sommeil que dans la veille. Une puissance supérieure a voulu que cette file d’idées vous ait passé par la tête, pour vous donner apparemment quelque instruction dont vous ferez votre profit. »
Je suis, etc.
LOUVET DE COUVRAY.
P.S. Pourquoi de Couvray ? Voyez la page suivante, et vous le saurez.
À MON SOSIE
Je ne sais, monsieur, si vous êtes l’heureux propriétaire d’une figure semblable à la mienne, et si, comme moi, vous descendez de ce fameux LOUVET… Je ne sais, mais il ne m’est plus permis de douter que nous avons à peu près le même âge ; que nous sommes décorés d’un titre presque semblable ; que nous nous glorifions d’un nom absolument pareil. Je suis surtout frappé d’un trait de ressemblance plus précieux pour nous, plus intéressant pour la patrie ; c’est que nous pourrons aller ensemble à l’immortalité, puisque tous deux nous composons de très jolie prose, puisque tous deux nous nous faisons imprimer vifs.
J’aime à croire que cette parfaite analogie vous a d’abord semblé, comme à moi, très flatteuse ; et cependant je suis persuadé que maintenant vous sentez, ainsi que moi, le terrible inconvénient qu’elle entraîne. À quelle marque certaine deux rivaux si ressemblants, en même temps lancés dans la vaste carrière, seront-ils reconnus et distingués ? Quand le monde retentira de notre éloge commun ; quand nos chefs-d’œuvres, pareillement signés, voyageront d’un pôle à l’autre, qui séparera nos deux noms confondus au temple de Mémoire ? Qui me conservera ma réputation, que sans cesse vous usurperez sans vous en douter ? Qui vous restituera votre gloire, que je vous volerai continuellement sans le vouloir ? Quel homme assez pénétrant pourra, par une assez équitable répartition, rendre à chacun la juste portion de célébrité que chacun aura méritée ? Que ferai-je pour qu’on ne vous prête pas tout mon esprit ? Comment empêcherez-vous qu’on ne me gratifie de toute votre éloquence ? Ah ! monsieur ! monsieur !
Il est vrai que l’ingrate fortune a mis entre nos destinées une différence pour vous toute avantageuse : vous êtes avocat au, je ne suis qu’avocat en ; vous avez prononcé, dans une grande assemblée, un grand discours, je n’ai fait qu’un petit roman. Or, tous les orateurs conviennent qu’il est plus difficile de haranguer le public, que d’écrire dans le cabinet ; et tous les gens instruits sont épouvantés de l’immense intervalle qui sépare les avocats en des avocats au. Mais je vous observe qu’il y a encore dans l’État des milliers d’ignorants qui ne connaissent ni mon roman, ni votre discours, et qui, dans leur profonde insouciance, ne se sont pas donné la peine d’apprendre quelles belles prérogatives sont attachées à ce petit mot au, dont, à votre place, je serais très fier. Ainsi, monsieur, vous voyez bien que malgré le roman et le discours, et le en et le au, tous ces gens-là, qui ne peuvent manquer d’entendre bientôt parler de vous et de moi, nous prendraient continuellement l’un pour l’autre. Ah ! monsieur, croyez-moi, hâtons-nous d’épargner à nos contemporains ces perpétuelles méprises qui donneraient trop d’embarras à nos neveux.
D’abord j’avais imaginé que, vous trouvant le plus intéressé à prévenir les doutes de la postérité, vous voudriez bien faire comme vos nobles confrères, qui, pour la plus grande gloire du barreau, augmentent ordinairement d’un superbe surnom leur baptistère, devenu trop modeste. Depuis, en y réfléchissant davantage, j’ai senti que délicatement je devais me donner ce ridicule pour vous l’épargner. Voilà ce qui me détermine. Vous pouvez, si bon vous semble, rester M. Louvet tout court ; moi, je veux être éternellement,
LOUVET DE COUVRAY.
La seconde édition s’étant faite en 1790, j’ajoutai la note suivante .
À ELLE
J’aurais osé le lui dédier, s’il s’en fût trouvé digne.
Cet ouvrage fut publié, pour la première fois, en juillet 1789
Que de bruit pour un petit livre ! Si beaucoup en ont ri, quelques-uns en ont pleuré ; plusieurs l’ont imité, d’autres l’ont travesti ; d’honnêtes gens l’ont contrefait, des gens honnêtes l’ont dénigré. Ainsi, puissamment encouragé de toutes les manières, j’ai repris la plume avec quelque confiance, et j’ai fini.
Maintenant, lecteur impartial, c’est à vous de m’entendre et de prononcer. Si quelquefois je suis trop gai, pardonnez-moi. Tant de romans m’avaient tant fait bâiller ! Je tremblais d’être comme eux soporifique ; au reste, attendez quelques années, peut-être alors j’en ferai de plus ennuyeux qui seront meilleurs. Je dis, peut-être. En effet, un romancier ne doit-il pas être l’historien fidèle de son âge ? Peut-il peindre autre chose que ce qu’il a vu ? Ô vous tous qui criez si fort, changez vos mœurs, je changerai mes tableaux !
M’accusiez-vous aussi d’immoralité ? Bientôt je tâcherai de vous persuader que vous aviez tort ; mais auparavant, approchez, prêtez l’oreille : c’est une vérité que je vais dire ; et, comme la littérature a encore ses aristocrates, il faut parler bas. En conscience, étaient-ils bien moraux, ces chefs-d’œuvre par lesquels se sont immortalisés l’Arioste et le Tasse, La Fontaine et Molière, Voltaire enfin, Voltaire et tant d’autres, beaucoup moins grands que lui, quoique plus grands que moi ? Tenez, j’ai bien peur que cette condition de moralité, si rigoureusement imposée de nos jours à tout ouvrage d’imagination, ne soit un violent remède savamment employé par ceux de mes frêles contemporains qui, désespérant de pouvoir jamais rien produire, voudraient nous châtrer.
Quoi qu’il en soit, lisez mon dénouement, il me justifiera sans doute. Au surplus, je déclare, et dès que les circonstances me le permettront, je m’engage à prouver que cet ouvrage, si frivole en ses détails, est au fond très moral ; qu’il n’a peut-être pas vingt pages qui ne marchent directement vers un but d’utilité première, de sagesse profonde, auquel j’ai tendu sans cesse. J’avoue qu’il sera donné à peu de gens de l’apercevoir d’abord ; mais je maintiens qu’avec le temps, je le pourrai découvrir à tous ; et le jour de mes confidences sera, je vous le promets, le jour des surprises.
Ils m’ont encore reproché de grandes négligences. Eh ! quel écrivain, assez peu maître de son art, voudrait également soigner toutes les parties d’un long ouvrage ? Quant à moi, je crois fermement qu’il n’y a point de naturel sans négligences, principalement dans le dialogue. C’est là que, pour être plus vrai, sacrifiant partout l’élégance à la simplicité, je serai souvent incorrect, et quelquefois trivial. C’est, ce me semble, où le personnage va parler, que l’auteur doit cesser d’écrire ; et néanmoins je me reconnais très fautif, s’il m’est souvent arrivé de permettre que madame de B *** s’exprimât comme Justine, et Rosambert comme M. de B ***.
Patient lecteur, encore un paragraphe apologétique.





























