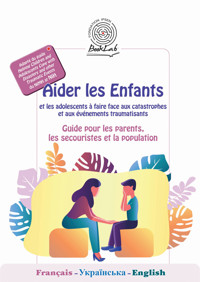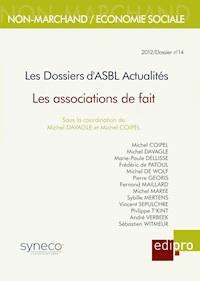
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EdiPro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Pour la première fois, un collectif consacré aux associations de fait. Retrouvez dans cet ouvrage les chapitres suivants :- « Les associations de fait : quel poids économique ? » par Michel Marée et Sybille Mertens. - « L'association de fait : notion, régime juridique et conséquences de l'absence de personnalité morale » par Michel Coipel. - « Des raisons de fonctionner en association de fait » par Pierre Georis. - « Le fonctionnement d'une association de fait » par Michel Davagle. - « La comptabilité des associations de fait » par Fernand Maillard. - « La responsabilité des membres d'une association de fait envers les tiers » par Michel Davagle. - « La responsabilité des dirigeants d'une association de fait envers les membres de l'association de fait » par Michel Davagle. - « Quelles assurances conseiller aux associations de fait ? » par André Verbeek. - « La représentation en justice de l'association de fait » par Philippe T Kint. - « Le volontariat dans les associations de fait » par Michel Davagle. - « L'association de fait et l'ONSS » par Marie-Paule Dellisse. - « Les associations de fait et la T.V.A » par Vincent Sepulchre. - « Les associations de fait et les impôts sur les revenus » par Michel De Wolf. - « Associations de fait et pratiques du marché » par Frédéric de Patoul. - « Une association sans personnalité juridique doit-elle être enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises ? » par Frédéric de Patoul. - « Les associations de fait et le droit d'auteur » par Sébastien Witmeur.Un dossier essentiel pour comprendre les mécanismes du droit entourant les associations de faits en Belgique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
Structures largement répandues, les associations de fait émaillent le paysage associatif et voisinent les personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif telles que les ASBL. Certes, elles jouent un rôle économique indéniable (article de Michel Marée et de Sybille Mertens), mais leur nombre et leur poids restent difficiles à quantifier.
Le sujet des associations de fait a été très peu étudié. Aussi, ce dossier va-t-il tenter de dresser une carte (aux contours certes imprécis) de ce paysage très fréquenté, en pratique, mais si peu connu d’un point de vue juridique.
Qu’est-ce une association de fait ? Faute de définition légale, il faut bien conclure que ce groupement qui ne possède pas de personnalité juridique naît d’un contrat innomé. Mais qu’en est-il des groupements qui se destinent à procurer aux membres un bénéfice sous la forme d’une économie de dépenses ? Michel Coipel franchit le Rubicon et considère que de tels groupements doivent être qualifiés de sociétés de droit commun. Un peu dans la même veine, Michel Davagle soutient, quant à lui, que le volontariat (tel que défini par la loi du 3 juillet 2005) ne peut se faire dans de tels groupements.
Certes, tous les groupements n’ont pas nécessairement un intérêt d’adopter le statut juridique d’ASBL. Diverses raisons peuvent en effet pousser les membres à inscrire leurs actions et leurs activités dans le cadre d’une association de fait (article de Pierre Georis). Mais le principal problème de ce type de groupement réside dans le fait que les membres assument une responsabilité personnelle, plus ou moins étendue, qui pèse donc sur leur patrimoine (articles de Michel Coipel et Michel Davagle).
L’association de fait ainsi constituée va devoir suivre certaines règles de fonctionnement. En l’absence de statuts ou de règlement d’ordre intérieur, la règle de l’unanimité, à moins de démontrer que les membres aient adopté implicitement une autre règle, semble prévaloir. La question de la représentation des membres dans les actes conclus avec les tiers revêt une grande importance puisqu’elle entraîne la responsabilité personnelle des membres de cette association de fait envers les tiers (article de Michel Davagle).
Si les règles de la tenue d’une comptabilité en partie double n’est pas imposée par un pouvoir subsidiant ou n’est pas décidée par les membres, la tenue d’une comptabilité simplifiée peut, en principe, être appliqué mais l’attention des membres doit être attirée sur l’importance du respect du principe de la transparence comptable (article de Fernand Maillard).
Qu’en est-il du patrimoine commun ? De quels biens est-il constitué ? (article de Michel Coipel). Assurément, un membre n’acquiert pas une part dans cet avoir, celui-ci constituant un fonds social affecté à la poursuite d’un but non lucratif (article de Michel Davagle). Et quand est-il des créanciers personnels des membres et des créanciers sociaux ? Quid en cas de dissolution ? (article de Michel Coipel).
La problématique de la responsabilité est, nous l’avons déjà dit, au cœur de l’association de fait puisque la responsabilité contractuelle des membres cocontractants est directement engagée (article de Michel Davagle). Quant à la responsabilité aquilienne, elle est supportée par les membres fautifs ou présumés fautifs (article de Michel Davagle). Elle est aussi mise en cause par l’ONSS pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées (article de Marie-Paule Dellisse). Heureusement, pour protéger le patrimoine personnel des membres, des assurances peuvent être souscrites (article d’André Verbeek).
L’action contre une association de fait est, faute de personnalité juridique, irrecevable, mais elle peut être dirigée contre les membres ou les mandataires ad litem. Celle faite au nom d’une association de fait est en principe aussi irrecevable, mais cette règle connaît divers tempéraments (article de Philippe T’Kint).
Les membres de l’association de fait encourent des obligations envers l’ONSS quand ils engagent des travailleurs salariés (article de Marie-Paule Dellisse), envers la TVA quand ils réalisent certaines activités (article de Vincent Sepulchre), envers le fisc (article de Michel De Wolf) mais aussi envers d’autres organismes comme, par exemple, la Sabam (article de Sébastien Witmeur). Ces matières soulèvent aussi la responsabilité des membres de l’association de fait. Ce dossier abordera brièvement la problématique des activités réalisées par l’association de fait au regard de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et la protection du consommateur et de l’obligation de s’inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises (Frédéric de Patoul).
Le sujet des associations de fait est intéressant mais ardu. Il recèle quantités de pièges largement méconnus par ceux qui vantent les vertus de l’association de fait comme échappatoire aux dispositions plus normatives édictées pour les ASBL. En clair, le patrimoine personnel est bien plus menacé que si les membres empruntaient le statut juridique d’ASBL. Par ailleurs, contrairement à ce que certains semblent croire, les membres n’ont pas de parts dans le fonds social mis en commun : ils ne peuvent donc réclamer un partage de celui-ci s’ils se retirent de l’association et, en cas de dissolution de celle-ci, ils ne peuvent se partager le boni de liquidation qui resterait après désintéressement des créanciers sociaux. De plus, la TVA et le fisc sont toujours en embuscade. Ceci dit, l’intérêt de créer une ASBL ne semble pas acquise quand les activités de l’association de fait sont de peu d’importance. Mais qu’est-ce « de peu d’importance »?
Michel DAVAGLE et Michel COIPEL
Les associations de fait jouent un rôle économique indéniable. Bien loin de correspondre à l’image populaire de groupements de personnes constitués autour de simples activités de loisirs, elles mobilisent des ressources - notamment en termes de bénévolat - pour répondre à des besoins importants dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, de la défense des droits, … Parfois même, elles s’“institutionnalisent” en prenant le statut de l’ASBL et/ou en bénéficiant de financements publics importants.
Comme les associations de fait ne se conforment pas à la loi du 27 juin 1921 comme le font les ASBL, elles n’ont pas la personnalité juridique, ne déposent pas leurs statuts au greffe du tribunal de commerce ni ne publient ces derniers dans les annexes du Moniteur belge. Il en résulte notamment qu’il n’existe pas en Belgique de relevé exhaustif des associations de fait et par conséquent, pas de données statistiques complètes et détaillées sur ce secteur. Quelques informations très fragmentaires sont toutefois disponibles. Nous en donnons un aperçu dans ce bref article, non sans préalablement situer cette question dans le cadre plus large des statistiques du secteur associatif pris dans son ensemble.
I. L’évolution des statistiques sur les associations en Belgique
A. Les ASBL
Bien qu’elles fassent depuis toujours l’objet d’un recensement dans le Registre National des Personnes Morales (actuellement Banque Carrefour des Entreprises)1, les ASBL n’ont donné lieu à des évaluations statistiques de leur poids dans l’économie belge qu’au cours des deux dernières décennies. Les premières données sur l’emploi dans les ASBL ont été obtenues par voie d’enquêtes au milieu des années nonante (Defourny et al., 1997). A la même époque, l’intégration progressive de la forme juridique des employeurs dans les statistiques de l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS) a ensuite permis, sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, de réaliser la première étude exhaustive sur le nombre d’emplois salariés occupés dans les ASBL (Marée et Mertens, 2002). Par la suite, il a été possible d’analyser l’évolution de l’emploi associatif sur plusieurs années (Marée et al., 2008). Il ressort de ces données que l’emploi dans les ASBL est proche de 10% de l’emploi salarié total en Belgique (et même de 15% si l’on inclut les emplois subventionnés de l’enseignement libre), et que cette part est en augmentation au fil du temps.
A partir de ces fichiers administratifs, des données statistiques mises régulièrement à jour sur les ASBL en Wallonie et à Bruxelles sont disponibles auprès de ConcertES, plate-forme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale dans ces deux Régions2.
B. Les ISBL
Le Système Européen des Comptes Nationaux (SEC) reconnaît l’existence d’”institutions sans but lucratif” (ISBL) : l’ISBL y est définie comme une organisation “créée pour produire des biens ou des services et à laquelle son statut interdit de procurer un revenu, un profit ou tout autre gain financier à l’unité qui la crée, la contrôle ou la finance” (Eurostat, 1996). D’une manière plus précise, et suite aux travaux d’un projet de recherche mené au niveau international sous la coordination de la Johns Hopkins University aux Etats-Unis (Salamon et Anheier, 1994), la Division statistique des Nations-Unies énumère cinq caractéristiques qui permettent d’identifier les unités assimilables à des ISBL (United Nations, 2003).
Le secteur des ISBL rassemble les entités qui satisfont aux cinq critères suivants :
(1) Ce sont des organisations, c’est-à-dire qu’elles ont une existence institutionnelle.
(2) Elles ne distribuent pas de profits à leurs membres ou à leurs administrateurs.
(3) Elles sont privées, séparées institutionnellement de l’Etat.
(4) Elles sont indépendantes, au sens où elles ont leurs propres règles et instances de décision.
(5) Enfin, l’adhésion à ces organisations est libre et celles-ci sont capables de mobiliser des ressources volontaires sous la forme de dons ou de bénévolat.
En pratique, si la définition des ISBL n’insiste guère sur la dynamique associative des entités visées, l’application de ces cinq critères au contexte belge revient à circonscrire un champ qui englobe, outre les fondations, l’ensemble des organisations de nature associative. Concrètement, sont principalement concernées les formes organisationnelles suivantes (ICN, 2004) :
Les associations de fait relèvent donc formellement des ISBL : même si elles ne sont pas des personnes morales, elles sont considérées comme ayant une existence institutionnelle, ainsi que le prescrit le critère (1) de la définition. Les indices de cette existence peuvent être la délimitation claire d’une structure, la continuité des objectifs et des activités, la constitution et le respect d’une charte, …
La définition des ISBL s’inscrit dans la volonté manifestée au niveau des Nation-Unies de promouvoir dans chaque pays la création d’un “compte satellite des ISBL” destiné à rassembler, en lien avec le cadre de la comptabilité nationale, les informations statistiques disponibles sur le secteur en termes de production, de valeur ajoutée, de ressources disponibles, etc. Aujourd’hui, différents pays produisent annuellement un compte satellite des ISBL. En Belgique, la première édition portant sur les années 2000 et 2001 a été publiée en 2004 par l’Institut des Comptes Nationaux (ICN, 2004). Elle a été suivie par d’autres éditions dont la dernière porte sur les années 2000 à 2008 (ICN, 2010).
II. Aperçu des (rares) données disponibles sur les associations de fait
A. L’emploi salarié
Une multitude d’associations dites “de fait” développent donc leurs activités sans statut juridique formel, et ce dans des domaines extrêmement variés. Il est évidemment très difficile de dénombrer ces associations. On notera qu’une enquête sur la vie associative menée en 1990 dans deux communes wallonnes - Herve et Rocourt - avait identifié pratiquement autant d’associations de fait que d’ASBL (Janvier, 1990), ce qui, par extrapolation, donnerait au niveau national environ 80 000 formes associatives sans personnalité juridique (Marée et Mertens, 2005).
De quelles données statistiques dispose-t-on sur ces associations? On pourrait penser a priori que le compte satellite des ISBL dont il vient d’être question fournit des informations à cet égard. En fait, ce dernier souffre de deux importantes limitations. D’une part, il ne porte que sur les ISBL procurant des emplois salariés, et exclut donc l’immense majorité des associations de fait dont l’activité repose exclusivement sur le travail bénévole. D’autre part, les données publiées sont agrégées et ne sont pas disponibles par type d’associations (ASBL, AISBL,…). Relevons toutefois que les associations de fait qui emploient du personnel rémunéré sont très peu nombreuses et représentent à peine 1,5% (soit 235 unités en 2001) des ISBL répertoriés dans le compte satellite3 (ICN, 2004). Parmi ces associations, on trouve notamment les syndicats et les partis politiques. Selon les données disponibles à l’ONSS, les associations de fait “employeurs” occuperaient environ 5 000 emplois (en équivalents temps plein - ETP), mais ce chiffre est probablement sous-estimé (Marée et al., 2008).
B. Le bénévolat
Qu’en est-il du bénévolat dans les associations de fait, qui constitue la base même de leurs activités? On se doute que, tout comme il n’existe pas de relevé des associations de fait, on ne dispose d’aucune donnée directe sur le nombre de personnes s’occupant, d’une manière ou d’une autre, d’une association sans forme juridique. D’une façon plus générale d’ailleurs, il n’y a pas en Belgique de statistiques exhaustives sur le bénévolat en tant que tel. De nombreuses études ont certes été réalisées sur la question, mais en recourant à des approches et des méthodologies différentes qui induisent des écarts, voire des contradictions, entre les données fournies (Dujardin et al., 2007). On peut toutefois penser qu’entre 1 et 1,4 millions de personnes pratiqueraient une activité volontaire en Belgique, ce qui représenterait environ 150 000 emplois ETP (Dujardin et al., 2007).
Ces personnes sont essentiellement (mais pas exclusivement) actives dans le secteur associatif. Peut-on estimer le nombre de celles qui prestent bénévolement dans les associations de fait? Selon un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif en 2003, le bénévolat représenterait environ 76 000 emplois ETP dans les ISBL employeurs en Belgique, hors établissements scolaires de l’enseignement libre (Mertens et Lefèbvre, 2004). On peut en conclure qu’environ 75 000 emplois ETP représentent l’importance du bénévolat dans les ASBL employeurs de l’enseignement libre, dans les ASBL non employeurs (qui sont au nombre d’au moins 60 000) et dans les associations de fait, sans qu’il soit malheureusement possible d’indiquer la moindre ventilation entre ces trois catégories.
C. La nécessité de mener des enquêtes de terrain
En résumé, les seules données dont on peut actuellement faire état sur les associations de fait en Belgique sont tout à fait approximatives et concernent leur nombre (environ 80 000) ainsi que les emplois salariés qu’elles proposent (environ 5 000 ETP). En fait, seules des études de terrain, effectuées à l’échelle d’une ville, d’une région ou du pays, seraient de nature à éclairer davantage la réalité économique de ce secteur qui reste encore très largement méconnu. On citera à titre d’exemple une enquête réalisée en 2007 auprès d’un échantillon de 84 associations de fait (dont 3 “employeurs”) dans le but de recueillir des données de nature financière et sur le bénévolat (Marée et al., 2008). Selon les réponses obtenues, et contrairement à une idée largement répandue selon laquelle ce type d’associations disposeraient de peu de moyens financiers et compteraient presque exclusivement sur le bénévolat, il apparaît qu’elles semblent en réalité bénéficier des mêmes types de revenus que les ASBL. En particulier, près de la moitié des associations de fait interrogées déclaraient recevoir des subsides publics. Il est certain qu’à l’avenir, des enquêtes d’une certaine ampleur et menées auprès d’échantillons représentatifs permettront, par extrapolation, de mieux cerner ce pan entier de la vie associative belge et de faire ressortir les différences qu’il présente avec le secteur, de mieux en mieux connu, des ASBL.
Bibliographie
1 http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/
2 http://www.concertes.be
3 Précisons que ce dernier exclut les établissements scolaires de l’enseignement libre.
I. Introduction
1. Il existe quantité d’associations dépourvues de la personnalité morale parce que ceux qui la composent n’ont pas jugé utile d’accomplir les formalités qui procureraient cette personnalité ou parce qu’ils ignorent que leur groupe a les caractéristiques d’une association au sens juridique du mot.
Il est traditionnel de dire que les associations dépourvues de personnalité morale sont des « associations de fait ». On veut probablement signifier par là qu’elles se créent, sans formalités spéciales, à la différence des ASBL. Toutefois, cette formule est malheureuse : puisqu’il est habituel d’opposer le fait au droit, on pourrait penser que ces associations n’ont pas de régime juridique. Or, c’est absolument faux, comme on le verra tout au long du présent dossier… dont l’intitulé utilise néanmoins la formule courante malgré son imperfection.
En pratique, les associations « de fait » sont nombreuses et variées. On peut citer quelques exemples parmi d’autres : le comité des parents d’une école, la fanfare municipale, les syndicats de travailleurs, beaucoup de petits clubs sportifs etc. 1
2. L’étude juridique des associations dites « de fait » soulève de redoutables difficultés. En effet, elles ont, certes, un régime juridique mais celui-ci n’est pas spécifique car nulle loi ne définit l’association ni les règles qui s’appliquent à elle lorsqu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique. C’est donc avant tout un contrat et celui-ci est innommé puisqu’il n’est pas réglé comme tel par la loi2. Faute de règles spécifiques, ce contrat est avant tout régi par la théorie générale des contrats (infra, n° 16). C’est notamment pourquoi il ne nécessite pas d’être constaté par un écrit conformément au principe du consensualisme3 : c’est ainsi que certaines personnes peuvent avoir la volonté de s’associer sans savoir que, juridiquement, elles ont conclu une association régie par le droit.
Nous verrons (infra, nos 17 et 18) que, à côté de la théorie générale du contrat, d’autres contrats (principalement, le mandat) ou solutions non spécifiques peuvent aussi servir à répondre aux questions que posent le régime juridique de l’association dite « de fait ».
Toutefois, une seconde raison des difficultés que pose l’étude des associations dites « de fait » est la quantité très réduite d’études théoriques qui leur sont consacrées et de cas pratiques ayant donné lieu à des décisions de justice : peu de doctrine (écrits des auteurs) donc, et peu de jurisprudence (décisions des juges). Ne pourrait-on en déduire qu’il n’y a guère de problèmes et que les gens se débrouillent sans trop s’occuper du droit ? Il y a certainement du vrai dans cette observation mais les incertitudes juridiques autour de l’association dite « de fait » sont probablement une des causes de cette débrouillardise et il vaut donc la peine de tenter d’y voir plus clair. De plus, si on quitte le régime de droit privé, il y a, par exemple en matière de T.V.A, des ignorances juridiques qui peuvent être fort dangereuses4.
Dans cette contribution, je vais d’abord tenter de cerner la notion d’association en exposant ses origines historiques et en montrant en quoi elle se distingue de la notion de société (II).
Ensuite, j’essaierai de répertorier les règles du droit privé qui peuvent être appliquées à l’association dite « de fait » (III). Enfin, j’examinerai les principales conséquences qui découlent de l’absence de personnalité juridique (IV).
II. La distinction entre l’association et la société
A. Pendant des siècles l’association a été régie par le droit public
3. Avant le vingtième siècle, le régime juridique de l’association relève essentiellement du droit public. Sauf dans les débuts de la République à Rome et à partir de 1830 en Belgique, le principe n’a jamais été la liberté d’association sans restriction. L’Etat n’a pas renoncé à un pouvoir d’autorisation et il l’a exercé de façon plus ou moins libérale selon les époques5. Soumises à un agrément qui leur confère parfois une forme de personnalité morale, surveillées et contrôlées par le Pouvoir, les associations n’apparaissent quasiment pas comme des institutions de droit privé et encore moins comme des contrats entre particuliers6.
Par contraste, les associations avec but de lucre, appelées sociétés, ont le plus souvent échappé à cette attitude restrictive du Pouvoir. Au lieu de faire figure de « rivales »7, elles représentent « plutôt pour l’Etat des auxiliaires précieux en ce qu’elles détournent vers des fins matérielles et utilitaires des activités en quête d’emploi »8 et créent même « un dérivatif à la discussion des intérêts généraux »9 ; de plus elles font circuler les richesses, à l’inverse des mainmortes10. Ce terme de « mainmorte » désignait, dans l’ancien régime, l’accumulation indéfinie de biens – meubles et immeubles – qui ne rentraient pas dans le circuit économique parce qu’ils restaient dans les mains du seigneur (dans le cas des serfs) ou des communautés religieuses (les biens apportés en dot par les religieux ne passaient pas à leurs héritiers) 11.
Dans l’ancien droit, l’association sans but de lucre n’émerge donc pas comme une catégorie du droit privé12. Et elle est absente du Code civil de 1804 qui ne traite que du contrat de société (défini à l’article 1832). Dans la préface de son célèbre traité sur le contrat de société de 1843, Raymond-Théodore Troplong note que « le mot société a un sens étendu » qui englobe les « associations religieuses, amicales, politiques, littéraires, économiques » mais que ces dernières combinaisons ne l’occupent pas : « Le cadre du jurisconsulte n’empiétera donc pas sur celui du publiciste » 13.
En droit public, la méfiance envers les associations subsiste14 mais, en Belgique, les choses changent avec l’indépendance : le Gouvernement provisoire proclame la liberté d’association par un décret du 6 octobre 1830. Puis le Congrès national l’inscrit à l’article 20 de la Constitution. Mais qu’en est-il de la possibilité pour les associations d’accéder à la personnalité juridique comme le peuvent les sociétés commerciales ? Le Congrès national renonce, après de vives discussions, à préciser quoi que ce soit à ce propos15. Il faudra donc attendre la loi du 27 juin 1921 pour que cette possibilité soit enfin offerte.
L’hostilité envers la puissance des congrégations religieuses et le spectre d’un retour de la mainmorte expliquent qu’il ait fallu attendre 91 ans pour donner à la liberté d’association proclamée dans la constitution en 1830 sa pleine efficacité.
4. Ces mêmes raisons ont retardé l’émergence du contrat d’association et de sa différence avec le contrat de société.
À partir de 1830, en effet, les communautés religieuses bénéficient, en Belgique, de la liberté constitutionnelle d’association et ne sont plus soumises à autorisation. Elles vont alors s’attirer progressivement l’hostilité des milieux laïques : « pullulant partout », elles reprennent « comme autrefois leur ascendant délétère sur des populations crédules »16. Pire : elles tentent de contourner la privation de personnalité morale par diverses astuces juridiques17 et, notamment, la constitution de sociétés civiles dotées de clauses qui visent à la mise sur pied d’indivisions permanentes. Sous la bannière d’un François Laurent déchaîné18, plusieurs auteurs19 et des décisions de jurisprudence20 dénoncent la nullité de ces sociétés et des actes juridiques conclus en leur faveur par l’interposition des associés. La controverse devient passionnée21, le débat s’enlise dans des subtilités et des imprécations22 ; l’idée d’un contrat innommé qui serait valable au regard de la liberté contractuelle et régi par la théorie générale des contrats23 ne fait pas l’unanimité car elle pourrait conduire à valider les essais de reconstitution de la mainmorte.24
B. La reconnaissance du contrat d’association et la distinction avec le contrat de société
5. Les choses changent avec l’adoption de la loi française du 1er juillet 1901 qui porte explicitement sur le contrat d’association. La liberté d’association ne figurait pas à l’époque dans la Constitution française ; elle pénètre donc par le biais de la liberté contractuelle et la portée constitutionnelle de ce principe se révèlera progressivement par la suite25. Cette loi offre aux associations déclarées la personnalité morale mais une seconde loi du même jour maintient la nécessité d’une autorisation pour les congrégations religieuses.
En droit belge, le contrat d’association s’installe solidement suite à la loi de 1921 ; les objections anciennes envers le contrat innommé d’association (supra, n°4) perdent, en effet, leur raison d’être puisque l’association peut bénéficier de la personnalité morale.
Ainsi voit le jour ce qu’on a qualifié de summa divisio à savoir une distinction bien nette entre deux types de contrats participant du phénomène de l’association au sens large ou, pour le dire comme Henri De Page et René Dekkers, exprimant « l’idée de groupement » 26.
À vrai dire, c’est la loi française de 1901 qui a véritablement lancé la summa divisio en définissant, en son article premier, l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » 27.
6. Une conséquence extrêmement importante découle de cette définition.
Dès lors qu’elle se caractérise par la mise en commun permanente d’apports dans un certain but, l’association ne se distingue de la société que par le but poursuivi.
Conformément à l’influence exercée à l’époque par le droit français, cette conception pénètre en droit belge à partir de 1921 mais il apparaît que, en droit belge, faute d’être régi par la loi, le contrat d’association est un contrat innommé (infra, n°s 10 et 16).
Sur un plan purement terminologique, la ressemblance entre association et société devrait conduire à qualifier d’associés ceux qui s’associent dans de tels contrats. Toutefois, j’utiliserai pour les associations le terme de « membre » par analogie à ce que prévoit la loi de 1921 sur les ASBL, surtout depuis la réforme de 200228. Cela permettra de mieux distinguer dans certains développements qui suivent ce qui concerne l’association et ce qui relève de la société.
C’est donc le but de lucre, présent en société et absent en association, qui établit la distinction entre deux contrats qui, pour le reste, ont les mêmes caractéristiques fondamentales.
Mais en quoi consiste précisément le lucre sociétaire ?
1. La conception stricte du lucre sociétaire
7. La vision traditionnelle du bénéfice était large ainsi que le révèle la lecture de Troplong qui esquisse même la distinction actuelle entre bénéfice patrimonial direct et indirect « Remarquons bien - écrit-il - qu’encore que la société n’eût pas pour but de partager une somme d’argent, elle n’en serait pas moins une société proprement dite, pourvu que l’avantage qu’elle procure fût appréciable en argent »29. Et de proposer des exemples attestant une vision très large du bénéfice matériel. Ainsi de la convention, considérée comme une société déjà dans les écrits de Pothier 30, par laquelle « deux voisins se sont associés pour acheter en commun un équipage et en jouir chacun à son tour ».
Dans le courant du dix-neuvième siècle, pourtant, cette conception cède la place à celle qui ne retient que le lucre sociétaire au sens strict : le profit partagé entre associés et qui accroît leur fortune. Pourquoi ? Deux raisons fort différentes semblent avoir joué un rôle non négligeable.
D’une part, la révolution industrielle « rejette dans l’ombre la société du Code civil »31 et met sur le pavois la mentalité commerciale et capitaliste. Comme le relève finement Jean-Claude Scholsem, « le bénéfice,but caractéristique de la société, se confond peu à peu avecles bénéficesréalisés par les sociétés de commerce »32.
D’autre part, il faut combattre, surtout en Belgique, une des astuces imaginées par certaines congrégations religieuses pour assurer la survie des communautés : le recours à la société civile (supra, n° 4). Une des raisons de la nullité de ces sociétés provient dit-on, de ce qu’elles ne répondent pas à l’exigence de l’intérêt pécuniaire. Et pour contrer les habiles juristes qui soutiennent que les religieux associés réalisent par là des économies33, Laurent et ses acolytes ne manquent pas de mettre en avant la notion stricte du lucre sociétaire34.
Cette vision s’installe fermement jusqu’à la moitié du vingtième siècle.
8. La conception stricte du bénéfice sociétaire a des conséquences importantes.
Tout d’abord elle permet une distinction sans bavure entre association et société. Ici, le seul bénéfice admis est le bénéfice patrimonial direct, qui enrichit directement les associés. Seul ce type de lucre est interdit en association.
Dès lors, et ceci doit absolument être souligné, l’association peut apporter à ses associés (membres) une économie, donc un bénéfice patrimonial indirect. Cette possibilité a été exploitée par quantité d’ASBL à partir de 1921 et a même été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 194035.
2. La retour de la vision large du bénéfice sociétaire
9. Les réalités économiques vont provoquer un retour du balancier à partir des années 1950. La coopération entre entreprises se développe et accompagne la concurrence selon une subtile dialectique. Les firmes s’associent pour fabriquer certains produits, prospecter des marchés, développer des recherches, etc. Le bénéfice patrimonial qu’elles en retirent ne se matérialise pas par un profit à partager mais, toutes choses égales par ailleurs, par une réduction de coûts.
Quelle formule juridique adopter pour organiser ces coopérations ? Dans la logique de la summa divisio, la seule voie disponible est celle de l’association, simplement contractuelle ou dotée de la personnalité morale. Les entreprises y recourent mais elles souhaitent aussi constituer des sociétés, notamment pour la mise sur pied de filiales communes36. La notion stricte du lucre sociétaire s’y oppose puisqu’il s’agit seulement de réaliser des économies. La pratique passe outre sans être inquiétée. Et la doctrine suit progressivement à la suite de Jean Van Ryn 37-38. Avec un certain retard, le législateur a consacré l’évolution : en France, avec la réforme de 1978 ; en Belgique, grâce à la loi du 13 avril 1995 qui a reformulé l’article 1832 du Code civil et stipulé qu’une société a pour « but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (texte repris, en 2001, par l’article 1er du Code des sociétés).
L’élargissement du lucre sociétaire à partir des années 1950 a donc émergé des réalités de la pratique - la coopération entre entreprises - et a ensuite été théorisé par la doctrine puis par le législateur. Il s’ensuit que, parallèlement à cette ouverture, l’association a continué, en pratique, à être utilisée pour coopérer ou pour défendre les intérêts des membres, notamment sur le plan patrimonial.
Par conséquent, en Belgique39 comme, d’ailleurs en France40, la doctrine a dû admettre que le bénéfice patrimonial indirect peut être poursuivi aussi bien en société qu’en association : ce qui provoque une intersection inévitable et met à mal la pureté de la summa divisio.
3. Conséquences de l’intersection entre les notions d’association et de société
10. Ceux qui s’associent avec pour finalité de procurer aux membres ou associés un bénéfice patrimonial indirect peuvent, en principe, choisir de le faire en association ou en société.
Lorsqu’ils veulent bénéficier de la personnalité morale, ils peuvent choisir entre des formes différentes de personnes morales, de type associatif ou sociétaire. Soit une ASBL ou une AISBL, soit une des formes de sociétés énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Code des sociétés ( SA, SPRL, GIE, etc.) et ils choisissent fréquemment la SCRL car, puisqu’il s’agit de procurer un bénéfice patrimonial indirect aux associés, on se trouve souvent dans un hypothèse de coopération entre entreprises et la SCRL est une formule bien adaptée pour une telle coopération.
Lorsque la personnalité morale n’est pas voulue, le choix s’opère entre deux contrats : soit un contrat d’association donnant naissance à une association dite « de fait », soit un contrat de société donnant naissance à une société de droit commun41.
Puisqu’il n’est question ici que de contrats, il faut constater que l’un, l’association, est un contrat innommé, c’est-à-dire non réglé spécifiquement par le Code civil ou une loi particulière (infra, n° 16) alors que l’autre, la société de droit commun, est un contrat nommé visé depuis 2001, à l’article 46 du Code des sociétés42 et régi par une série de règles de ce Code (articles 18 à 44 et 49 à 55).
Selon la théorie générale des contrats, applicable à tous les contrats sauf dérogations dans les règles spécifiques aux contrats nommés43, lorsqu’un contrat à première vue innommé présente toutes les caractéristiques d’un contrat régi par Code civil ou par une autre loi, il s’agit d’un contrat « prétendument innommé » qui doit « réintégrer le cadre des figures contractuelles éprouvées »44, c’est-à-dire bénéficiant de règles spécifiques.
Si on applique cette manière de faire au contrat d’association lorsque son but est de procurer un bénéfice patrimonial indirect aux membres, on est conduit à qualifier ce contrat d’association de société de droit commun puisque c’est une figure contractuelle bénéficiant de règles spécifiques. En effet, l’association et la société ont les mêmes caractéristiques à l’exception du but de lucre (supra, n°6). Par conséquent, lorsqu’on se trouve dans l’hypothèse d’une intersection (supra, n° 9), le but de lucre ne sert plus à distinguer l’association et la société : c’est la conséquence du retour à la vision élargie » du lucre sociétaire (supra, n° 9). Cette absence de distinction n’empêche pas de choisir entre des formes différentes de personnes morales, comme on l’a vu ci-dessus, mais lorsque l’on se trouve en face de simples contrats, la théorie générale du contrat conduit à préférer le contrat nommé au contrat innommé.
11. La conséquence du raisonnement qui vient d’être tenu me semble inéluctable : je l’avais déjà suggérée dans une étude parue voici dix ans45, sous forme d’une interrogation, toutefois, car j’étais un peu effrayé par cette solution logique mais pas du tout anodine comme on va le voir. Cette prise de position n’a été, à ma connaissance, ni contredite, ni approuvée par d’autres auteurs. Ceci découle probablement du peu de doctrine consacrée à l’association dite « de fait », surtout dans ses aspects théoriques. Certes, je ne puis exclure que ce silence provienne d’un geste de charité chrétienne de la part de collègues qui auraient estimé que je m’étais égaré. En tout cas, plus je réfléchis à cette question, plus je suis convaincu de la pertinence juridique de mon analyse.
12. Si on admet que l’association dite « de fait » qui a pour but de procurer un bénéfice patrimonial indirect à ses membres est qualifiable de société de droit commun à objet civil, les conséquences théoriques et pratiques de cette solution sont loin d’être négligeables.
La notion d’association dite « de fait » ne vise plus que les associations qui ne procurent à leurs membres aucun bénéfice patrimonial : qu’il soit direct ou indirect.
Celles qui visent à procurer un bénéfice patrimonial indirect ne sont pas des associations mais des sociétés de droit commun régie par les articles du Code des sociétés relatifs à de telles sociétés. Elles disposent d’un régime juridique grâce à ces textes mais cela ne signifie nullement que la différence de régime est totale avec les associations dites « de fait ». En effet, diverses solutions qui seront examinées dans la suite de cette contribution (infra, n°s 19 et suiv.) découlent de l’absence de personnalité juridique qui est commune aux associations dites « de fait » et aux sociétés de droit commun ou encore aux sociétés momentanées (article 47 du Code des sociétés).
Une conséquence importante de la qualification société de droit commun qui, selon moi, doit être donnée à certaines associations dites « de fait » concerne la responsabilité pénale. En effet, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 5 du Code pénal tel que modifié par la loi du 4 mai 1999 sur la responsabilité pénale des personnes morales, les sociétés dépourvues de la personnalité morale et notamment les sociétés civiles qui n’ont pas pris une forme commerciale – ce qui vise la société de droit commun – sont assimilées à des personnes morales pour l’application de cet article 5. Assimilation étonnante a priori mais je ne puis développer cette question ici46.
13. Le lecteur attentif aura probablement déjà aperçu une conséquence pratique assez spectaculaire de l’analyse proposée. Les syndicats de travailleurs ont certes pour but de défendre les intérêts moraux de leurs membres mais leur but principal est de défendre leurs intérêts matériels et de leur rendre des services qui leur procurent des économies, en d’autres termes, de leur procurer un bénéfice patrimonial indirect. Ces syndicats devraient donc être qualifiés non plus d’associations de fait mais de sociétés de droit commun, soumises au Code des sociétés et à la responsabilité pénale prévue à l’article 5, alinéa 3, 3° du Code pénal47.
Détonant, n’est-il pas ?
III. Où trouver les règles applicables aux associations dites « de fait » ?
14. On vient de voir que les soi-disant associations « de fait » qui ont pour but de procurer un bénéfice patrimonial indirect à leurs membres sont à qualifier de sociétés de droit commun. Les règles du Code des sociétés leur sont donc intégralement applicables.
Au contraire, ces règles ne s’appliquent en principe pas aux autres associations dites « de fait ». Toutefois, certains auteurs et quelques décisions de jurisprudence n’excluent pas l’application de certaines de ces règles par analogie « dans la mesure ou les caractéristiques d’une association de fait ne s’y opposent pas »48 ou, du moins, avec grande réserve et prudence49 mais cette optique quoique assez répandue est remise en cause et avait déjà, il faut le noter, été combattue par Jos Goedseels50, le premier auteur – et un des rares – à avoir étudié de façon approfondie les associations dites « de fait » qu’il qualifiait d’ailleurs, assez bizarrement de « communautés de fait »51.
Je rejette l’application par analogie des règles du Code des sociétés parce que, soit elle est inutile (a), soit elle déroge au droit commun du mandat (b) ou des contrats (c), ce qui exclut l’analogie en raison du principe de l’interprétation stricte des exceptions52.
a) L’analogie est inutile pour les solutions contenues dans le Code des sociétés qui sont des applications du droit commun des obligations ou du mandat et peuvent donc régir les associations dites « de fait » par le biais de ce droit commun sans qu’il soit utile de se référer au droit des sociétés. C’est par exemple le cas des articles 35 et 51 du Code des sociétés (anciens articles 1858 et 1862 du Code civil).
b) Certains textes du droit des sociétés dérogent au droit commun du mandat et ne peuvent donc être appliquées par analogie. C’est notamment le cas de l’article 36, 1° du Code des sociétés (ancien article 1859, 1° du Code civil) qui présume le mandat entre associés53. Autre exemple : l’article 50 du Code des sociétés (ancien article 1864 du Code civil) qui présente en plus de réelles difficultés d’interprétation54 qui peuvent être évitées si cet article n’est pas applicable à l’association dite « de fait » lorsqu’elle n’est pas qualifiable de société de droit commun (supra, n° 12).
15. c) Enfin, certaines règles propres aux sociétés ne peuvent manifestement s’appliquer car elles sont exorbitantes du droit commun des contrats. C’est notamment le cas pour les causes de dissolution de la société55 prévues par les articles 39 à 45 du Code des sociétés.
Ainsi, la possibilité pour tout associé de provoquer, par sa renonciation unilatérale, la dissolution d’une société lorsqu’elle est à durée illimitée56 n’est pas d’application : en raison de la liberté d’ association, chaque membre a la possibilité de démissionner, sans remettre en cause l’existence de l’association (à moins qu’il ne reste qu’un membre car l’association à membre unique est évidemment contraire à la notion même d’association) mais les statuts ou le contrat peuvent prévoir des modalités pour la démission d’un membre et même prévoir qu’elle mettra fin à l’association. À noter que, dans la société de droit commun, on peut arriver à la solution de la démission en cas d’accord unanime des associés57.
De même la possibilité de demander en justice la dissolution d’une société pour justes motifs (article 45 du Code des sociétés) n’est pas applicable à l’association dite « de fait » et c’est une fois encore la démission qui s’applique en cas de silence des statuts mais ceux-ci peuvent organiser une procédure d’exclusion d’un membre ou prévoir qu’une mésentente irrémédiable mettra fin à l’association. Dans la société de droit commun, au contraire, la dissolution judiciaire pour justes motifs est un principe impératif en ce sens qu’il ne peut être écarté d’avance par les statuts58 mais, une fois qu’un litige est né entre associés, ils peuvent renoncer à la dissolution judiciaire et choisir d’autres modes de résolution de leur conflit59.
16. Puisque l’application analogique du Code des sociétés doit être rejetée, c’est la théorie générale du contrat qui, sur le plan du droit privé, est la principale source de règles applicables au contrat innommé d’association. À noter, cependant qu’elle s’applique aussi à la société de droit commun, comme à tous les contrats nommés sauf dérogations prévues par les dispositions spécifiques à ces contrats nommés. Pour la détermination du contenu du contrat d’association ce sont avant tout les articles 1134, 1135 et 6 du Code civil qui interviennent.
En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, la liberté contractuelle est le principe : les membres ont donc en principe toute liberté pour établir leurs droits et obligations et organiser le fonctionnement de l’association. L’exception évidente est l’interdiction de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (article 6)60. Pour les atteintes aux bonnes mœurs, pas besoin de donner des exemples : je fais confiance à l’imagination du lecteur. Pour l’atteinte à l’ordre public, on peut relever un exemple qui est dans la continuité de ce qui vient d’être vu à propos de la dissolution (supra, n° 15) : la clause qui interdirait à un membre de démissionner tant que dure l’association serait nulle car la liberté d’association61 est d’ordre public. De même, sont interdites les associations dont le but est de propager des idées ou opinion prohibées par certaines lois comme la loi du 23 mars 1995 sur la négation du génocide nazi ou la loi du 30 juillet 1981 condamnant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie62.
Le contrat est la loi des parties (article 1134, alinéas 1er et 2) : les membres sont tenus de le respecter : soit qu’ils aient marqué leur accord à la constitution de l’association soit qu’ils soient entrés dans celle-ci par la suite car par leur adhésion à l’association, ils sont censés accepter le règlement de celle-ci (article 2 de la loi du 24 mai 1921)63.
Toutefois, le contrat n’oblige pas uniquement à ce qui est exprimé mais aussi, en vertu des article 1134, alinéa 3 et 1135, à ce qui découle du principe général de la bonne foi, de l’équité, des usages ou de la loi : le contrat a donc un contenu implicite64 dont le rôle s’étoffe s’il n’y a pas de contrat d’association constaté par écrit, ce qui est permis en vertu du principe déjà signalé (supra, n° 2) du consensualisme.
Il est particulièrement important de souligner le rôle de la bonne foi. C’est elle qui permet d’introduire dans le contenu du contrat d’association l’exigence d’un « esprit de collaboration et d’égalité » qui caractérise aussi le contrat de société 65 et s’avère plus adéquate que l’affectio societatis : cette formule latine traditionnelle est critiquée car elle est assez vide de sens66 et convient encore moins pour l’association puisque celle-ci est une notion distincte de la société67. L’esprit d’égalité commun à l’association et à la société implique principalement un « droit de critique et de contrôle d’égal à égal »68.
17. Il faut encore observer que pour le fonctionnement de l’association69, sa gestion et la conclusion de contrats avec des tiers, l’application analogique des règles du Code des sociétés relatives à la société de droit commun n’est pas nécessaire car les solutions peuvent être trouvées dans le droit du mandat, aux articles 1984 à 2010 du Code civil70. Je souligne que cette matière du mandat est commentée, expliquée et illustrée par de nombreuses études doctrinales et décisions de jurisprudence et qu’une analyse remarquable, très complète et clairement rédigée, peut être trouvée dans le traité de Patrick Wéry, publié en 200071.
18. Reste enfin à noter que sont transposables aux associations dites « de fait » diverses solutions qui ont été développées par la doctrine ou la jurisprudence en marge des textes légaux spécifiques aux sociétés de droit commun et aux sociétés momentanées (appelées erronément associations momentanées avant l’introduction du Code des sociétés en 2001) : en effet, il s’agit de solutions qui atténuent les conséquences de l’absence de personnalité juridique (ou morale) et peuvent donc s’appliquer aux associations dépourvues de cette personnalité juridique. C’est ce que l’on va notamment voir dans la dernière partie de cette contribution.
IV. Les conséquences de l’absence de personnalité morale de l’association dite « de fait », qu’elle soit ou non qualifiée de société de droit commun
19. Que l’on accepte ou non ma thèse sur la qualification de « société de droit commun » de certaines association dites « de fait » (supra, n° 10), les conséquences de l’absence de personnalité juridique ne différent pas72 car elles ne découlent pas de règles légales inscrites dans le Code des sociétés mais de solutions dégagées par la doctrine et la jurisprudence et de certaines dispositions légales qui s’appliquent aux groupements dépourvus de personnalité morale quelle que soit leur qualification.
A. Le rejet d’une approche « tout ou rien »
20. À première vue les choses sont simples. Les groupements dépourvus de personnalité morale n’ont aucune existence juridique : ils ne peuvent donc être titulaires de droits ou obligations et le droit doit ignorer le fait social que représente le groupement de personnes physiques : c’est seulement dans le chef de celles-ci qu’il faut envisager les conséquences juridiques du groupement. Au contraire, les groupements pourvus de la personnalité morale sont des sujets de droit à l’égal des personnes physiques.
Cette vision manichéenne est séduisante pour l’esprit et commode pour les enseignants mais elle est trop tranchée. Même si les différences entre les groupements personnalisés et ceux qui ne le sont pas restent fort importantes, les groupements sans personnalité morale ne sont pas relégués dans un néant juridique et, par ailleurs, la capacité juridique de ceux qui en sont pourvus n’est pas totale. Ainsi qu’on va le voir, la capacité juridique des seconds et l’incapacité des premiers sont le principe mais avec, dans les deux hypothèses, des exceptions.
1. La pleine capacité de principe des groupements dotés de la personnalité morale
21. Ce qui caractérise fondamentalement la technique de la personnalité morale, c’est le principe de la pleine capacité de l’entité sujet de droit.
Ce principe découle, a contrario, du fait que nulle part la loi n’énumère de façon limitative les prérogatives reconnues aux entités dotées de la personnalité morale. De plus, il a été clairement affirmé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 31 mai 195773, du 17 mai 196274 et du 13 avril 198975. Ce principe traduit le caractère libéral de notre droit. On préfère accorder aux entités avec personnalité morale une capacité de principe plutôt que de procéder par voie d’attribution expresse de droits76.
Grâce à sa pleine capacité, l’entité sujet de droit peut réunir dans son patrimoine tous les droits et obligations qui se rapportent à son activité.
2. Exceptions à la pleine capacité de principe
22. Tout en posant le principe de pleine capacité, la Cour de cassation indique que celle-ci connait deux types d’exceptions : celles qui résultent de la « nature » de la personne morale (a) et celles qui sont prévues par la loi (b).
a) Certains actes - c’est-à-dire certains droits ou certaines obligations - sont exclus en raison de la « nature de l’être moral ». Qu’est-ce-à dire ?
De toute évidence, un certain nombre d’actes sont hors de portée des êtres moraux comme le droit de se marier, de faire un testament ; comme le fait d’être mis en prison… ou d’avoir la tête tranchée, etc.
L’exception n’a d’intérêt véritable que là où l’hésitation est permise. Ainsi envisagée, il apparaît que sa portée est assez réduite et tend même à diminuer avec l’évolution des idées et la prise de conscience du fait que la personnalité morale est avant une technique d’affectation patrimoniale. Ce qui s’est notamment manifesté à propos des sociétés civiles professionnelles. Alors que pendant longtemps, l’exercice d’une profession libérale a été jugé incompatible avec la « nature de l’être moral », les sociétés ayant pour objet social l’exercice de pareilles professions sont désormais admises. De même admet-on de nos jours que les sociétés ont un droit à l’honneur77 car une atteinte à leur réputation peut leur faire perdre de la clientèle, ce qui constitue un préjudice patrimonial.
Une autre évolution concerne le droit à la vie privée. Normalement, ce droit fait partie de ces prérogatives dont les personnes morales sont exclues à raison de leur nature propre : elles n’ont ni vie familiale, ni orientations sexuelles, ni dossier médical, ni convictions religieuses, etc. à protéger. Ce principe est, toutefois, nuancé depuis longtemps, par la reconnaissance d’un droit au « secret des affaires « dont bénéficient les entreprises personnes morales. Mais ce droit peut-il s’appuyer sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou 22 de la Constitution Belge ou, encore, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui reconnaissent à toute personne « le droit au respect de sa vie privée et familiale » ? On a pu en douter78 mais, depuis quelques années, une réponse affirmative est devenue incontestable, ce qui se manifeste clairement dans un important arrêt de notre Cour constitutionnelle du 19 septembre 200779. Certes, l’évolution concerne le secret des affaires des sociétés commerciales mais je pense qu’elle doit pouvoir être appliquée aux groupements sans but lucratif car la réalisation optimale de leurs missions suppose la protection de divers secrets – sur leur stratégie, leurs projets, leur savoir-faire ou sur certains événements de leur vie interne – dont la divulgation est susceptible de leur causer un préjudice et qui peuvent être assimilés à des secrets d’affaires entendus au sens large80.
Voici, cependant, deux exemples d’exceptions persistantes. Un : L’article 6, alinéa 1 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur stipule que seules les personnes physiques peuvent être titulaires originaires du droit. Les sociétés dotées de la personnalité morale ne peuvent détenir que des droits dérivés. Deux : jusqu’à nouvel ordre, la jurisprudence refuse d’admettre qu’un groupement doté de la personnalité morale puisse être engagé dans les liens d’un contrat de travail81.
b) Certaines exceptions à la pleine capacité résultent de la loi. Il s’agit d’abord de la spécialité légale des personnes morales quant à leur but ou leurs activités. Ainsi les ASBL ne peuvent-elles avoir pour but d’enrichir leurs membres alors que c’est, au contraire, un but obligatoire pour les sociétés. De même, les sociétés agricoles ne peuvent avoir comme activité que l’exploitation d’une entreprise agricole ou horticole (article 789 du Code des sociétés). Ensuite, certaines activités sont, en vertu de dispositions légales particulières, interdites à certaines formes de personnes morales : par exemple, les entreprises privées d’assurance ne peuvent se constituer en SPRL82.
3. L’incapacité de principe des groupements dépourvus de personnalité morale
23. L’absence de personnalité morale implique, par corollaire à ce qui vient d’être vu, une incapacité de principe.