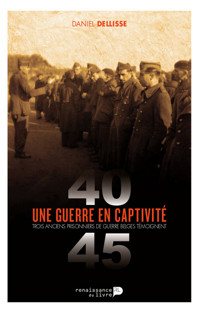Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’odyssée des émigrants belges au Wisconsin au milieu du XIXe siècle
« Les hautes forêts qui couvrent le pays ont un aspect qui, de prime abord, peut en faire considérer le défrichement comme impossible, tant les arbres y sont épais et gigantesques (…) se croisant en tous sens et formant des masses presque impénétrables. » Tel est le décor qui attend les quelques milliers d’émigrants belges qui, entre 1853 et 1856, fuient la misère des campagnes brabançonnes et hesbignonnes, et tentent l’aventure américaine dans le nord-est du Wisconsin. Après l’enfer de l’entrepont et les pièges des « trafiquants de passagers », ceux qui s’astreignent au défrichement ne sont pas au bout de leurs peines. Ils connaîtront un des pires incendies de forêt de l’histoire des Etats-Unis, et certains d’entre eux seront entraînés dans la guerre de Sécession. Mais à force de courage et de persévérance, et parfois avec l’aide des « sôvadjes » (sauvages, comme ils appellent les Indiens), ils parviendront au bien-être qu’ils ne pouvaient atteindre en Belgique. Aujourd’hui, leurs descendants constituent la plus grande communauté d’origine belge aux USA. Ils préservent un héritage fait de détails architecturaux, de recettes de cuisine et de quelques mots de patois wallon.
Un ouvrage passionnant qui retrace au travers de nombreux témoignages l'aventure américaine de milliers de Belges à la recherche d'un Eldorado !
EXTRAIT
New York ! Un premier, un énorme soulagement pour tous les émigrants. Dans le récit de son voyage en décembre 1849, lorsqu’il accompagnait, à la demande du gouvernement belge, le premier groupe d’émigrants en route pour la colonie subsidiée de Sainte-Marie, en Pennsylvanie, le chirurgien-major N. Reiss rapporte : « Enfin (…) on vit terre du haut des mâts. Le lendemain de grand matin, le pilote vint à bord. Les passagers étaient tous sur le pont. Tous les regards étaient dirigés vers les hauteurs que l’on vit poindre à l’horizon. Mais la brise était faible, nous avançâmes lentement. Dans l’après-dinée des bateaux à vapeur-remorqueurs voltigèrent d’une manière agaçante autour de nous, enfin après de longs débats, l’un d’eux s’attella au navire. Un hourra vigoureux, trois fois répété par tous nos émigrants, salua cet heureux événement, et le soleil était à peine couché, que nous pénétrâmes au milieu de la flotte marchande, qui en rangs serrés, longe les quais de New-York. »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste de formation,
Daniel Dellisse travaille actuellement dans la presse syndicale après avoir collaboré pendant onze ans au journal
Le Soir. Son intérêt pour l’histoire de l’émigration l’a conduit aux Etats-Unis à quatre reprises, au Wisconsin mais aussi à New York et dans la région des Grands Lacs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCTION
C’était en septembre. Par une lumineuse fin d’après-midi, au volant d’une Chevrolet de location, j’arrivais pour la première fois dans ce coin d’Amérique que l’on disait habité par des descendants d’émigrants belges. Pour une raison que j’ai oubliée, mon premier objectif était de visiter, et d’abord de trouver un cimetière réputé pour ses pierres tombales à consonances belges. Un peu monotone au début, la « highway 57 » finissait par traverser, à l’époque, le village de Dyckesville, en même temps qu’elle longeait la baie Green. L’endroit était plaisant, je m’y suis arrêté. Près de la baie, au hasard, j’ai sonné à une porte. Une dame âgée est venue ouvrir. A peine m’étais-je présenté comme visiteur venu de Belgique, mon Américaine appelait une voisine et, ensemble, nous nous mettions en route vers le fameux cimetière.
Elle s’appelait Alice M. Bader. Elle portait le même nom que Jean-Baptiste et Marie Bader qui, avec leurs trois fils, ont quitté Longueville (Chaumont-Gistoux) en 1855. Chaumont-Gistoux, aujourd’hui une des communes les plus riches de Belgique en termes de revenus par habitant, était à l’époque peuplée de paysans en sabots que l’organisation de la société condamnait à la misère. Comme quelques milliers de compatriotes entre 1853 et 1856, les Bader ont préféré tout quitter et tenter leur chance en Amérique. Ils ne connaissaient guère que leur village et ceux de leurs parents ; ils ont rejoint Anvers, pris la mer et, arrivés dans un pays dont ils ne comprenaient pas la langue, se sont frayé un chemin jusqu’aux rives du lac Michigan, posant enfin leurs bagages au Wisconsin, dans une forêt épaisse où vivaient déjà des ours et des Indiens. Un périple et un pari extraordinaires.
Avec le temps, les émigrants belges ont eu d’autres voisins, émigrants comme eux, mais venus d’autres pays. Il est étonnant de constater qu’à l’époque, le fameux melting-pot américain ne brassait pas encore les populations dans cette partie du Midwest. Malgré les difficultés qu’ils rencontraient tous au même moment, les Belges, les Allemands, les Irlandais, les Norvégiens ne se mélangeaient pas. Dans cet environnement si nouveau, si différent, chacun s’accrochait à son groupe, sa langue, ses traditions. Dans une certaine mesure, la communauté belge du Wisconsin s’y accroche d’ailleurs toujours.
Pendant la rédaction de cet ouvrage, l’actualité a livré son lot d’exemples de racisme ordinaire : « chasse au nègre » en Calabre, rejet des demandeurs d’asile dans le Luxembourg belge, crainte d’une arrivée massive de réfugiés après les révolutions arabes… A Schaerbeek, aux beaux jours, les trottoirs encombrés de la commerçante chaussée de Helmet font parfois penser à ces vieilles photos de New York, quand les émigrants juifs et italiens s’entassaient dans le bas de Manhattan. D’aucuns s’en offusquent. Pourtant, quelle différence entre l’homme aux babouches dans les rues de Bruxelles en 2010, et l’homme aux sabots dans les rues de Green Bay, au Wisconsin, en 1855 ? On ne quitte jamais les siens de gaieté de cœur.
Il est étonnant, aussi, de constater que les descendants des émigrants belges sont globalement conservateurs, et que certains d’entre eux ne cachent pas leur agacement devant ces Mexicains qui, à leur tour, aujourd’hui, se déplacent dans l’espoir d’un avenir meilleur.
En gros, l’histoire de la vague d’émigration belge vers le Wisconsin est connue chez nous depuis les années 1950. Antoine De Smet, Jean Ducat, Mary Ann Defnet, Thierry Eggerickx, Guy Gallez et Kathleen Race, notamment, ont exhumé ces souvenirs d’exil et accompli le travail de fourmi qui nous permet aujourd’hui de mieux comprendre cette émouvante page d’histoire.
Par rapport aux ouvrages déjà parus sur le sujet, celui-ci se veut original sur le plan du récit. On n’y trouvera pas de tableau avec les dates de départ et d’arrivée des bateaux, ni la liste des passagers. L’approche, ici, donne la priorité aux témoignages d’époque – transcrits en respectant la graphie et la syntaxe originales –, de manière à ce que chacun puisse, dans la mesure du possible, revivre le parcours des émigrants, des circonstances du départ jusqu’à l’incendie de Peshtigo, qui marqua un tournant dans l’histoire de la communauté. Un exercice de reconstitution en somme, mais avec les limites naturelles du genre, imposées par la distance temporelle et la formidable évolution de notre mode de vie, qui influencent forcément notre lecture du passé. Napoléon Ier l’a dit à sa manière : « Qu’est-ce l’histoire, sinon une fable sur laquelle tout le monde est d’accord ? ».
Un récit, donc, mais sans sacrifier la rigueur pour autant. Confrontation des sources – y compris les sources américaines –, volonté de combler les vides, lecture attentive des archives : ce livre s’appuie aussi sur une documentation qui, par rapport aux publications précédentes, permet d’ailleurs d’apporter quelques précisions de fond. Ces précisions concernent notamment les Indiens qu’ont rencontrés les émigrants belges, le contingent d’émigrants flamands, la réaction des autorités belges et le comportement des émigrants pendant la guerre de Sécession.
Enfin, tout un chapitre, le dernier, est consacré aux traces laissées par les émigrants dans le Wisconsin d’aujourd’hui. Cette partie-là, plus proche du reportage, rassemble les impressions et les paroles glanées au cours de quatre séjours dans une autre Amérique, de New York aux Grands Lacs, sur les pas de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui, un matin, il y a cent cinquante ans, ont fermé la porte de leur maison, se sont retournés, ont respiré profondément et se sont lancés dans l’inconnu.
Bon voyage.
PREMIÈRE PARTIE
« La séparation », huile de Charles Degroux, 1862.
LA TERRE ET LE CIELLa Belgique rurale de 1850
C’est l’époque de « L’Angélus ». Le tableau de Jean-François Millet a fait le tour du monde : penché sur sa terre, un couple de paysans interrompt son travail pour prier, alors que sonnent au loin les cloches de l’église du village, quelque part en Île-de-France. En Belgique aussi, le réalisme social eut ses adeptes. Charles Degroux, parmi d’autres, nous a légué quelques images de la vie à la campagne au milieu du XIXe siècle : un paysan, sarrau bleu sur les épaules, sabots aux pieds, dépité devant un champ de blé couché par l’orage (« La récolte perdue ») ; des glaneuses au regard triste, bonnet sur la tête, rassemblant dans leur tablier les épis abandonnés après la moisson (« Les glaneuses ») ; la famille nombreuse réunie autour de la table, priant avant de partager le repas (« Le bénédicité ») ; des prêtres de passage, portant soutane et tricorne noirs (« La promenade ») ; et ce milicien ou cet émigrant, baluchon à la main, faisant ses adieux à des femmes en pleurs (« La séparation »).
La jeune Belgique compte alors 4,5 millions d’habitants. Selon le recensement de 1846, la moitié de la population vit de la terre. Les paysans du nord parlent le flamand, ceux du sud parlent le wallon et la bourgeoisie parle le français. Dans les lieux de pouvoir, la tradition, défendue par les catholiques, s’oppose à la modernité représentée par les libéraux. En réponse à la vague révolutionnaire qui a secoué les capitales européennes en 1848, le gouvernement de Charles Rogier (libéral), un vétéran de l’indépendance, a revu à la baisse le niveau d’impôt requis pour voter, de sorte que le nombre d’électeurs a été multiplié par deux : désormais, 2% de la population belge a le droit de vote…
La Belgique de 1850, c’est aussi la révolution industrielle. La métallurgie traditionnelle utilisait le charbon de bois comme combustible. Depuis l’adoption du coke de houille, les centres métallurgiques se sont déplacés des régions forestières vers les bassins houillers comme ceux de Liège et de Charleroi. Le développement des voies de communication accompagne la croissance économique. Des canaux ont été creusés sous le régime néerlandais, notamment le canal Charleroi-Bruxelles, inauguré en 1832. Puis, le pays a entamé la construction du premier chemin de fer du continent européen. Entre 1834 et 1859, la production hennuyère de charbon est multipliée par huit, celle de fer par six, celle de fonte par quatre. La Belgique est et restera jusqu’à la fin du siècle la deuxième plus grande puissance industrielle, à l’égal des Etats-Unis d’Amérique, derrière la Grande-Bretagne.
Londres est le centre du monde. La capitale de l’empire britannique accueille d’ailleurs l’Exposition universelle de 1851, première du genre. L’heure est au machinisme et à la voie ferrée. Avec sa chaudière surbaissée et ses grandes roues motrices, la locomotive Crampton atteint la vitesse incroyable de 140 km/h ! Dans les allées de l’Exposition, sous les verrières du Crystal Palace, les redingotes et les fourreaux échangent leurs impressions sur l’exploration de l’Afrique et le démembrement de l’Empire ottoman. Des nouvelles du monde dont le paysan ignore tout. Les journaux n’atteignent pas les campagnes, où le bouche à oreille reste le meilleur moyen de propager les informations. Au village, on sait lire aussi, mais on se contente d’almanachs et de livres de prière1.
Un ouvrier qui loue ses bras à un fermier
Cette terre dans laquelle il place tous ses espoirs, le paysan ne la possède pas. C’est un journalier, un ouvrier agricole qui loue ses bras à un « cinsi » (fermier) qui lui-même dirige une grande exploitation pour le compte d’un noble ou d’un bourgeois. Ne devient pas fermier qui veut. Entre propriétaires et exploitants, les liens sont tenaces, et seules quelques familles ont le privilège de diriger les grandes fermes, de génération en génération. Les alliances sont d’ailleurs soigneusement contrôlées. C’est l’aristocratie agricole2.
La journée de travail débute à 6 heures et s’achève à 18 heures en été ; elle commence à 7 heures et se termine à 17 heures en hiver, avec deux heures à deux heures et demie d’interruption selon la saison3. En échange de sa peine, l’ouvrier reçoit un salaire de misère : 1 franc et quelques centimes par jour, voire moins s’il est nourri par son employeur4. La terre, elle, dans le canton de Jodoigne, coûte entre 3.000 et 4.000 francs l’hectare5.
Alors, pour permettre à sa famille de subsister, le paysan loue un champ d’un demi-hectare ou d’un hectare. Un investissement de 50 ou 100 francs par an6. La mère et les enfants en bas âge, surtout, cultivent cette parcelle, mais quand il le faut, le père les y rejoint, avant ou après sa journée chez le fermier. L’école, payante – jusqu’à 1 franc par mois si l’enfant doit apprendre à écrire7 –, n’est pas une priorité. Les produits de ce champ, du lin, du froment, du seigle, des pommes de terre, ajoutés aux légumes, au houblon et au tabac du potager, sont consommés par le ménage, sauf le froment qui est vendu, car les paysans ne mangent que du pain de seigle, moins cher8. Le lin est filé par la mère et les enfants, puis tissé par le père, le soir et pendant la saison creuse.
A Gaasbeek, près de Bruxelles, le comte Giovanni Arrivabene, un proscrit italien, économiste et philanthrope, témoigne : « Vous voyez l’ouvrier porter le fumier, brouettes par brouettes, sur un champ, qui est souvent à un quart de lieue (environ 1 kilomètre, NDLR) de son habitation, et reporter de la même manière les récoltes à la maison. Vous le voyez, courbé sur la terre, la remuer à grande peine avec la houe. Vous voyez mari, femme, enfants, tous attelés à la herse, la traîner péniblement à coups de collier9. »
Pour survivre, de nombreux ménages exercent aussi un métier d’appoint. Dans les communes du centre du pays, le teillage du lin est une activité répandue10. Il s’agit de séparer la fibre de l’écorce, pour le compte d’un marchand. Un travail particulièrement pénible, car il dégage beaucoup de poussière.
Ces journaliers constituent la majorité des habitants des campagnes. Mais les villages comptent également des artisans, maréchaux-ferrants, menuisiers, charpentiers, tisserands, qui louent eux aussi un champ et grossissent les rangs des ouvriers agricoles à la moisson11.
Et puis, il existe des « petits fermiers » qui travaillent exclusivement à leur compte, vivant de quelques hectares de terre, et à qui les « grands fermiers » louent leur matériel. « Les produits des terres des petits propriétaires et des petits fermiers sont un peu moins abondants et moins beaux que ceux des terres des grands fermiers », note encore le comte Arrivabene. « La raison en est simple ; ils ne peuvent labourer leurs terres avec la charrue qu’après que les fermiers ont achevé leurs travaux, et souvent c’est hors de saison ; s’ils les labourent à la bêche, le travail est grand, ils ne le font que superficiellement, et ne détruisent pas les mauvaises herbes ; outre cela ils manquent de fumier et n’achètent pas de chaux12. »
Des murs en torchis, un toit de chaume
Dans une enquête sur les budgets des familles ouvrières parue en 1855, la Commission centrale de statistique de Belgique distingue trois catégories de ménages : « aisés », « peu aisés » – ceux-là ne participent pas au financement de l’assistance publique – et « indigents ». L’enquête rassemble les contributions des administrations communales et provinciales. A Liernu, en Hesbaye namuroise, le journalier « aisé » possède une maison de trois pièces avec une petite grange, une étable et un four à pain. Il élève une vache, un porc et des poules.
Disposer d’une vache est une bénédiction. Non seulement la brave bête tire la herse à la place des hommes, mais encore elle leur donne du lait, et donc du fromage et de la tarte. C’est cher – de 140 à 160 francs –, mais les marchands de bétail font crédit13. Pour nourrir sa vache, on la mène paître sur les talus, une tâche dévolue aux femmes et aux enfants. Les pauvres sont aussi autorisés à glaner sur les champs après les récoltes.
Mais en bas de l’échelle, l’indigent ne possède rien ou presque, pas même une poule. Sa maison de deux pièces lui coûte 30 francs par an, et pour engraisser son potager, il utilise le fumier que ses enfants ramassent sur les chemins. La commission provinciale de Namur constate que « cette famille offre le type le plus ordinaire des journaliers agricoles dans les campagnes14 ».
Dans la même publication, l’administration communale d’Opwijk, dans le Brabant flamand, note : « Les habitations sont, pour la plupart, de petites chaumières, avec toitures en paille, construites en charpentes de bois blanc, et dont les murs en lattes sont enduits d’argile. Les chaumières présentent, dans leur ensemble, beaucoup d’irrégularités ; elles se composent, au rez-de-chaussée, de trois petites pièces sans pavement et d’un petit vestibule qui sert de refuge, et dans lequel se trouve ménagée une couchette pour les enfants. Il n’y a qu’un foyer dans la pièce qui sert de cuisine et de lieu de réunion. Le tout est surmonté d’un grenier mal planchéié. L’étage est très bas et les ouvertures sont insuffisantes et mal disposées ; de sorte que toutes les émanations nuisibles séjournent dans la maison. En général, les ouvriers sont, quant à leurs habitudes hygiéniques, d’une insouciance qui ne peut s’expliquer que par l’ignorance où ils sont de ses effets pernicieux. La seule mesure d’assainissement à laquelle ils aient recours, c’est le badigeonnage au lait de chaux de leur cabane, une fois par an, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; mais leur seul but est de donner à leur demeure un air de fête à l’occasion de la kermesse. »
La même administration décrit également les repas des « ouvriers cultivateurs » : « Leur alimentation se compose d’ordinaire : au lever, d’une bouillie de sarrasin (variété de céréale, NDLR) au lait battu ; au déjeuner, vers huit heures, de quelques tranches de pain de seigle, recouvertes de fromage de lait battu caillé ; au dîner, de pommes de terre, assaisonnées d’un peu de graisse, de poivre et de sel ; l’après-midi, d’un morceau de pain avec du fromage comme le matin et quelques tasses de café-chicorée très limpide ; le soir, de pommes de terre comme le midi ou du restant de la bouillie du matin15. »
Les statistiques provinciales confirment que les pommes de terre et le pain de seigle constituent l’essentiel du régime alimentaire paysan. Dans les arrondissements de Nivelles, de Louvain, et dans la campagne namuroise, un ouvrier agricole consomme en moyenne 1 kilo de pommes de terre par jour et presque autant de pain de seigle16. Ceux qui ont la chance de posséder un porc le tuent traditionnellement en fin d’année et salent la viande pour la conserver six mois, en la consommant au rythme d’un ou deux repas par semaine. La viande fraîche et le pain blanc sont des plaisirs coûteux que l’on s’autorise uniquement les jours de kermesse.
Une brève revanche sur la misère
Temps fort de la vie de la communauté villageoise, la kermesse est organisée le dimanche qui suit le jour de la fête du saint patron. Ou le dimanche précédent, car « on adore la panse avant le saint ». Brève revanche sur la misère, c’est le temps de la bombance et des libations, que l’on fait durer plusieurs jours. La fête bat son plein le dimanche et le lundi. Le cheval, bête de trait des nantis, est l’attraction principale. L’après-midi, les cavaliers font la course ou participent au carrousel, où il s’agit d’enfiler des anneaux avec une tige. Le vainqueur emporte une bride, une pendule ou une lampe à huile. Puis, le soir, on danse dans les cabarets. Officiellement, les « jeunesses étrangères » sont les bienvenues, mais les rivalités sont tenaces et les bagarres fréquentes. Le mardi, réservé aux habitants du village, est le jour des jeux d’adresse : course en sac et jeu des grenouilles, qu’on transporte sur une brouette. Et on remet ça le dimanche suivant, le dimanche de la « remise »17.
Mais en dehors des jours de fête, les divertissements sont rares. L’administration communale d’Opwijk observe encore que « les distractions, le dimanche, consistent, pour les parents, l’été, en une causerie dans le voisinage, sur la perspective d’une bonne ou mauvaise récolte, et l’hiver, en plaintes sur les intempéries et la rigueur de la saison. Les enfants ignorent les jeux de leur âge ; en été, ils se roulent dans la poussière et en hiver dans la neige. La pénurie des ressources de ces pauvres familles leur interdit l’accès du cabaret, et leur chef est trop heureux lorsqu’il peut se permettre un petit verre de genièvre le dimanche, avant ou après la messe. Tous les ouvriers du sexe masculin font d’ailleurs une certaine consommation de tabac à fumer ; c’est pour eux une espèce de pain quotidien, dont ils se régalent lors de chacun des repos du jour. (…) heureusement que le tabac leur coûte fort peu ; chacun en cultive quelques plants pour son usage particulier (…)18. »
Cette vie austère, le paysan la supporte parce qu’il est croyant. A peine né, l’enfant est baptisé, car s’il meurt avant, il errera dans les limbes. Le dimanche est le jour du Seigneur, du linge propre et des souliers. Grand-messe le matin, vêpres l’après-midi. Les nouvelles s’échangent sur le parvis de l’église et les conflits sont jugés en chaire, d’où le curé, dit-on, reconnaît les « macrales » (sorcières) dissimulées dans l’assistance. Au printemps, la communauté processionne sur les chemins caillouteux jalonnés de potales, pour implorer la protection divine. Le son familier de la cloche rythme la vie. A toute volée les jours de fête, lentement pour annoncer un décès. Jusqu’au champ où, trois fois par jour, il appelle le fidèle à interrompre son labeur pour réciter l’angélus : « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs… »
Une structure sociale déséquilibrée
La maisonnée compte habituellement cinq à six membres. Traditionnellement, les enfants quittent leurs parents entre 14 et 18 ans pour devenir domestique ou servante chez un fermier. Ils font des économies puis se marient entre 20 et 30 ans. S’ils n’ont pas hérité de la maison de leurs parents, ils achètent ou louent un petit terrain pour y bâtir une maison et deviennent à leur tour ouvriers agricoles19. Une structure sociale bien hiérarchisée que reflète le fonctionnement des secours apportés aux victimes d’un incendie : « Lorsqu’une maison de journalier devient la proie de l’incendie, son propriétaire reçoit un certificat du bourgmestre qui constate les faits ; le curé et les principaux fermiers signent aussi ce certificat. Muni de cette pièce authentique, il parcourt le pays, pendant deux ou trois mois ; il se présente aux personnes aisées et en reçoit des aumônes. (…) Toute la tournée pourrait lui rapporter à peu près 400 francs20. »
Mieux vaut naître du bon côté de la barrière, car, pour le fils de paysan, les opportunités de promotion sociale sont inexistantes. Dépendants de quelques rares employeurs, les journaliers sont condamnés à la misère. Ce déséquilibre social est encore accentué par la croissance démographique que connaissent les pays d’Entre-Loire-et-Rhin depuis le XVIIIe siècle. Les disettes et les épidémies s’espacent. Chaque année, un médecin itinérant payé par le gouvernement s’installe pour quelques jours dans le chef-lieu du canton et vaccine les enfants qu’on lui amène. L’hygiène progresse lentement. Même les plus pauvres ont pris l’habitude de manger avec une fourchette plutôt qu’avec leurs mains21.
La mortalité infantile régresse et l’espérance de vie s’allonge. Depuis l’indépendance, la Belgique a gagné un demi-million d’habitants. C’est déjà un des pays les plus densément peuplés d’Europe. Les villages de la Hesbaye brabançonne enregistrent des populations records – même lorsque, cent cinquante ans plus tard, dans une Belgique de 10 millions d’âmes, ils deviendront des dortoirs pour navetteurs pressés, ils ne compteront pas autant d’habitants.
Cette pression démographique se traduit par un morcellement des exploitations agricoles. En 1846, on compte 80 exploitants pour 100 hectares, et deux tiers des terres sont louées22. En 1847, la chambre de commerce et des fabriques de Bruxelles constate : « La Belgique dont la population va toujours croissant, n’a plus (…) assez de terres pour nourrir ses habitants ; c’est là un fait que plus personne ne conteste23. »
En réponse au manque de terre, le Parlement adopte en 1847 une loi autorisant la vente des « communaux » à des particuliers. Les communaux sont des terres appartenant aux communes, inexploitées mais où les pauvres mènent paître leur bétail, ramassent du bois de chauffage et coupent du bois de construction. Après l’adoption de la loi, en vingt ans, l’étendue des communaux tombe de 324.000 à 262.000 hectares. Cette campagne de défrichement touche surtout le Luxembourg, le Limbourg et la Campine. Mais les terres sont attribuées à des investisseurs non agriculteurs, et les paysans n’en profitent donc pas, au contraire24.
Car, dans ce contexte de surpopulation, la terre est un bon investissement. Le comte Arrivabene explique : « Les propriétaires ont un receveur ; celui-ci, lorsqu’il a un champ à louer, le fait annoncer, et le loue au plus offrant, si toutefois c’est une personne qui lui convienne. (…) La concurrence est grande. Les propriétaires aiment à louer leurs terres en petits lots, parce qu’ils les louent ainsi plus cher. (…) Ceux qui ne louent pas de terre sont considérés comme bien pauvres, et ils le sont en réalité ; lorsqu’on veut dire qu’une famille est très pauvre, on dit qu’elle n’a pas de terre25. »
Dans l’arrondissement de Nivelles, la valeur locative d’un hectare s’établissait à 70 francs en 1830 ; elle franchit la barre des 100 francs au milieu du siècle. La valeur vénale suit la même tendance. Dans le même temps, les salaires stagnent ou augmentent de quelques centimes26. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches.
Cet écart se traduit à toutes les étapes de l’existence, et notamment lors du service militaire. Une fois par an, dans chacun des cantons de milice, un tirage au sort désigne les conscrits. Tous les jeunes hommes de 19 ans sont convoqués. A l’appel de son nom, chacun prend un numéro dans une urne. Les plus petits numéros sont enrôlés, jusqu’à concurrence du contingent attribué au canton27. Mais les malchanceux peuvent se faire remplacer. Plus précisément, on peut « acheter un remplaçant ». Le prix est officiellement fixé à 1.600 francs, une somme considérable qui trouve toujours preneur. Les fils de bourgeois se font donc remplacer. Les fils d’ouvrier, eux, n’échappent pas à la caserne.
Les pommes de terre ont le mildiou
Tel est le sort peu enviable d’un grand nombre de Belges au milieu du XIXe siècle. C’est à ce sombre tableau que vont venir s’ajouter deux malheurs qui pousseront certains à l’émigration.
On l’a vu, la pomme de terre occupe une place importante dans le régime alimentaire du paysan. D’un naturel conservateur, celui-ci a tout de même adopté à la fin du siècle précédent cette nouvelle plante importée d’Amérique du Sud, parce que son rendement est le double de celui du blé – sur une surface identique, elle nourrit deux fois plus de personnes – et qu’elle résiste mieux au passage des armées. Or, à la mi-juillet 1845, partout on signale que les tubercules sont malades. Les jeunes pousses présentent des taches blanches duveteuses. Les feuilles brunissent et se recroquevillent. C’est le mildiou. En quelques semaines, le fléau dévaste la Belgique mais aussi la plupart des pays européens.
En Belgique, la perte de production atteint 87%28. Pire encore : l’origine du mal n’est pas identifiée et aucun remède n’est proposé aux cultivateurs. Il faut dire qu’en dehors du Conseil supérieur de l’agriculture, organe consultatif gouvernemental, la promotion du progrès scientifique dans l’agriculture ne mobilise pas grand-monde. Charles Rogier, le chef du gouvernement, annonce des mesures en 1847, mais l’Institut agricole de l’Etat à Gembloux ne sera fondé qu’en 1860, et le ministère de l’Agriculture ne sera créé qu’en 1884. Quant aux comices organisés en 1848, ils ne regroupent que des notables29. Le mildiou continue donc de faire des ravages pendant de longues années, sans plus atteindre néanmoins les proportions connues en 1845.
Comme si cela ne suffisait pas, le froid s’attarde dangereusement dans les campagnes. En 1846, des gelées tardives, précédées d’un hiver humide et suivies de fortes chaleurs, abîment les champs de céréales. Le seigle est lui aussi frappé d’une maladie : la rouille. Cette année-là, puis encore en 1849, les récoltes de froment et de seigle sont de 20 à 50% inférieures à celles d’une année normale30.
Une fois de plus, la loi de l’offre et de la demande s’applique au détriment des pauvres en faisant grimper les prix des denrées alimentaires. En deux ans, les prix des pommes de terre et du pain de seigle sont multipliés par deux pour atteindre respectivement 12 et 35 centimes le kilo. Quant au pain de froment, il culmine à 49 centimes le kilo31. Inabordable, plus que jamais, pour beaucoup.
Les organismes sont affaiblis. La Belgique est touchée par une épidémie de typhus qui fait 12.000 victimes en 1846 et 1847, puis par le choléra qui provoque 22.000 décès en 1849. Dans les communes rurales du Brabant, le typhus est une maladie récurrente qui emporte près de 400 personnes par an. Dans son registre 1854, le curé de Grez-Doiceau écrit : « Depuis le mois d’août 1854, le typhus exerce ici ses ravages. Grande chèreté des denrées, hiver très rigoureux, 16 degrés centigrade sous zéro32. »
Les artisans face à la mécanisation
Cette crise alimentaire, c’est le premier malheur qui s’abat sur les futurs candidats à l’émigration. Le second, c’est la disparition de l’artisanat. Les Britanniques, encore eux, ont inventé la navette mécanique et la machine à filer le coton. Ils exportent de grandes quantités de tissu bon marché sur le continent européen, où ces nouvelles techniques sont appliquées au lin. Face aux manufactures, les artisans ne sont pas de taille. Les fileuses et les tisserands perdent leur revenu d’appoint au moment où ils en ont le plus besoin.
Dans une enquête sur la condition des ouvriers et le travail des enfants publiée en 1846, le docteur J. Dieudonné, secrétaire du Conseil central de salubrité publique de Bruxelles, raconte : « Dans une commune voisine de la ville de Bruxelles, vit une famille composée du père, de la mère et de ses sept enfants, dont l’habitation est sise en pleine campagne ; le père, la mère et deux filles de l’âge de douze à quatorze ans environ, exercent la profession de tisserands en coton. Leur logement est au rez-de-chaussée, et se compose d’une petite pièce carrée, dans laquelle se trouvent deux métiers à tisser, qui en remplissent tout l’espace, puis d’un réduit attenant à cette pièce, et juste assez grand pour contenir un métier ; c’est dans ce réduit que la famille a trouvé moyen de se loger la nuit, en fixant au-dessus du métier, et à 80 centimètres environ de distance du plafond, un immense bac, garni d’une mauvaise paillasse ; c’est dans ce réduit encore que nous avons rencontré les provisions de ménage consistant en quelques légumes, plus quelques lapins vivants, partageant et corrompant avec la famille l’air déjà si peu salubre de cette pièce. Le pauvre ménage dont nous nous occupons ne mange jamais de viande : sa nourriture se compose exclusivement de pain, de pommes de terre et de faible café au lait. La mère, en travaillant depuis cinq heures du matin jusqu’à dix heures du soir, estime qu’elle peut gagner environ 1 franc ; une de ses filles, habile travailleuse, peut gagner à peu près autant ; le père, occupé dans une fabrique des plus insalubres, gagne 1 franc par jour ; quant au travail des autres enfants, il est improductif, par la raison qu’ils ne font que garnir les navettes. Voilà donc quelles sont les ressources de cette famille, ressources fort éventuelles, car l’ouvrage manque souvent, et alors la journée du père et l’exploitation d’un petit coin de terre doivent subvenir à tous les besoins du ménage. Une fille était bossue et rachitique ; la mère et une autre fille étaient pâles et étiolées, et plusieurs autres enfants étaient scrofuleux. Notre cœur était navré en quittant cet intérieur, d’ailleurs assez propre, où nous avions vu tant de misère, tant de courage et de résignation33. »
Les artisans du textile souffrent, mais ils ne sont pas les seuls. Car la mécanisation s’introduit dans de nombreuses professions. En 1851, la chambre de commerce de Nivelles constate : « Nos distilleries ne peuvent soutenir la concurrence ruineuse que leur font les grands établissements, qui peuvent produire à des conditions plus avantageuses et, principalement, ceux des grandes villes (…) ; de 27 établissements qui fonctionnaient dans notre arrondissement en 1840, fabriquant plus de 200.000 hectolitres, il ne s’en trouvait plus, en 1850, que huit qui n’ont pas travaillé 50.000 hectolitres34. »
La « misère des Flandres »
C’est la « misère des Flandres » que mentionneront toutes les histoires de Belgique. Les pauvres mangent les chiens et les chats. On déterre les cadavres d’animaux. Des bandes de mendiants pillent les boulangeries, attaquent les convois de grains. La taille des conscrits diminue. La phtisie et le rachitisme se répandent35. Bien plus tard, aux Etats-Unis, un émigrant se souviendra de sa jeunesse à Grand-Leez, en Hesbaye namuroise : « Souvent des gens venaient à notre porte mendier des croûtes de pain mais cela avait toujours été comme ça et je ne me rappelle pas que quelqu’un s’en plaignait particulièrement36. »
Dans sa synthèse de l’enquête sur les budgets des ménages ouvriers parue en 1855, Edouard Ducpétiaux, inspecteur général des établissements de bienfaisance, souligne que « peu de familles ouvrières peuvent atteindre, nous ne dirons pas à l’ordinaire du marin ou du soldat, mais même à celui du prisonnier. (…) Comment se fait-il, cependant, qu’un grand nombre, nous pourrions dire la grande majorité des travailleurs, vivent à des conditions plus économiques ? C’est, comme nous l’avons déjà dit, en recourant à des expédients dont l’ouvrier seul a le secret ; en réduisant sa ration journalière ; en substituant le pain de seigle au pain de froment, comme c’est d’ailleurs la coutume dans une grande partie du pays et notamment dans les Flandres ; en mangeant moins de viande ou même en la supprimant tout à fait, de même que le beurre, les assaisonnements ; en se contentant d’une ou deux chambres où la famille est entassée, où les garçons et les filles couchent à côté les uns des autres, souvent sur le même grabat ; en économisant sur l’habillement, le blanchissage, les soins de propreté ; en renonçant aux distractions du dimanche ; en se résignant enfin aux privations les plus pénibles. Une fois parvenu à cette extrême limite, la moindre élévation dans le prix des denrées, un chômage, une maladie, augmente la détresse du travailleur et détermine sa ruine complète ; les dettes s’accumulent, le crédit s’épuise, les vêtements, les meubles les plus indispensables sont engagés au mont-de-piété, et, finalement, la famille sollicite son inscription sur la liste des indigents37. »
Les ménages indigents s’inscrivent au bureau de bienfaisance de leur commune. Le bureau de bienfaisance est l’ancêtre du centre public d’action sociale (CPAS). Il dispose de terres et de capitaux mis à sa disposition par la commune. Le curé assure la gestion quotidienne et rend compte aux membres du bureau, nommés par le conseil communal. Et « si toutes ces ressources n’étaient pas suffisantes, les fermiers et les propriétaires demeurant dans la commune se cotiseraient volontairement pour empêcher tout désordre, et garantir leurs propriétés38 ».
Entre 1840 et 1850, à l’échelle du pays, le nombre des indigents double pour atteindre 901.456 inscrits, soit un habitant sur cinq. Soit aussi deux ouvriers sur cinq. Pour la période 1848-1850, le rapport s’élève à un habitant sur quatre dans les communes rurales du Brabant, un sur sept dans les communes rurales de la province de Namur39.
Le village des chaufourniers et des « lapoteux »
Grez-Doiceau, le village brabançon d’où partiront les premiers émigrants vers le Wisconsin, ne fait pas exception. En 1859, après la vague d’émigration, le bureau de bienfaisance de la commune enregistrera encore 1.028 bénéficiaires, c’est-à-dire plus d’un habitant sur trois. Au début de la décennie, le bourg compte pourtant deux fabriques sur son territoire : une clouterie installée dans l’ancien moulin banal, au centre de la commune, sur le Train, et une papeterie, elle aussi établie sur le site d’un ancien moulin, mais sur la Dyle celui-là, dans le hameau de Gastuche. En 1850 débute la construction du chemin de fer qui doit relier Charleroi à Louvain, avec une gare à Gastuche, ce qui promet de beaux jours à la papeterie40.
La place du village ne manque pas de charme. Le matin, au bord de la route Wavre-Jodoigne, l’église Saint-Georges, en briques et pierre blanche, et dont la haute croix faîtière a depuis longtemps perdu ses deux bras, projette son ombre sur la maison communale. Le rez-de-chaussée de la maison communale est occupé par l’école des garçons de l’instituteur Constant-Joseph Lacourt, qui a obtenu un prix au concours de 1841. L’école des filles, tenue par deux religieuses, sur la route de Jodoigne, est plus récente. Tous les mardis a lieu un marché où l’on trouve du beurre, des œufs, de la volaille, du gibier et des légumes, et où l’on voit s’arrêter la malle-poste Jodoigne-Gastuche, comme chaque jour, deux fois dans chaque sens.
Ici aussi, la terre est un bien précieux. La commune comptait 1.254 habitants en 1786, puis 2.190 en 1831 ; elle en enregistre 2.961 en 1852. Parmi les 524 exploitations agricoles identifiées par le recensement de 1846, quatre sur cinq ont une superficie de moins de 2 hectares ; six exploitations totalisent plus de 50 hectares, la plus grande étant la ferme de Laurensart (90 hectares), tenue par une femme, la veuve Hendrickx, et appartenant au comte de Baillet. Le froment, le seigle, les pommes de terre, mais aussi l’avoine et la luzerne constituent l’essentiel des cultures.
Ancien chef-lieu de canton et de justice de paix, Grez compte de nombreux artisans parmi ses habitants, et même trois pharmaciens, trois médecins et un notaire. Mais la spécialité locale, c’est la craie que l’on remonte des puits et des galeries creusés dans la colline des Lowas, jusqu’à 40 mètres de profondeur ; les chaufourniers en font de la chaux, un matériau qui intéresse les agriculteurs et les maçons ; et les « lapoteux » en font des bâtons de craie à écrire. Il y a aussi la vieille carrière de grès, près de la clouterie, qui a été rouverte pour la construction de la route Wavre-Jodoigne en 1837. Mais en 1850, ces deux filons sont presque épuisés, et l’on ne recense déjà plus que deux puits, trois chaufours et une dizaine de « lapoteries » dans le village.
Fin avril, la communauté participe à la procession de la Saint-Georges et assiste à la bénédiction des chevaux. Mais la grande fête se déroule à la fin du mois d’août, après la Saint-Barthélemy. Pour l’occasion, on cuit des tartes au fromage et aux prunes « passées » (écrasées). Le dimanche, on processionne, encore, après la messe. Et le lundi, sur les rives du Train, les filles suivent les prouesses de leurs favoris engagés dans les régates. Avec, en guise d’embarcations, ces bassines en bois dont les ménages les moins pauvres possèdent deux exemplaires : une grande pour saler les jambons, et une autre pour faire les lessives et prendre des bains.
Un nouveau pays grand comme l’Europe
Grez-Doiceau compte aussi, et c’est plus rare, une vingtaine de protestants parmi sa population. Ce détail a son importance, car c’est au sein de ce groupe que naît en 1853 le projet d’émigrer aux Etats-Unis. Plus précisément, c’est le pasteur Vleugels, titulaire des paroisses de Biez et Sint-Joris-Weert jusqu’en 1850, qui conseille à ces familles avec lesquelles il est resté en contact, d’émigrer en Amérique41. Pour échapper à l’oppression religieuse en même temps qu’à la misère socio-économique ? La question reste posée. A cette époque, après une période d’opposition ouverte, le clergé catholique se montre plus conciliant vis-à-vis du protestantisme. Quoi qu’il en soit, pour l’immense majorité – catholique – des émigrants belges qui suivront les pionniers gréziens au Wisconsin, la religion n’est pas un motif de départ.
En 1853, les Etats-Unis ont achevé leur expansion territoriale vers le Pacifique. Au nord-ouest, la Grande-Bretagne a cédé le vaste territoire de l’Oregon à son ancienne colonie en 1846. Au sud-ouest, au terme de trois années de guerre, le Mexique a livré le Texas, le Nouveau-Mexique et l’Utah à son ambitieux voisin en 1848, ainsi que la Californie où l’on venait de découvrir de l’or. Un nouveau pays prend forme, grand comme l’Europe entière. Les immigrants de souche anglaise, protestants, y restent majoritaires.
Cette Amérique encore essentiellement agricole a besoin de bras. Pas tellement pour coloniser l’immense territoire à l’ouest du Mississippi, ce « grand désert » tout juste bon pour les Indiens42. Ni pour peupler les Etats situés au sud de l’Ohio, où les planteurs de coton s’offrent les services d’esclaves noirs43. Mais pour défricher la région des Grands Lacs, où la forêt recouvre les terres les plus fertiles du pays. L’extension du « rail fermier » autour de Chicago, dans les années 1850, marquera d’ailleurs l’histoire du chemin de fer.
Le prix des terres américaines a de quoi séduire le paysan européen. D’est en ouest, dans toutes les régions formellement abandonnées par les Indiens, des fonctionnaires fédéraux marquent les arbres, plantent des poteaux et dressent des plans quadrillés dont la plus petite unité correspond à 40 acres, soit 16 hectares. Ces terres sont ensuite mises en vente au prix incroyablement bas de 1,25 dollar l’acre, soit 16 francs belges l’hectare44. Bémol : pendant les deux premières semaines, les lots sont vendus aux enchères. Les plus belles parcelles passent ainsi dans les mains de spéculateurs.
La loi protège le colon qui s’est avancé dans les bois et qui s’est installé sur une terre avant sa mise en vente : il peut faire valoir un droit de préemption, à condition, notamment, d’acheter au moins 80 acres (32 hectares) et d’être citoyen américain – ou d’avoir fait enregistrer une déclaration d’intention d’être naturalisé.
Second bémol : le gouvernement fédéral vend ses terres au comptant. L’émigrant doit donc disposer d’au moins 50 dollars (260 francs) pour acquérir la plus petite division, celle de 16 hectares. Mais la loi ménage aussi l’indigent qui, après les enchères, s’installe sur un lot non attribué, en lui accordant un double délai d’un an : le premier, théorique, pour manifester son souhait de devenir propriétaire ; le second pour régler sa dette, aux conditions de la préemption45.
Anvers voit défiler les émigrants allemands
Entre l’Europe et les Etats-Unis, les migrations de masse ont débuté dans les années 1840. Un million d’Irlandais ont quitté leur pays depuis la famine consécutive à la maladie de la pomme de terre, et déjà ces émigrants catholiques se heurtent, parfois violemment, aux protestants nativistes qui se considèrent comme les vrais Américains. D’abord structurés en société secrète – d’où leur surnom « Know Nothing » (je ne sais rien) –, les nativistes remporteront une série de victoires électorales en 1854, avant de se désorganiser et de disparaître de la scène politique46.
Les Etats allemands, après l’échec de la révolution de 1848, envoient eux aussi de nombreux émigrants en Amérique. Grâce au chemin de fer, une partie de ces migrants allemands passe d’ailleurs par la Belgique. Depuis que, sur la ligne Cologne-Anvers, l’Etat belge accorde une remise de 30% aux émigrants qui embarquent à Anvers, sans supplément pour les bagages, le port belge attire les Rhénans et les Bavarois qui empruntaient jusque-là le Rhin pour rejoindre Brême ou Rotterdam47.
Car, entre les ports d’émigration continentaux, la concurrence est rude. En 1850, Anvers, qui voit défiler bon an mal an 10.000 émigrants, perd sa troisième place au profit de Hambourg, derrière Le Havre et Brême48. La même année sont instituées en Belgique une « commission d’expertise » chargée de vérifier l’état des navires, l’embarquement des vivres et la santé des passagers, ainsi qu’une « commission d’inspection des émigrants » qui doit arbitrer les conflits, notamment entre les émigrants et les expéditeurs d’émigrants49.
Une dizaine de ces expéditeurs d’émigrants sont établis à Anvers, où ils se montrent particulièrement entreprenants, jusque dans la gestion du port. Ce sont des exportateurs, des courtiers. D’un côté, ils affrètent des navires ; de l’autre, ils racolent les émigrants à travers un vaste réseau de représentants, jusqu’en Allemagne. La majorité d’entre eux sont d’ailleurs allemands, à l’instar d’Adolphe Strauss, le plus connu, un Juif établi à Anvers depuis 1846. Les escroqueries sont fréquentes. Pour échapper aux contrôles, on organise des embarquements clandestins à Vlissingen, à l’embouchure de l’Escaut, ou on enregistre les émigrants comme passagers de cabine, non soumis à l’inspection, contrairement à ceux de l’entrepont.
Les armateurs belges n’ayant pas réussi à s’imposer sur ce marché, ce sont des armateurs américains qui fournissent les navires, en l’occurrence des bateaux de commerce qui ont transporté du coton, des céréales ou du bois à l’aller. Les émigrants qui optent pour Anvers se voient ainsi proposer jusqu’à quatre-vingts départs par an50.
Les villes et l’industrie belges d’abord
Confronté à la surpopulation du pays, le gouvernement belge entend lui aussi profiter de l’ouverture des frontières américaines. En 1844, il a chargé le baron Auguste van der Straten Ponthoz, premier secrétaire de la légation de Belgique à Washington, d’un voyage d’exploration en vue d’établir des colonies subsidiées. Après avoir parcouru le Midwest, le diplomate écrit : « Il n’existe probablement pas sur le globe une contrée plus favorable que celle-ci aux besoins de la population qui se trouve à l’étroit en Europe. (…) Un sol à bas prix, d’une étendue illimitée, assez fertile pour dispenser d’un capital d’exploitation, est une puissante attraction pour les populations agricoles de l’Europe. Au XIXe siècle, cette attraction a plus de pouvoir qu’aucune institution faite par les hommes51. »
Dans son rapport, le baron van der Straten Ponthoz décrit l’organisation de la vente des terres, les villes et les moyens de transport. Il conseille d’émigrer en groupe, comme les Allemands, et pas isolément, comme le font déjà certains Belges. « Les environs d’Alost, le Luxembourg, la Lorraine, l’Alsace, la Franche-Comté et la Suisse, fournissent le plus grand nombre de ces émigrants isolés qui vont s’établir dans quelque partie des Etats-Unis. (…) Les exemples de détresse sont innombrables dans cette classe d’émigrants. (…) Lorsque la famille est fatiguée de chercher sa demeure, elle s’arrête pour acheter, au milieu des Américains, une ferme épuisée, d’un accès difficile, ou dans une situation malsaine. L’acquisition absorbe le capital, et le sol est sans ressources. (…) On ne doit pas hésiter à conclure que l’Européen, placé sans expérience au milieu des Américains, dont il ne connaît ni la langue ni les habitudes, est exposé à tous les genres de misère. Il lui faut à tout prix la protection d’une agglomération52. »
Publié sous forme de brochure en 1846, ce rapport servira de base à la rédaction de plusieurs guides pour émigrants53.
Deux projets de colonies subsidiées sont mis sur pied en Pennsylvanie et au Missouri en 1849 et 185054. Moins honorable : des communes, des provinces et même le gouvernement encouragent des mendiants hébergés dans les dépôts de mendicité, puis des détenus et ex-détenus à s’expatrier, et payent leur voyage55. Mais l’émigration séduit peu en Belgique. Les colonies subsidiées sont des échecs56. Selon Henry W. Mali, consul général de Belgique à New York, il y a mille trois cents Belges aux Etats-Unis en 1850, dont quelques centaines de paysans luxembourgeois dispersés dans une dizaine d’Etats57.
Il faut dire que, dans nos régions, le chemin de fer rapproche les campagnes des villes et des bassins industriels qui ont eux aussi besoin de bras, et où l’on gagne tout de même 2, voire 3 francs par jour dans certaines usines58. La mine, la métallurgie, mais aussi la domesticité attirent de nombreux agriculteurs sans terre59.
A Grez-Doiceau, en 1852, septante personnes quittent la commune. Quinze d’entre elles s’installent à Bruxelles, cinq dans le Hainaut60. Et deux premières familles tentent l’aventure américaine isolément : Ambroise Degodt, un tisserand de 41 ans, sa femme et leurs six enfants ; et Alexandre Leurquin, tisserand lui aussi, 38 ans, avec sa femme et leur fils. Ils arrivent à New York le 3 octobre61. Nous y reviendrons.
Quatre-vingt-un volontaires pour l’exil
Au printemps 1853, sur le conseil du pasteur Vleugels, c’est un grand groupe qui se prépare à partir. Car les protestants gréziens ne restent pas seuls. Certes, c’est à Grez que l’on s’agite le plus : neuf familles et trois célibataires, soit cinquante-cinq personnes, seront du voyage. Mais le rêve américain fait des adeptes dans au moins trois autres communes proches, qui ont en commun de compter des protestants parmi leurs habitants. Se laissent ainsi convaincre, à Bonlez, une famille et un célibataire, soit sept personnes ; à Biez, une famille et deux célibataires, soit six personnes ; et à Sint-Joris-Weert, une famille et un célibataire, soit quatre personnes qui, il faut le noter, sont peut-être les seuls néerlandophones du groupe. Peut-être car trois autres familles, soit neuf personnes, dont les archives n’ont pas retenu le village d’origine, se joignent aux volontaires. En tout quatre-vingt-un candidats à l’exil.
Les parents – et une grand-mère – ont de 22 à 65 ans, les enfants de 5 mois à 21 ans, les célibataires de 19 à 52 ans. Dix d’entre eux sont journaliers ou cultivateurs. Les autres sont tailleurs de pierre (quatre), à la fois journaliers et tailleurs de pierre (trois), menuisiers (deux), barbier (un), cordonnier (un) ou boulanger (un)62. Ils sont pauvres, mais pas indigents. Car, pour espérer partir, il faut disposer de quelques biens que l’on puisse transformer en capital, ne fut-ce que pour payer la traversée. Pas d’Amérique pour les plus pauvres.
Parmi les enfants, il faut retenir le nom de Xavier Martin, 21 ans, qui jouera un rôle important dans l’histoire de la communauté belge du Wisconsin63. Né dans le hameau de Doiceau, c’est un des membres les plus fervents de la paroisse protestante de Biez, au grand dam de ses parents catholiques, qui sont allés jusqu’à le chasser de la maison – pendant moins d’un mois – lorsqu’il avait 15 ans. En 1850, il s’est installé à Bruxelles où il a travaillé comme ouvrier tailleur jusqu’au départ des siens pour les Etats-Unis64.
Que de questions ces hommes et ces femmes se sont-ils posées avant de se décider à tout quitter ! Certes, ils trouvent difficilement de quoi manger. Certes, les artisans ont de moins en moins de travail. Certes, la société condamne les paysans à la misère. Certes, la terre, ici, est rare et chère, alors que là-bas, elle est abondante et bon marché. Encore faut-