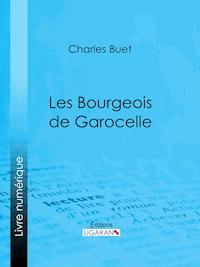
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "En 1846, vers le milieu de la rue Saint-André-des-Arts, une maison bombait au-dessus du trottoir sa façade jaune où se lisait, peinte en lettres dorées de la plus grande dimension, cette enseigne : « Hôtel de la Boule-d'Or. » Cette maison à cinq étages, aux fenêtres rapprochées et garnies uniformément de rideaux rouges, présentait, à son rez-de-chaussée, une boutique où les locataires et quelques pensionnaires venaient prendre leurs repas."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROFESSEUR AU COLLÈGE ROYAL DE RIMINI.
Pont de Beanvoisin, 8 septembre, 1874.
En échange de certain sonnet, qui valait un long poème, et qui m’arriva de Rimini, un jour que je me plais à appeler le plus beau jour de ma vie, je t’envoie, mon cher ami, un gros livre qui te rappellera le beau pays où s’écoulèrent tes premières années. Ce livre n’est pas d’un grand mérite ; il te paraîtra dicté par des sentiments difficiles à définir ; les jugements que j’y porte sur des hommes et sur des choses que tu connais, tu les estimeras sévères, trop sévères peut-être ; et quant au caractère des gens sur le visage desquels j’ai mis un masque, tu croiras aussi que je l’ai un peu exagéré.
Eh bien ! je veux me défendre d’abord de ces critiques que je prévois, par ce motif que, donnât-on au genre humain un pur chef-d’œuvre, le genre humain y trouverait matière à critiques. Or, je suis fort loin de prétendre écrire des chefs-d’œuvre, et je me voue très volontiers au fouet d’Aristarque. Cependant je désirerais n’être censuré que justement, – et l’expérience, hélas ! m’a démontré que l’on critique généralement ce qui est bien, – et qu’on loue assez ordinairement ce qui est mal. Ceci, en littérature seulement, car il m’en coûterait d’entrer dans un développement philosophique, destiné à démontrer qu’on peut dire, à tous les points de vue, ce que je me borne à envisager au seul point de vue littéraire. La seule pensée qui m’ait préoccupé alors que j’écrivais, il y a deux ou trois ans, le Trésor du Commandeur Azupert, était celle de tracer un portrait fidèle d’une petite ville, et de guérir, en en faisant une satire sans fiel, les défauts et les travers de plusieurs habitants d’icelle. Je n’ai point eu et n’aurai jamais l’intention de tourner en ridicule les mœurs de la province. Je trouve, en effet, un trop grand charme à vivre de la vie provinciale, pour la dénigrer, et ce serait jeter une pierre dans mon propre jardin. Mais aussi je t’assure, mon ami, qu’il faut être come torre fermo che mai non crolla, pour résister aux assauts formidables qu’on est obligé de subir, précisément lorsque l’on aime la province, et surtout sa province, et qu’on y veut couler ses jours. À ce propos, j’ai essayé de narrer quelques-unes des péripéties qui menacent, dans ce milieu, l’homme ban, naïf et simple, qui ne peut se faire aimer, et ne veut pas se faire craindre. Dans le domaine des faits, je suis cependant resté toujours au-dessous de la vérité, et n’ai dit que ce qu’il est permis de dire sans médisance.
Il s’en suit donc que si j’ai porté des jugements sévères, ils n’en sont pas moins justes et que personne n’aurait le droit de se plaindre. J’aurais peut-être dû, néanmoins, me rappeler ce proverbe : « Toute vérité n’est pas bonne à dire, » Il se trouve que j’appartiens à cette classe de gens que l’on intimide difficilement.
Enfin, j’ai si peu exagéré le caractère des personnages que je mets en scène, que je les ai laissés tous incomplets. Mes modèles sont pires ou meilleurs. Je n’ai rien copié servilement, j’ai emprunté un trait à celui-ci, un trait à celui-là, un vice à un troisième. Qui sait ? La Mottière n’est peut-être pas un avocat, ni Varçon, médecin ! Il ne manquera pas de gens qui chercheront à deviner le vrai nom de mes marionnettes. Inutile ! elles ne sont plus de chair et d’os, et ce n’est pas mon livre qui leur donnera l’immortalité.
J’ai clone fait comme Cicéron et plaidé pro domo meâ, sans y mettre toute l’ardeur et l’éloquence de l’orateur romain, et ce pour tant de raisons que j’en dispense d’en énoncer une seule. Je présume qu’on ne me demandera pas d’autre explication.
Et toi, cher ami, tu liras avec un affectueux intérêt, je le sais, un récit qui te par fera de notre commune patrie, et que met sous ton égide amicale le constant souvenir et le sincère attachement de
L’AUTEUR.
En 1846, vers le milieu de la rue Saint-André-des-Arts, une maison bombait au-dessus du trottoir sa façade jaune où se lisait, peinte en lettres dorées de la plus grande dimension, cette enseigne : « Hôtel de la Boule-d’Or. »
Cette maison à cinq étages, aux fenêtres rapprochées et garnies uniformément de rideaux rouges, présentait, à son rez-de-chaussée, une boutique où les locataires et quelques pensionnaires venaient prendre leurs repas. Un couloir longeait l’un des côtés du restaurant et aboutissait à un bureau vitré qu’un guichet mettait en communication avec les gens venant du dehors.
Or, le 4 décembre de cette année-là, Mme Césarine Lenoir, une grosse femme dont la peau rouge se bouffissait sur les joues, comptait, vers onze heures du soir, sa recette de la journée.
– Cent-sept et deux, cent-neuf ; et sept, cent-seize ; cent-seize francs, eh ! eh ! ce n’est pas mal. Sans compter ce qu’il y a là-dedans.
Et, ce disant, elle soupesait doucement la tirelire en terre, représentant un diablotin, la bouche horriblement ouverte, et dont le ventre rebondi contenait quantité de sous.
Or, pendant ce temps, un homme, les épaules couvertes d’un épais manteau, une valise à la main, suivait la rue Saint-André des-Arts, en regardant chaque maison à gauche et à droite.
Une lanterne à l’ancienne mode, suspendue au bout d’un long bras de fer vingt fois recourbé, attira ses yeux ; il regarda et lut : « Hôtel de la Boule-d’Or. »
– Oh ! oh ! fit-il à mi-voix en examinant la maison, cela m’irait assez. Cette auberge ne me paraît ni trop laide, ni trop belle, bah ! allons-y !
Et, saisissant la tête de chien en fer qui servait de loquet, il la souleva et la fit retomber de tout son poids.
Au coup qui gronda sous le corridor, Mme Césarine bondit sur sa chaise et aussitôt, sans réfléchir, par un premier mouvement instinctif, elle ferma le tiroir de son bureau.
– Caroline ! appela-t-elle, va donc voir qui frappe à cette heure !
La servante prit un bougeoir et courut ouvrir. Aussitôt un homme s’engouffra dans le corridor, et en quelques pas fut auprès de Mme Césarine Lenoir qui, les deux coudes sur son bureau, la tête dans les mains et tout le corps comme ramassé contre son tiroir, considérait l’étranger de ses deux grands yeux écarquillés sous des cheveux blond-roux en désordre.
– Madame, dit l’étranger, je désirerais une chambre pour la nuit et peut-être pour quelque temps, si je me plais ici.
Elle fut quelque temps à répondre, tant elle s’absorbait dans la vue de cet homme.
Son visage et toute sa personne accusaient quarante-cinq ou cinquante ans. Son front était grand, plutôt haut que large, ridé, avec une courbure intelligente et tenace, entouré de cheveux noirs où se mêlaient quelques poils gris ; ses yeux vifs ; avec des paupières rougies, éclataient derrière des lunettes, au-dessus de joues couturées de rides, toutes tiraillées par les nerfs. Son nez d’aigle, mince, aux narines brunes et mobiles, ses lèvres fines, son menton saillant sous sa barbe épaisse, annonçaient de l’audace, de la résolution. Une expression d’amertume, de remords, de tristesse, enveloppait, pour ainsi dire, toute sa figure et se retrouvait jusque dans l’affaissement de ses épaules que le rocher de Sisyphe de la vie semblait avoir écrasées.
Toutefois, ce n’était pas cette physionomie singulièrement caractéristique qui fixait l’attention de madame Césarine. Non, c’était le manteau usé qui recouvrait les épaules de l’étranger, son pantalon râpé, sa redingote marquée aux coudes de râpures luisantes. Étonné du long silence que gardait la maîtresse d’hôtel, l’homme allait renouveler sa demande, quand elle lui dit avec hésitation :
– Monsieur, nous avons encore une chambre au deuxième étage ; elle est de cinquante francs par mois : une chambre superbe, sur la rue. Mais je doute qu’elle fasse votre affaire.
– Au contraire ! Justement, c’est ce qu’il me faut. Elle est habitable, n’est-ce pas ? je la désire ainsi. Veuillez m’y faire conduire, car je meurs de sommeil.
– C’est que… balbutia Césarine Lenoir…
Et son regard éloquent fit le tour de l’habit et alla palper les étoffes amincies par l’usure.
– Ah ! ah ! rit en riant l’homme.
Et, achevant la phrase commencée :
– C’est que… je ne paie pas de mine, dit-il d’un ton ironique. Eh bien ! voilà.
Et, d’un air dégagé, il ouvrit sa valise, en retira un portefeuille bondé de billets de banque.
– Voici cent francs, dit-il. Je vous paie deux mois à l’avance. Si je m’en vais avant ce temps, vous me rendrez le surplus : j’ai confiance en vous.
Mme Césarine Lenoir devint pâle, puis pourpre bondit de sa chaise qui tomba à la renverse, se précipita à la porte de sa cage vitrée, l’ouvrit, arracha d’une main le flambeau des doigts de Caroline stupéfaite, saisit de l’autre le billet de cent francs, et humble, souriante, courbée en deux, elle dit :
– Si Monsieur veut se donner la peine de monter !…
Alors, passant la première, elle monta à petits pas, s’arrêtant quand il s’arrêtait, lui indiquant les paliers, les marches plus hautes, l’éclairant avec soin. Songez donc ! un homme qui a son portefeuille bondé de billets de banque, et qui vous tombe des nues à onze heures du soir ; mais aussi dans quelle mise !… à faire croire qu’on a affaire à un mendiant.
Tout en montant, elle débitait ces phrases entrecoupées par la fatigue de l’ascension :
– Ah ! Monsieur, pourquoi ne nous avoir pas prévenus de votre arrivée, on vous aurait préparé un excellent dîner, tandis que vous avez mal soupé, j’en suis sûre.
– J’ai fort bien mangé, fort bien, je vous assure, et dans un endroit où on ne m’a pas demandé d’argent avant de me servir.
La maîtresse du lieu se mordit les lèvres, et, comme le corbeau de La Fontaine, jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
– Tenez, Monsieur, voici votre chambre, dit-elle.
C’était une grande pièce carrée avec une large fenêtre ; tout ce qu’on peut imaginer de plus vulgaire comme ameublement, mais assez confortable. Par terre, un tapis à fond rouge avec de grandes fleurs bleues, des rinceaux verts et jaunes ; un lit à baldaquin avec des rideaux de perse, les mêmes à la fenêtre une armoire, une commode ; sur la cheminée, une pendule en zinc doré surmontée d’un sujet rococo et flanquée de deux candélabres du goût le plus affreux, singeant le style Louis XV, le tout reflété dans une grande glace. Aux murs pendaient des enluminures de foire, encadrées de baguettes jaunes. Quatre chaises et deux fauteuils bourrés d’étoupe complétaient l’ornement de ce logis.
L’étranger l’embrassa d’un coup d’œil, se débarrassa de son manteau, et, salué d’une « Bonne nuit, Monsieur, » de son hôtelière, à laquelle il ne répondit pas, il s’enferma.
– Ah ! fit-il quand il fut seul, me voilà donc à Paris, à Paris, où on n’a pas de préjugés. Il rit moqueusement.
– À Paris, où l’or est tout, où il règne. Il paraît, on se prosterne, témoin cette femme. Ici je puis donc me faire oublier, je puis rompre avec mon passé. J’ai de l’or ; suis-je encore un homme taré, accusé de captation de testament, chassé de ma chaire de professeur par le roi Charles-Albert ? Ah ! l’or, l’or, c’est le dieu du monde. À genoux devant lui, il peut tout !
Ah ! qu’ai-je dit ? il peut tout. Mais il peut… oui, il peut servir à me venger !…
Cet homme resta longtemps la tête entre ses deux mains, songeant, puis il s’étendit sur son lit et dormit, non d’un sommeil calme comme celui qu’on goûte après une journée bien remplie par le travail, mais d’un sommeil agité, fiévreux, où revenaient fréquemment en songe les noms de Charles-Albert, de Salignies, de Lestourges, tous noms encore inconnus du lecteur, mais avec lesquels il fera connaissance dans le cours de cette très véridique histoire.
Le jour, en se levant, éclaira Paris tout blanc de neige. Les toits, au loin, élevaient et abaissaient leurs pentes, semblables à de petites montagnes que perçaient les tuyaux des cheminées, végétation bizarre de ce sol hétéroclite.
Les moineaux, au sortir du nid, piaillaient, posés sur les points émergeant de cette mer argentée, promenaient d’un mouvement engourdi leurs yeux de tous les côtés, cherchant cette pâture que Dieu leur promit en les créant ; puis, quand ils apercevaient quelques grains d’avoine ou de blé tombés dans la neige, s’appelant par de petits cris et s’invitant à ce festin que la main divine, leur avait réservé.
Dans la rue, les charrettes des marchands allant à la Halle, ont les premières tracé le chemin. Les ouvriers arrivent avec leurs pelles sur le dos ; d’autres, une main dans la poche et tenante l’autre un gros morceau pain qu’ils mangent en marchant ; puis les laitières s’installent sous les portes qui s’ouvrent les unes après les autres ; les boutiquiers apparaissent sur le seuil de leurs magasins ; les garçons, les yeux encore bouffis par le sommeil, enlèvent les fermetures et arrangent les étalages.
Tout ce monde ressent les atteintes du froid ; les mouvements sont lents, les yeux mi-clos réclament le sommeil interrompu, les mains se rougissent sous la bise qui fouette, les bouches bâillent, les langues se gèlent.
Le mouvement augmente peu à peu ; les voitures passent plus rapides et écrasent la neige sous leurs roues et les pieds des chevaux ; une commère arrive et lance un mot éclatant, on lui répond, les paroles se donnent et ne se vendent pas ; on se plaint (et c’est la première chose qu’on dise à Paris, un peu comme partout ailleurs), on se plaint du froid qui persiste, de la neige qui gêne les communications, de la bise qui gerce. Chacun dit son mot et s’anime. Les passants deviennent plus nombreux ; le froid diminue, et peu à peu la grande ville s’éveille et commence à vivre.
Le docteur Varçon, – ainsi avait déclaré s’appeler l’étranger, – le front appuyé aux vitres de sa chambre, suivait la progression de ce mouvement et considérait d’un œil curieux toute cette agitation qui fait de Paris une ville unique.
Puis il s’habilla, déjeuna, se fit indiquer un magasin en vogue et revint transformé. C’est à peine si Mme Césarine Lenoir put le reconnaître, les épaules redressées, la taille sanglée dans son habit, les yeux brillants, la physionomie intelligente, portant d’ailleurs un costume élégant avec une distinction parfaite.
L’après-midi, il alla se promener sur les quais. La Seine, emprisonnée en beaucoup d’endroits sous une couche épaisse de glace, charriait d’énormes glaçons qui choquaient les piles des ponts, montaient les uns sur les autres, poussaient des poutres, des tonneaux enlevés aux ports.
Sur les bords, quelques enfants essayaient des glissades.
Le docteur Varçon s’arrêta un instant avec la foule à les regarder. Tout à coup, l’un de ces petits aventureux s’éloigna trop de la rive. En ce moment la glace se fendit et un énorme glaçon fila à la dérive, entraînant l’enfant à demi-mort de frayeur.
Ses petits camarades poussaient des cris affreux. La foule, qui s’assembla, suivait sur le bord, craignant à tout moment de voir l’imprudent englouti. Alors, un jeune homme plus courageux courut en avant, prit une barque couchée sur le quai, la fit glisser sur la glace et la lança à l’eau. Une longue gaffe à la main, après mille efforts, il rejoignit l’enfant qui était devenu blanc de froid et de terreur. Il le saisit au moment où il s’évanouissait, le déposa dans sa barque et le ramena sur la berge.
La foule l’applaudit frénétiquement, lui fit une ovation, voulut le porter en triomphe.
Le sauveteur s’occupa tout d’abord de l’enfant.
– Se trouve-t-il un médecin dans la foule ? demanda-t-il.
– Tiens ! se dit Varçon, je vais faire une bonne action, une fois n’est pas coutume.
Il s’approcha :
– Je suis docteur, Monsieur, et me mets à votre disposition. Transportons d’abord le malade dans un endroit chaud.
Le jeune homme prit l’enfant dans ses bras et le déposa, cinq minutes plus tard, dans une pharmacie où il ne tarda pas à revenir à lui sous les frictions énergiques du docteur.
Tout en soignant son petit malade, celui-ci examinait très attentivement le jeune homme qui l’avait sauvé.
Il paraissait vingt-cinq ans. Ses vêtements, simples et élégants, faisaient valoir sa prestance noble et souple. Modelé comme un Antinoüs, il avait une tête pâle, de cette pâleur mate si aristocratique, encadrée de cheveux noirs, et où brillaient deux yeux bruns pleins de feu, sous des sourcils arqués et bien fournis.
Son front se développait accentué de deux légères bosses au-dessus des yeux. Son nez droit et d’une finesse de camée antique, une légère moustache noire ombrant sa lèvre supérieure, sa bouche petite, nerveuse, marquée aux commissures de deux fossettes où s’étaient réfugiés le rire et la malice, le tour de sa bouche qui accentuait de mouvements divers chacune de ses paroles, l’ovale parfait et un peu maigre de son visage lui donnaient une grande distinction.
Tous ses mouvements étaient doux et souples, mais aussi forts et nerveux comme ceux de la panthère qui se couche et se tient toujours prête à bondir.
Bientôt, grâce à leurs soins, l’enfant ouvrit les yeux, les remerciant d’un sourire avant de pouvoir exprimer sa reconnaissance par des paroles.
– Comment vous nommez-vous ? lui demanda le jeune homme d’un ton très doux, et que faites-vous ?
– Je me nomme Joseph Guélard. Je suis de Savoie. J’ai perdu mon père et ma mère quand j’avais huit ans. J’entendis dire qu’à Paris il suffisait de travailler pour trouver du pain. Je vins ici. J’apprends le métier de menuisier ; le soir, je fais des courses pour les personnes qui veulent bien m’employer ; trois fois par semaine je suis des cours gratuits dans une école.
– Tu veux donc devenir savant ? interrogea Varçon.
– Oh ! oui, je veux devenir savant, si je puis. Je sais déjà lire et compter jusqu’à cent. Plus tard j’apprendrai autre chose, jusqu’à ce que je sache tout.
– Et après ?
– Après ! répéta le petit garçon d’un ton qui indiquait que pour lui le travail qu’il se traçait devait remplir toute sa vie, et qu’il ne concevait pas quelque chose au-delà.
– Ah ! enfant, enfant, dit le docteur d’une voix où perçait une étrange émotion, puisses-tu ne jamais trop savoir !
– On peut donc trop savoir ?… Mais plus on sait, meilleur on devient.
– Tu crois ! reprit Varçon, dont la voix résonna en notes d’une tristesse inouïe. Le petit Savoyard, bien rétabli, bien réchauffé, joyeux, sortit après avoir remercié ses bienfaiteurs et donné son adresse à son sauveur.
– Puisque la Providence met cet enfant sur notre chemin, dit le jeune homme au docteur, ne vous semble-t-il pas, Monsieur, qu’il est de notre devoir de nous en occuper un peu ? Si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous pour ce soir au Palais-Royal. Nous causerons de notre petit protégé.
Varçon, nouvellement arrivé à Paris, où il ne connaissait personne, n’eut garde de refuser ; d’ailleurs l’allure de son compagnon lui plaisait beaucoup, et il accepta en remerciant le hasard de le rapprocher d’un homme qui paraissait appartenir au meilleur monde.
Le docteur Varçon passa une partie de la journée à se promener, en observant l’allure et les habitudes de ce monde parisien qui conne le ton au monde. Il visita quelques monuments, rentra pour souper à l’Hôtel de la Boule-d’Or et fut au Palais-Royal à l’heure exacte.
Le jeune homme s’y trouvait déjà ; ils se saluèrent et entrèrent dans un café.
Après quelques banalités sur la pluie et le beau temps, ils s’occupèrent de leur protégé. On résolut de l’aller voir et de lui prodiguer tous les encouragements et toutes les facilités qui lui seraient nécessaires pour acquérir une bonne instruction primaire. La physionomie franche de l’enfant, son air intelligent les avaient frappés.
M. Georges de Selves, ainsi s’était présenté le jeune homme, esquissait même quelques projets d’avenir.
– Peut-être, dit-il, deviendra-t-il un savant ? Qui sait !
– Que Dieu l’en préserve ! répondit Varçon avec un accent d’amertume, oui, que Dieu l’en préserve ! La science nous ôte le bonheur, à nous autres savants. Le philosophe, le romancier, le médecin, à force de creuser cette montagne qui s’appelle l’homme, à force de la sonder et de la perforer dans tous les sens, y découvrent des couches de vices et de misères qui en forment les bases. Dans ces volcans qu’on appelle Richelieu, Napoléon, dont la cime superbe se dresse orgueilleuse au-dessus du monde, on trouve des abîmes où bouillonnent des flots d’une lave impure. C’est un triste métier que de sonder le cœur humain ; on y trouve tant d’horreurs, que bien des fois on est tenté de fermer la porte sur ce cloaque, de la barricader avec des barres de fer, d’y accumuler toutes les pierres de ses illusions et de s’en éloigner.
Mais une force secrète, invincible vous y ramène et vous contraint à plonger les deux mains dans ce bourbier pour y chercher si une pierre précieuse n’est pas cachée au fond et l’en ramener. Ce langage imagé, un peu déclamatoire, trahissait l’ancien professeur. M. de Selves ne s’y trompa nullement.
– Mais, Monsieur, tout ce que vous dites est vrai si vous considérez seulement les cœurs pervertis. Qui vous force à n’examiner que ceux-là ? À côté s’en trouvent d’autres ; beaux comme le cristal le plus pur, dont toutes les facettes réfléchissent l’honnêteté, la droiture, la vertu. Ils sont rares, et comme perdus dans la foule des autres : ils existent pourtant.
– Et dans quelle serre, Monsieur, croissent ces plantes de choix ? J’avoue n’en avoir jamais rencontrées. À quel soleil différent du nôtre se chauffent-elles ?
– Ces plantes croissent dans l’Église et se chauffent au soleil de la foi.
– Ah ! ah ! dit le docteur, c’est donc là que vous vouliez en venir. Vieilles illusions dont on est revenu ! L’Église, dites-vous, produit, élève et conserve des cœurs aussi précieux, aussi purs, aussi bons ? Allons donc ! l’Église, qu’est-ce donc ? Une invention philanthropique, mais non une institution divine !
Voyons, si l’Église venait de Dieu, existerait-il des mauvais prêtres ?
– Monsieur, répondit Georges avec beaucoup de calme, on augmente, on grossit à plaisir le nombre des mauvais prêtres, parce qu’on est bien aise, pour excuser ses propres fautes, de trouver des vices à ceux qui vous prêchent la vertu.
Je connais les prêtres, je les fréquente, je les juge avec impartialité, et je puis vous affirmer qu’il y en a très peu de mauvais.
Mais quand même ils seraient si nombreux, cela n’affaiblit pas la réalité de l’Église comme une institution divine ! Bien plus, plus leur nombre est grand, plus ils affirment l’origine du temple qu’ils souillent !
Je vous fais juge et je vous demande quelle institution humaine, si fortement conçue qu’elle soit, fût-elle l’œuvre d’un génie extraordinaire, tout à fait supérieur, quelle institution d’origine humaine eût résisté aux tempêtes soulevées par les mauvais prêtres, par ceux-là mêmes qui auraient dû défendre l’Église !
Rappelez-vous Arius, Eutychès, Nestorius, Luther, Calvin, les faux papes du grand schisme. Une barque, conduite par un homme, se fût brisée à traders tant d’orages, surtout quand les matelots, ceux-là qui auraient dû veiller à la sûreté du vaisseau, se révoltaient, y mettaient le feu, y pratiquaient des voies d’eau !
La main de Dieu façonna ce navire, et le conduit encore malgré ses mauvais serviteurs.
– Vous raisonnez fort bien, Monsieur, reprit Varçon avec une légère pointe d’ironie, et qui plus est en beau style ! Mais, j’ai vu trop de choses, j’ai trop vécu, j’ai trop appris les ruses et les mensonges de l’homme pour y croire. Avant même que d’entendre affirmer, fût-ce en termes aussi éloquents que vous l’avez fait tout à l’heure, une thèse quelconque, regardée comme une vérité, j’en doute. Je me dis que mon esprit ne perçoit pas tout de suite les raisons qu’il y a d’en douter, mais qu’il doit en exister. Je ne puis plus être persuadé.
– Je vous plains, Monsieur, dit Georges d’une voix triste, car vous devez être bien malheureux. Pour le bonheur de l’homme, il vaut mieux trop croire que ne plus croire. Un esprit fanatique, emporté par sa fougue, passe par-dessus les misères de cette vie ; un esprit désabusé les ressent toutes les unes après les autres, il les approfondit et se trouve bien malheureux.
– Mais vous, reprit Varçon, vous qui semblez si bien me comprendre, pourquoi n’êtes-vous pas comme moi ?
– Parce que je crois. Je crois à la compensation de tous les maux que nous souffrons ici-bas ; je crois aux châtiments et aux récompenses d’une autre vie, voilà pourquoi je suis consolé quand je souffre !
Varçon et Georges se séparèrent.
Le lendemain, poussé par une force inconnue, et presque sans s’en rendre compte, le docteur alla visiter Notre-Dame.
Et lorsqu’il eut franchi la porte ogivale dont les soixante saints, portés sur des démons grimaçants, regardent de leurs yeux de pierre ceux qui entrent, il fut saisi d’un sentiment étrange.
L’obscurité presque complète où l’on se trouve en passant sans transition de la rue éclairée sous ces voûtes sombres ; le grand silence qui règne dans l’édifice comme dans une ville endormie au milieu de Paris, agité de mouvements fébriles, ces longues et robustes colonnes se profilant depuis la porte jusqu’au chœur, supportant bien haut les voûtes ogivales, les verrières tout au fond, aux tons crus, un rayon de soleil passant à travers les vitraux et semant sa clarté moirée de couleurs ardentes sur l’autel ; en haut, les tribunes avec leurs ogives accouplées trois par trois, les grandes rosaces du Midi et du Nord, cette terreur religieuse qui tombe des voûtes, le charme mystérieux qui s’enroule aux piliers et s’épand dans l’air, tout cela le prit, le secoua, le tordit malgré les roidissements de son esprit, l’émut, et il tomba à deux genoux, pleurant et sanglotant, et demandant pardon à ce Dieu, qu’il ne croyait point, de ne pas le croire.
Oh ! c’est un sentiment étrange et qu’il faut avoir sinon ressenti, au moins perçu pour s’en rendre compte, et pourtant rien de plus humain que ces retours à la foi de la jeunesse. Car, tout au fond du cœur, on croit toujours. Les lèvres peuvent mentir, l’esprit errer ; à de certains moments ces sentiments se réveillent et courbent l’orgueil de l’incrédule devant le Dieu qu’il voudrait renier et ne peut !
Varçon resta ainsi une heure entière, la tête dans ses deux mains, pleurant de son cœur desséché des larmes de sang, et pourtant son esprit pendant ce temps, comme écrasé sous le rocher retombé de ses souvenirs de foi, s’agitait en spasmes violents et tentait de se dégager de ce poids qui l’opprimait, de le renverser et de se dresser, glorieux, sur ce roc vaincu.
Mais, pour un moment, il se retrouvait homme. Son cœur bondissait dans sa poitrine à la briser et dominait tout en lui. La foi, qui est du cœur, dominait le raisonnement, qui est de l’esprit.
Mais enfin celui-ci, par un horrible effort, rejeta loin de lui tous ces souvenirs qui l’oppressaient, et railleur, se drapant dans ses guenilles, éclata en un long rire méphistophélique.
Varçon se redressa ; il eut honte, le malheureux, d’avoir prié ; il considéra cela comme une lâcheté, et il éclata d’un rire qui fut un sacrilège.
Les anges qui habitent nos temples, surtout à l’heure où nous les laissons déserts, durent se voiler la face et pleurer.
Lui riait, et il riait si fort que quelques visiteurs se retournèrent pour le regarder, mais de ce rire sardonique, qui pince les lèvres, creuse les joues, fait briller des éclats jaunes de pierres fausses dans l’œil, de ce rire qui ricane, de ce rire qui n’exprime pas la joie, mais la force affectée couvrant la douleur intime, le fard à l’odeur de rose qu’on étend sur un ulcère pour le cacher.
Il se mit alors à examiner dans tous ses détails, mais moqueur, quand il rencontrait quelque naïveté, le superbe monument qui grave en traits de pierre l’histoire de nos siècles de foi.
Et il rentra chez lui.
Le soir, après dîner, on vint frapper à la porte. Étonné, il ouvrit.
Un homme entra. C’était un petit vieillard dont les lèvres minces se plissaient, dont le regard de fouine perçant, acéré, brillait derrière des lunettes et dardait deux traits de feu, comme les serpents font vibrer leur langue fourchue.
Il portait une redingote assez fanée, et s’appuyait sur une canne ; en deux mots, avait l’air d’un pauvre hère. Son chapeau défraîchi cachait à demi une figure qui n’avait plus d’âge. De toute sa personne se dégageait quelque chose de louche et d’explorateur qui s’émanait par tous les fils de ses habits. Il semblait un ancien policier en retraite.
Varçon, qui possédait le coup d’œil du médecin, le dévisagea du haut en bas et de long en large en un seul regard. Il vit aussi les joues ridées et jaunies, la peau rouge relevée haut sur ses yeux qui clignaient, les tempes dégarnies.
– À qui ai-je l’avantage de parler, Monsieur, et quelle affaire me vaut l’honneur de votre visite ? interrogea Varçon.
Le petit vieillard, sans répondre, s’assit, puisa dans une tabatière enchâssée sur le pommeau de sa canne, se fourra tranquillement son tabac dans le nez, posa ensuite les deux mains sur ses genoux, et, fixant attentivement le docteur, commença :
– C’est au docteur Varçon que j’ai le plaisir de parler ?
– Oui, Monsieur.
– Au docteur Priam-Hermogène Varçon ? continua le vieillard, qui fut docteur en médecine et en chirurgie à vingt-sept ans, docteur ès-science trois ans plus tard, qui occupa une chaire de professeur à l’Université de Turin.
– Mais, Monsieur… comment !… d’où vient… que vous savez tout cela ?… Qui êtes-vous ?
– Je me nomme actuellement Richard Aubépin, un nom qui vous est inconnu, n’est-ce pas ?
– Peu importe !
– Cela vous étonne que je fasse ainsi votre histoire. Laissez-moi continuer.
En 1843, sur la recommandation et les pressantes instances de gens qui vous sont restés complètement inconnus jusqu’à présent, le roi Charles-Albert vous créa chevalier des SS. Maurice et Lazare.
Peu après, un ouvrage qui fut trouvé remarquable et qui traitait de la botanique et de la faune du duché de Savoie, vous valut la médaille du Mérite civil.
Jusque-là vous ne sûtes ni trouver ni remercier ceux qui vous protégeaient.
Aussi furent-ils forcés de vous rappeler que vous étiez leur obligé d’une autre façon.
– Ah ! fit Varçon lentement… Ah ! je comprends, c’est vous qui me fîtes perdre ce fameux procès en captation de testament, qui fûtes cause de ma disgrâce, qui fîtes persuader au roi de me forcer à me démettre !
C’est que vous vouliez me mettre en cet état-là, de n’être plus rien, de fuir de ma patrie. C’était pour enchaîner ma volonté, me posséder, dicter mes actes, mes paroles.
Qui donc êtes-vous ? s’écria-t-il avec un élan superbe, pour tenter de me commander ?
– Qui nous sommes ?… Rien et tout… Insaisissables et présents partout.
Mais, dites-moi, ne songez-vous point quelquefois à votre belle position perdue, à tout ce que vous laissez là-bas, ne regrettez-vous donc rien ?
– Si je ne regrette rien ! s’écria Varçon avec un éclat terrible. Je ne regrette qu’une chose, de ne pas m’être vengé !
Il se tenait debout, superbe de colère, la veine de son front gonflée, les yeux brillants, ses narines frémissantes, sa poitrine haletante, sa taille redressée, les traits du visage agités, les sourcils froncés le menton tenace, les dents serrées, la mâchoire saillante, la taille redressée, le corps nerveux, tendu comme une flèche sur la corde de l’arc, et il redit d’une voix qui frémissait :
– Je veux me venger !
– Peut-être est-ce à cela que vous pensiez tantôt à Notre-Dame, le front penché devant ce Dieu que vous ne croyez pas ? dit le vieillard d’une voix cauteleuse.
– Un moment de folie !… Les têtes les plus fermes en éprouvent bien quelquefois.
– Je suis sûr que c’est ce projet que vous agitiez avec ce jeune homme, hier, au Palais-Royal, avec ce jeune abbé manqué qui parlait si bien et si gentiment théologie.
Le petit vieillard martelait ses phrases lentement, avec soin, et les enfonçait comme un coin dans l’esprit du docteur.
– Ne me parlez pas de cela.
– Ma foi, vous avez raison. Parlons d’autre chose, des histoires du temps passé. J’en connais entre autres une fort intéressante.
– Voyons !
– La voici :
« L’année dernière, dans une des maisons les plus riches et de la meilleure apparence de Turin, vivait un homme à qui son esprit et sa science donnaient une certaine célébrité. Riche et considéré, honoré de l’estime de son souverain, il avançait dans la vie d’un pas ferme. On le voyait se promener dans la ville, salué de tous ceux qui le rencontraient, et répondant à tous par un amical bonjour. Il ne se souvenait plus guère du point de départ d’où il était monté, marche par marche, jusqu’à cette position.
Le soir, rentré chez lui, assis face à face avec la plus charmante des femmes, entouré de quelques amis qui le chérissaient, non à cause de ses biens et de l’avantage qu’ils espéraient en retirer, comme cela arrive souvent, mais à cause de lui-même, de son caractère aimable, de ses vertus ; cet homme se trouvait l’être le plus heureux du genre humain.
Mais il était cupide, trop désireux d’acquérir l’argent. Il arriva qu’il se trouva appelé au chevet d’un malade riche à millions…
– Eh ! je connais cette histoire, s’écria Varçon.
– Parbleu, repartit Richard d’une voix railleuse, c’est la vôtre.
– Je n’ai pas besoin que vous me la rappeliez.
– Pardon ! vous ne vous en souvenez pas assez… Vous fûtes donc appelé auprès de ce malade, et là, ébloui par ses millions, attiré invinciblement vers eux, vous captiez peu à peu la confiance du moribond.
Vous l’enlaciez des replis savants de vos machinations, comme l’araignée entoure de ses fils la mouche qu’elle va dévorer.
Un jour, profitant d’un moment de fièvre, amenée par un remède savant, vous lui fîtes écrire, en lui tenant la main, un testament qui vous léguait tous ses biens et qui déshéritait ses héritiers légitimes.
Tout cela, le procès eût pu me l’apprendre, mais il est des détails plus secrets.
Le malade reprenait ses forces et avec, sa raison. Il se souvint de ce qu’il avait fait pendant son délire ; il s’en repentit et vous demanda le testament.
Vous refusâtes de le lui apporter. Il se leva.
Vous étiez seuls.
Alors une lutte effrayante s’engagea entre vous, l’homme bien portant, et le moribond qui râlait sous l’effort et ne se tenait debout que par la force de ses nerfs surexcités.
Et vous, vous le mainteniez enlacé sur votre poitrine, le pressant pour l’étouffer, et son haleine embrasée de mourant, courte et saccadée, vous soufflait à la face. Il posait autour de votre cou ses mains qu’il ne pouvait plus serrer.
Vous l’avez terrassé, et comme la mort le saisissait aux cheveux, vous l’avez rejeté sur le lit… Il râla, et… ce fut fini.
Ah ! quelle douleur vous fîtes éclater alors. Mais trop bruyante, car elle vous trahit.
On ne sut pas que c’était vous qui aviez achevé le vieillard. Et c’est vrai, n’est-ce pas, c’est vrai ?
La poitrine oppressée de Varçon se soulevait de longs sifflements. Il était pâle comme un mort ; ses lèvres bleues s’agitaient, sans parler, d’un tremblement convulsif : des lignes vertes sillonnaient ses joues. Droit, rigide, il écoutait encore. Il haletait.
Soudain il rit d’un rire forcé, et toisant le vieillard d’un air méprisant :
– Vous voulez de l’argent, fit-il, pour prix de votre silence ?
Richard Aubépin rendit au docteur insulte pour insulte, et l’écrasant du regard :
– Nous ne recevons pas d’argent, et nous ne composons avec personne. Nous donnons celui qu’on nous demande, et nous protégeons ceux qui nous sont dévoués.
Ce nous, revenant à chaque instant, accentué d’une façon toute spéciale, désignait évidemment une association. Varçon y songea et se demanda ce qu’on voulait de lui.
Richard suivit cette idée sur le front plissé du docteur.
– Aimez-vous le roi Charles-Albert, interrogea-t-il soudain, lui qui vous chassa de votre chaire de médecine ?
Varçon tressaillit, mais ne répondit pas : il attendait que la lumière se fît.
– Vous l’aimez, sans doute, car il est catholique, et vous aussi vous faites semblant de l’être… Voyons, que feriez-vous bien pour vous débarrasser de lui ?
– Ah ça ! où voulez-vous en venir ? Vous ne me tourmentez pas pour le plaisir de le faire. Vous poursuivez un but, expliquez-vous franchement.
Quinze jours plus tard, Richard Aubépin présentait à la Loge des Amis le docteur Varçon, qui fut reçu maçon. Trois semaines après, celui-ci partait pour Genève, qui déjà s’affichait comme la tête et le centre des sociétés secrètes.
S’il y avait quelque chose dans la ville de Garocelle, dont ses habitants pussent tirer de l’orgueil, c’était bien, sans nul doute, la rue des Portiques, et, dans cette rue, le café du Commerce qui servait à la fois de café, de cercle et d’estaminet.
Nous laissons à l’impartialité de notre lecteur le soin d’apprécier notre assertion, et, pour qu’il puisse avantageusement juger, voici une courte mais fidèle description de l’une et de l’autre merveille de Garocelle.
La rue des Portiques s’étend entre la place de l’Église et la place du Marché au milieu de laquelle se pavane fièrement la statue en bronze patiné de vert, d’un célèbre jurisconsulte. L’émule des Cujas et des Barthole serait bien étonné si, un jour de marché, il revenait de l’autre monde à seule fin de se contempler dans sa gloire !… Et gloire il y a ! La statue a six pieds de haut ; le piédestal en a douze ; total : six mètres de célébrité… Il y a donc que, les jours de marché, les choux, les carottes, les épinards et les betteraves, confondus en un admirable pêle-mêle avec des moutons, des chevreaux, des… porcs aux soies luisantes, entourent d’une ceinture peu agréable à l’œil, moins encore à l’odorat, le piédestal en pierre grise au sommet duquel on a juché maître Bonaventure Pantaléon, de son vivant, professeur de droit à l’université de P****, né natif de Garocelle.
Les portiques, que les étrangers s’obstinent à nommer des arcades, sont, en effet, des arcades semblables à celles de la rue de Rivoli, et bâties suivant le goût italien, fort à la mode en Savoie depuis le XVIIIe siècle. Des magasins de toute espèce embellissent les deux côtés de la rue, et, lorsque les boutiquiers ont peu de chose à faire, ils apportent des chaises entre les colonnes et contemplent, en causant à outrance, le spectacle peu animé que présente une rue de petite ville, fut-ce la voie principale.
Quant au café du Commerce, ainsi nommé parce que tout le monde y va, à l’exception des commerçants, il occupe cinq devantures, au centre même des Portiques. Il est flanqué, à droite, d’un magasin de libraire ; à gauche, d’une boutique de mercier. En face, et sous les portiques opposés, un marchand de porcelaines a planté sa tente.
Les cinq ouvertures du café sont d’un joli bois de noyer lourdement travaillé ; les montants enchâssent des vitres carrées derrière lesquelles on aperçoit des rideaux en guipure fausse, retenus par des embrasses en galon de laine bleue. Au-dessus de l’ouverture centrale une large enseigne attire les regards. Cette enseigne est tout un poème : sur un fond du plus pur carmin, – ce que les héraldistes appellent champ de pourpre, – d’énormes lettres dorées se détachent en relief ; au-dessus d’elles, au centre d’une manière de fronton arrondi, une paire de balances non moins dorées, entrelacées de branches d’olivier, émerge d’une auréole de pièces de cent sous alignées en rayons… Aux deux extrémités, l’on voit d’un côté une chope remplie de bière mousseuse flanquée de trois billes de billard ; de l’autre une élégante bouteille vermillon, enrubannée d’azur et accompagnée de deux verres à Champagne emplis de fort beaux fruits à l’eau-de-vie. Le peintre de cette enseigne fameuse avait été décoré à l’unanimité du titre de second Michel-Ange par les connaisseurs en peinture. L’admiration de madame veuve Nicrabeau, la propriétaire du Commerce, s’était exprimée par une pile de beaux écus tout neufs formant la somme respectable de cent francs.
C’est que les habitants de Garocelle ne marchandent pas avec les arts.
Les anciens habitués du lieu, déclarant que madame veuve Nicrabeau, née Célimène-Aréthuse Piffrard, avait fait des folies en restaurant sa taverne avec un tel excès de luxe, comparaient purement et simplement le café du Commerce aux palais des califes de Bagdad, dont il est tant question dans les contes du bonhomme Galland. Pour dire la vérité, les tentures de papier velouté à grands ramages d’or sur un fond écarlate ; les tables de marbre à pieds de fonte vernie ; le parquet à lames alternativement blanches et noires ; les chaises de rotin à dossier carré ; l’énorme poêle en faïence entouré d’anneaux de cuivre reluisant comme de l’or ; les lampes de porcelaine transparente ; ce merveilleux ensemble, pour tout dire en un mot, était bien fait pour éblouir jeunes et vieilles imaginations.
Au temps jadis, en 187., madame veuve Nicrabeau occupait une espèce de niche ménagée au centre du café ; elle avait, à sa gauche, la salle de billard, à sa droite, la salle « des consommations. » Un comptoir de noyer verni, encombré de flacons de toutes formes et de toutes capacités, de « topettes » de rhum, de bouteilles d’absinthe, de coupes à sucre, la séparait du commun des mortels. Cette respectable dame partageait ses loisirs entre la lecture assidue du Petit-Journal et les plaisirs de la conversation. Tandis que son esprit se délassait ainsi, ses doigts manœuvraient activement de longues aiguilles d’acier à l’aide desquelles elle obtenait des bas, des fichus, des bonnets.
Célimène-Aréthuse, femme entre deux âges, avait de quarante à soixante ans. Ses cheveux gris formaient autour de son visage ridé comme une pomme à la fin du carême, des « coques » prétentieuses, dont un prodigieux bonnet à rubans jaune citron augmentait encore l’effet. Le dimanche, le jaune citron se changeait en amaranthe, et des marabouts couleur de rose embellissaient de plus belle cette coiffure imposante. En ce même jour, consacré au Seigneur, apparaissait une robe de soie gorge de pigeon, inaugurée par madame veuve Nicrabeau le jour même de ses noces, et qui remplaçait la toilette des jours ouvriers, une simple robe de mérinos à raies bleues sur un fond chocolat. Ces détails si oiseux qu’ils paraissent, ont déjà fait entrevoir au lecteur un coin du caractère de la veuve : il en a pu conclure que cette Artémise provinciale possédait l’amour du travail, la soif du savoir, l’économie, la propreté, le tout joint à une inexprimable envie de briller.
Ce défaut était l’unique, hâtons-nous de le dire. Madame Nicrabeau savait exercer la charité ; son tricot chaussait force petites jambes frileuses, coiffait nombre de têtes mignonnes que le sort impitoyable négligeait d’orner avec des rubans amaranthe ou citron ; elle avait toujours un verre de bon vin, un morceau de pain et une assiette de soupe au service des pauvres voyageurs ; elle ne refusait point un petit sou aux pifferaris déguenillés que l’Italie une envoie mendier partout. D’un autre côté, cette bonne femme gardait rigidement la probité commerciale que les Parisiens rangent au nombre des imperfections de la province. Elle ignorait l’art de frelater ses liqueurs, de baptiser son vin, de faire du café avec de la chicorée, de remplacer la bière par une décoction de racine de buis.
Donc, il y a de cela quelques années – et, si notre lecteur veut que nous précisions davantage, c’était entre 1850 et 1874, – le café du Commerce était, un beau jour, au grand complet. Il n’y manquait pas un seul de ses habitués ; une heure sonnait, et comme à Garocelle on dîne à midi, les gourmets venaient humer l’arôme du fin-vert et du Bourbon-Saint-Leu, d’autant mieux que la neige couvrait les montagnes, et qu’alors on préfère un cent de piquet, dans un endroit bien chaud, à la promenade la plus sentimentale.
En province, le café est le centre commun où toutes les opinions, toutes les professions, tous les âges se réunissent. Il remplace le cercle et le salon. C’est un terrain neutre où les distinctions sociales auxquelles on attache tant d’importance disparaissent ; où les opinions diverses – il y en a autant que d’individus – se rencontrent sans se heurter. C’est là que se forme cette bête à sept têtes que l’on nomme l’opinion publique ; l’on y élabore des projets ; l’on y ourdit de petites conspirations contre la municipalité ; – l’on y fait de l’opposition ; l’on y prépare les élections. C’est du café que partent les Délites médisances et les grosses calomnies ; c’est là que l’on déchire les réputations ; c’est là que l’on confectionne les célébrités.
Le café du Commerce aurait passé, sans hyperbole, pour le type du genre.
Il y avait grande réunion.
Sans nous occuper du menu fretin, nous porterons tout d’abord notre attention sur trois groupes différents composés par les personnages de cette histoire véridique.
Le premier de ces groupes comprenait trois individus.
L’un, sorte de colosse aux membres herculéens, semblait présider le cercle et tenir le dé de la conversation. Assis sur un escabeau, le corps raide comme un piquet, la canne entre les jambes et le chapeau sur la tête, il parlait d’une voix haute énergiquement accentuée, dédaigneuse, ronflante. Les mots je et moi revenaient fréquemment sur ses lèvres. Il portait un pantalon gris, une redingote noire, son visage était soigneusement rasé. Il serait bien inutile de cacher le nom et la profession de M. La Mottière, avocat au tribunal civil de Garocelle. Il avait soixante ans, n’en montrait que cinquante, jouissait de huit cents livres de rente, et se créait, à force de réclames, plus ou moins saugrenues, une petite réputation de lettré.
À sa gauche, un monsieur tout de noir habillé, mais râpé comme un dix-huitième clerc d’huissier, représentait la docte faculté. C’était le docteur Varçon ; omni-savant, sentencieux, matérialiste et spirite, théologien consommé, médecin émérite, démocrate et socialiste, fort aristocrate en ses manières et libéral à la façon de ceux qui ne veulent de liberté que pour eux. Cet émule de Proudhon soignait avec orgueil sa longue barbe grise ; ses yeux s’abritaient derrière de fortes lunettes. Le troisième, un pharmacien, exécutait ceux que le docteur condamnait. C’était cependant un gros garçon joufflu au visage rose et glabre, aux lèvres épaisses, au ventre proéminent. Quoiqu’il n’eût pas trente ans, il siégeait déjà au conseil municipal et formait, en qualité de secrétaire, le principal ornement de l’Académie Garocelloise. Il s’appelait Morteret, mais son parrain lui avait imposé le prénom harmonieux d’Athenulphe…
Il est des gens qui ne doutent de rien !
Nous aurons occasion tout à l’heure d’entendre la basse de l’avocat, le ténor du docteur, et le grêle fausset du jeune Athenulphe. Pour l’instant, occupons-nous de présenter au lecteur le groupe catalogué sous le numéro deux.
Autour d’une table, couverte d’un tapis chargé de cartes et de jetons, s’asseyaient quatre bourgeois à peu près du même âge. L’un, M. Taulier, fin matois, dirigeait le commerce de porcelaines à l’enseigne du Magot de la Chine. Le second, M. Egault vivait de ses rentes, après avoir vendu pendant vingt ans du drap et de la flanelle à ses concitoyens. Il paraissait fort intelligent, avare de ses paroles, bien élevé. Nous le ferons mieux connaître plus tard. Son partenaire, vieillard d’une soixantaine d’années, Me Ouzaux (François), s’intitulait, non sans une légitime fierté, notaire impérial.
Il faudrait un volume pour tracer un portrait bien exact du quatrième personnage : le capitaine baron Crépinat. On ne rencontrait jamais cet homme autrement que vêtu d’un habillement complet de drap gris-rougeâtre, coiffé d’un chapeau flambard ; une canne à la main ; une pipe à la bouche. Ce n’était pas un vieux grognard. Il avait tout au plus quarante ans. Seulement l’eau-de-vie, l’absinthe, le vin blanc, le tabac, toutes choses dont il abusait, doublaient son âge. Rien ne pouvait plus l’enivrer, quoiqu’il semblât perpétuellement en état d’ivresse. Ses yeux ternes, sa langue pâteuse, ses jambes tremblantes, son visage blême en faisaient un objet de dégoût. Il avait gagné son grade pendant la campagne d’Italie ; son titre lui venait de son père, ancien maître d’hôtel du vice-roi de Sardaigne, lequel père avait un secret pour l’apprêt du canard aux navets. En récompense de ses talents culinaires, il fut baronifié.
Que de titres ont une origine plus ridicule, voire moins honorable.
Le capitaine conservait une profonde reconnaissance à la maison de Savoie. On le disait à son aise, non sans raison, car feu le premier baron Crépinat eût inventé la danse du panier, si cet exercice chorégraphique n’eût été déjà connu de son temps.
Hâtons-nous de crayonner rapidement le troisième groupe que formaient une douzaine de jeunes hommes, très simples, très bruyants, très altérés, qui se livraient avec passion au culte du carambolage.





























