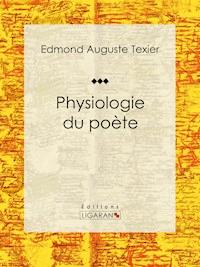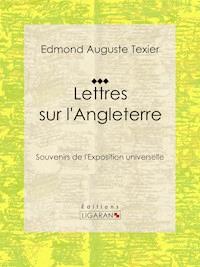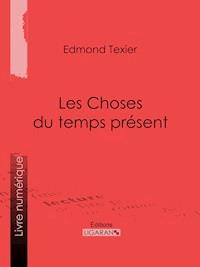
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quand ils s'occupent de la grosse question du mariage, la plupart de nos moralistes se contentent de constater que les jeunes gens d'aujourd'hui sont exigeants, que les jeunes femmes aiment passionnément la toilette, et que, lorsque les millions ne sont pas de la noce, il n'y a pas de noce."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On ne fait plus de préface, et c’est peut-être pour cela que j’en voudrais faire une, si mince qu’elle fût. Une préface est au livre ce que le vestibule est à l’édifice. L’auteur doit aller au-devant du lecteur et lui souhaiter la bienvenue. « Entrez, homme rare et bienveillant, mais avant de vous conduire dans mon modeste appartement, permettez-moi de vous dire quelles pièces le composent. Cela n’est pas très orné, ni très doré, ni même très meublé ; c’est petit, c’est simple, – un appartement sur la cour, au quatrième étage de la littérature. – Si vous pouvez vous passer des colifichets à la mode, des petits dunkerques, des enjolivements et de la potichomanie du style moderne, vous ne serez peut-être pas trop dépaysé. Sinon, n’allez pas plus loin, seigneur, ne franchissez pas le seuil de cette antichambre et frappez à la porte du voisin. »
Ce livre, qui a pour titre : les Choses du temps présent, n’a pas été écrit tout d’une haleine. Il s’est fait, pour ainsi dire, tout seul, au jour le jour ; c’est une suite de réflexions bâties sur la tête d’une épingle. L’évènement du jour a inspiré telle page, et telle autre page est née d’un mot saisi au vol. Un tel livre ne se lit pas d’un trait, et, s’il se lit jusqu’à la fin, ce n’est que chapitre par chapitre, et en mettant un intervalle entre celui qui précède et celui qui suit.
Ce livre, on le prend le matin, on l’abandonne, et si le soir on le retrouve, tant mieux. L’auteur n’est ni un moraliste, ni un philosophe, ni même un penseur, – un vilain mot dont tout le monde s’affuble depuis quelques années ; – il ne voit guère des choses que la surface, et c’est pourquoi il ne prétend point à l’honneur d’avoir fait des découvertes au pays de la psychologie. Il raconte plus qu’il ne prouve ; c’est une plume légère ; il n’appuie pas, à peine il effleure. Et voilà le lecteur prévenu.
E.T.
Quand ils s’occupent de la grosse question du mariage, la plupart de nos moralistes se contentent de constater que les jeunes gens d’aujourd’hui sont exigeants, que les jeunes femmes aiment passionnément la toilette, et que, lorsque les millions ne sont pas de la noce, il n’y a pas de noce.
On a bientôt fait de critiquer son temps ; mais, bon gré mal gré, il faut prendre son temps comme il est. Quand vous m’aurez montré cette meute de prétendants à la recherche d’une héritière, ces mariages commerciaux où deux coffres-forts se jurent un éternel amour ; quand vous m’aurez cité, en opposition avec ce qui se passe en France, l’exemple de l’Angleterre où les hommes riches ne dédaignent pas d’épouser de jeunes filles pauvres, je me permettrai de vous demander où vous voulez en venir. Vous signalez un mal que tout le monde connaît, mais vous n’indiquez pas le remède.
Je ne me dissimule pas, cependant, que la conclusion, s’il en est une, n’est pas facile à trouver, et que le remède, s’il existe, ne peut opérer immédiatement comme l’onguent sur la brûlure.
Les pères et les mères de famille se récrient ouvertement contre les exigences des jeunes gens qui demandent à une jeune fille, outre le cortège obligé de ses vertus, un appoint en argent. Les jeunes gens, s’ils ne sont pas riches surtout, n’ont pas tout à fait tort. Pourquoi iraient-ils de gaieté de cœur s’atteler à cette charrette du mariage qu’il leur faudrait éternellement traîner dans des chemins semés d’ornières et de précipices ? Le mariage est une admirable institution, mais il ne vaut pas le sacrifice des facultés et quelquefois de la dignité de l’homme, et à ce terrible jeu de la misère on a bientôt perdu l’énergie et la conscience de soi-même. Ah ! si les jeunes filles avaient reçu une autre éducation et surtout une instruction plus solide ; si au lieu de leur apprendre les arts frivoles dont le banal programme est invariablement étalé sous les yeux de tout prétendant, on leur avait enseigné les connaissances pratiques, cette vraie science de la vie, si, en un mot, on avait fait de toutes ces jeunes filles des compagnes de l’homme et non des poupées de cire, peut-être les jeunes gens se montreraient-ils plus accommodants sur le redoutable chapitre de la dot ! La femme telle que la font les pensionnats est une châsse vivante que l’homme doit orner, embellir, parer de soie, de velours, de satin, de dentelles, de pierres précieuses ; son rôle dans la communauté consiste à porter de belles robes, de beaux châles, des chapeaux élégants, et à jouer du piano ! Ah ! le piano !
Que les gens riches donnent à leurs filles cette éducation, ou plutôt ce semblant d’éducation, je le comprends jusqu’à un certain point. La jeune fille riche devenue femme payera avec sa dot ses opulents loisirs. Qu’elle soit belle, qu’elle soit gracieuse, qu’elle plaise, c’est tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle. Mais comment se fait-il que cette éducation, bonne tout au plus pour quelques-unes, soit l’éducation de toutes ? Comment le petit bourgeois, qui n’a pas un sou de dot à donner à sa fille, ne comprend-il pas que ce piano, ce dessin à l’aquarelle ou au pastel, tous ces prétendus arts d’agrément sont les dons les plus funestes ? Il se sera saigné aux quatre membres, cet honnête père de famille, pour que sa fille fût aussi bien élevée que telle autre jeune fille qui pourra échanger un demi-million contre une corbeille de noce ; il lui aura donné tous les goûts d’une patricienne, l’amour de la toilette, le mépris de la vie pratique, l’appétit des élégances, et le jour où elle sortira de pension, le jour où elle sera une fille à marier, il s’étonnera si quelque honnête jeune homme recule d’effroi à la proposition d’être son gendre !
On prétend que notre pays est le pays pratique par excellence ; je ne dis pas non, mais à voir ce qui s’y passe, on ne s’en douterait guère. Quoi de plus absurde, de plus romanesque, de plus fatal, que cette uniformité de l’éducation imposée à de jeunes filles de conditions et de fortunes si diverses ? Puisque toutes les jeunes filles se ressemblent, puisqu’elles ont toutes été taillées sur le même patron intellectuel et moral, puisque celle-ci a les mêmes idées, les mêmes goûts, les mêmes prétentions, la même éducation en un mot que celle-là, pourquoi feriez-vous aux jeunes gens un crime de préférer celles qui, outre la somme générale des qualités et des agréments fournis par le pensionnat, ont par-dessus le marché l’attrait particulier de la dot ?
En opposition avec le père de famille dont je parlais tout à l’heure, supposez un homme de sens qui ait élevé sa fille dans des conditions toutes différentes. Il a écarté de ce jeune esprit l’essaim des chimères, des puérilités, et il l’a nourri des mets substantiels de l’intelligence ; il a voulu qu’on lui enseignât de bonne heure l’ordre, l’économie, la simplicité et les soins si importants du ménage. Ce mariage, qui apparaît à toutes les jeunes filles comme une porte ouverte sur le champ de la liberté, il lui en a parlé comme d’une chose grave et souvent lourde qui impose de part et d’autre des devoirs, des sacrifices et un dévouement sans bornes. Il s’est efforcé de préparer sa fille à être la compagne sérieuse, l’associée de cœur et d’esprit de l’homme qu’elle doit un jour épouser. Lorsqu’elle aura atteint l’âge de dix-huit ans, celle-là ne croira pas que la beauté rehaussée par la toilette est la seule qualité de la femme, et elle n’attendra pas que le fils du roi passe par hasard devant sa porte et tombe subitement amoureux d’elle, comme cela se pratique dans les contes de fées ; mais si un honnête jeune homme la rencontre, soyez sûr qu’il saura apprécier ce solide mérite, fruit naturel d’une exceptionnelle éducation. C’est la fausse éducation des jeunes filles, c’est leur infériorité relative qui explique, et jusqu’à un certain point justifie l’exorbitant impôt de la dot. Les jeunes filles, quelle que soit leur condition, sont toutes élevées en princesses de salon ; il me semble tout naturel que les épouseurs leur demandent une dot de princesse. Une princesse, cela coûte cher.
Je ne voudrais pas qu’on se méprît sur ma pensée et qu’on supposât que je propose de faire des jeunes Françaises une race de précieuses et de pédantes. Le pédantisme, si ridicule chez un homme, est intolérable chez une femme ; mais il n’y aurait aucun inconvénient à enseigner aux jeunes filles beaucoup de choses qu’elles ignorent, à leur apprendre qu’elles ne sont pas faites seulement pour être adulées, pour briller dans un bal et pour écorcher Rossini tout vif sur le clavier d’un piano. Les femmes qui ont doublé le cap de trente ans ne tardent pas du reste à s’apercevoir, en dépit des hommages menteurs et des compliments boursouflés dont on les enguirlande, combien est nul et dérisoire le rôle qui leur a été imposé. Les plus ardentes se révoltent, les plus sages se bornent à protester en silence.
Ainsi donc, pères et mères de famille dédaignés de la fortune, au lieu de vous récrier contre les rapaces exigences des hommes à l’endroit de la dot, commencez par donner à vos filles une éducation solide qui inspire l’amour des vertus domestiques. Et si vous voulez qu’on les épouse pour elles-mêmes, faites-en des femmes et non des poupées de salon.
Éloignez surtout de leur esprit les fantaisies monstrueuses de la toilette et l’appétit du luxe moderne, de ce luxe qui se pavane dans la rue avec dix-huit mètres de velours et de dentelles, et qui, rentré chez lui, économise une bûche par un froid de dix degrés. Beaucoup d’entre nous sont pauvres, mais nous avons tous l’apparence de la richesse, et comme nous sommes un peuple d’imagination, l’apparence nous suffit. Vous allez dans une maison, et l’on vous reçoit dans un salon tout étincelant de dorures, tout rempli de potiches, et si encombré de meubles qu’il n’y a place que pour les étagères, les petits dunkerques, les fauteuils, les poufs et les canapés tordus ; mais le salon n’est si plein que parce que les autres chambres sont vides. Nous nous sommes beaucoup moqués de la petite bourgeoisie anglaise, cette grenouille qui se gonfle pour paraître aussi grosse que le bœuf millionnaire, et nous sacrifions comme elle aux faux dieux de l’extérieur. À Londres, tout pauvre diable qui reçoit un visiteur dont il veut capter la considération, lui offre tout de suite du vin de France. Il tient enfermé dans une armoire une bouteille unique de ce vin cher dont il ne boit jamais, mais qu’il montre avec ostentation pour constater son honorabilité. En France, l’honorabilité consiste, chez beaucoup de gens, à avoir un salon splendide, quitte à coucher dans un galetas. L’honorabilité consiste encore, pour une femme dont le mari n’est pas riche, à se procurer coûte que coûte une robe de ville qui a été payée douze cents francs. Un grand marchand de nouveautés à qui l’on demandait s’il était content de son commerce répondit : « Cela va très bien ; encore un petit effort, et nous arriverons à faire adopter la robe de ville de deux mille francs. » Je ne parle pas, bien entendu, des robes de bal ou de soirée dont quelques-unes représentent la valeur d’un domaine en pleine exploitation. N’a-t-il pas été question, en ces dernières années, d’une belle étrangère qui avait paru dans un bal avec une robe estimée deux cent mille francs ? Quel crève-cœur et quelle honte pour celles qui ne portaient ce soir-là que pour dix mille francs de dentelles !
Les femmes lancées dans cette course à fond de train de la toilette et du chiffon ne savent peut-être pas assez que personne n’est dupe du faux éclat de l’apparence. Il ne faut pas être un observateur bien fin pour deviner les ennuis, les privations, les dettes, les lâchetés, toutes les misères mal dissimulées sous le satin et le velours. La vie parisienne est pleine de contrastes et de mystères que tout le monde connaît, et c’est parce que tout le monde a pénétré ces secrets, qui ressemblent si fort à ceux du seigneur Polichinelle, qu’il serait peut-être temps de mettre fin à cette comédie du luxe à outrance, du luxe du salon et de l’indigence de la salle à manger. On vit exclusivement pour les autres : on se gêne et l’on gêne. Un jour peut-être il se rencontrera quelques gens d’esprit qui demanderont que le rideau tombe sur cette farce dont la représentation dure depuis trop longtemps. L’un dira à l’autre : – Permettez-moi de retrancher quelque chose dans l’ameublement de mon salon et de m’installer un peu plus confortablement dans mon cabinet. – Volontiers, répondra celui-ci ; je vous promets en retour d’avoir dorénavant moins de chinoiseries dans mes étagères et plus de tapis dans ma chambre à coucher. Si de leur côté les femmes voulaient se convaincre que ce n’est pas la robe, mais la façon dont on la porte qui constitue la véritable élégance, la cause de la raison et du bon goût serait bientôt gagnée.
Mais il ne faut pas espérer que cette grande question de la robe soit de sitôt résolue. À l’heure qu’il est, une robe qui a paru dans trois bals a produit tout son effet, et est destituée par ce simple fait de toute élégance et de toute richesse. Rien n’est plus éphémère que le règne d’une robe comme il faut, et quand on vient à songer à quel monstrueux total s’élève à la fin de chaque saison l’addition de la bonne faiseuse, on comprend ce mari dont l’exaspération se traduisait, en face d’un mémoire à payer, par cette exclamation pittoresque : « Les femmes de ce temps-ci ne demandent que plaies et bosses ! »
Cette comédie du luxe doit engendrer une foule de drames conjugaux. Il n’y a pas bien longtemps, un jeune marié de six mois fumait tranquillement son cigare dans son cabinet de travail pendant que sa femme était allée promener au bois une robe toute neuve. Un mémoire se présente ; le mari regarde et voit un chiffre rond de vingt mille francs pour articles de toilette féminine. Notre homme, abasourdi, congédie le mémoire, paye deux termes au propriétaire et fait enlever tous ses meubles. Ce mari philosophe a rendu à sa femme sa dot et sa liberté. Étonnez-vous que la perspective des mémoires à payer l’ait dégoûté de l’association !
Notre temps a donc vu se développer outre mesure les besoins factices et l’appétit des jouissances ; l’homme qui mettait trente ans amasser une petite fortune pour ses enfants appartient au vieux répertoire de la comédie sociale. Nous ressemblons tous plus ou moins à ces beaux seigneurs du camp du Drap d’or qui portaient des prés et des moulins sur leurs épaules. Aussi chaque jour révèle un nouveau désastre et signale une nouvelle victime de la maladie contemporaine. Hier, c’étaient deux jeunes gens qui, avec 6 000 francs d’appointements, menaient le train de millionnaires, et disparaissaient avec cinq ou six millions dans leur poche. À Lyon, un caissier éprouve aussi le besoin de traverser l’Atlantique, mais il est plus modeste que les deux caissiers parisiens, et il n’emporte que 400 000 francs. À Berlin, un homme de confiance disparaît laissant deux millions de déficit. À Francfort, fuite d’un autre caissier qui ne prend à son patron qu’une centaine de mille francs, le misérable ! À Londres, nous voyons un M. Robson, employé à l’administration du palais de Cristal, mener la vie à grandes guides avec des appointements de 100 francs par semaine, acheter chevaux, voiture, petite maison et le reste, puis, au bout de deux ou trois ans de cette existence fashionable, disparaître comme un sylphe après avoir fait à la caisse un emprunt forcé d’un million trois cent mille francs. On a démenti le vol de deux millions commis au préjudice des jésuites de la rue de Sèvres ; je n’insisterai donc pas ; mais les révérends pères, qui ne veulent peut-être pas faire connaître, par humilité chrétienne, l’immensité de leurs richesses, n’ont contesté que l’exactitude du chiffre. Que sont-ils devenus ces caissiers du Gymnase, ces caissiers honnêtes, probes, antédiluviens qui, aux jours de crise, déposaient furtivement dans la caisse leurs propres économies, sauvaient leur patron du déshonneur, et trouvaient dans le calme de leur conscience, et dans un couplet final chanté au public, la récompense de leur généreuse probité ? Hélas ! ceux-là sont allés on ne sait où, pendant que les autres allaient en Amérique !
Le luxe est devenu une nécessité, la première nécessité de notre temps. Jamais la folie des riches mobiliers, des salons resplendissants, des tableaux, des objets d’art et des chinoiseries n’a été poussé si loin que depuis que les logements sont hors de prix. La possession de la richesse est un besoin si impérieux que les pauvres mêmes, pour se faire illusion, s’entourent d’un luxe factice qui ne trompe personne. Et pourtant voyez la contradiction ! quand par hasard un pauvre diable a gagné le gros lot à la loterie de la fortune, il perd ordinairement sa belle humeur, et il tombe dans la mélancolie du savetier de La Fontaine. Je rencontrai un jour un ancien camarade que la Bourse avait fait millionnaire et que l’argent avait fait philosophe. Arrivé au port, il avait le mal de mer, et il regrettait les tempêtes de la traversée. M. Hope, qui avait jeté plusieurs millions dans la décoration de sa résidence héliogabalienne, M. Hope, qui avait des meubles en or, des plats en or, des trépieds en or, et qui se serait, je crois, consolé de la perte d’une jambe en songeant que rien ne l’empêchait de la remplacer par un tibia en or incrusté de diamants, M. Hope était un des hommes les plus ennuyés et les plus ennuyeux, et il avouait que, s’il n’avait pas eu la passion du jeu, il se serait probablement fait sauter la cervelle. Il était seul à jouir de toutes ses richesses, et il en jouissait tout seul en bâillant toute la journée. Il est mort au milieu de son or, après avoir avalé sa dernière médecine dans une coupe d’or, et le lendemain il était à six pieds sous terre, à côté du pauvre diable qui avait crevé la veille à l’hôpital, ce qui prouve une fois de plus que tout finit en ce monde, la richesse du riche, la misère du pauvre, les privations de celui-ci et les millions de celui-là.
L’or ne préserve donc pas de l’ennui, et je suis convaincu que c’est l’ennui plus que la passion qui pousse tant d’héroïnes vers le lac de Côme. C’est là où elles vont toutes, ces belles révoltées qui ont brisé la chaîne conjugale, et ce serait une piquante histoire à raconter l’histoire de ce lac parfumé et scélérat, de ce coin de terre où fleurit l’adultère avec l’oranger, et où l’on vit moins dans les joies du présent que dans le regret du passé : le regret de la position perdue, de la réputation perdue, de l’avenir perdu. Dans cet élégant monastère de l’amour illicite, elles ont l’air tiède et embaumé, les douces senteurs du lac, les blonds rayons du soleil, mais elles traînent partout avec elles le souvenir de ce monde qu’elles ont abandonné en un jour de fièvre chaude et où elles ne rentreront jamais !
Autrefois, quand le bruit d’une aventure galante éclatait par la ville, c’était toujours quelque jeune fille, quelque colombe de seize à dix-sept ans qui en était l’héroïne. Un mousquetaire, un officier aux gardes avait escaladé les murs d’un couvent, et le lendemain une blanche brebis manquait au troupeau. Hélas ! ce sont les femmes déjà mûres, les femmes qui s’apprêtent à passer sous le tropique de la trentième année qui suivent les mousquetaires d’à présent. Avouons que l’horloge de la passion retarde singulièrement dans notre siècle ! Clarisse Harlowe ne suivrait plus Lovelace ; elle épouserait un banquier de la Cité, bien vieux peut-être, mais à coup sûr fort riche, et elle dirait à l’amant préféré : « Repassez dans dix ans, mon cher : je suis encore trop raisonnable aujourd’hui ; mais dans dix ans, l’âge des folies arrivant, nous irons de compagnie grossir la galante colonie du lac. » On veut être riche avant tout ; on sacrifie à cette sérénissime richesse sa passion, sa jeunesse, son amour, et comme le diable ne perd jamais ses droits, voici que la passion se réveille à l’heure même où devrait triompher la raison, à cette heure grave et mélancolique où nos grands-mères, moins attardées que leurs petites-filles, disaient sans trop se faire prier : « Adieu, paniers, vendanges sont faites. »
Il faut dire aussi que les don Juan d’aujourd’hui ont pris beaucoup trop au sérieux les paradoxes de Balzac, l’inventeur des héroïnes de la saison d’automne. À l’époque où l’on n’avait pas encore supprimé le printemps, où la jeunesse était reine, où l’amour avait seize ans dans les romans et dans la vie, les chaises de poste emportaient à Côme ou ailleurs plus de pensionnaires que de matrones. Tout n’était pas perdu sans retour pour ces fugitives écervelées : la famille se mettait de la partie, et l’aventure finissait souvent comme les vaudevilles de M. Scribe. Mais quoi de plus triste que ces folies mûres, ces passions retardataires, ces fugues en plein midi ! et quelle compassion voulez-vous qu’elles laissent après elles, c’est Julie et c’est Charlotte majeure qui abandonnent leur mari, leurs enfants, leurs amis, le foyer respecté, pour aller languir indéfiniment dans les marais-pontins du demi-monde !
– Et le mari ? me direz-vous. Puisque vous me parlez du mari, je vais vous raconter l’histoire d’un sénateur. Il a soixante ans, une jeune femme et cent mille francs de rente. Il a assisté à tous les bals travestis de la cour et de la ville. Il le fallait. Quelques jours avant le premier bal, il dit à sa femme : « Puisqu’il faut absolument que je me déguise, j’aurai un domino noir. » Le jour du bal arrivé, il trouve dans sa chambre un magnifique domino lilas. « Ma femme m’aura mal compris, » pense-t-il, et le voilà parti aussi printanier qu’un bouquet de violettes. Au retour, il jette le domino sur un fauteuil et prie sa femme de lui en commander un noir pour le bal du surlendemain ; mais c’est un domino mauve qu’il voit étalé sur le canapé de sa chambre à coucher. Il n’y avait plus à reculer. Au troisième bal, domino vert tendre, et domino couleur violette de Parme au quatrième. Le sénateur a promené de bal en bal les couleurs les plus juvéniles, et il ne se doute pas encore, à l’heure qu’il est, que sa femme ne lui a imposé tous ces dominos impossibles que pour les faire tailler à son usage et ajouter quatre nouvelles robes à sa collection.
Une autre histoire qui a fait du bruit. Une grande dame paraît à une soirée avec une très belle parure en diamants. On admire beaucoup cette parure, et l’on en fait compliment au mari, lequel est myope. Celui-ci, dont l’attention est éveillée par toutes les choses flatteuses qu’on lui adresse, examine de près la toilette de sa femme, et ne reconnaît pas les diamants. Il demande une explication à voix basse. La dame embarrassée propose l’ajournement. Insistance du mari, altercation assez vive devant tout le monde, et départ précipité des deux époux. Ah ! les diamants !
« Je ne t’ordonne pas de faire de riches présents à ta maîtresse, dit Ovide dans l’Art d’aimer ; offre-lui quelques bagatelles, pourvu qu’elles soient bien choisies et données à propos. Lorsque la campagne étale ses richesses, lorsque les branches d’arbre plient sous le poids des fruits, qu’une jeune esclave lui apporte de ta part une corbeille pleine de ces dons champêtres. Tu pourras dire qu’ils viennent d’une campagne voisine de la ville, bien qu’ils aient été achetés sur la voie Sacrée. Envoie-lui ou des raisins ou de ces châtaignes qu’aimait Amaryllis. Un envoi de grives ou de colombes lui prouvera que tu ne l’oublies point. »
Offrez donc, jeunes amants, aux Amaryllis d’aujourd’hui, des raisins, des grives et des châtaignes ; mais joignez-y, pour faire excuser votre témérité, quelques-uns de ces dons champêtres qui fleurissent dans les vitrines de Baugrand et de Janisset.
J’aurais bien voulu dire aussi quelques mots de la crinoline, ce ballon en caoutchouc qui a été la cause d’un grand nombre de maladies et qui donnerait à la Vénus de Milo l’apparence d’une gigantesque sonnette ; mais on m’assure que la crinoline est morte, si bien morte ; que les femmes de chambre elles-mêmes ont envoyé leurs anciens atours au quai de la Ferraille. Le quai de la Ferraille est, pour le quart d’heure, le panthéon des charmes, des grâces, des élégances de la dernière saison ; j’y ai reconnu, l’autre jour, une taille divine qui a été pendant trois mois l’orgueil et la gloire du bois de Boulogne ; elle gisait entre une vieille soupière et un jeune chaudron. Et dire que tant de gens ont suivi, le cœur palpitant, le sein gonflé, cette fière encolure drapée de satin, qui ne se détourneraient pas aujourd’hui pour lui faire l’aumône d’un regard ! Que lui manque-t-il cependant à cette tournure naguère triomphante ? il ne lui manque que le satin. Ah ! la gloire, la beauté et les tournures d’acier, tout cela n’a qu’un jour.
Quoi qu’il en soit, voilà le forgeron à tout jamais exilé du boudoir ! Ce n’est plus toi, vieux Vulcain, qui confectionneras désormais les charmes vainqueurs ! À l’Académie, cela s’appelle encore les charmes, de même que les appas veulent dire autre chose. Les appas et les charmes, les charmes et les appas ! je ne connais pas de mot dans tout le dictionnaire qui soit plus utile que ces deux tropes majestueux. Ils permettent à un pauvre écrivain de désigner toutes sortes de choses qu’il serait difficile et peut-être malséant de nommer par leur nom. Ceci vous prouve, ô lecteurs, qu’il ne s’agit que de s’entendre et de connaître à fond la langue qui se parle au bout du pont des Arts.
Donc, la crinoline a fait son temps, et elle a été remplacée par la longue robe à draperies et à plis flottants, une robe ample, majestueuse, qui donne aux femmes un certain air de ressemblance avec la muse de la Tragédie ; il ne leur manque que le péplum et le cothurne. Comme cette robe tombant en plis bouffants traîne beaucoup par derrière, il sera difficile de la porter partout ailleurs que dans un salon ou en voiture, à moins que les femmes ne se décident à balayer toute la poussière du trottoir, ce qui pourra bien arriver, pour peu que la mode s’en mêle. Quelques maris s’étaient flattés de cette douce espérance que, la crinoline une fois partie, les volants, les colifichets, les mètres supplémentaires s’en iraient avec elle, et il était même vaguement question d’inaugurer dans l’empire de la toilette les timides théories de l’école littéraire du bon sens. Cruelle déception ! La robe nouvelle exige encore plus d’ajustements et plus d’étoffe que l’ancienne ; la crinoline n’est plus, mais les dix-huit mètres à la robe toujours sont très bien portés. Le Ponsard de l’économie domestique n’est pas encore né.
Mais comment cette question des falbalas ne tiendrait-elle pas une grande place dans l’esprit des femmes, quand on voit le succès qui accompagne depuis quelque temps ces petits bouquins à couverture lustrée, exhalant un parfum d’huile de Macassar, et qui sont destinés à propager le culte du chiffon, de la dentelle, du ruban et des cosmétiques ? La librairie épuisée s’occupe à rééditer toute la galante pharmacopée du passé. Voulez-vous être belles, mesdames ? on vous livre, moyennant vingt sous, toutes les recettes des portières du Moyen Âge et de l’antiquité. On vous apprend comment la femme de Marc-Aurèle, cette inconstante Romaine qui porta trois cents chevelures différentes dans l’espace de cinq ans, avait découvert pour la conservation de la beauté un procédé bien supérieur à celui de M. Appert pour la conservation des petits pois. Ce précieux procédé, perdu pendant des siècles, fut retrouvé par madame Diane de Poitiers, ou plutôt par son parfumeur, passé maître dans l’art d’embaumer les vivants. Diane de Poitiers était encore si belle à l’âge de soixante-cinq ans, que Brantôme, un connaisseur, faillit tomber à la renverse à la vue de cette vieille femme restée jeune. Il comprit tout de suite l’empire exercé par la châtelaine d’Anet sur le cœur d’Henri II, et s’il n’écrivit point à ce sujet un gros mémoire sur la corrélation secrète qui existe entre la parfumerie et la politique, c’est que notre homme était un homme léger, qui aimait mieux griffonner des histoires galantes que des traités maussades et ennuyeux.
Ce n’est pas tout ; ces petits livres, et il en pleut que c’est une bénédiction, contiennent une foule d’autres enseignements. Porter une robe de telle couleur, tel jour plutôt que tel autre jour, pour telle ou telle raison. Consulter l’état de l’atmosphère avant d’adopter tel nœud de rubans. Ne point se risquer dans un salon sans en connaître la décoration, etc., etc. Si toutes les femmes d’aujourd’hui ne sont point aussi belles et aussi jeunes que Diane de Poitiers à l’âge de soixante-cinq ans, c’est qu’elles auront dédaigné cette littérature au benjoin, à l’aloès, à la gentiane, au safran superfin, cette littérature manipulée par une société d’hommes de lettres et inspirée par une association de couturières et de parfumeurs.
Et c’est ainsi que le luxe outré, extravagant de la toilette a pris sur toutes les imaginations un tel empire, que la beauté et la jeunesse ne sont plus, même aux yeux des hommes, que des qualités accessoires. Vénus en personne descendrait de l’Olympe avec une robe de taffetas que personne ne se retournerait pour la regarder passer. Jamais le falbala, le ruban, le volant, la broderie, le rubis, le diamant, tout ce qui pare, n’a eu plus de succès. On est amoureux d’une toilette, le cœur bat pour une étoffe, on fait la cour à une parure. Comment expliqueriez-vous autrement le long règne de ces femmes qui tirent un nouveau feu d’artifice à chaque première représentation ? Elles ne sont plus jeunes, quelques-unes n’ont jamais été belles ; mais la plus splendide châsse italienne n’est pas plus parée qu’elles ne sont. Et les innocents de l’orchestre assistent avec un intérêt palpitant au combat de diamants, de dentelles et de cosmétiques qui se livre sous leurs regards. Celui-ci se déclare pour la rivière, celui-là tient pour le diadème, celui-là est subjugué par une triple couche de blanc de perle.
Un beau jour il fut question de supprimer le luxe. Des dames animées d’intentions économiques formèrent une association dont le but était d’éteindre le feu d’artifice des toilettes. « Les membres de l’association, disaient les statuts, devront renoncer à tout ajustement qui blesserait la modestie ; tels sont, par exemple, les robes trop décolletées, les chapeaux trop découverts, les volants, les crinolines, etc. Les femmes se restreindront à dix robes au plus. Il sera fait plus tard des prescriptions sur le luxe dans tous ses détails : tables, équipages, ameublements. Il serait à désirer que l’on pût faire paraître un journal sous l’invocation de sainte Élisabeth de Hongrie, au moyen duquel les associées se mettraient en rapport et où il leur serait donné des indications sur les ouvrages dont on recommande la lecture. Ce journal aurait pour but de conserver l’unité entre les associées. »
Voilà qui est bien. Mais les femmes ne commencent à s’apercevoir de l’immodestie des robes décolletées que lorsqu’elles n’ont plus à montrer que la place où fut Ilion. Tant que Troie subsiste, la couturière a carte blanche ; elle ne coupera jamais de corsage trop échancré, elle ne fera jamais assez étinceler aux regards le satin des blanches épaules. Voyez Célimène ; elle a vingt ans, elle est belle, et elle sait qu’elle est belle ; croyez-vous qu’elle ira chercher chicane à la bonne faiseuse parce que celle-ci aura donné un audacieux coup de ciseau dans le corsage de la dernière robe ? Et comme Alceste ou Oronte seraient bien reçus s’ils venaient, sous le prétexte qu’ils veulent épouser Célimène, lui offrir un abonnement au journal de sainte Élisabeth de Hongrie !
Quand Célimène aura quarante-cinq ans, peut-être soupçonnera-t-elle l’immodestie des robes trop courtes par le haut ! Alors, mais alors seulement, elle réformera sa garde-robe, elle se révoltera contre le luxe indécent des jeunes femmes, et elle s’enrôlera dans la pieuse association des dames unitaires. Qu’on nous montre la liste des femmes qui font partie de la confrérie somptuaire, et je parie que sur cent, quatre-vingt-dix-neuf ont déjà descendu l’échelle des premières illusions. Dans ce temps où les femmes ont trouvé le secret de prolonger leur jeunesse, il faut avoir au moins huit lustres carillonnés pour se réfugier dans le giron réformiste de sainte Élisabeth de Hongrie.
– La question des femmes est à l’ordre du jour partout, même en Orient. Il y a peu de temps, le sultan ne se plaignait-il pas, en un style plein de mélancolie, que les femmes de Constantinople, répudiant toutes les lois de la morale et des bonnes mœurs, se servissent de voiles très minces et de robes diaphanes ? En France, c’est le contraire qui existe ; les femmes qui ont passé l’âge équinoxial portent volontiers des voiles très épais, et en cela elles sont peut-être plus coupables que les dames de Constantinople, à cause des méprises que peut provoquer la vue d’une taille jeune appartenant à un visage qui l’est moins. Quant aux robes diaphanes turques, elles sont probablement un acheminement vers les modes plus savantes de la vieille Europe, où les femmes portent si peu de robe qu’il est à peu près indifférent que la robe soit transparente ou ne le soit pas.
Je ne doute pas de la toute-puissance du sultan. Son empire est un vaste jardin où il peut cueillir, en guise des fleurs, toutes les têtes qu’il lui plaît. Ce souverain absolu n’a que l’embarras du choix pour la composition du bouquet, mais je suis à peu près certain, cependant, que cette toute-puissance se brisera comme du verre contre le rocher de la coquetterie féminine. L’introduction à Constantinople de l’étoffe légère a été le dernier coup porté à l’islam, et cette révolte des femmes me paraît bien plus grave que les conspirations du vieux parti turc. La conspiration a toujours été un des éléments de la civilisation musulmane. Tout le monde conspire en Orient, depuis le grand-vizir jusqu’à l’homme du peuple ; puis un matin la mèche est éventée, le sultan envoie les conspirateurs se repentir au fond du Bosphore, et tout est dit jusqu’à la conspiration prochaine. Quant à l’étoffe légère, c’est bien autre chose : c’est le fruit défendu, et il n’y a pas de sultan qui puisse empêcher les Èves turques de mordre à ce fruit-là. Ève se promène dans le paradis terrestre ; elle a une robe de drap coupée sur le patron orthodoxe et approuvée par Mahomet. Il fait chaud, et Ève ne sait pourquoi elle est si accablée et si maussade. Tout à coup le serpent fait chatoyer sous le regard d’Ève les plis d’une jolie robe de mousseline blanche qui arrive de Paris… Je vous demande si l’ordonnance impériale… Ève n’aura pas plutôt aperçu la robe de mousseline qu’elle aura été l’essayer dans son cabinet de toilette. Le serpent est encore plus puissant qu’Abdul-Azis.
Je ne ferai point aux Françaises la grosse injure d’établir entre elles et les femmes turques la plus petite comparaison ; la supériorité de notre civilisation est suffisamment démontrée d’ailleurs par quelques articles de l’ordonnance : « Aucune famille ne pourra avoir des équipages au-dessus de ses moyens. » Un pareil article soulèverait chez nous des tonnerres de haro. Cinq cents économistes se lèveraient comme un seul homme pour réclamer au nom de l’industrie frappée et pour prouver que ce frein imposé à la vanité équivaudrait à la mort de la carrosserie nationale. Vive la carrosserie !
Autre exemple : « Les femmes ne porteront ni broderie, ni passementerie, ni autres ornements extérieurs d’aucune sorte. » Cela peut convenir aux femmes turques, ou plutôt au sultan ; mais si l’on défendait à Paris l’usage des broderies, la poitrine des femmes ne ressemblerait plus au plastron d’un hussard, et ce serait dommage. Quelques femmes portent même des épaulettes, une mode charmante qui autorise les gens qui les connaissent à les saluer militairement et à leur dire : Bonjour, mon officier ! Quant à l’article suivant : « Les conducteurs ou cochers ne doivent point être choisis parmi les gens dont la compagnie peut offrir des inconvénients pour les femmes, » il est inapplicable chez nous… pour plusieurs raisons que je n’ai pas besoin d’expliquer.
L’ordonnance s’élève contre les femmes qui se permettent de fréquenter la promenade des hommes. En France, on se plaint beaucoup de la négligence de la majorité masculine touchant les relations sociales. Là ce sont les hommes qui ne fréquentent plus la promenade des femmes. Dans un salon, vous verrez quinze femmes sur vingt personnes, et encore les cinq fidèles appartiennent-ils la plupart du temps à une autre civilisation, à d’autres mœurs, à un autre siècle. Les chasseurs manquant, la chasse reste fermée. Si une voix timide s’élève pour demander où sont les jeunes gens, un vieillard répond qu’il n’y a plus de jeunes gens, et tout le monde suppose qu’ils sont au club, à moins qu’ils ne soient ailleurs. La vérité est qu’ils sont ailleurs. C’est un endroit où la jeunesse va beaucoup depuis quelque temps. On entre là botté comme Louis XIV ; on a une redingote et même un paletot si l’on veut. On est à son aise, on est chez soi, et puis pas pour un sou d’esprit à dépenser. Quelle économie ! Un pacha n’a pas plus d’efforts à faire pour passer de sa maison dans son harem ; on est un pacha, et quelquefois le pachalik est en commandite ; et voilà comment les mœurs turques se faufilent à Paris, pendant que les modes françaises s’implantent à Constantinople.
Il ne faut pas croire cependant que cette jeunesse qui fait l’école buissonnière dans les faciles sentiers du monde que vous savez n’ait pas la réplique prompte aux critiques qu’on lui adresse. « Nous allons là-bas, c’est vrai ; nous y vivons même, mais en honnêtes gens, c’est-à-dire pour notre argent, et personne n’a le plus petit mot à dire. Ferions-nous mieux de nouer des intrigues ténébreuses presque autorisées par les mœurs et réprouvées par la morale de tous les peuples ? Les maris ont-ils jamais été moins inquiétés qu’aujourd’hui ? Qui pense à chasser sur leurs terres ? Nous ne savons pas un être plus ridicule, dans toute la zoologie, que l’ancien braconnier de l’opéra-comique. Le vieux théâtre avait juché l’amant sur un piédestal dont la cariatide était le mari. Le théâtre contemporain a relevé le mari trompé et a fait de lui le personnage intéressant du drame. Nous ne l’en blâmons pas, quoique au fond cela nous soit bien égal ; mais nous savons par cœur le répertoire de M. Scribe, et ce grand docteur nous a signalé tous les écueils de la passion. Nous sommes des esprits positifs, et nous ne voulons pas repasser, s’il vous plaît, par la ridicule filière des malheurs d’un amant heureux, sauter par les fenêtres, nous enrhumer sous les balcons, étouffer dans une armoire, fuir comme un voleur au premier talon de botte conjugale qui retentit dans l’escalier, et vivre dans des transes perpétuelles. Foin des plaisirs illicites qui coûtent tant de fatigues ! Votre monde de femmes honnêtes est une honnête pépinière d’honnêtes jeunes filles à marier. Le jour où nous voudrons en finir, comme on dit, nous irons lui faire une visite en habit noir et en cravate blanche ; mais, en attendant, nous restons où nous sommes, parce que nous nous y trouvons bien, et si vos moralistes avaient le sens commun, ils nous applaudiraient au lieu de nous blâmer, et les maris, ces ingrats, nous élèveraient des autels. En quel temps la vertu des femmes honnêtes fut-elle plus respectée par la jeunesse ? Est-ce de cela que l’on se plaint ? Nous prétendons, nous, dût cette prétention vous paraître extravagante, ébouriffante et paradoxale, que l’institution du demi-monde a plus fait que tous les traités des philosophes pour le triomphe de la morale publique. »
Voilà ce qu’ils disent, les sophistes ! ils s’abritent effrontément sous le patronage de la morale, et ils vous démontreront quand vous voudrez que Mlle Souris et Mlle Rigolboche ont leur raison d’être et accomplissent une mission. On aura de la peine à croire cependant que c’est l’amour de la vertu qui pousse et retient les jeunes gens d’aujourd’hui dans le monde où ils vont, et l’on sait, à n’en point douter, que c’est le mépris de certaines obligations qui les éloigne du monde où ils ne vont pas ; plus de gêne, plus de politesse, plus d’amabilité, plus de mœurs sociales, voilà le résultat prévu et très prochain de cette émigration de la jeunesse. Je ne parle pas de l’âme qui se déflore au contact de certaines amours, de l’esprit qui s’use au frottement des plaisanteries risquées, des jeux de mots peu vêtus, et sort contrefait de ce moule de conversation où toutes les choses s’appellent parleur vilain nom. Attendez encore quelques années, et si le flot suit le même courant, vous verrez quels fruits portera l’arbre de la génération actuelle, de cette génération aussi bien douée que les précédentes, mais qui a tout sacrifié à trois amours, à trois passions, à trois dieux : le club, l’écurie et le salon interlope.
À ce propos, voici ce que me disait un jour un galant homme de mes amis :
« Vous avez parfois parlé d’une certaine classe de la société parisienne, de ces dames qui s’étalent dans les plus belles loges aux premières représentations et qui, venues au monde sans fortune patrimoniale, achètent les plus beaux attelages, portent les diamants les plus précieux, les étoffes les plus coûteuses, et s’installent dans des mobiliers de cinquante mille écus. Parler de ces dames, c’est fort bien, il n’est plus question que d’elles en haut et en bas, dans le salon et dans la loge du portier ; pourriez-vous me citer, s’il vous plaît, un roman, une nouvelle, une comédie, moins que cela, un vaudeville où la courtisane ne soit pas en scène ? Elle partout, toujours elle ; mais il serait peut-être mieux encore de dire pourquoi elle existe, non plus comme il y a vingt-cinq ou trente ans, à l’état de champignon social, mais comme une conséquence nécessaire de nos mœurs modernes.
– Elle existe aujourd’hui, répondis-je, comme elle existait hier, et sans remonter aux temps fabuleux de la vieille Grèce et de l’ancienne Rome, le XVIIIe siècle…
– Je vous attendais là, interrompit mon homme, vous allez me citer les petites maisons du faubourg Saint-Antoine, les nids galants des oiseaux de cour, et me fournir, sans vous en douter, le meilleur argument à l’appui de ma thèse, car j’ai une thèse. En attendant que je m’explique plus catégoriquement, permettez-moi de vous faire remarquer, en passant, que la petite maison était exclusivement visitée par les grands seigneurs. La noblesse seule y allait, et c’est peut-être pour y avoir été trop souvent que cette même noblesse s’est trouvée si dépourvue quand la bise est venue ; le vent de 1789 a renversé une forêt d’arbres morts.
– Je ne prétends pas le contraire, mais tout cela ne prouve pas que le mal dont vous parliez tout à l’heure soit de date récente.
– Vous n’avez qu’à regarder autour de vous pour être convaincu que s’il n’est pas né d’hier, il fait chaque jour d’immenses progrès. L’exception se généralise, la peuplade est devenue une tribu, la tribu deviendra, si l’on n’y prend garde, une nation. À mon avis, ce n’est pas la jeunesse qui est coupable : que la jeunesse jette sa gourme, c’est peut-être ce qu’elle a de mieux à faire. Moi, j’accuse les grands-parents, pères, mères, oncles, tantes, tous les personnages soi-disant sérieux de la comédie sociale. S’ils n’ont pas engendré le monstre, ce sont eux qui le nourrissent et l’engraissent. Ce sont eux qui lui donnent ces belles robes, ces riches mobiliers, ces diamants sans prix, cette vie opulente et misérable qui fait quelquefois, assure-t-on, le désespoir et l’envie des femmes du monde. Ils ont parlé à leurs enfants le langage de la raison, ces excellents pères de famille ; ils leur ont dit que l’amour est un enfantillage, le sentiment une faiblesse, et ils ont inventé cette magnifique spéculation qui s’appelle le mariage d’argent. Le mariage d’argent a tellement réussi, qu’on n’en connaît plus d’autres aujourd’hui. On n’épouse plus ni un cœur, ni un esprit, ni une femme, on se marie avec une dot. Et c’est l’union des dots qui a créé le demi-monde. Ce monde-là a eu sa raison d’être le jour où le prêtre a béni les serments des deux coffres-forts.
Vous souriez ; écoutez-moi, je ne serai pas long. Vous me parliez tout à l’heure des petites maisons des grands seigneurs du XVIIIe siècle, et, ainsi que je vous le disais, vous me donniez un argument de plus en faveur de ma thèse. La noblesse ruinée restaurait son blason avec l’or de la mésalliance, puis, la restauration accomplie, elle reprenait son train de vie. Quand un gentilhomme épousait une bourgeoise parce qu’elle avait deux cent mille écus, il ne se croyait pas forcé d’aimer une femme qu’il ne connaissait pas, et il allait aimer ailleurs… dans la petite maison. Aujourd’hui, il n’y a plus ou presque plus de blasons à dorer, mais tout le monde veut dorer sa vie. Tout le monde est devenu gentilhomme au point de vue de la dot. La beauté, la grâce, l’éducation, la vertu même, tout cela ne pèse pas une demi-once dans le plateau de la balance conjugale. – Combien a-t-elle ? demande le jeune homme. – Combien a-t-il ? demande la jeune fille ; et, si le chiffre est honnête des deux côtés, voilà deux cœurs épris et une affaire faite. L’affaire a l’air superbe à la première vue, mais en réalité elle est déplorable. Le mari, qui n’avait seulement pas regardé sa femme la veille de son mariage, s’aperçoit le lendemain qu’elle est moins jolie que Mlle X… avec laquelle il a rompu le mois dernier. La femme, qui ne connaissait pas son mari, le trouve peu empressé, peu aimable et beaucoup moins charmant que M. Z… qui lui a fait une petite cour et qu’elle n’a point épousé pour cause d’incompatibilité de dot. Laissez passer quelques mois, et je vous promets que le mari retournera grossir le flot des adorateurs de Mlle X… Votre petite maison du XVIIIe siècle, cachée dans les faubourgs, était une bicoque isolée qu’on ne voyait pas, qu’on soupçonnait à peine, mais le mariage d’argent l’a restaurée, agrandie, embellie, et en a fait un édifice à cinq étages. Aujourd’hui c’est un monument.
Ces dames ne se trompent pas sur les conséquences de ces mariages bâclés ; elles savent que le mariage, tel qu’on le comprend et le pratique de nos jours, est leur principal pourvoyeur ; c’est lui qui leur envoie tous ces maris que l’ennui ou le dégoût chasse de leur foyer. Quant aux jeunes gens, la perspective du ménage s’offre à eux sous un aspect si triste et si froid qu’ils entrent littéralement dans le mariage comme on entrerait en prison : Lasciate ogni speranza.
Les grands-parents seuls semblent ne rien comprendre à ce qui se passe. Il n’y a pas très longtemps, une belle dame vint me voir, qui était, comme vous allez en juger, une excellente mère de famille : « Mon ami, me dit-elle, on m’a assuré que vous connaissiez une riche héritière ; mon fils a vingt-cinq ans, et nous avons en Touraine un château à restaurer et à conserver. – Mais, madame, cette riche héritière n’est pas jolie. – Oh ! Alfred est raisonnable, il ne tient qu’aux qualités solides. – Quatre cent mille francs de qualités solides ; malheureusement elle a un petit caractère… – Oh ! elle se formera. Et puis n’oubliez donc pas que ce château a toujours appartenu à notre famille, et qu’il serait bien triste de le voir passer en d’autres mains… » Et à tout ce que je lui disais pour l’engager à réfléchir avant d’entreprendre les premières démarches, elle me répondait : « Château ! » Ce n’était pas son fils qu’elle mariait, c’était son château, et, en effet, le château est marié à l’heure qu’il est, mais Alfred l’est si peu, que ce n’est pas la peine d’en parler. On ne se doute pas, en France, du rôle important que jouent les châteaux dans les affaires matrimoniales.
Je ne sais si vous êtes converti à mon opinion, mais je suis fermement convaincu que le demi-monde pousse à l’ombre du mariage d’argent comme la mousse à l’ombre des grands arbres. Ceci a engendré cela, et la meilleure preuve que je puisse mettre en avant, est que le demi-monde est inconnu partout où le mariage d’argent n’existe pas. On ne le connaît pas en Angleterre, où les femmes valent encore par leur beauté, leur jeunesse, leur grâce, leurs agréments intellectuels et leurs qualités morales ; on ne le connaît pas non plus en Allemagne, où Charlotte est toujours restée la joie de la maison et l’ange du foyer. On ne le connaît nulle part en un mot où l’arbre de la famille tient au sol par de fortes racines. Le sol de la famille c’est le mariage. Ne vous étonnez donc pas que, chez nous, l’arbre soit si dépouillé, planté sur un sol si pauvre et si pierreux !
Si je ne craignais d’abuser de vos instants, je vous ferais toucher du doigt tous les vices rédhibitoires du mariage d’argent. C’est lui qui a créé le luxe insolent. Toute femme richement dotée est implacable sur le chapitre de la toilette, et je ne trouve pas qu’elle ait tort. Pourquoi ne serait-elle pas aussi richement vêtue que la maîtresse de son mari ? Et puis, dans la zone d’indifférence où elle vit, les chiffons ne sont-ils pas sa seule distraction innocente ? Une robe de mille francs, très échancrée, console de bien des illusions perdues.
Maintenant détournez vos regards de ce tableau, et voyez ce jeune homme et cette jeune femme. Ils se sont placés sous un patronage dédaigné ; ils ont invoqué la déesse antique de l’inclination. Ô imprudence ! Eh bien non ; ils sont heureux. La femme se contente d’une robe de deux cents francs, parce qu’elle aime son mari et qu’elle en est aimée. S’ils ont un jour des enfants, ils en seront respectés. Ceux-là, croyez-moi, ont encore choisi le meilleur lot, et pour peu que vous vouliez réfléchir seulement pendant cinq minutes aux conséquences de la spéculation matrimoniale, vous conviendrez avec spéculation matrimoniale, vous conviendrez avec moi que c’est sur le fumier du mariage d’argent qu’a poussé le champignon du demi-monde. C’est là et non ailleurs qu’il faut aller déterrer la comédie d’aujourd’hui.
– À propos de comédie, ce ne sont pas toujours sur les théâtres que se jouent les comédies les plus intéressantes. Un beau jour une jeune miss arrive à Pau, un jeune homme la voit, et voilà l’amour qui se met de la partie. La jeune fille apprend au jeune homme tous les mots amoureux de la langue de son pays ; puis, quand l’élève sait assez d’anglais pour dire à son professeur : My dear Ellen, I love you