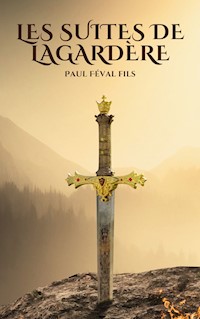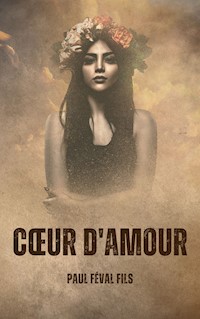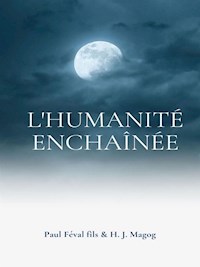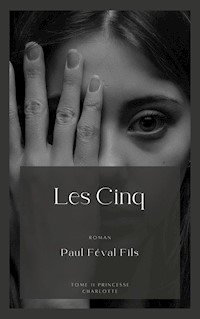
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un titre peu connu, en 2 volumes, de Féval fils, grand feuilletonniste devant l'éternel, en imitation de son père.
Das E-Book Les Cinq wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, romance, AVENTURES, tragédie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Féval Fils
LES CINQ
Tome II – Princesse Charlotte
Le Figaro – 1875
Paris, E. Dentu – 1875
Table des matières
DEUXIÈME PARTIE PRINCESSE CHARLOTTE
I DEMANDE EN MARIAGE
II DEUX BONNES LAMES
III ENTENTE PARFAITE
IV FIANÇAILLES DE M. CHANUT
V LA BERLINE
VI LE CONCIERGE EN CHEF
VII LES TROIS PREMIERS PORTRAITS
VIII LE QUATRIÈME PORTRAIT
IX LE PORTRAIT SANS VISAGE
X OÙ PERNOLA COMMENCE UNE HISTOIRE
XI UNE PARABOLE
XII EXPLICATION
XIII MOYENS LÉGAUX
XIV LA PETITE PORTE
XV CHARLOTTE S’EN VA EN GUERRE
XVI NE SAIS QUAND REVIENDRA
XVII DERRIÈRE LE PAVILLON
XVIII SOUS LES TILLEULS
XIX LA GROTTE
XX LA MORT DE ROLAND
XXI NUMÉRO 1
XXII ENTRE DEUX PORTES
XXIII LE FILS ET LE PÈRE
XXIV LE SCALPEL
XXV LE SCALPEL
XXVI LA GOUTTE DE SANG
XXVII LES TRAVAUX DE SAVTA
XXVIII VILLE-D’AVRAY
XXIX POUR LE BON MOTIF
XXX PORTES CLOSES
XXXI DEUX LETTRES
XXXII MYLORD
XXXIII ÉLECTION DU NUMÉRO 1
XXXIV LA CHAMBRE RONDE
XXXV SECOURS CONTRE L’INCENDIE
XXXVI ANTIQUITÉS
XXXVII TOILETTES DE MYLORD
XXXVIII CE QUE MYLORD VENAIT CHERCHER
XXXIX QUATRE « PRATIQUES »
XL M. MORFIL
XLI TOILETTE DE LA MARQUISE
XLII DERNIÈRE CONSULTATION
XLIII SUPERBE FÊTE
XLIV FROTIN, RENAUD, LAMÈCHE ET LE HOTTEUX
XLV GARDE À CARREAU
XLVI LE GUET-APENS
XLVII LA RAFANETTA
XLVIII MACHINE À TUER
XLIX L’ENGRENAGE
L LE BAISER DE MYLORD
LI ON ORGANISE LE COTILLON
LII TRIBUNAL DE FAMILLE
LIII TRIOMPHE DE MYLORD
LIV LE DERNIER TÉMOIN
LV DESTINS D’UNE CAUSE CÉLÈBRE
Mentions légales
DEUXIÈME PARTIEPRINCESSE CHARLOTTE
IDEMANDE EN MARIAGE
Au contact du doigt mouillé de Laure, Donat, dit Mylord, eut un tressaillement léger, mais il ne s’éveilla pas. La cicatrice était authentique et parfaitement naturelle.
Laure n’avait pas beaucoup de temps à perdre ; nous savons qu’un autre point d’interrogation l’attendait au petit salon où Hély avait introduit M. Vincent, et cependant Laure se laissait aller malgré elle à chercher la solution de ce singulier problème.
Son esprit travaillait. En somme, il y avait là une indication positive. Laure l’admettait, la pesait à sa juste valeur, la discutait de bonne foi, mais n’y croyait pas.
Au bout de quelques minutes, Mylord se mit à sourire et rouvrit ses yeux que le sommeil ne chargeait point.
— Madame, dit-il d’un air goguenard, ma nuque s’engourdit : avez-vous assez regardé ?
— Vous ne dormiez donc pas ? demanda la baronne.
— Non ; je voulais vous laisser la facilité de bien voir.
Il se mit sur son séant et rattacha le bouton de sa chemise en ajoutant :
— Je suis un gentleman. J’apprendrai vite le métier de prince, et la grosse dame qui est ma chère maman pouvait tomber plus mal !
— Quel petit serpent vous faites ! murmura Laure qui avait les yeux baissés.
Mylord sourit orgueilleusement et rétablit avec soin le nœud de sa cravate. Laure continua :
— Je vous avais témoigné beaucoup de confiance, Donat, une confiance absolue.
— C’est-à-dire, madame, que vous comptiez vous servir beaucoup de moi.
— J’avais pour vous une véritable affection…
— C’est-à-dire, traduisit encore l’élève de Jos. Sharp en rougissant pour tout de bon, que vous aviez dirigé vers moi des regards coupables.
Il s’était redressé. La fière sincérité de la vertu éclairait sa prunelle. Laure garda son sérieux.
— Comment se fait-il que vous ayez cassé le vase du grand salon ? demanda-t-elle.
Mylord perdit du coup une notable portion de son arrogance.
— Vous savez, répliqua-t-il d’un air embarrassé, quand on ne connaît pas les êtres… J’ai entendu qu’on venait, je me suis lancé dans l’embrasure. Ce n’est pas la place d’une potiche, soyons juste !
— Vous avez eu du bonheur, de n’être pas découvert, ami Donat !
— Si j’avais été découvert, vous n’étiez que deux femmes et je suis toujours armé.
— Est-ce que vous nous auriez tuées ? s’écria Laure.
— Je ne savais pas encore que la grosse lady était ma mère, répondit Mylord. D’ailleurs, j’appartiens à une école, et il y a les principes. Pour chaque cas donné, la théorie fournit la pratique à suivre. Je n’en suis pas à mon coup d’essai, madame.
— Vous avez déjà tué ? dit Laure qui baissa la voix malgré elle.
— Trois fois, repartit Mylord, et la première…
Il n’acheva pas. Vous eussiez dit qu’une main mystérieuse étranglait la fanfaronnade dans sa gorge.
Assurément, la belle baronne n’en était pas non plus à son coup d’essai. Il est probable même qu’au jeu du mal, elle eût rendu bien des points au disciple de Jos. Sharp. Et pourtant, cet étrange compagnon lui faisait froid.
Il y avait pour elle quelque chose de redoutable dans cette créature hybride qui semblait faite de contrastes : enfant et vieillard à la fois, naïf et rusé, amalgamant la pudeur et l’effronterie, plein de gaucheries, mais adroit comme un prestidigitateur, assassin effrayé par un péché véniel, rangé, formaliste, bohémien capable de tout excepté d’un bon mouvement, presque beau garçon quoique contrefait, comique avec gravité, cagot frotté d’athéisme et sinistre sous sa douceur comme un couteau de table qui tuerait entre les repas !
Ces animaux-là peuvent naître n’importe où, mais le dressage ne s’en fait qu’en Amérique ou en Angleterre.
— La première fois ?… répéta Laure.
Mylord la regarda de travers et répondit sèchement :
— Je ne suis pas ici à confesse.
— C’est juste, dit la baronne ; seulement, mon cher garçon, je vous ferai observer que vous avez mal récompensé ma confiance. Avec les autres, j’ai gardé mon masque, tandis que je vous introduisais dans ma propre maison…
— À combien évaluez-vous le bien de cette marquise ? interrompit Mylord.
Mme de Vaudré s’assit auprès de lui sur le divan et il se recula aussitôt d’un mouvement plein de pruderie.
— Vous ne répondez pas ? dit-il.
— Qu’est-ce que cela vous fait ? demanda Laure.
— Puisque je suis l’héritier…
— En êtes-vous bien sûr ?
Elle le regardait en dessous.
— Faut-il ôter de nouveau ma cravate ? dit-il d’un air résigné.
— Non. Peut-être savais-je d’avance ce qu’il y a dessous. Peut-être même avais-je l’intention de m’en servir, mais, dans une association, il ne peut y avoir deux maîtres.
— C’est clair : je suis le maître.
— Je crois plutôt que vous êtes un employé congédié. Vous ne faites plus partie de l’association, Donat.
— Passez-vous donc de moi ! s’écria Mylord. Je vous en défie !
— Nous essayerons, dit la baronne.
En même temps, elle voulut se lever, mais les doigts de Mylord s’étaient refermés sur son poignet. Leurs yeux se heurtèrent. Laure l’examinait curieusement. Elle était brave. À la première lueur de menace qui s’alluma dans la prunelle de Mylord, elle dit froidement :
— Connaissez-vous M. Chanut ?
Les paupières de Mylord eurent un frémissement.
— Moi, je le connais très-peu, poursuivit Laure. C’est aujourd’hui sa première visite. Il m’attend de l’autre côté de cette porte, et vous m’excuserez si j’abrège notre entrevue.
Mylord lâcha son poignet. Laure reprit :
— Je ne voudrais pas le faire attendre : c’est un homme à ménager. Vous savez, je ne vous en veux pas du tout pour votre manque de galanterie, ajouta-t-elle en agitant sa main qui portait une légère trace de pression. Le respectable docteur Jos. Sharp n’a pu vous enseigner les usages du monde parisien qu’il ne connaissait pas. Je vous pardonne aussi l’accident arrivé à mon vase et l’indiscrète curiosité qui l’a produit. Quand je vous ai ouvert ma porte, je savais bien que je n’introduisais pas chez moi un modèle de délicatesse…
— Madame, interrompit Mylord piteusement, je suis un gentleman !
— Certes, certes, un parfait gentleman… Y a-t-il longtemps que vous n’avez vu votre mère ?
— Je viens de la voir pour la première fois, madame, et je sens que je l’aimerai.
— Pas celle-là, mon camarade, l’autre ; celle qui vous accusera un jour d’avoir retiré l’échelle…
— Madame !… balbutia Mylord épouvanté.
— Votre père en mourut, ami Donat, et c’est cela que vous n’osiez pas dire tout à l’heure.
Mylord baissa la tête franchement.
— Parfait ! dit Mme de Vaudré. Je reconnais là mon sauvage. Jamais les Iroquois ne continuent la bataille une fois qu’ils sont découverts. Vous aviez cru que vous pouviez vous passer de nos associés, ce qui est, en effet, possible, et même de moi, ce qui est absurde. Mon camarade, vous êtes un jeune serrurier de beaucoup de mérite, mais pour faire un prince, avec cela il faudrait…
— Il ne faudrait que votre volonté, madame, interrompit Mylord en relevant sur elle son regard grave et soumis.
— C’est exactement vrai, dit Laure, et même votre audacieux abus de confiance, le Post-Scriptum ajouté par vous à la lettre que je vous avais confiée, nous aiderait positivement dans cette voie… mais, malheureusement, la place est prise.
— Par qui ?
— Par le vrai fils de Sampierre.
— Où est-il ?
— Dans ma main.
— Qui est-il ?
— Votre associé et votre maître.
— C’est lui le n° 1 ! prononça tout bas Mylord.
La baronne souriait. Mylord était sombre comme la nuit. Il semblait réfléchir profondément.
— C’est bien, reprit-il, je le tuerai ; j’en ai le droit puisqu’il me prend ce qui est à moi. Le vrai Sampierre est mort ; vous avez fabriqué celui-là, et il doit être mieux réussi que moi, car il n’y a rien de si adroit ni de si habile que vous. La femme est la coupe de perdition ! La femme est le serpent, source de tout venin ! La femme est le courtier infatigable qui voyage pour le compte de l’enfer ! La femme…
Il s’arrêta pour reprendre haleine. Il parlait avec une animation extraordinaire. Ses lèvres fiévreuses tremblaient. Quelque chose d’inouï s’agitait dans ce cerveau baroque où la tempête couvait toujours sous l’apparence du calme plat.
Laure se tenait sur ses gardes et elle avait raison, car elle allait subir une rude attaque.
— La femme, reprit Mylord en fermant les poings, est la pierre d’achoppement spirituel, la tentation, la damnation ! Je hais la femme. Jos. Sharp m’avait dit : « Tout est permis excepté la femme ! » il avait raison, mais il ajoutait : « À moins que ce ne soit pour affaires. » Il avait tort !… Écoutez-moi bien ! je suis jeune, j’ai des talents, de la conduite et des agréments personnels. Le léger défaut de symétrie qui incline ma tête n’a rien de répugnant puisqu’il provient d’une blessure. Je possède encore la fleur de ma candeur, je le jure ! Je puis vous sacrifier tout cela si vous voulez mettre de côté le n° 1 et me donner sa place.
Il fixait sur la charmante baronne un regard mendiant, tout plein d’une étrange passion, mais plus froid que la glace : regard de Shylock adolescent qui dévore le bénéfice d’un marché.
Ce regard, Mme de Vaudré l’accueillait, l’enveloppait dans le plus coquet de ses sourires et « jouait avec », pour employer la formule vulgaire qui est académique chez nos voisins les Anglais.
— Est-ce que vous m’aimeriez, Donat ? dit-elle doucement.
Il fut un peu étonné. Le mot lui parut vif et surtout étranger à la question.
— Dans la purification du troisième ordre, répliqua-t-il, le célibat est recommandé comme supériorité d’état, mais le mariage n’est pas défendu. C’est ce qu’on nomme la tolérance du péché d’alliance, et le saint Nicholas Daws admet les excuses fondées sur l’intérêt sérieux. Que serait une religion qui entraverait les affaires ?
— Un non-sens, répondit Laure… Vous m’intéressez beaucoup, Donat.
Mylord avait quelques gouttes de sueur sous les cheveux.
— Je consentirais donc, poursuivit-il, à contracter mariage avec vous, et alors vous partageriez légalement tous les avantages de ma nouvelle position, aussitôt que je serais reconnu en qualité d’héritier unique des familles de Sampierre et Paléologue. Je pense que ce serait un joli parti pour vous.
— Et que deviendrait le numéro 1 ?
— Je me chargerais de tout ce qui le concerne.
Laure songeait.
— Donat, dit-elle après un silence, vous allez monter en voiture sur-le-champ et vous rendre à ma maison de Ville-d’Avray. Vous y trouverez les nos 2 et 3… et d’autres encore. Soyez discret et que votre obéissance me fasse oublier vos péchés. Votre proposition est raisonnable, je demande le temps d’y réfléchir.
— Réfléchirez-vous longtemps, madame ?
Du revers de ses doigts, Laure lui effleura la joue.
— Quel amoureux ! dit-elle. Un peu de patience : cette nuit verra du nouveau… allez, Donat, je vous aurai rejoint dans une heure.
IIDEUX BONNES LAMES
Vincent Chanut était de ces hommes qui ne s’ennuient jamais. Pour passer son temps agréablement, il n’avait pas même besoin des Sept parfums du sanctuaire, ni du Jardin de la controverse ; ses petits papiers lui suffisaient, il portait sa joie dans sa poche, et, dès qu’il avait une minute, il égrenait son chapelet d’informations avec un plaisir toujours nouveau.
Ils sont rares, les heureux qui réalisent pour leur propre usage les poétiques imaginations de Charles Fourrier, ce vaste génie, si mal connu, dont la formule appliquée mettrait fin tout d’un coup aux misérables agitations de notre siècle. Chaque créature humaine, dit-il, a sa vocation et chaque vocation a sa créature : cela ressort de la toute-sagesse de Dieu. Il ne s’agirait donc que de trier parmi les grandes dames celles qui ont des instincts de cuisinières et parmi les cochers ceux qui se résigneraient à être ducs. C’est une affaire de soins. Et une fois que tout Belleville serait inscrit à la Salle des croisades, le monde irait, soyez certains de cela.
M. Chanut était né policier, comme le grand Condé, général d’armée. Il avait eu son Rocroy aux environs de ses dix-huit ans, ainsi que nous avons déjà pu le dire et, déjà revêtu de la dignité d’agent auxiliaire (n° 17), il s’était promené dans les dessous de notre histoire dès le temps où elle déroulait ses premières scènes à l’hôtel Paléologue.
Depuis lors, à l’exemple de tous ceux de son métier, il avait été mêlé à une innombrable quantité d’aventures publiques et privées où son sang-froid professionnel coudoyait toutes sortes de passions, où son paisible caractère passait à travers les drames les plus violents, où son honnêteté, j’allais dire sa candeur, vivait de pair à compagnon avec le crime.
La salamandre est au frais dans le feu. M. Chanut savait, assurément, le monde sur le bout du doigt, et, mieux que n’importe quel romancier ; mais c’était une science d’État, et qui ne tirait les conséquences, ni en long, ni en large. Il était limier par instinct, en dehors de toute philosophie. Il ne croyait pas aux calculs déductionnistes des charlatans américains et anglais qui essayent d’idéaliser la détection, et de remplacer le témoignage des sens par des probabilités algébriques.
Sans mépriser le raisonnement, il allait vers les faits. Sa force était dans sa mémoire.
La veille, nous nous en souvenons, Vincent Chanut s’était promis de placer capitaine Blunt en face de la française, dont le portrait avait fait naître chez le frère du vicomte Jean une si profonde émotion.
Depuis ce moment-là, l’ancien inspecteur avait travaillé sans relâche. Il était content de lui-même, et pensait être armé de toutes pièces. L’Observation est aussi une science exacte ; M. Chanut arrivait chez Laure sûr de son fait, comme Herschel lorsqu’il agrandissait le télescope pour fouiller le vide apparent où il devinait sa planète invisible.
En entrant, M. Chanut s’était dit : « Voilà la tanière, la bête est là, prenons l’affût. »
L’extrême décence de la maison ne l’inquiétait point, l’air ultra respectable de la vertueuse Hély ne lui inspirait aucun doute. Une fois assis au petit salon, et malgré la longueur de l’attente, il n’eut pas une minute d’impatience entre ses réflexions et ses petits papiers. Mme la baronne de Vaudré était « la Française » voilà le fait acquis : la porte, en s’ouvrant tôt ou tard, allait lui montrer l’original de la miniature laissée par l’ancien chercheur d’or, Arregui.
La porte s’ouvrit. Il a été donné à chacun de vous, sans doute, d’admirer, au moins une fois en sa vie, une vraie comédienne. Je dis ceci par politesse et pour ne froisser personne, car elles sont rares. Celles de théâtre (il y en a de magnifiques) ont à leur disposition des moyens matériels que l’art du costumier, l’art du coiffeur et l’art du peintre sur peau, combinés avec l’éclairage d’une part, avec l’éloignement perspectif de l’autre, peuvent pousser jusqu’à la toute-puissance.
Nous ne parlons pas ici de celles-là, mais bien des autres qui ne montent pas sur les planches : de celles qui jouent leur rôle à bout portant, sous la lumière du soleil, et qui n’ont d’autre ressource que leur génie.
Quand Laure entra, la bonne Domenica aurait vainement cherché en elle « sa chérie », la gracieuse femme toute brillante de charme et de jeunesse dont nous avons pu dire en toute vérité qu’elle se donnait trente ans, mais qu’elle n’en paraissait pas vingt-cinq. Par un coup de baguette, le portrait de Mme L. de V., si remarqué au dernier Salon, était devenu un effronté mensonge, et quant à la miniature d’Arregui, il n’en fallait même pas parler.
Et pourtant, Arregui avait dit : « C’est ressemblant comme deux gouttes d’eau, vous la reconnaîtrez entre mille ! »
On peut affirmer que Vincent Chanut en avait vu bien d’autres, et cependant, au premier moment, l’idée lui vint que Mme la baronne, craignant de se montrer à lui, s’était fait remplacer par quelque dame de confiance, encore plus « convenable » et mieux confite en méthodisme que l’austère Hély.
C’était du reste le même genre qu’Hély : une brebis du saint Nicolas Daws, mais d’un étage évidemment supérieur, parvenue au quatrième, ou même au cinquième ordre de purification.
Comment cette métamorphose s’était-elle produite ? Il n’y avait aucun changement appréciable dans la toilette décrite par nous au début de l’entrevue de ce matin, entre Domenica et sa belle petite ; la coiffure seule avait été refaite à la hâte et sans aucune affectation d’austérité. On n’avait même pas ajouté de bonnet pour rendre le front maussade, ni de guimpe pour crier : « Voyez jusqu’où monte ma pudeur ! »
Il n’y avait rien par le fait, sinon la comédienne elle-même et son prodigieux mérite. Sa volonté la transformait dans une mesure très-large, mais en même temps très-sobre, sans invraisemblance ni choc, par la simple suppression des prestiges qui étaient le fruit de son art, aidé par l’étrange et longue complicité de la nature. Elle était belle à cette heure comme le sont les belles femmes ayant passé quarante ans, tristes de leur jeunesse perdue, et réfugiées aux étages les plus inaccessibles du sérieux.
Elle salua M. Chanut avec une bienveillance grave et l’invita du geste à se rasseoir en disant :
— Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre.
— C’est bien à madame la baronne de Vaudré que j’ai l’honneur de parler ? demanda Vincent Chanut respectueusement.
— Oui, répondit Laure qui s’assit à son tour.
Elle tira de sa poche la carte de Vincent, qu’elle relut attentivement, puis elle releva sur lui son regard.
— Tout d’abord, dit-elle, je vous remercie de l’empressement que vous avez bien voulu mettre à répondre à mon appel. C’est ce matin seulement que je vous ai écrit…
— Permettez, interrompit Chanut, je n’ai pas eu l’honneur de recevoir votre lettre.
Laure examina de nouveau la carte et laissa paraître une nuance d’embarras sur son visage.
— Les deux noms qui sont là, murmura-t-elle : Laura-Maria et Tréglave, se trouvaient également dans ma lettre ; cela m’a fait croire que vous étiez le célèbre M. Chanut.
On peut trouver des gens qui ne boivent jamais entre leurs repas, il y en a même encore quelques-uns pour résister à la contagion du cigare, mais je n’ai jamais rencontré celui qui refuse un petit verre de gloire. Vincent eut un sourire entre cuir et chair.
— Bien pauvre célébrité, madame la baronne, répondit-il, mais enfin, telle qu’elle est, je ne puis la renier : Je suis l’ancien inspecteur Chanut, et si je n’ai pas écrit mon nom tout entier sur ma carte, c’est que, généralement, la célébrité dont nous parlons ici, ferme pour moi plus de portes qu’elle n’en ouvre. Quant aux deux autres noms, Laura-Maria et Tréglave, en les inscrivant sur ma carte, je n’ai fait qu’obéir aux ordres exprès de mon client.
— Celui qui vous envoie vers moi ?
— Oui, madame la baronne.
— Alors, monsieur Chanut, au lieu de vous interroger comme je l’espérais, c’est moi qui vais subir un interrogatoire ?
— Madame, je vous prie de remarquer que je suis dépourvu de tout caractère officiel. Je gagne mon pain en dehors de l’administration, et, je puis le dire, sous l’œil très-sévèrement ouvert de l’administration. Je n’interroge pas, je m’informe. La bonne volonté seule me répond. J’ajoute que me voici tout porté pour prendre vos ordres, au cas où il vous conviendrait de m’accorder votre confiance. Comme je ne venais pas ici en adversaire, rien ne me défend (du moins, jusqu’à plus ample informé) de prendre en main vos intérêts. Je tiens boutique.
Laure tournait et retournait la carte entre ses doigts.
— Qui va commencer ? demanda-t-elle tout à coup.
— Vous, si vous voulez ; moi, si vous le désirez, répliqua M. Chanut : À votre volonté.
Laure hésita pendant le quart d’une minute.
— Il y a ici, dit-elle, en chiffonnant le carton qu’elle tenait à la main, une chose très-extraordinaire : « De la part du vicomte Jean de Tréglave. » Ma croyance est que le vicomte Jean est mort.
— Un mort peut laisser des instructions, repartit Vincent, et alors le mandataire du mort parle régulièrement en son nom.
— Êtes-vous donc le mandataire de feu le vicomte Jean ?
— Non, madame.
— Pouvez-vous me nommer votre mandant ?
M. Chanut salua, et répondit :
— Envers nos clients, madame la baronne, le premier de tous nos devoirs est la discrétion.
— C’est juste, fit Laure. M’est-il au moins permis de vous demander pourquoi votre note porte cette double mention : « À Laura-Maria. »
— Parce que, répliqua Vincent, celui qui m’envoie vers vous ne connaît pas Mme la baronne de Vaudré.
— Et il connaissait Laura-Maria ?
— Oui, madame.
— Et il prend Mme la baronne de Vaudré pour Laura-Maria ?
Cette dernière question, prononcée à voix basse, fut accompagnée d’un pâle et triste sourire.
Vincent Chanut s’inclina en signe d’affirmation.
C’était un assaut de premier ordre : deux joûteurs, engageant le fer avec une prudence consommée et une science parfaite. Laure venait de marquer la première feinte. Chanut tenait sa garde comme s’il n’eût pas même soupçonné le coup.
L’ardente curiosité éveillée en lui par la dernière parole de Laure n’alluma rien dans la fixité paisible de sa prunelle.
— Moi, reprit la baronne en changeant de main, dans ma lettre que vous n’avez pas encore lue, je vous parlais aussi de Laura-Maria et de M. de Tréglave, mais ce n’était pas du vicomte Jean… Avez-vous rencontré Mme de Sampierre à la porte de chez moi, tout à l’heure ?
— J’ai cru reconnaître madame la marquise.
— C’est pour elle… j’entends, c’est dans son intérêt que j’ai eu la pensée de m’adresser à vous. Nous cherchions un homme à la fois très-honnête et très-habile…
Laure s’arrêta, M. Chanut salua :
— Ma sœur était bien plus parisienne que moi, reprit Laure, c’est peut-être elle qui m’avait parlé de vous dans le temps.
— Dois-je comprendre, dit Vincent, que madame la baronne est seulement la sœur de Laura-Maria ?
— Seulement ! répéta Laure avec un soupir, n’est-ce pas assez ?… Il n’en faut pas davantage pour gâter une existence, monsieur Chanut… mais nous allons revenir à tout cela. Veuillez m’apprendre le motif de votre visite.
— Volontiers… J’ai mes notes.
M. Chanut mania ses papiers comme un jeu de cartes et dit :
— C’est un simple renseignement et qui ne vous prendra pas une minute. Voici la note. Je suis chargé de vous demander… mais si vous n’êtes pas Laura-Maria, je suppose que ma démarche va rester sans résultat. Enfin, n’importe. Je suis chargé de vous demander si vous connaissez ou si vous avez les moyens de connaître le sort final du nommé Arregui (Antonio-Jose), Mexicain de naissance, âgé de quarante-cinq ans environ, taille un mètre quatre-vingts centimètres, brun, cicatrice légère au-dessus de l’œil droit ; parti de New-York pour la France en octobre 1866, avec l’intention hautement exprimée de rejoindre à Paris une dame qu’il désignait (peut-être indûment) sous les noms de Maria Strozzi et aussi Laura-Maria et dont (je parle dudit Arregui) on n’a pas eu de nouvelles depuis le 21 avril 1867, présente année.
IIIENTENTE PARFAITE
M. Chanut avait défilé ce chapelet d’indications la tête penchée sur sa note qu’il consultait en parlant. Quand il se redressa pour regarder Laure, il vit qu’elle avait des larmes plein les yeux.
— Madame, dit-il, je vous répète que je n’ai absolument aucun droit légal vis-à-vis de vous. Il vous est loisible de laisser ma question sans réponse, et je vous demande pardon…
Elle l’arrêta d’un geste.
— Il y a quelque chose de plus fort que le droit, murmura-t-elle, c’est la nécessité. Je ne refuse pas de vous répondre : je ne peux pas vous refuser. Entre la question que vous me posez et celle que je vais vous adresser moi-même, il existe je ne sais quelle connexité qui mêle évidemment nos intérêts. Aussi, tout ce que je sais, vous allez le savoir ; mais j’ai beau faire, je ne puis garder l’apparence de la résignation quand on me parle de cette malheureuse, de cette chère créature qui a été la douleur de toute mon existence.
Elle porta son mouchoir à ses yeux et continua d’une voix profondément émue :
— Maria ! ma sœur ! celle qui fut un jour la joie angélique du foyer de notre mère ! Je la vois encore, malgré les ans écoulés, je vois son sourire brillant et si doux, j’entends sa chanson chérie ! Mon Dieu ! comme nous l’aimions ! Quand notre mère mourut, j’étais la plus âgée et je gagnais déjà ma vie à instruire les enfants d’une famille américaine. Ma sœur, qui était restée en Europe, tomba sous la tutelle du frère de mon père, le docteur Strozzi…
La physionomie placide de M. Chanut s’épanouit. Laure s’interrompit pour dire :
— Vous savez ces choses peut-être aussi bien que moi, peut-être mieux : j’en suis contente. Cela vous met à même de voir à quel point ma bonne volonté est sincère. Le docteur Strozzi, sans respect pour le nom qu’il portait comme nous, dressa ma sœur au métier de somnambule. Il alla plus loin…
— Madame la baronne, interrompit Chanut avec bonté, vous vous imposez une souffrance inutile. Je cherche un renseignement sur Antonio Arregui, voilà tout.
— Et moi, s’écria Laure, je cherche un renseignement sur ma sœur, et sur une chère enfant qui m’intéresse encore plus que ma sœur, car je suis seule ici-bas, et il me semble que je serais sauvée si j’avais à protéger, à aimer le seul être qui ait dans ses veines une goutte du sang de mes aïeux ! Je vous l’ai dit : votre route et la mienne se côtoient ; elles se rejoignent. Si le docteur Strozzi fut le mauvais génie de ma sœur, un Tréglave, Laurent de Tréglave, faillit la relever au rang d’où jamais elle n’aurait dû déchoir. Maria aimait Laurent, mais la fatalité se mit entre elle et lui. Il y eut un crime hideux : l’oncle abusa de sa nièce, et Maria écrivit, un jour, à Laurent : « Je suis morte pour vous… »
— Cela nous mène-t-il à Arregui ? demanda M. Chanut doucement.
— Tout droit. Maria traversa la mer et alors commença pour elle une vie d’aventures. Je la vis à son passage à New-York ; comme elle était changée, mon Dieu ! Je voulus la retenir, mais elle allait à son destin. Elle avait appris que les deux frères de Tréglave étaient au pays d’or. Une force irrésistible l’y entraînait… Que vous dire !
» Après avoir été victime, fut-elle coupable ?
» Cet Arregui devint son maître. Un jour, au désert, elle risqua sa vie, mais en vain, pour sauver celle du vicomte Jean, le frère de Laurent, que les compagnons d’Arregui avaient condamné à mort…
La baronne s’arrêta. M. Chanut la couvrait d’un regard placide.
C’est la troisième fois que nous voyons revenir cette histoire qui nous fut contée d’abord par M. Chanut lui-même chez le capitaine Blunt.
Pour sa part, cette belle Laure nous en a fourni déjà deux versions dissemblables, dans chacune desquelles un atome de vérité se mêlait à des flots de mensonges.
Elle reprit :
— Le reste se peut dire en deux mots. Dans l’intervalle, je m’étais mariée et j’étais devenue veuve. Maria, prise d’horreur pour son passé, se réfugia près de moi à Paris ; elle se croyait bien cachée, mais cet Antonio Arregui trouva sa trace, et Maria s’enfuit.
— Connaissez-vous sa retraite ?
— Je désire la connaître. Nous la chercherons ensemble. Quant à Antonio Arregui, je sais qu’il est retourné en Amérique.
— Ah ! fit M. Chanut.
Laure ajouta :
— Il m’a écrit de San-Francisco.
Vincent rassembla aussitôt ses papiers et les remit dans sa poche, d’où il tira un volumineux calepin, lequel gardait à peine quelques pages blanches. Vincent choisit une de ces pages, mouilla sa mine de plomb, la suspendit en arrêt et dit :
— Madame la baronne, j’ai l’honneur de vous remercier. Veuillez me donner vos ordres, je vais prendre mes notes pendant que vous parlerez.
Depuis quelques minutes, Laure l’examinait avait un redoublement d’attention. Ce brave Vincent avait quand il voulait le plus parfait visage de bois qui se puisse imaginer. Nous ne dirons pas que sa physionomie exprimait la crédulité ; non, il avait tout uniment dans les yeux cette indifférence parfaite de l’observateur par état qui a fait sa question, qui a reçu sa réponse et qui dort là-dessus.
Laure interrogea la pendule qui marquait deux heures et demie.
— Je serai brève, dit-elle, le temps me presse désormais… Vous permettez ?
Elle sonna, Hély se montra et reçut l’ordre de faire atteler sur-le-champ, après quoi Laure reprit :
— Il y a deux choses très distinctes : d’abord l’affaire de madame la marquise dont je vous parlais aussi dans ma lettre. Je n’ai pas à vous expliquer le problème qu’on veut résoudre à l’hôtel de Sampierre, Paris tout entier le connaît.
Il a été fait, on peut le dire, des efforts immenses, mais très mal dirigés et qui ont abouti à néant. La seule indication féconde a été fournie par Maria, ma pauvre sœur : Domenico de Sampierre existait en septembre 1862 ; il était aux mains de Laurent, cadet de Tréglave, et tout porte à croire qu’à cette époque ils ont tous les deux changé de nom.
M. Chanut écrivait, Laure continua :
— Je suis autorisée à vous dire que si vous trouviez la trace de M. de Tréglave et du jeune comte Domenico, vous seriez riche.
— Ce qui signifie en chiffres ? demanda Chanut.
— Je garantis une somme de cinquante mille francs et vous pouvez marchander.
— En vingt ans, dit Chanut, j’ai mis de côté à peu près douze cents francs de rentes ; vous jugez si je vais faire de mon mieux… m’est-il permis de glisser un petit erratum ? J’ai omis tout à l’heure d’aborder un sujet assez délicat, et pour lequel je vous demande toute votre indulgence. Au temps où décéda le vieux prince Michel Paléologue, il fut dit que cette jeune Maria Strozzi avait essayé en vain de faire valoir certains droits, fort réels, mais non reconnus par la loi…
— Monsieur Chanut, interrompit Laure avec une fierté austère, je vous ai livré le passé de ma sœur, mais tenez-vous ceci pour dit : en toute ma vie, je n’ai connu qu’une vraie sainte, c’est ma mère. Ni Maria, ni moi, nous n’avons aucun droit d’aucune sorte à l’héritage d’autrui.
— Cependant, voulut insister Vincent, un souvenir qui m’est personnel…
Laure l’arrêta encore, disant :
— Je vous rappelle que le docteur Strozzi avait fait de ma sœur son esclave et que les gens comme lui sont capables de toutes les supercheries.
Vincent se tut et reprit son carnet. Laure poursuivit :
— Pour ce qui regarde mon affaire privée, celle qui m’avait principalement donné le désir d’entrer en relations avec vous, ma modeste aisance est hors de toute proportion avec l’opulence de la princesse marquise : je vous offre vingt-cinq louis pour vous mettre en campagne et trois mille francs si vous réussissez.
— À quoi ? demanda Chanut. Précisons la besogne.
— Elle est malaisée, je le crois, dit Laure qui, malgré toute son habileté, ne put dissimuler un embarras léger. Le temps écoulé est si long ! Il y a dix-huit ans, quand ma sœur quitta la France pour la première fois, elle laissait derrière elle un enfant.
— De quel sexe ?
— Une petite fille.
— À Paris ?
— Non. L’enfant était en nourrice dans le pays de notre famille, chez une paysanne des Hautes-Pyrénées aux environs d’Argelès.
— Avez-vous le nom de cette paysanne ?
— À cet égard, dit Laure en lui tendant un papier, voici toutes les indications que vous pouvez souhaiter.
M. Chanut jeta un regard sur la note et demanda :
— Y a-t-il eu des démarches de faites ?
— Oui, plusieurs.
— Ont-elles eu un résultat ?
— Un mauvais résultat. La paysanne vit encore, mais elle refuse tout renseignement. Ses voisins disent qu’une dame, une étrangère, vint la voir vers l’année 1851, et lui donna beaucoup d’argent pour avoir la petite fille…
— Et cette dame avait nom ?
— Seule, la nourrice pourrait la faire connaître.
— Est-ce tout ?
— C’est malheureusement tout.
M. Chanut ferma son calepin.
— On peut essayer, dit-il.
Laure se leva. Sa joue, tout à l’heure, si pâle, avait du sang sous la peau. Elle tendit à M. Chanut un billet de cinq cents francs que celui-ci mit dans sa poche.
— Monsieur, dit-elle, désespérant de cacher son émotion et tâchant du moins de l’expliquer, j’ai confiance absolue en votre habileté. Cette enfant est ma nièce et vous savez que je suis seule… horriblement seule ! Je mets entre vos mains le dernier espoir de ma vie. Je l’adopterais, elle serait ma fille, et ma reconnaissance ne se bornerait pas à remplir l’engagement que je viens de prendre envers vous.
Chanut s’était levé à son tour et Laure avait fait un pas déjà pour le reconduire vers la porte.
— De mon habileté, répliqua-t-il bonnement, je ne peux rien dire ; je réponds seulement de mon zèle. J’ai envie de vous faire une dernière question, madame la baronne.
— Faites, dit Laure.
Il s’était arrêté en la regardant fixement.
— Ou plutôt, continua-t-il, de vous adresser une humble requête. Vous êtes à même de me rendre un service.
— Parlez.
— Un grand service. Mon client, celui de mes clients qui m’a envoyé vers vous, ambitionne l’honneur de vous être présenté.
— Eh bien ! qu’il vienne dit Laure en souriant. Est-ce là ce grand service !… Comment l’appelez-vous, le client ?
— Voilà précisément où le bât nous blesse, répliqua Vincent : je n’ai pas mission de vous révéler son nom.
Le sourire de Laure disparut.
— C’est singulier ! dit-elle.
— Si singulier, reprit M. Chanut, que je n’osais pas risquer ma pétition.
Ils étaient debout en face l’un de l’autre. Vous eussiez mis une couronne de rosière sur le front de M. Chanut, tant il avait l’air innocent. Quant à Laure, sa physionomie n’exprimait que l’étonnement frivole d’une femme du monde se heurtant à « quelque chose qui ne se fait pas. »
C’était ici l’apparence. Le vrai, c’est que les deux champions jouaient la belle qui termine régulièrement tout assaut d’armes. Leurs fers croisés se touchaient, se croisaient et frémissaient.
— Mon cher monsieur Chanut, dit Laure avec bonhomie, je ne suis pas une bien grande dame, et je puis mettre de côté l’étiquette, pour une fois. Je recevrai votre anonyme quand vous voudrez.
— Ce soir ? demanda M. Chanut.
Laure se mit à rire.
— Peste ! fit-elle, vous ne perdez pas de temps ! Ce soir, je ne m’appartiens pas, mais demain…
— Demain donc, madame la baronne, dit Vincent qui passa la porte, et veuillez accepter tous mes remerciements bien sincères.
IVFIANÇAILLES DE M. CHANUT
Mme la baronne était réellement très-pressée ; car elle avait une longue route à faire. Cependant, elle resta immobile, et les sourcils froncés, devant la porte refermée par où M. Chanut venait de s’éloigner. Il y avait des rides à son front, et les sourcils rapprochés disaient le travail de sa pensée.
— Il m’a entamée ! murmura-t-elle, et je n’ai rien tiré de lui !
Hély entr’ouvrit la porte, annonçant que la voiture attendait. Laure la renvoya d’un geste.
— Demain ! dit-elle encore. C’est le dernier acte du drame, je sens cela. Qui sait ce qui se passera d’ici à demain ? Pourquoi ai-je peur ? Ce nom d’Arregui a-t-il été prononcé au hasard ? ou bien quelque fantôme va-t-il sortir de terre ?
Elle secoua la tête brusquement.
— Il y a loin jusqu’à demain, fit-elle, et la partie doit être jouée cette nuit !
Elle alla rejoindre Hély qui lui dit en drapant le mantelet de soie sur ses épaules :
— Je m’y connais : madame la baronne vient de recevoir quelque heureuse nouvelle.
Laure répondit :
— On ne peut rien vous cacher, ma bonne ! Je suis, en effet, toute joyeuse. Prenez votre liberté jusqu’à ce soir, je reviendrai m’habiller pour le bal de l’hôtel de Sampierre.
— Ma liberté ! repartit Hély non sans une pointe de reproche, madame la baronne sait bien que je n’ai qu’une joie : nourrir mon esprit par la lecture et la méditation…
Laure descendait déjà l’escalier. Quand elle franchit la porte cochère, demi couchée gracieusement dans sa voiture découverte, elle éblouissait de jeunesse et de beauté.
Hély, demeurée seule, procéda sans retard à la nourriture de son âme. Dans la purification consolidée et concentrée, elles savent toutes préparer le Holy-Rod ou Rosée céleste. C’est un julep rafraîchissant qui se fait avec du madère, du sucre, de la cannelle, du romarin, un clou de girofle, une pincée de poivre et du genièvre qu’on peut remplacer par une pinte de rhum. Les « piliers dans Israël » ont de l’amitié pour ce breuvage ; il les porte à la méditation.
Pendant que la casserole chauffait, Hély suspendit une serviette à l’appui de la croisée. Si c’était un signal, soyez sûrs qu’il ne pouvait appeler que les anges.
Il en vint un qui appartenait au train d’artillerie.
La rue Saint-Guillaume, comme on sait, donne par son encoignure sur un passage muni d’une grille et nommé la rue Neuve de l’Université.
En dedans du passage, un fiacre, attelé de deux grands vieux chevaux, stationnait. Il semblait vide, les portières en étaient ouvertes.
Sur le seuil de l’allée voisine, un brave homme en manches de chemise fumait sa pipe paisiblement.
Quand Laure passa, dans sa voiture, elle jeta au fiacre un rapide regard. Elle se dressa même à demi pour plonger de plus haut et put constater que l’une et l’autre banquettes étaient inoccupées.
Évidemment, elle s’était attendue à découvrir quelqu’un dans ce fiacre.
Et, bien qu’elle n’y eût vu personne, ce fiacre continuait de la préoccuper, car elle se retourna plusieurs fois pour le regarder.
Au moment où elle allait quitter le passage pour déboucher dans la rue de l’Université, elle crut voir le cocher rassembler ses chevaux.
Un fiacre est fait pour marcher. Au fond, c’était la chose la plus simple du monde, mais cette belle Laure venait d’un pays où la guerre se fait à la loupe. Dans le désert américain, l’indice le plus frivole en apparence raconte quelquefois toute une longue histoire.
Le fiacre, pour elle, c’était Vincent Chanut, c’est-à-dire un espion.
Pour nous autres naïfs, un fiacre-espion a ses stores baissés qui le dénoncent comme les lunettes vertes trahissent le déguisement d’un jaloux. Mais Laure n’aurait pas craint M. Chanut derrière des stores baissés. Les stores baissés lui auraient dit au contraire : « M. Chanut n’est pas là. »
Elle rendait justice à son adversaire et n’attendait point de lui la botte enfantine que tout le monde sait porter.
Et voyez ! Laure ne se trompait pas en soupçonnant le fiacre. À peine eut elle dépassé le fiacre, que le cocher descendit de son siège et entra dans l’allée de la maison voisine où il jeta son carrick sur les épaules du fumeur en manches de chemises qu’il coiffa de son chapeau.
Cet homme redevint ainsi le cocher, tandis que le cocher redevenait Vincent Chanut, qui se glissa aussitôt dans le fiacre.
— C’est de filer cette jolie voiture-là à la douce, dit-il au vrai cocher qui remontait sur son siège… Allume, Chopé, ma vieille !
— La petite dame a une crâne jument, répondit Chopé, mais on va bien voir !
Je penche à croire que ce fiacre, son attelage, en apparence lamentable et son cocher Chopé faisaient partie du mobilier industriel de l’établissement Chanut, car celui ci, ayant relevé le coussin du siège de derrière, puisa dans le coffre comme il eût fait dans son armoire, et en retira divers objets : entre autres une perruque noire et une superbe cravate de soie bleue.
D’un autre côté, les deux grandes rosses efflanquées, après avoir tourné péniblement, se mirent à allonger comme des tigres, au premier coup de fouet de Chopé.
En atteignant la rue de l’Université, M. Chanut fit prendre à gauche, et mit la tête à la portière. Il vit la voiture de Laure à la hauteur de la rue de Beaune.
— La reconnais-tu ? demanda-t-il.
— Parbleu ! répondit Chopé ; c’est celle de Ville-d’Avray, et vous allez en conter à la payse, vous ?
M. Chanut dit en riant :
— Ouvre l’œil et ne la perds pas de vue. Nous ne savons pas encore, bien au juste, où nous allons.
À la rue de Bourgogne, la voiture de Laure gagna le bord de l’eau et prit le quai d’Orsay. Chopé dit, avant de dépasser le pont :
— Il n’y aura pas épais de voitures ici le long de l’eau, et la dame se retourne souvent. Des yeux comme ça, ça doit voir d’aussi loin qu’une jumelle !
— Passe la rivière, ordonna M. Chanut ; tu la veilleras aussi bien de l’autre côté.
Les équipages ne sont jamais bien nombreux sur cette mélancolique et belle route qui va du palais Bourbon au Champ-de-Mars. Quand Chopé eut filé au grand trot le pont de la Concorde et pris le cours la Reine, la charmante chaise découverte de Mme de Vaudré se montra presque seule, atteignant déjà l’esplanade des Invalides.
Une ou deux fois encore, on put voir Laure se retourner pour jeter un regard par-dessus la capote rabattue, puis elle ne bougea plus.
— La petite dame se dit comme ça, grommela Chopé : « Enfoncé le sapin ! il n’a pu tenir ! » C’est des bêtes de Saint-Brieuc, ma poule, et moi aussi, un peu ruinés tous trois, mais si on voulait, on éreinterait encore, à la longue, tous les Malbroucks de Longchamps, qui n’ont que trois lieues dans le ventre, à la fois.
Il tint en bride, parce que la voiture de Laure tournait le pont de l’Alma.
— Vire ! ordonna M. Chanut.
Laure jeta un dernier regard paresseux vers le quai de Billy et ne remarqua même pas ce fiacre lointain qui semblait retourner à Paris.
M. Chanut, lui, ne perdait point de vue la plume gris-de-perle qui flottait sur le chapeau de la baronne. Au bout d’une minute, le fiacre fit une seconde évolution et suivit de nouveau la chaise qui glissait rapidement vers Passy.
— Maintenant vieux, dit Vincent, nous sommes fixés : tu peux marcher à volonté.
— À Ville-d’Avray, alors ? par Auteuil, Boulogne et Saint-Cloud ?
— Non pas : le Point-du-Jour et Sèvres ! Tu t’arrêteras au poteau, cordon de l’Ouest, dans le bois de Fausse-Repose.
— À l’endroit du domestique sans place, hé ? dit Chopé en riant.
Au lieu de répondre, M. Chanut ferma les deux stores.
— Bon ! pensa Chopé, le patron va faire son bout de toilette !
Et la route se poursuivit silencieusement. Il était environ quatre heures du soir quand le fiacre s’arrêta au lieu indiqué, en plein bois. Pendant que Chopé mettait le nez de ses chevaux dans leurs sacs d’avoine, la portière ouverte donna passage à un bon gros gaillard, coiffé d’une forêt de cheveux noirs, habillé de drap fin qu’il portait mal et dont la cravate bleu de ciel était piquée d’une superbe épingle aussi décorative que la croix d’honneur.
Chopé avait parlé de payse et de domestique sans place ; M. Chanut, à l’aide de changements peu nombreux, mais savants, s’était donné la tournure classique d’un valet de chambre, bonne qualité commune, déguisé en bourgeois pour avancer ses affaires d’amour.
La cravate bleue surtout et l’épingle qui représentait un sabot de cheval faisaient glorieusement illusion. Aucun connaisseur n’aurait pu le rencontrer sans se dire : « Voilà Baptiste qui va où son cœur l’appelle ! »
Chopé, tout blasé qu’il était sur ces métamorphoses féeriques, ne put s’empêcher de rapprocher ses deux grosses mains comme font les délicats du théâtre Italien, quand ils applaudissent à la muette.
M. Chanut alluma un magnifique londrès sans défauts, car Baptiste congédié fume encore pendant trois mois le souvenir de son maître, et disparut au coin de la rue en jouant avec le stick perdu que « monsieur » a tant regretté, le stick qui a pour pomme la tête du cheval dont l’épingle est la patte.
Le jardinier-concierge de madame Marion reçut Baptiste avec cette franche et hospitalière cordialité des gens qui offrent le bien d’autrui. Jules lui-même, l’épagneul mâtiné, montra par ses caresses qu’il reconnaissait en Baptiste quelqu’un de la partie.
— C’est mignon à vous, dit le père Cervoyer en mettant sur la table une bouteille qu’il n’avait pas achetée et deux verres qu’il avait conquis : malgré que je ne devrais pas vous remercier de la visite, puisque vous venez pour Mlle Félicité. Elle en tient, vous savez ? Elle ne jure que par vous. C’est sage comme une image et ça a des économies… À la vôtre !
Baptiste goûta l’eau-de-vie.
— Jolie, dit-il.
— Sept ans de cave, chez moi ! Ça vient du cinquième avant-dernier locataire. J’en ai déjà de Mme Marion ; mais on ne la boira qu’à son tour.
— Là, vraiment, père Cervoyer, dit Baptiste d’homme à homme ! pensez-vous qu’il faut sauter le pas, au vis-à-vis de Mlle Félicité ?
Papa Cervoyer, pris ainsi par les sentiments, donna un coup de pied caressant à Jules et répondit :
— Moi, elle m’irait. Je sais qu’elle a du Turc pas mal et du Foncier… Voulez-vous qu’on lui soutire l’addition avec délicatesse ?
Baptiste lui serra la main chaudement.
— Et va-t-on la voir un tantinet ? demanda-t-il.
— Aujourd’hui, pas beaucoup, je vas vous dire : il y a du monde. Madame vient d’arriver ; les autres l’attendaient depuis midi. Vous savez, c’est d’abord les trois de la fameuse nuit qu’on n’a jamais su par quelle cheminée ils étaient entrés dans la baraque ; il y en a ensuite un gros, mais gros, gros ! que je n’ai pas encore vu et qui a été apporté par un soldat de la ligne. Il fume sa pipe au jardin, j’entends le soldat ; Jules l’a mordu, n’aimant pas le militaire. Alors donc, comme M. Germand, le valet de chambre, est à Paris, avec permission de minuit, Mlle Félicité se trouve seule pour servir la société.
Baptiste écoutait de toutes ses oreilles, mais il en avait si peu l’air que papa Cervoyer dit :
— Mais ça ne vous fait rien, pas vrai ?
— Et qu’est-ce qu’ils manufacturent ensemble, tous ceux-là ? demanda Baptiste.
— Voilà ! peut-être du cirage, peut-être de la politique…
— Et Mlle Félicité ne peut pas quitter, je conçois ça… mais si j’allais la trouver ?
— Ça se peut tout de même… au point où vous en êtes.
— C’est que je ne connais pas bien mon chemin.
Papa Cervoyer cligna de l’œil.
— Je vas vous conduire, dit-il. Retroussez vos manches.
— Compris ! répliqua Baptiste qui obéit en riant. Ce n’est pas à vous qu’on en remontrerait, dites donc ! merci du conseil.
Mlle Félicité était en train de disposer un plateau à grogs, dans la salle à manger, séparée seulement par une porte entr’ouverte du salon où les hôtes de Mme Marion tenaient conseil.
— Voici quelqu’un, dit papa Cervoyer, entrebâillant la porte extérieure et montrant les manches de Baptiste relevées jusqu’au coude, qui vient de donner un coup d’épaule à je sais bien qui… pour le bon motif.
Mlle Félicité rougit, sourit à la cravate bleue et remercia l’épingle d’or. Baptiste entra.
L’ennemi était dans la place, et chacune de ses oreilles s’ouvrait déjà, large comme le pavillon d’une trompe de chasse.
Les premiers mots qu’il entendit, en baisant galamment la main de Mlle Félicité, le mirent en goût.
— Laissez parler le père Preux, disait-on ; allez, père Preux !
Et une voix essoufflée répondit :
— Le père Preux vous connaît tous, mes cadets, sur le bout de son petit doigt, mais d’abord, fermez les portes, crainte des courants d’air !
Quelqu’un se leva pour exécuter l’ordre du père Preux qui continua :
— En second lieu, il manque quelqu’un ici : les Cinq ne sont que quatre, et le père Preux ne se déboutonnera pas tant qu’on ne lui aura pas montré le n° 1, ce petit tout en or, qui vaut la Californie.
La phrase fut coupée par la porte qui se fermait bruyamment, et M. Chanut n’entendit plus rien.
VLA BERLINE
C’était à peu près l’heure où Domenica Paléologue, marquise de Sampierre, abusant de « son fluide », forçait Laure de Vaudré à déchirer pour elle le double voile qui recouvrait le passé et l’avenir. Il n’y avait personne à l’hôtel de Sampierre, du moins en fait de maîtres, et les domestiques festoyaient.
Vous auriez beau chercher, vous ne trouveriez aucun point de comparaison qui pût vous donner une juste idée de ce paradis de la valetaille. On était là si parfaitement en pays conquis que les marauds mâles et femelles n’appréciaient même plus les joies du pillage. On y était blasé sur la paresse et la bombance. On ne dévalisait plus que par habitude et en quelque sorte par devoir d’état.
Il y avait six mois que le chef en chef, M. Hons, mieux payé, pourtant, qu’un colonel, n’avait paru dans les cuisines ; son secrétaire général, M. Teck, ne venait que tous les quinze jours, et M. Kopp, secrétaire de M. Teck, faisait faire sa besogne par un délégué, M. Hart, qui avait sous lui un maître cuisinier, M. Hof, lequel s’en reposait sur M. Spie, son aide. M. Spie avait un lieutenant, le seul français de la bande, travaillant ferme et mal payé parce qu’il était à la solde de l’invasion.
Ainsi du reste. Nulle parole ne saurait dire le dédain malveillant et universel de ces vainqueurs. Il n’y avait pas un marmiton qui ne regardât la marquise comme une créature d’espèce absolument inférieure. Ces charançons la dévoraient avec mépris, sans goût ; ils lui en voulaient pour cela, et ils l’insultaient la bouche pleine.
Rien n’est au-dessus de la langue poétique, qui peut tout dire, même la gloire des dieux ; mais la langue poétique est forcée de se donner aux chiens quand il s’agit de peindre les énormités de l’antichambre.
On se souvenait cependant d’une époque où les choses marchaient autrement chez la marquise. L’hôtel avait été tenu d’une main sévère au début du majordomat de M. le comte Giambattista Pernola. Szegelyi, le magnifique concierge valaque, disait que M. le comte avait maintenant ses raisons pour fermer les yeux. Il ajoutait :
— Celui-là, au moins, n’est pas un imbécile. Il fait danser quelque chose de meilleur que l’anse du panier, et chaque fois qu’on lui vole vingt francs, il marque vingt louis sur son carnet de coulage. Ça lui servira plus tard pour faire interdire la vieille comme il a fait interdire le vieux. Il a son idée.
La « vieille », c’était notre ancien rêve d’Orient, la pauvre princesse marquise.
Nous savons que Domenica était absente depuis l’heure de la messe. On avait vu sortir un peu après elle la princesse Charlotte avec son « attendante » Savta, et le comte Pernola n’avait pas paru de la matinée.
Personne au monde ne surveillait le bataillon des ouvriers tapissiers qui tenaient les salons en état par abonnement ; les gens de la marquise ne faisant jamais œuvre de leurs dix doigts.
Nous n’avons pas oublié que, le soir même de ce jour, il y avait grand bal à l’hôtel de Sampierre : bal travesti, malgré la saison.
Cette pauvre bonne Domenica était si triste ! Et il fallait bien amuser un peu princesse Carlotta.
D’ordinaire, le précieux Pernola donnait le coup d’œil du factotum aux apprêts nécessités par chaque fête, mais aujourd’hui nous devons penser que des occupations plus importantes le retenaient loin du logis, car il avait fait atteler, la veille au soir, la berline de famille, et ses deux valets particuliers qu’il laissait derrière lui n’avaient point su dire le but de son voyage.
Ajoutons que, depuis le matin à la première heure, les deux valets du comte Pernola, italiens tous les deux, dont l’un s’appelait Lorenzin et l’autre Zonza, s’étaient introduits dans le pavillon solitaire, situé dans la partie la plus ombreuse et la plus reculée du parc, et dont la fenêtre du père Preux apercevait la façade, à travers les feuillées.
C’était de ce pavillon que le jeune comte Roland avait fait sa demeure pendant les derniers mois de sa vie. Il y était mort. Personne n’y entrait jamais, sauf Pernola lui-même. Une lueur avait été souvent aperçue cependant aux croisées qui donnaient vers le trou Donon, dans les nuits d’hiver.
On disait alors que le maître déchu de l’hôtel de Sampierre et de tant de richesses, le marquis Giammaria (dont pas un serviteur de la marquise n’avait vu le visage depuis des années) avait obtenu par son calme et sa bonne conduite, la permission de passer quelques jours hors de la maison de santé qui lui servait de prison.
Et, dans ces circonstances, une clôture en treillages de fer qui enserrait la partie la plus retirée du parc sous prétexte de garder deux paires de gazelles que la fameuse expédition, sous les ordres du vicomte de Moeris, avait rapportées d’Amérique, fermait ses portes avec un soin scrupuleux.
Ordre était donné, en outre, aux gens de service de ne point s’approcher du pavillon.
M. de Sampierre était fou. Nul ne mettait en doute sa folie. De plus, on peut dire que nul ne s’intéressait à cela.
La légende de cette nuit terrible que nous racontâmes au début de notre drame : l’accouchement de Domenica à l’hôtel Paléologue était surabondamment connue. On s’en moquait parmi cette valetaille repue qui encombrait la maison de Sampierre. Tous les marauds et toutes les maraudes qui mangeaient le pain de la marquise étaient blasés à force de rire sur cette aventure où il y avait de la honte et du sang.
La Fontaine l’a dit, résumant d’un seul mot l’histoire de l’humanité : Notre ennemi, c’est notre maître. Il n’est même pas besoin de descendre jusque dans les lâches profondeurs des antichambres pour trouver cette joie féroce que provoque, à coup sûr, la souffrance du pouvoir ou l’angoisse de la richesse.
Un million qui pleure, c’est le plus consolant de tous les spectacles après une grandeur qui tombe !
Lorenzin et Zonza, pour la besogne qu’ils accomplissaient dans le pavillon, n’avaient appelé à leur aide aucun des ouvriers employés à l’hôtel. Leurs places restaient vides à la table du déjeuner, quoi qu’on fût au dessert. Et Dieu sait qu’il y avait loin de la première bouchée jusqu’au dessert, dans la salle d’office où les gens de l’hôtel de Sampierre prenaient leurs plantureuses et interminables réfections.
On avait parlé un peu du meurtre commis la semaine précédente, au saut de loup, dans le trou Donon, et qui était déjà une vieille histoire, un peu du voyage de Pernola, un peu des absences fréquentes de princesse Charlotte et un peu de ce Joseph Chaix qui semblait, depuis plusieurs jours, accomplir auprès de Mlle d’Aleix un mystérieux emploi.
Mlle Coralie, première femme de chambre, s’était laissé entraîner à des appréciations peu charitables au sujet des prétentaines (c’était son mot) que courait sa jeune maîtresse.