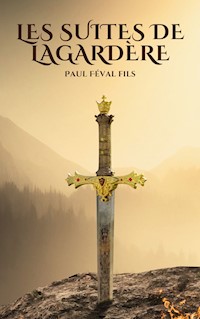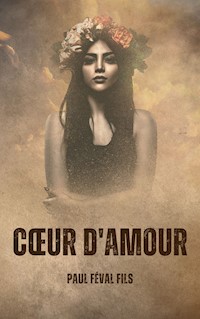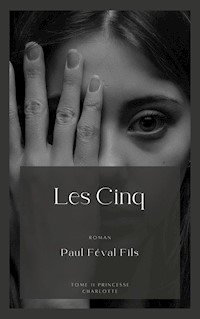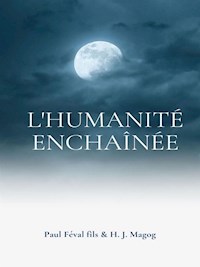0,85 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Au commencement du vingt-et-unième siècle, personne ne l’ignore mais nous nous permettons de le répéter pour le cas où certains l’auraient oublié, l’agglomération Yokohama-Tokio était devenue l’une des capitales les plus modernes du monde.
Son importance et le développement qu’elle avait pris ne venaient pas seulement du rang occupé par le Japon dans le monde asiatique. – Et c’était le premier rang puisque l’ancien Mikado portait présentement le titre de Président des États-Unis d’Asie. – Mais ils découlaient encore du fait que la puissante république, après avoir ressuscité et galvanisé l’indolence des jaunes, marchait en tête de la Civilisation.
Autant que Paris ou Londres, plus que Rio-de-Janeiro ou New-York, Yokohama était donc une ville cosmopolite. C’est dire que le moindre événement y attirait une foule bigarrée, comptant autant d’Européens que d’Asiatiques, sans parler des Américains, des Australiens et des Africains de toutes couleurs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LE RÉVEIL DE L’ATLANTIDE
Paul Féval fils & H. J. Magog
LES MYSTÈRES DE DEMAIN
(volume 3)
1922-1924
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383833970
CHAPITRE PREMIERFANTASTIQUE SURENCHÈRE
Au commencement du vingt-et-unième siècle, personne ne l’ignore mais nous nous permettons de le répéter pour le cas où certains l’auraient oublié, l’agglomération Yokohama-Tokio était devenue l’une des capitales les plus modernes du monde.
Son importance et le développement qu’elle avait pris ne venaient pas seulement du rang occupé par le Japon dans le monde asiatique. – Et c’était le premier rang puisque l’ancien Mikado portait présentement le titre de Président des États-Unis d’Asie. – Mais ils découlaient encore du fait que la puissante république, après avoir ressuscité et galvanisé l’indolence des jaunes, marchait en tête de la Civilisation.
Autant que Paris ou Londres, plus que Rio-de-Janeiro ou New-York, Yokohama était donc une ville cosmopolite. C’est dire que le moindre événement y attirait une foule bigarrée, comptant autant d’Européens que d’Asiatiques, sans parler des Américains, des Australiens et des Africains de toutes couleurs.
Telle était celle qui se pressait certain après-midi dans la plus spacieuse des salles de l’Hôtel des Ventes. Les vastes proportions de cette salle avaient déterminé ce choix, et il s’expliquait encore non seulement par l’énorme affluence de public, mais aussi à cause des dimensions de l’objet qui allait affronter le feu des enchères.
Long d’une douzaine de mètres, large de deux, avec une hauteur égale, une sorte de monstre fossilisé s’allongeait, dans un box surélevé de trois marches, au milieu de la foule des curieux.
À en juger par la grosseur des poutres et des croisillons de fer dont on avait dû étayer le plancher, le poids de ce monstre pétrifié devait être considérable. Des siècles, – à ce qu’on supposait – l’avaient recouvert d’une carapace métallique et brillante. Les gens les mieux informés affirmaient que ce devait être de l’or – métal déprécié depuis le jour où la découverte du gisement formidable du Fouzi-Yama en ayant inondé le monde, les gouvernements avaient été mis dans l’obligation de pourvoir son remplacement, en tant qu’étalon monétaire.
Quant à l’animal contenu dans cette enveloppe, les avis étaient partagés : on parlait de dragon, de brontosaure, d’ichtyosaure, d’iguanodon, et de toute la ménagerie préhistorique. Car l’opinion unanime s’accordait pour admettre l’antiquité de cette trouvaille.
Les circonstances dans lesquelles elle avait été mise au jour plaidaient il est vrai, en faveur de cette thèse. C’était au cours des fouilles faites sur l’emplacement du volcan sacré, le Fouzi-Yama, disparu récemment dans les entrailles du sol, pendant qu’un subit tremblement de terre secouait tout le Japon(1).
Une aussi formidable convulsion de la croûte terrestre ne pouvait avoir mis au jour qu’un fossile, jusqu’alors enseveli dans les couches géodésiques les plus profondes.
On en déduisait qu’il datait des premiers âges du monde ; de sa période secondaire.
À l’époque où elle avait été faite – cela remontait à quelques mois – on n’avait point parlé de cette découverte qui aurait dû révolutionner le monde paléontologique.
Cela tenait à ce que la bête métallisée avait été aussitôt vendue à un vieux bonze collectionneur. Celui-ci, fort jaloux de ses trésors, s’était bien gardé d’ébruiter son aubaine. Ayant subrepticement fait introduire le fossile dans sa bonzerie dont il avait fait partir les mousmées, afin d’éloigner les dévots, il passait ses jours et ses nuits en contemplation devant sa monumentale relique.
Mais ce collectionneur venait de mourir et les héritiers, tenant naturellement à tirer le meilleur parti possible des curiosités qu’il s’était plu à rassembler, avaient au contraire trompeté aux quatre coins du monde les mérites de cette pièce unique.
Cela expliquait l’affluence des curieux et des amateurs qui se pressaient dans le vaste hall des enchères. Il y avait là l’ordinaire tourbe des intermédiaires, des brocanteurs venus de toutes les parties du monde. Bien entendu, on y trouvait le dessus du panier des races agioteuses, commerçantes et rapaces : Grecs, Persans, Chinois et Arméniens.
Ils étaient venus pour le fossile d’or, véritable pièce de Musée ; chacun espérant pouvoir l’acquérir à bon compte, et comptant bien le revendre ensuite un prix fabuleux.
À l’un des bouts de la longue rangée de fauteuils de rotin, réservés aux amateurs sérieux, un vieillard paraissait somnoler.
Ce n’était évidemment pas un professionnel. Son aspect sordide n’annonçait pas davantage le riche amateur. Son teint coloré, sa maigreur squelettique trahissaient quelque dévot ascète de l’Inde, appartenant vraisemblablement à la secte religieuse des banians ou à l’ancienne caste des fakirs.
Tout d’abord, ce personnage parut se désintéresser des enchères, comme de tout ce qui se passait autour de lui. Mais quand le flot des amateurs du fossile se fut réduit et qu’il ne resta plus en présence qu’une demi-douzaine d’enchérisseurs sérieux, le vénérable vieillard se réveilla comme par magie.
— Où en est-on ? demanda-t-il à son voisin.
Celui-ci répondit :
— Le petit Persan a été jusqu’à neuf mille Orons… Le grand Arménien en met dix… C’est cher !
— Cher ? répéta le Banian. Écoutez ?
Et d’une voix calme il surenchérit :
— Cent mille Orons !
Cette enchère formidable sidéra les concurrents et toute l’assistance. L’Oron, ainsi appelé du nom abrégé du savant Oronius qui avait découvert le métal entrant dans sa composition, avait remplacé l’ancienne livre sterling et représentait à peu près cinquante francs de le monnaie d’autrefois.
C’était donc une enchère de cinq millions que venait de jeter ce vieillard dont l’aspect était celui d’un mendiant.
Qui était-il ?… Ou au nom de qui agissait-il ?
Certes, il fallait avoir une sérieuse envie de posséder le fossile d’or pour en offrir un prix aussi disproportionné. L’or, nous l’avons dit, était un métal déprécié.
Atterrés, les autres amateurs se turent.
Ils étaient vaincus.
Et déjà, la traditionnelle baguette d’ivoire s’abaissait, quand une voix de tonnerre emplit la salle :
— Deux cent mille Orons ! clamait cette voix. Faites vos prix, messieurs ; vous perdrez votre temps ! Je suis prêt à doubler n’importe quel chiffre qui sera offert.
L’assistance se regarda avec effarement. Qu’était le premier coup de théâtre auprès du second ?
De plus, ce nouveau mouvement de stupeur n’était pas seulement causé par l’offre folle, mais aussi par ce fait que la voix, cette voix tonitruante, n’était sortie du gosier d’aucun de ceux qui se trouvaient dans la salle.
Elle provenait du dehors, et même d’un lieu éloigné. Après s’être entre-regardée, l’assistance dut le constater, non sans un certain frisson.
Seul, le vieux fakir ne donna aucun signe d’étonnement ni d’effroi. Toutefois, ses prunelles, ternes jusque-là, se mirent à briller d’un éclat singulier.
— Qui porte cette enchère ? demanda-t-il d’une voix calme.
La question était sensée. Le commissaire-priseur s’empressa de la répéter, en chevrotant légèrement, car il éprouvait, comme son entourage, une assez compréhensible émotion.
— Qui enchérit ? cria-t-il.
Alors, au milieu d’un profond silence, la voix de l’enchérisseur invisible laissa tomber ce seul mot :
— Oronius !…
*** ***
L’illustre savant, dont nous avons entrepris de rapporter les aventures, n’était pas l’homme des fantaisies ni des caprices.
Que pouvait-il vouloir faire du singulier fossile, lui qui avait dispensé à l’humanité les trésors de la science et mis au service de ses contemporains les forces asservies de la Nature ?
Il se trouvait à Paris, entre sa fille Cyprienne, gracieuse blonde de vingt ans et son futur gendre, en même temps son élève – l’ingénieur Jean Chapuis.
En leur compagnie et en celle de ses dévoués serviteurs – le mécano Victor Laridon, master Julep son nègre polychrome, la délurée soubrette Turlurette, Mandarinette, la jeune Chinoise, et les petits chiens Pipigg et Kukuss, le Maître avait toutes les raisons du monde de souhaiter vivre tranquille.
Within-globe-trotter, il rentrait à peine de la fantastique randonnée qui lui avait fait traverser la sphère terrestre de part en part, sans cesse menacé par la haine de son rival Hantzen, savant dévoyé, lié aux puissances du Mal que représentait la mystérieuse Hindoue Yogha.
De la lutte effroyable qui s’était déroulée dans les soufflures endothermiques, Oronius et les siens étaient revenus seuls. Leurs ennemis y ayant trouvé leur tombeau.
Après une telle suite d’entreprises cyclopéennes, de luttes forcenées contre des adversaires inexorables et contre les révoltes de la nature, toujours disposée à anéantir ses trop audacieux violateurs, l’illustre maître ne devait-il pas aspirer au repos ? Ses travaux le réclamaient ! De plus le Palais-Laboratoire que ses concitoyens venaient de lui réédifier pour remplacer sa Villa Féerique détruite par la haine de Hantzen, comptait maintenant un nouvel hôte qu’Oronius devait tenir à étudier : c’était un échantillon d’une branche sous-terrienne de la race humaine. Ramenée de l’étrange expédition, cette créature répondait au nom de Taï. Elle avait rendu d’appréciables services dans le séjour des ténèbres et s’était particulièrement attachée à Cyprienne et à Jean Chapuis.
Encore une fois, comment Oronius pouvait-il, dans de telles conditions, s’intéresser au fossile découvert chez le bonze antiquaire japonais ?
C’est que, comme tous les savants de l’Univers, il avait reçu des héritiers du collectionneur la missive que voici.
« Illustre Maître,
« Nous avons l’avantage de vous signaler le prochain passage à l’Hôtel des Ventes de Yokohama d’une pièce unique de Musée. C’est un fossile certainement préhistorique et que des millénaires ont revêtu d’une carapace d’or. Il provient des fouilles effectuées sur l’emplacement du Fouzi-Yama. Ci-joint la photographie de ce monstre qui constitue, pour un amateur éclairé, un trésor inestimable. »
La lecture de ce prospectus et la vue de la photographie avaient fait bondir Oronius.
— Mais, c’est lui ! s’était-il écrié. C’est le Snaky qui a servi de cercueil à Hantzen, à Yogha et à leurs âmes damnées. Je comprends maintenant pourquoi nous l’avions vainement fait chercher par notre brave Victor. Le pauvre garçon arrivait comme les carabiniers de jadis. Le fameux serpent avait déjà été recueilli et caché par ce collectionneur bouddhiste.
Sa fille et son futur gendre s’étaient approchés pour l’écouter. Laridon, Julep et les soubrettes prêtaient l’oreille.
Tous semblaient singulièrement impressionnés. N’était-ce point naturel : ces simples mots : Hantzen – Yogha – le Snaky leur rappelaient tant de cruels instants ! Ce cercueil qui reparaissait à la lumière du jour et qui contenait les corps de leurs ennemis ne pouvait les laisser indifférents.
— Certes ! cette méchante boîte ne peut plus être qu’un ossuaire, réfléchit Oronius à mi-voix. Et pourtant, le simple nom de fossile d’or sonne à nos oreilles comme une menace. C’est à nous de nous en constituer les gardiens. J’achèterai l’animal prétendu fossilisé.
— Peut-être ne serez-vous pas le seul enchérisseur, émit Jean Chapuis.
— Bah ! les autres compétiteurs n’auront pas des raisons aussi valables que les miennes de désirer l’acquérir. Il nous suffira d’y mettre le prix.
— Qui enverrez-vous au Japon ? demanda Cyprienne.
— Envoyer quelqu’un là-bas… Pourquoi ?… N’ai-je pas les moyens de voir et d’entendre ce qui se passera aux enchères – et cela sans sortir de mon laboratoire ? N’ai-je pas l’Oroniphone et l’œil cyclopéen ?
Grâce à ces merveilleux instruments qui donnaient à la voix et au regard humain une portée presque illimitée, Oronius avait pu, en effet, suivre les conversations et les différents incidents de la Salle des Ventes de Yokohama.
Contrairement à son attente, il trouvait, en face de lui, un compétiteur particulièrement sérieux, en la personne du vieux fakir. La formidable enchère lancée par ce dernier lui avait ouvert les yeux. Aussi, comprenant la nécessité de décourager immédiatement un pareil adversaire, avait-il lancé simultanément l’enchère doublée et le défi qui devaient stupéfier l’assistance.
*** ***
Dans la salle des Ventes de Yokohama, le fakir s’était redressé. Il ne paraissait nullement disposé à abandonner la lutte. Au contraire, on aurait dit que le nom d’Oronius était pour lui un stimulant. Disposait-il donc de ressources illimitées ? Qui, en ce cas, lui fournissait de pareils trésors ?
— Ce n’est pas le tout d’enchérir, il faut prouver sa solvabilité, ricana-t-il. En somme, vous n’entendez que les offres d’une voix affirmant être celle d’Oronius. Qui vous garantit l’authenticité de cette voix ? N’est-ce point celle d’un mauvais plaisant ? Pour moi, je suis prêt à payer comptant… et j’en fais la preuve ! Demandez présentement à votre Oronius de montrer ses Orons !… Tenez, voici, en diamants, la valeur offerte. Il tira de dessous ses vêtements une boîte métallique assez volumineuse et l’ouvrit.
Tous avancèrent la tête, et durent reculer en tumulte, car juste au moment où le vieil ascète s’apprêtait à plonger sa main dans la boîte pour exhiber les joyaux annoncés, un rayon lumineux sembla jaillir du sol et atteignit le coffret.
Avec un cri de douleur le fakir le lâcha aussitôt et se mit à secouer ses mains comme si elles venaient d’être atrocement brûlées… Le coffret était devenu tout rouge et une épaisse fumée en sortait. Quand elle se dissipa, chacun put constater que le coffret était vide.
Apporté par l’Oroniphone, un ricanement sarcastique retentit.
— Voilà vraiment une belle monnaie. D’où tenez-vous ce talent de fabriquer de faux diamants ? Malheureusement pour vous, ils ne sauraient résister à l’action des rayons Z, qui volatilisent les substances dont vous les avez composés. Vous n’êtes qu’un vieux filou. Retirez-vous au plus vite si vous ne voulez que j’éclaircisse les raisons secrètes de votre intervention. En quoi ce que contient le Fossile d’Or vous intéresse-t-il ?
La curiosité dont le menaçait Oronius dut probablement paraître importune au vieux fakir, car il s’éloigna aussitôt.
— J’abandonne la partie, maugréa-t-il, avec un visible dépit. Adjugez l’objet… Mais, que l’acquéreur prenne garde ! Le « Yoghi » ne fabrique pas que de faux diamants. Il possède une puissance plus réelle, que pourront expérimenter à leurs dépens ceux qui tenteront d’emporter le serpent d’or… Il n’est pas encore entre les mains d’Oronius et je doute même qu’il lui parvienne jamais !…
CHAPITRE IIS.O.S. CÉRÉBRAL
En dépit de cette énigmatique menace, Victor Laridon, dépêché au Japon par le Maître, avait pris passage sur un navire spécialement aménagé en vue de sa mission, et était arrivé à bon port dans les États du Soleil-Levant.
Mis au courant des propos du vieux fakir, au moment où il s’apprêtait à faire embarquer la merveille antédiluvienne, notre Parisien s’était contenté d’en rire.
— Qu’il s’y frotte ! avait-il dit. Je lui apprendrai ce que pèse le « tampon d’un Pantruchard » qui a affronté Hantzen en son repaire de l’Everest, et a bouffé sa part du feu central. J’affalerai le Snaky à Paname… ou bien nous n’y « aboulerons » ni l’un ni l’autre.
Une heure après avoir prononcé ces paroles mémorables, l’entêté mécano faisait transporter le pseudo-fossile sur le quai, à proximité de l’Autonef. (C’était le nom du navire qui l’avait amené.)
L’Autonef, on doit le penser, tant pour la forme du carénage, que pour ses commandes de propulsion ou de manœuvre, n’avait rien de commun avec le genre de construction navale du siècle écoulé. Pourvu d’une installation électrique qui permettait l’automatisme de toutes les manœuvres possibles, en se passant complètement de main-d’œuvre humaine, pour tout état-major et pour tout équipage, l’Autonef n’avait à son bord que Victor Laridon et master Julep.
Personne – en dehors des deux envoyés d’Oronius – ne devait mettre le pied sur le pied du bâtiment. Et ce furent eux seuls qui procédèrent à l’embarquement du Snaky.
Laridon était donc bien certain qu’il n’emmenait aucun ennemi. Il n’avait pas à craindre une trahison machinée ou payée par le fakir.
Au moment du départ, ayant placé Julep en observation sur la passerelle, il effectua une minutieuse visite du bâtiment. Après quoi, certain que tout fonctionnait à souhait et que rien de suspect n’existait, il passa dans le poste des chiffres et appareilla en quelques secondes, électriquement :
— À présent, bien malin serait ce fakir s’il nous causait quelque ennui, confia-t-il à Julep quand leur bâtiment se trouva à une certaine distance des côtes du Nippon, courant, à une allure de 45 à 50 nœuds, vers le sud. Vois-tu, blanc de poulet, on est seuls, ici, nous deux, avec, comme cargaison, une boîte à bijoux qui est un peu là… Quoi que tu dis ? Qu’elle a coûté un peu chérot ? T’en fais pas, vieux zinc ! La « cocotte » contient un frichti d’Hantzen au piment Yogha à s’en lécher les babigouinsses !
Or, on aurait difficilement fait admettre à maître Laridon que son « frichti » pouvait représenter un danger quelconque.
N’était-il pas enfermé dans une double carapace d’airain et d’or ? Et cette dernière enveloppe, qui moulait exactement le Snaky (puisque tel était le nom dont Hantzen et Yogha avaient baptisé leur appareil) constituait une prison dont le serpent mécanique ne pouvait s’échapper.
D’autre part, Laridon avait pleine confiance dans son ship ultra moderne et dans sa machinerie électrique – œuvre exécutée par Jean Chapuis sur les plans du Maître.
L’Autonef était véritablement une merveille. D’une cabine vitrée, située sur la passerelle, un seul homme pouvait le diriger sans le moindre effort et lui faire accomplir toutes les évolutions voulues.
Bien mieux, ayant réglé la route et actionné les différents mécanismes qui assuraient la marche de l’Autonef, son pilote pouvait s’endormir d’un sommeil exempt d’appréhension. Non seulement il était assuré que, grâce à la précision du mécanisme, tous les organes du bâtiment continueraient à fonctionner selon le programme prévu et aux heures déterminées à l’avance – mais il était en outre bien certain d’être réveillé, en temps utile, si quelque incident impossible à prévoir venait à se produire.
En effet, des avertisseurs automatiques existaient dans toutes les parties du bâtiment, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
De plus, l’approche même d’un danger se trouvait automatiquement signalé. Des dispositifs électro-magnétiques et des appareils enregistreurs, munis de plaques sensibles à toutes les émanations, ondes et courants, possibles entouraient et doublaient la carène ainsi que les superstructures d’une véritable armature nerveuse.
Si, par exemple, dans un rayon déterminé, un écueil affleurait, un submersible évoluait, ils exerçaient aussitôt, du fait de leur voisinage, une action combinée sur les cloches sous-marines et sur les plaques vibrantes de l’Autonef dont chaque appareil, isolément, pouvait déclencher les organes sifflants de l’avertisseur. Mis en alerte, le commandant Laridon n’avait plus qu’à consulter le tableau indicateur pour connaître la nature du danger, sa direction et la distance à laquelle on en était encore.
Un tel système de protection n’était-il pas suffisant pour autoriser la confiance à toute épreuve dans laquelle se confinait Victor Laridon, navigateur novice en même temps qu’officier de marine improvisé.
La route ayant été déterminée à l’avance par Oronius, il suivait ponctuellement les instructions du maître en tournant certains boutons dans le sens indiqué et dans un temps prescrit, selon l’horaire d’un régulateur mis en marche à la sortie du port de Yokohama.
Cette besogne accomplie, il pouvait naviguer en dormant sur ses deux oreilles. C’était le cas ou jamais de le dire : le bateau marchait tout seul. L’Autonef fendait les flots à une vitesse prestigieuse.
En raison même de sa vélocité toute spéciale et de son très petit tirant d’eau, il ne suivait pas les routes ordinaires, mais bien celle qui lui avait été imposée par Oronius. Pour éviter l’étranglement de Bab-el-Mandeb, à l’entrée de la Mer Rouge et l’étroit couloir du canal de Suez où il eût dû prendre la file et marquer le pas, le Maître avait prescrit à son navire électrique la traversée du Pacifique.
Il nous paraît nécessaire de noter ici un point d’histoire : les travaux entrepris en 1875, par Ferdinand de Lesseps, pour le percement de l’isthme de Panama et l’établissement d’un canal interocéanique, fut un gouffre dans lequel les capitaux français s’engloutirent pour un milliard quatre cent millions de francs. En 1889, la société ayant été mise en liquidation, le travail fut abandonné, puis repris pour le compte des États-Unis. Ceux-ci, grâce à de nouveaux capitaux, purent pousser jusqu’à l’achèvement, et le début du XXe siècle vit l’inauguration du gigantesque canal établi sur les plans d’un grand Français. Jusqu’en 1950, les navires purent donc passer de l’Atlantique au Pacifique en suivant le tracé du canal, entre Colon et Panama, après s’être fait monter ou descendre par les trois écluses de Gatun, et les trois écluses de Pedro Miguel et de Miraflorès. Mais, à cette dernière date, qui vit la grande guerre sino-américaine, les Unionistes ayant fait sauter les portes des barrages, leurs ennemis, complétant la dévastation, coupèrent littéralement l’isthme en pulvérisant les racines de la Culebra, de Pedro Miguel à Obispo, en utilisant pour la première fois l’énergie intra-atomique du radium.
Le passage désormais libre, sur une largeur moyenne de plus de deux cents mètres, on hésita tout d’abord à s’y engager à cause de la hauteur inégale des deux mers. C’était une erreur ; le niveau des deux océans est bien le même, mais si l’oscillation de la marée n’atteint que 0 m. 58 d’amplitude à Colon, par contre à Panama, elle est à 2 mètres en morte-eau et peut atteindre 6 mètres en vive-eau ; de là un courant de 2 nœuds 5 ; des simili cascades à Obispo, devant le rio Chagres, et quelques tourbillons entre Juan Grande et Tavernilla.
En somme, rien qui puisse arrêter les lévriers des mers et encore moins le navire électrique d’Oronius.
Quelques heures après avoir quitté Yokohama, l’Autonef, ayant traversé le tropique du Cancer et laissé derrière lui les îles Hawaii filait à toute vitesse vers la Mer Panamienne.
Le temps n’était plus où il fallait dix-huit jours à un paquebot pour aller du Japon à San-Francisco.
Sans souci comme sans crainte, Victor Laridon, dans la cabine vitrée de la passerelle, s’abandonnait donc béatement au plaisir contemplatif, quand, tout à coup, un concert de sifflements le fit sursauter.
Stupéfait, il consulta le tableau.
— Pas possible ! s’exclama-t-il. Que nous arrive-t-il ? Il faut que quelque chose se doit détraqué.
Alors, s’élançant hors de la cabine, il appela à pleine voix :
— Julep !… Ohé ! Blanc d’Espagne !… Arrive tout de suite, extrait de jus de chique !…
Ces noms d’amitié avaient le privilège de faire surgir immédiatement le nègre polychrome.
Comme de coutume, il se présenta, riant de tout son cœur.
C’était un caractère enjoué et qui savait comprendre la plaisanterie.
Mais l’expression plutôt sévère du visage de son capitaine de manœuvre lui fit entrevoir que ce n’était pas le moment de s’amuser.
Il se produisait certainement de graves inconvénients pour que « massa Victor » eût une « binette » pareillement bouleversée.
Le rire de Julep se figea sur sa large bouche, et son nez épaté esquissa un allongement impossible.
— Quoi y a, massa Laridon ? demanda-t-il avec inquiétude. Toi pas bonne « bobine ». Toi méchante guegueule à raffût ! Dis à master Julep : perdu blague ? Cassé pipe ?
D’un haussement d’épaules, le mécano fit justice de ces suppositions puériles.
— Il en faut d’autres pour me retourner ! déclara-t-il tragiquement. Ma vieille tarte de suie à la groseille-pistache, ou j’ai le vertigo et, comme on dit, ou je la perds, ou nous sommes en train de passer à l’as !
— À la as ? répéta le nègre sans comprendre.
— De couler ! De plonger ! si tu aimes mieux, précisa le Parisien. Comme notre bâtiment n’est pas un submersible et qu’il n’est aménagé qu’en vue de la navigation en surface, nous pouvons nous apprêter à boire à la tasse.
— Julep soif… Julep boire océan, affirma le nègre en ouvrant une bouche d’une dimension effrayante.
— Imbécile ! Tu oublies les poissons. Ils ne passeraient pas. Et puis il y a les « c’est assez ! » Silence donc et reviens au sentiment de la situation. Je t’annonce une nouvelle non seulement inquiétante, mais absolument inexplicable. Or tu l’accueilles comme un événement normal… Ta bêtise est immonde !… Je te répète qu’il se passe à bord un truc « sardi-napoilesque ». Si je n’étais pas aussi sûr que personne autre que nous n’a mis ses « arpions » sur l’Autonef, je t’insufflerais : le fakir est en train de nous démonter un bateau… Mais l’olibrius est resté sur le plancher des mousmées.
— … Jolies ! confirma le nègre en se frottant les mains avec une satisfaction évidente.
— Imbécile ! tu as du goût pour ces tranches de citron ?… Viens tout de même visiter les cales… Je ne puis comprendre à quoi nous sommes en butte. Sans crier gare, ou plutôt si, en sifflant gare, l’avertisseur vient de m’annoncer que le bâtiment s’enfonçait et que le niveau de l’eau, dans la cale, atteint la ligne des œuvres mortes ! Cela voudrait dire que nous avons embarqué de la flotte sans nous en apercevoir… Mais, est-ce possible avec un pareil « rufiau » ? Le signal aurait fonctionné… Et puis d’où viendrait la limonade ? L’Autonef n’est pas une coquille à se détraquer comme ça pour rien, pour le plaisir de faire des chichis… Ce n’est pas une petite « menesse » nerveuse. Il est solidement construit… D’autre part, nous ne sommes passés dans le voisinage d’aucun écueil. Nous en aurions été avertis… Alors, quoi ? Dois-je donner ma langue aux requins ?…
— Nous aller voir, conseilla le nègre.
— Quoi ? Les requins ?
— Non ! Cale basse de petite menesse.
Ils descendirent et passèrent une inspection complète du navire.
Les murailles étaient intactes. Dans les cales, il n’y avait pas trace de voie d’eau et la grande soute ne renfermait que le Snaky.
Cependant, quand ils remontèrent, un simple coup d’œil jeté au tableau de la cabine les troubla : le signal d’alarme retentissait sans interruption et le graphique indiquait que l’Autonef s’enfonçait lentement, mais continûment sans faire eau.
— Hein ! constata le Parisien. N’est-ce pas plus fort que de jouer au bouchon ?
— Plus fort ! accorda son écho.
De fait cette descente non motivée prenait des proportions inquiétantes.
Quand la mer atteindrait le niveau des dalots, – si cette inexplicable descente ne s’arrêtait pas, – ils embarqueraient forcément et le navire coulerait, car toutes les écoutilles étaient ouvertes.
Or que faire pour empêcher cela ? Condamner les ouvertures ?… Le temps manquait.
Et puis, comment se défendre contre un péril dont la cause est inconnue ?
Chaque seconde de réflexion rendait Laridon de plus en plus soucieux. Il avait maintenant conscience d’être environné par un péril mystérieux. Des forces invisibles le menaçaient, sans lui laisser la chance de se défendre.
À quoi visaient-elles ? D’où pouvaient-elles provenir ?
Le mécano se rappela la mystérieuse menace du fakir. Elle était en train de se réaliser. Il ne pouvait s’empêcher de faire ce rapprochement.
De là à penser que le singulier personnage pouvait – si invraisemblable que cela parût – être pour quelque chose dans l’aventure, il n’y avait qu’un pas.
Laridon le franchit :
— Ce serait au Snaky qu’on en veut, murmura-t-il. Ne m’as-tu pas seriné le refrain ? On ne veut pas qu’il arrive au port. Le cochon s’opposerait-il lui-même à son transport ?
— Lui mort… Lui peut pas !
— Si fait, blond de fumée !
— Comment qu’il ferait ?
— Et s’il lui plaisait de forcer son poids !…
Les sourcils du mécano se froncèrent. Le pli volontaire de son front indiqua la concentration de toutes ses forces de combat.
Il n’était pas facile d’entamer le moral de maître Laridon ni d’obtenir qu’il s’abandonnât.
— Mais moi, j’ai dit qu’il arriverait là où je le mène ! reprit-il avec entêtement. On n’est pas sans comprendre les « magnes » et du moment où la roublardise est éventée, c’est à Bibi de retrousser ses manches ! La manigance doit être démolie… Allons, jus de lentilles au caramel ! Un peu d’huile de bras, mon canard ! Nous allons sauver les meubles. Puisque c’est pour descendre le Snaky au fond de la grande baille qu’on veut y envoyer l’Autonef et nous aussi par-dessus le marché, on va faire un radeau et nous nous y installerons avec le serpent… Ah ! mais il ne faut pas croire qu’on les prend sans vers, ceux de Pantruche !
Le premier effort à effectuer pour réaliser ce beau projet était de hisser le Snaky sur le pont.
Cette opération n’était pas aussi difficile qu’on pourrait le croire, car tout avait été prévu pour qu’elle pût être aisément conduite en cas de nécessité. Un puissant treuil électrique, qu’un enfant eût manœuvré d’un seul doigt, tellement son mécanisme était à la fois simple et perfectionné, était boulonné sur le pont, au pied du mât de misaine et sous la corne de brigantine, faisant fonction de grue. Du haut de cette corne non décapelée, descendaient toujours, dans le grand panneau, les chaînes d’acier qui avaient servi à l’embarquement du Snaky. Descendu sur sa plateforme de poutres, celui-ci n’avait pas été débarrassé de ses entraves. De sorte qu’aucun préparatif n’était nécessaire. Au contraire tout était disposé en vue de l’opération du débarquement.
Laridon et Julep ayant procédé seuls à l’introduction du fossile, il n’y avait aucune raison pour que l’opération inverse ne pût être effectuée avec autant de facilité.
Les mêmes moyens mécaniques qui devaient être mis en jeu. Et ceux-ci avaient fait leurs preuves.
Le mécano actionne donc la dynamo avec assurance, l’objet devant être enlevé par le treuil « à la guibe de saton » (jambe de bois).
Le treuil, obéissant, se mit en marche, embraqua en vitesse tout le mou de la chaîne, puis celle-ci se tendit avec un râlement de ses anneaux et, brusquement, le cylindre s’arrêta.
Le Snaky résistait !
— Saperlipopette ! gronda notre capitaine estomaqué. Le bibelot fait de la rouspétance ! Mets de l’avance à l’allumage, miroir à moricaudes !… Quoi ?… Ça flanche encore ?
Littéralement stupéfait, il dut constater l’étrange résistance qu’opposait le Snaky à tous les efforts faits pour l’arracher. En dépit de l’action de la grue élévatrice, conçue cependant pour jongler avec des poids bien plus considérables, il demeurait collé au plancher de la cale.
Son poids s’était-il donc subitement accru dans des proportions inquiétantes ?
Cette réflexion démente fit germer une autre idée dans l’esprit désemparé de Laridon : cette modification de poids ne pouvait-elle pas être la cause principale de l’étrange aventure qui menaçait la sécurité de l’Autonef ?
N’était-ce pas ce maudit Snaky, inexplicablement et progressivement alourdi, qui faisait s’enfoncer le navire ?
Durant quelques minutes, le mécano demeura interdit et anxieux, éprouvant – et peut-être pour la première fois de sa vie – une impression d’incommensurable terreur.
Car, cette fois, il sentait combien peu de chose est l’atome humain environné de ces forces hostiles et mystérieuses que la Nature cache à nos regards et à notre intelligence.
Ce conflit avec des puissances invisibles, dont il ne pouvait se faire aucune idée, démontait le pauvre Victor, le privait en partie de cette assurance dont il avait fourni tant de preuves.
Avec Julep, – qui ne comptait guère en la circonstance, – il était seul à bord. Cela, il en était sûr.
Et pourtant quelque chose agissait sur la dangereuse cargaison, pour l’attirer au fond de la mer ; entraînant avec elle le navire qui la portait et son modeste équipage.
Or, de l’avis de Laridon, cette diabolique interposition, qui ne pouvait venir que de l’extérieur, avait été annoncée.
Vraiment, pour une pareille lutte, le mécano ne se sentait pas de taille. Il avait besoin d’être aidé.
Perdu au milieu de l’Océan, loin de tout secours humain possible, quelle assistance utile eût-il pu réclamer, sinon celle de son grand patron, le savant Oronius.
Mais Oronius, absorbé par ses travaux de laboratoire, était à Paris… de l’autre côté de la terre !
N’importe ! Pour communiquer avec le Maître, il avait mieux que la T.S.F. Et ce n’était pas le trop bref S.O.S. qu’il allait lancer.
Les ondes cérébrales amplifiées – perçues selon le procédé d’Oronius par les cerveaux dotés de l’amplificateur de l’Aqueduc de Sylvius – remplaçaient avantageusement les ondes hertziennes.
Ce mode de communication, par exemple, exigeait un puissant cerveau, tendu jusqu’à l’extrême, – puisque ce cerveau se trouvait constituer à la fois le poste émetteur et le poste récepteur.
Pour la réception des messages cérébraux, Oronius – nous venons de le dire – y avait pourvu. Grâce à l’amplificateur, tout individu qui en était doté, pouvait être atteint par lesdits messages.
Mais, pour l’émission, il en allait tout autrement. Seul un Maître de la Pensée avait le pouvoir, sans le secours d’un dispositif spécial et par sa seule force de concentration cérébrale, de lancer des ondes d’amplitude suffisante pour que des cerveaux éloignés fussent atteints par elles.
Le mécano n’était évidemment pas de cette catégorie privilégiée.
Heureusement, le cas avait été prévu. Et il existait, à bord de l’Autonef une cabine amplificatrice d’où l’appel cérébral de celui qui y était enfermé partait avec une puissance suffisante.
Laridon courut à cette cabine et s’y claquemura. Là, concentrant toute sa pensée, il lança son appel désespéré.
Pendant ce temps, le nègre caméléon, terrorisé autant par le visible affolement de son compagnon que par l’inexplicable façon dont se comportait leur bâtiment, passait par toutes les couleurs assombries de l’arc-en-ciel.
Pour le polychrome Julep, ce n’était point là un tour de force !…
De son côté, cédant à la mystérieuse pression qu’exerçait sur ses membrures le Snaky alourdi, l’Autonef continuait à s’enfoncer lentement…
CHAPITRE IIILE FOSSILE NAUFRAGEUR
À Paris, dans le Palais-Laboratoire construit pour lui par la reconnaissance publique, Oronius et les siens attendaient le Snaky et ses convoyeurs avec une certaine curiosité.
Turlurette, elle, se sentait animée d’un autre sentiment. Son agitation inaccoutumée décelait une certaine impatience. Dame ! on n’attend pas un futur mari, connu et estimé, avec le même calme qu’on afficherait en espérant un quelconque particulier. Or, la jolie soubrette le savait : le même jour où seraient célébrées les noces de Cyprienne Oronius et de Jean Chapuis, elle épouserait Victor Laridon, mécanicien de talent et garçon à ne pas engendrer la mélancolie.
D’ailleurs, d’une façon générale, Laridon manquait à tout le monde – aussi bien aux espiègles petits chiens Pipigg et Kukuss qu’à Taï, le sous-terrien ramené du centre de la Terre.
Oronius lui-même, tout préoccupé qu’il fût par la reprise de ses travaux, n’était pas insensible à l’éloignement de son mécano préféré.
Pourtant cette absence devait être brève en raison de la merveilleuse vitesse du navire électrique. Malgré l’intervention du fakir dans la Salle des Ventes de Yokohama, le Maître ne prévoyait aucune complication. Les précautions prescrites à Laridon, il en gardait l’assurance, devaient parer à tout.
Malgré cette certitude absolue, en homme prévenu, il n’abandonnait jamais les fils de ses opérations ; aussi pour pouvoir, le cas échéant, suivre les péripéties du voyage de son envoyé, le père de Cyprienne avait-il installé à proximité de son laboratoire un appareil de vision à distance.
Cet appareil – simple perfectionnement de l’œil cyclopéen – réfléchissait et agrandissait, sur une surface plane recouverte de sel d’argent, l’image perçue par l’œil. Il permettait donc à plusieurs personnes de suivre simultanément la scène observée.
Pendant le voyage aller de Victor Laridon, les enchères, l’embarquement du Snaky et le départ de Yokohama, Oronius et sa famille n’avaient eu qu’à venir jeter au miroir quelques coups d’œil intermittents. Ils s’éloignaient satisfaits après avoir constaté que tout marchait pour le mieux.
Une fois l’Autonef hors des eaux du Nippon avec sa cargaison, Oronius s’abstint même de toute nouvelle visite au miroir d’argent. Il estimait qu’aucune tentative hostile n’ayant eu lieu avant le départ, il ne s’en produirait plus.
Il semblait, en effet, beaucoup plus facile de disputer la possession du Snaky avant son embarquement. Une fois en mer, étant donné les précautions prises, le fossile présumé pouvait être considéré comme hors d’atteinte.
Seule, nous l’avons dit, Turlurette, agitée, continuait à passer des heures entières à contempler la silhouette du navire, en route pour Panama, qui rapportait son cher mécano.
Or, un matin, poussant un grand cri, elle abandonna le miroir pour se précipiter dans la laboratoire d’Oronius. Son irruption soudaine, sa pâleur firent se dresser d’un même mouvement Cyprienne et Jean Chapuis qui se trouvaient là et conversaient avec le Maître.
De leur côté, épouvantés par le cri entendu, Mandarinette et Taï accoururent, suivis des insemables petits chiens.
Mais, avant que la soubrette eût ouvert la bouche pour expliquer son invasion insolite, le Maître, les yeux dans le vague, traça dans l’air un geste impérieux. C’était un ordre ! l’ordre de garder le silence.
Les premiers mots du message mental du malheureux capitaine de l’Autonef venaient de l’atteindre. Et c’était pour mieux percevoir et comprendre qu’il désirait pouvoir se recueillir au milieu d’un silence absolu.
Mais Turlurette pouvait-elle se conformer religieusement à ce qu’imposait ce muet commandement, selon l’usage établi chez Oronius ?
Non !… Elle était bien trop bouleversée.
— Victor est en danger ! gémit-elle. L’Autonef fait naufrage… Venez voir… Venez voir…
D’un geste réprobateur et semi-menaçant, durement Oronius lui coupa la parole. Il y réussit, cette fois.
La pauvre fille, bouche ouverte, s’arrêta haletante, regardant le Maître avec une expression suppliante et désespérée.
Il en fut touché.
— Venez ! dit-il simplement, en faisant signe à tous de le suivre.
Et il les amena devant le miroir.
Celui-ci avait été réglé sur un mécanisme mobile, semblable à celui en usage pour les équatoriaux stellaires, pour permettre à tout spectateur d’y suivre automatiquement la course de l’Autonef.
Dès leur entrée dans la pièce, tous se trouvèrent donc en face du réfléchissement d’un point éloigné de l’Océan Pacifique, à la surface duquel avançait encore le navire électrique.
Avançait ?… À peine !… Et dans quelle posture !… À la surface ?… Si peu !… plus pour longtemps !
Cela n’était que trop visible…
Tous ses hublots noyés, et par bonheur vissés à fond ; l’Autonef aux trois quarts submergé, ne levait plus à la lame ; les vagues le poursuivaient, comme montant à l’assaut, à la hauteur de sa ligne de pont. Ses dalots buvaient… Depuis longtemps ses écubiers devaient embarquer sans arrêt !
Sur le pont, on n’apercevait que Julep, affolé. Laridon, lui, restait invisible. Il était enfermé dans la cabine amplificatrice, en communication avec Oronius, mais ce dernier était seul à le savoir.
Le spectacle de ce bateau sans équipage, mangé graduellement par les flots comme un submersible au début de sa plongée, était bien fait pour emplir les cœurs d’un inexprimable sentiment d’angoisse.
Turlurette se mit à gémir.
Nul n’y fit attention. L’émotion était ailleurs… Les regards d’Oronius avaient pris une fixité impressionnante. Une sorte de radiation lumineuse s’échappait du front du Maître et l’entourait d’un halo.
Ses yeux étincelants, dédaignant le miroir, semblaient traverser l’espace et voir au-delà.
La contraction de ses traits indiquait le travail de sa pensée. Non seulement, il recevait la communication de Laridon et l’interrogeait mentalement ; mais, pour percer les causes de l’étrange naufrage, il devait encore, au prix d’un effort terrible de concentration et de projection hors du « moi », parcourir cérébralement les différents compartimentages de l’Autonef.
Une certaine agitation décela bientôt le trouble que lui causait ses stupéfiantes constatations.
On l’entendit murmurer à mi-voix :
— La cause ?… Parbleu ! c’est le Snaky. Oui ! oui ! il s’alourdit pour naufrager l’Autonef !…
Plus bas encore et avec un visible frémissement, il ajouta bientôt :
— Alors, ils ne sont pas morts !… Est-ce possible ?… Oh ! Je veux les voir !… Je veux m’assurer !…
L’effort psychique intensifié convulsa ses traits : des flammes jaillirent de ses yeux… Il haletait…
— Ce sont pourtant des cadavres ! murmura-t-il, en promenant ses regards sur quelque chose que ses compagnons ne pouvaient apercevoir.
Ils ne pouvaient l’apercevoir, non, car le miroir ne reflétait rien de ce mystère : mais, désormais, ils en avaient comme l’intuition et une sueur glacée leur coulait dans le dos.
Par la pensée Oronius venait de percer la carapace d’or puis l’enveloppe d’airain du Snaky… du Snaky voguant à des milliers de kilomètres de Paris, enfermé dans la cale de l’Autonef !
Que sont le Temps et l’Espace pour l’esprit libéré de la matière ?