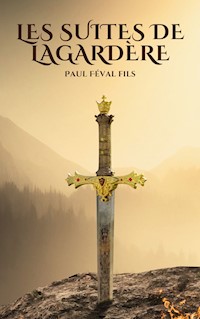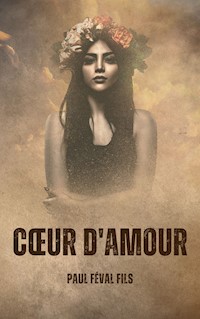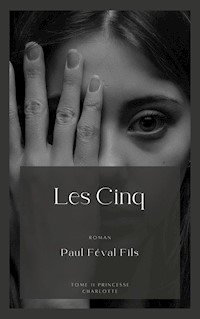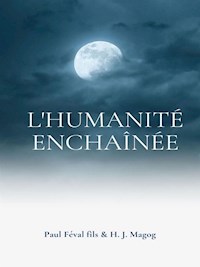
0,85 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
L’Histoire ne pourra perdre le souvenir des terrifiants cataclysmes qui se succédèrent durant les premières années du vingt-et-unième siècle. Assailli par des fléaux imprévus, le monde faillit périr. Tout au moins, si ce ne fut pas la fin de la terre, on put croire que c’était celle de l’humanité.
On sait maintenant quelle avait été l’origine de ces forces destructrices qui menacèrent d’anéantir la Vie. Nul n’ignore à qui il convient de les attribuer. La science a deux visages – comme le Janus Bifrons des Romains – et la plupart des armes qu’elle manie peuvent indifféremment tuer ou guérir. La même science inspirera le génie du mal et le génie du bien. Et c’était bien ces deux génies qu’incarnaient, au début de l’an 2.000, ces savants ennemis, le professeur Hantzen et l’illustre maître Oronius.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
L’HUMANITÉ ENCHAÎNÉE
Paul Féval fils et H. J. Magog
LES MYSTÈRES DE DEMAIN (volume 4)
1922-1924
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383833987
CHAPITRE PREMIERMIRAGE POLAIRE
L’Histoire ne pourra perdre le souvenir des terrifiants cataclysmes qui se succédèrent durant les premières années du vingt-et-unième siècle. Assailli par des fléaux imprévus, le monde faillit périr. Tout au moins, si ce ne fut pas la fin de la terre, on put croire que c’était celle de l’humanité.
On sait maintenant quelle avait été l’origine de ces forces destructrices qui menacèrent d’anéantir la Vie. Nul n’ignore à qui il convient de les attribuer. La science a deux visages – comme le Janus Bifrons des Romains – et la plupart des armes qu’elle manie peuvent indifféremment tuer ou guérir. La même science inspirera le génie du mal et le génie du bien. Et c’était bien ces deux génies qu’incarnaient, au début de l’an 2.000, ces savants ennemis, le professeur Hantzen et l’illustre maître Oronius.
Les maux déchaînés sur le monde vinrent du premier, de même que le second seul y trouva les remèdes et les palliatifs.
Mais, parmi ces divers et gigantesques bouleversements, comment ne pas accorder une mention particulière au formidable mascaret de chaleur qui assécha l’Océan en moins de quelques heures ; puis ou raz-de-marée atmosphérique qui faillit asphyxier l’humanité, en refoulant sur un seul point du globe la presque totalité de l’air respirable ?
Au soir de ce sur-phénomène, un appareil volant, encore mal dégagé de la couche d’air solidifié qui l’avait un instant transformé en aérolithe, retombait sur la terre, après avoir été projeté aux limites de la stratosphère par le flux atmosphérique.
Parti de l’ancien continent des Atlantes(1), qui pouvait dire en quel point du globe il retombait ? La courbe qu’il avait involontairement décrite lui avait certainement fait franchir, à une incalculable vitesse, une distance considérable.
Son équipage et ses passagers, tous en observation derrière les hublots de la carlingue, devaient donc chercher à deviner l’endroit qui allait être leur point de chute. Sans doute, on n’aura point de peine à le comprendre, un peu d’appréhension se mêlait à leur légitime curiosité.
Pourtant, bien moins que la généralité de leurs contemporains, les humains enfermés dans cet oiseau d’acier ne devaient se laisser impressionner par la perspective d’aventures nouvelles.
Ce navire aérien n’était-il pas l’Alcyon-Car, le célèbre appareil de l’illustre Oronius ? Résumé et habitacle de toutes les merveilles de la science, n’emportait-il pas dans ses flancs de quoi parer aux éventualités les plus imprévisibles ? Et n’était-il pas guidé par le Maître lui-même, assisté de son élève, l’ingénieur Jean Chapuis, et du roi des mécanos, l’inénarrable bellevillois Victor Laridon ?
L’Alcyon-Car ! Merveille des merveilles ! Forteresse inaccessible et laboratoire procéleste ! Avion-protée qui pouvait, avec une égale facilité, être tantôt oiseau et tantôt poisson, auto sur le sol, tank au besoin, canot électrique, transformable en sous-marin, auto-poisson, enfin, capable de rouler au fond des mers. Il n’était aucune situation à laquelle ne fût susceptible de s’adapter ce Fregoli de la machinerie moderne.
Entraîné dans un nombre incalculable d’effarantes aventures, depuis le jour où le sommet de Belleville, se transformant en volcan, il avait été arraché à son paisible laboratoire(2), le maître Oronius n’avait jamais hésité à lui confier ce qu’il avait de plus précieux. L’Alcyon-Car n’emportait pas seulement les trésors scientifiques du savant, il emportait aussi celle qu’il chérissait le plus : Cyprienne, sa blonde fille aux yeux d’azur, l’intrépide et délicieuse fiancée de Jean Chapuis.
Deux soubrettes accompagnaient cette amazone des airs, la Parisienne Turlurette au minois très éveillé et Mandarinette, jeune Chinoise arrachée par elle à une affreuse servitude ; la première s’était promise au mécano Laridon ; la seconde, moins avancée sous le rapport sentimental, semblait pourtant s’intéresser assez fort au nègre Julep, – peut-être à cause des singularités que présentait l’épiderme du digne serviteur, rendu polychrome par les expériences d’Oronius.
Enfin, et pour terminer le dénombrement des passagers de l’Alcyon, il y avait encore à son bord deux petits chiens papillons, Pipigg et Kukuss, puis Taï, singulière créature sous-terrienne ramenée des environs du feu central(3).
Bêtes et gens, tels étaient ceux qui, en ce soir catastrophique descendaient du ciel vers la terre inconnue.
Ils l’observaient à travers les panneaux vitrés de l’avion et comme grâce à la perfection des appareils optiques utilisés par Oronius, cette observation était facilitée, ils pouvaient s’émouvoir du spectacle qu’ils avaient sous les yeux.
Jamais il ne leur avait été donné de contempler plus singulier paysage. De la hauteur à laquelle ils se trouvaient encore, le sol terrestre aurait dû leur apparaître sous l’habituelle forme d’une circonférence encerclée de ciel.
Or, la terre, sous eux, leur semblait avoir pris une forme elliptique. Il n’eût plus été exact de parler de cercle à l’horizon : il aurait fallu dire l’ellipse.
De plus, les dimensions de cette ellipse présentaient des proportions singulièrement considérables. Certainement, sa superficie dépassait de beaucoup celle qu’eût dû enclore le regard de l’observateur contemplant de pareille altitude un autre point du globe terrestre. L’étendue embrassée pouvait varier du simple au double. Sur une toute autre échelle, l’œil aurait ressenti une impression analogue si, après avoir contemplé de haut un œuf posé sur sa pointe, il l’avait ensuite – de la même hauteur – regardé posé dans le sens de la longueur. Dans le premier cas, l’image perçue était un cercle de dimension restreinte. Dans le second, c’était une ellipse ayant pour petit axe le diamètre de la précédente circonférence et dont le grand axe pouvait être double, sinon triple.
De cette anomalie, Oronius devait conclure qu’il contemplait la terre sur une de ses faces aplaties.
Il avait donc sous les yeux l’un des pôles ou ses abords immédiats.
Lequel ? D’après le graphique de la courbe décrite depuis le cataclysme qui avait projeté dans les airs l’Alcyon-Car, le Maître estima que la chute avait été orientée dans la direction du sud. C’était donc vers le pôle austral ou antarctique que descendait l’avion.
Et à mesure qu’il se rapprochait du sol, Oronius s’étonnait davantage de trouver la réalité si différente des vérités – supposées – données par les géographes comme étant articles de foi.
À vrai dire, c’était un bien étrange paysage !
Plus qu’étrange… hallucinant !
Le disque du soleil demeurait perpétuellement au-dessous de l’horizon et ses rayons n’éclairaient qu’indirectement la surface polaire. Il y régnait donc constamment une demi-lumière qui, sans être celle des nuits claires, n’était pas non plus celle du jour normal.
En ce point du globe, théoriquement percé par le prolongement de l’axe de rotation, – essieu du monde ! – il n’y avait ni lever ni coucher de soleil. Quelle que fût la face présentée par la terre aux rayons solaires, le centre polaire ne s’en trouvait ni plus ni moins éclairé.
Un jour étrange – ou plutôt une clarté spectrale, demi-ombre et demi-lumière, – baignait donc le sol sur lequel s’apprêtait à aborder l’appareil.
Il approchait du pôle… mais il ne descendait pas exactement au-dessus. Il allait atterrir sur le rebord d’un plateau rocheux décrivant la ceinture complète autour d’une sorte de plaine ronde formant cuvette. Le pôle théorique devait se trouver au centre et au fond de cette cuvette.
Quels yeux ouvraient les compagnons d’Oronius ! Et quels regards lui jetait le Maître lui-même !
Comme ce qu’ils découvraient mettaient à néant les plus savantes déductions !
Le fameux cercle antarctique et ses glaces devait être fort loin derrière eux. Ils survolaient la zone séculairement assiégée par les explorateurs les plus fameux, mais jamais atteinte : la zone inviolée ! Ils avaient franchi la mystérieuse et dernière barrière contre laquelle s’étaient brisés les suprêmes efforts de tant de hardis pionniers.
Les passagers de l’Alcyon faisaient mieux que d’entrevoir le but, de le deviner, de le frôler – ils y étaient dans l’Elglacero rêvé par tous les malheureux Orellana du pôle.
Et ce qui se révélait à eux, ce n’était ni la mer libre, ni le désert de glace hypothétiques. C’était cette couronne de roc dressée par la Nature comme une enceinte destinée à enfermer le secret de l’aimant !
Qu’était-il… ce pôle ?
Un instant – un instant éphémère ! – ils l’eurent sous les yeux. Ils crurent le tenir… Ils l’entrevirent…
Illusion !… La vision était si inattendue qu’ils pensèrent être les jouets d’un mirage.
L’Alcyon venait de se poser au haut du roc, à quelques mètres du rebord d’où les regards pouvaient plonger dans la mystérieuse cuvette.
Jean Chapuis ouvrit une écoutille…
Ou plutôt il tenta de l’entr’ouvrir.
Mais, aussitôt un froid mortel se répandit à l’intérieur de l’avion et Julep fit un bond en arrière comme s’il avait reçu en pleine poitrine un pavé de glace.
— Referme !… Referme ! se hâta de crier Oronius. T’imagines-tu que nous puissions sans préparation affronter la température du pôle.
Sur ce point, tout au moins, des observations et les déductions des explorateurs se trouvaient confirmées. La température polaire s’opposait à la présence de tous organismes animés.
Cependant, pas plus que les flammes d’une fournaise, le froid ne pouvait arrêter le Maître. Il revêtit et fit revêtir à ses compagnons des combinaisons à double enveloppe enfermant un matelas d’air réchauffé par un courant électrique. Des masques pareillement chauffés furent appliqués sur les visages et des gants protégèrent les mains.
Ainsi transformés en radiateurs vivants, les aviateurs pouvaient sortir. Un à un, tous se risquèrent hors de l’Alcyon et foulèrent le sol glacé de la calotte polaire. C’était un sol mort, noir et lugubre. Le froid y tuait tous les germes. Il n’y avait aucune trace de végétation même la plus élémentaire ; la vie animale en était également absente.
Un silence écrasant y régnait.
— Naturellement, murmura Oronius, en hochant la tête. La mort seule peut habiter sous cette latitude. Notre curiosité trouvera ici bien peu à glaner… le néant !… Donnons-nous cependant le plaisir de descendre au fond de cette cuvette et de poser le pied sur le point exact qui est le pôle austral lui-même…
Il se retourna vers la cuvette et se rapprocha du rebord.
Tous ses compagnons l’avaient imité. La même exclamation de stupeur leur échappa.
Une buée grise emplissait la grande cuvette. Le coup d’œil était assez semblable à celui d’une mer de nuages vue du sommet d’une montagne.
Cette brume n’était pourtant pas assez dense pour former un voile impénétrable aux regards. Elle laissait apercevoir confusément les formes qu’elle enfermait en son sein.
Le Maître, sa fille, son futur gendre et leurs serviteurs crurent donc distinguer, à leur profonde stupéfaction, des silhouettes de constructions massées au fond de la cuvette.
Ce pouvait être une illusion d’optique : le brouillard déforme les objets ou leur prête une apparence fantastique ; les troncs d’arbre revêtent des aspects humains, un buisson, un pan de mur se transforment en monstres qu’on imagine vivants.
Les spectateurs n’auraient donc attaché que peu d’importance à ce qu’ils voyaient ou croyaient voir ; le brouillard et la distance considérable qui les séparait du fond de l’immense cuvette et des formes entrevues constituant une double cause d’erreur. Cela eût suffi à les mettre en garde contre l’invraisemblable vision de ce qui ne pouvait être qu’un importun mirage, s’il n’y avait eu autre chose. Or, de cette autre chose, ils ne pouvaient douter, sans douter en même temps du témoignage de leurs sens.
Du sein de la buée grise des tours colossales émergeaient.
Cette fois il était impossible de mettre l’étrange apparition sur le compte d’une déformation due au brouillard. En effet, les masses imposantes que découvraient nos voyageurs stupéfaits s’élevaient bien au-dessus de la mer de brume, elles se dressaient dans la partie relativement claire de l’atmosphère et sans l’interposition d’aucun rideau de vapeurs.
Les contours et les silhouettes étaient donc absolument nets. Et il était aisé à Oronius d’en observer la forme et la nature.
Chacune pouvait être éloignée de quelques kilomètres. Mais comme leur diamètre atteignait certainement un millier de mètres, elles demeuraient encore suffisamment visibles pour que l’œil pût douter de leur réalité.
Ce n’était pas des rochers, c’était indiscutablement des édifices dressés par d’habiles architectes et selon toutes les règles de l’art.
Des œuvres humaines ! une architecture au pôle austral ! au delà de la limite assignée à la vie !
Médusés, tous demeuraient stupides devant les énormes silhouettes dominant la mer de brouillard.
Cette fantastique apparition rendait moins invraisemblable ce qu’ils avaient cru distinguer au fond de la vaste cuvette. Ils n’étaient plus sûrs d’être les jouets d’une illusion en y découvrant, sous le voile de brume, le fourmillement de la vie active des pays d’usines, l’agitation de multitudes humaines se livrant à des travaux… Entre les constructions couvrant le sol de la cuvette, des points noirs, représentant comme une armée de pygmées, allaient et venaient en chaînes ininterrompues… Des formes plus volumineuses couraient sur le sol. Et, dans les airs, au sein même du brouillard, d’autres formes, qui paraissaient voler, passaient et repassaient.
Des usines, une industrie, des êtres actifs, des trains peut-être, tout au moins des véhicules – et des aéroplanes ou des trailles aériens – semblaient animer la vie polaire !…
Nos explorateurs surprenaient là les manifestations de vie et d’activité intense que pourrait offrir n’importe quel pays minier ou métallurgique.
N’était-ce pas des fumées de haut-fourneaux qui s’élevaient dans le ciel, formant cette mer de nuages ? Le sol ne tremblait-il pas sous le choc lointain de marteaux-pilons ?
Aucun de nos héros ne pouvaient admettre cela. Avec Oronius, ils préféraient récuser le témoignage de leurs yeux, dupes d’apparences déformées.
Cela écarté, il n’en restait pas moins les tours si nettement visibles – les tours et la singulière destination qu’elles paraissaient avoir.
Quel était ce phénomène, constaté, mais absolument déconcertant ! Était-il purement physique et naturel ? Ou bien une volonté scientifique et créatrice le commandait-elle ?
C’était étrange et inexplicable. Cela aurait été tel en tous lieux du monde. Jamais Oronius n’avait contemplé rien de semblable. Jamais il n’avait réalisé ni rêvé de réaliser sous cette forme et sur une aussi vaste échelle le miracle qu’il contemplait et qualifiait aisément : la captation directe de l’énergie incluse en toute source lumineuse, la déviation et la décomposition des rayons solaires pour en extraire les forces caloriques ou autres.
Car ce ne pouvait être que cela : mystérieusement attirée du fond de l’horizon derrière lequel se tenait caché le soleil invisible, une masse lumineuse montait, se courbait et retombait, en se divisant, sur le sommet des tours. C’était la masse diffuse des rayons solaires répartis dans l’espace qui, détournés de leur parcours normal et rassemblés en faisceau par une intervention inconnue, se trouvaient amenés vers les tours polaires.
Mais, déjà, soit au moment de la captation, soit en cours de trajet, un premier travail de décomposition et d’élimination s’était effectué. Car ce n’était pas toute la lumière solaire que recueillaient les mystérieuses tours : dépouillés notamment de leur éblouissante luminosité habituelle, ils n’arrivaient au but que sous forme de radiations à peine visibles et que, seule, leur grande masse permettait de discerner.
Rêveur, en présence de cette colossale tentative de captation des forces de la Nature, Oronius évaluait les formidables réserves de chaleur et d’énergie qui pouvaient ainsi s’accumuler et se transformer dans les réservoirs des édifices babéliques.
À quoi servaient-elles ces réserves ?… Ou à quoi serviraient-elles un jour ?
Qui les captait ?…
— Des hommes ont construit ces tours, murmura pensivement le Maître. Ceci est indiscutable ! Nous avons devant nous une manifestation du génie humain… Au fait, quels peuvent être ces hommes ? Et que font-ils là ?
De ses yeux ardents, il fixait le sommet des tours, sur lequel ils se figurait distinguer des silhouettes humaines, courant, s’agitant et se livrant à diverses besognes.
Mais, brusquement – et au moment précis où il allait porter à ses yeux l’œil cyclopéen, la nuit se fit, subite, totale et inexplicable…
Plongés à l’improviste dans d’épaisses ténèbres, nos amis ne s’apercevaient même plus les uns les autres. Ils durent se chercher à tâtons en s’appelant et se rapprocher troublés et inquiets.
Les tours-usines avaient brusquement interrompu leur travail. Brisé, le faisceau lumineux ne montait plus du fond de l’horizon. Tout s’était éteint !
Un silence angoissant pesait sur la nuit du pôle.
— Avons-nous été aperçus ? Cette nuit est-elle voulue, provoquée ? murmura Oronius. Le Pôle enferme-t-il donc un secret jalousement gardé qu’a paru menacer notre apparition inattendue ?
Nul ne lui répondait. Il poursuivit, pour lui-même, la série des réflexions que lui inspirait la situation.
— Il y a là des vivants… des êtres d’une intelligence supérieure… pour le moins égale à la nôtre… Ce que nous venons d’entrevoir ne permet pas d’en douter… Donc, ce sont des humains… Parmi la création, quelle autre espèce pourrait posséder cette intelligence ?… Or, pourquoi cette défiance aussi formidablement manifestée ? Quels qu’ils soient, des êtres entre les mains de qui se trouvent de telles forces ne sauraient regarder comme un danger la venue de quelques voyageurs… Pourquoi cette nuit ? Veulent-ils nous interdire l’accès du pôle ? En sont-ils les gardiens et ceux de ses mystères ?… Je ne puis comprendre… Incontestablement, je le sens, nous venons de provoquer une alerte… Mais comme nous ne saurions constituer personnellement une menace sérieuse, il faut tout bonnement conclure que nous avons surpris un spectacle qu’on désirait cacher… L’homme polaire, insoupçonné jusqu’à ce jour, veut encore qu’on ignore son existence… Pourquoi ?
Malgré soi et en dépit du témoignage de ses yeux, il exprima ce doute :
— Quelle folie ! L’homme polaire existe-t-il ?… Peut-il exister ?… La raison dit : non… Les tours-usines aspiratrices d’énergie solaire affirment le contraire… Une seule chose est sûre : le pôle est habité… Par qui ?
Inexplicablement troublés par le mystère qui les entourait, les passagers de l’Alcyon-Car se serraient en un groupe inquiet.
Le silence et l’obscurité leur semblaient enfermer une menace. Ils attendaient presque une attaque…
De qui ? – comme disait Oronius.
Tout à coup – et ce fut une impression générale, puisque tous frissonnèrent en même temps – ils entendirent au-dessus d’eux et autour d’eux des battements d’ailes. Les ténèbres s’emplirent de formes que l’effroi leur faisait deviner. Ils se sentirent frôler… Ils virent briller des yeux étranges – des yeux à facettes polyédriques, qui rappelaient l’éclat du diamant – certainement pas des yeux humains.
Et pourtant, entre les grandes ailes sombres qui battaient l’air, il leur semblait distinguer des corps.
Des corps ayant la forme humaine…
Ils n’eurent d’ailleurs pas le temps de se livrer à de nombreuses constatations, ni celui de se poser beaucoup de questions.
L’étrange essaim qui venait de les entourer et semblait vouloir les reconnaître à la faveur des ténèbres, s’éloigna presqu’aussitôt. La nuit retrouva son calme. L’air cessa d’être agité. Ils purent douter de la réalité de cette nouvelle fantasmagorie.
— Il n’y avait rien… rien que la nuit, se répétait chacun. Notre imagination seule a peuplé les ténèbres.
L’alerte ne se renouvelant pas et les minutes s’écoulant sans apporter d’autre incident, ils se rassérénèrent peu à peu.
D’ailleurs, l’inexplicable nuit dura peu. Le voile s’éclaircit. La demi-clarté polaire reparut, arrivant de l’horizon.
Les voyageurs revirent le plateau en couronne sur lequel ils se tenaient.
Ils revirent la cuvette et sa mer de nuages grisâtres, un peu plus opaques qu’avant l’éclipse. Mais en vain leurs yeux cherchèrent les étranges tours… Elles n’émergeaient plus du brouillard…
Elles avaient disparu et avec elles toute trace de vie.
CHAPITRE IILA FORÊT ENCHANTÉE
— C’est de la magie ! cria Cyprienne.
Et la rieuse Turlurette, se frottant les yeux, murmura :
— Comme escamotage, ce farceur de Laridon ne fait pas mieux !
Oronius fronçait les sourcils et hochait la tête.
Il se répétait mentalement, avec une obstination qui défiait les illusionnistes du pôle de le duper.
— Il y avait pourtant quelque chose là… J’ai vu… Je suis sûr d’avoir vu…
Comment douter, après cela ? Le pôle recelait bien un secret, et les gardiens de ce secret entendaient le dérober aux regards des autres mortels.
— Ils ne me connaissent pas ! murmura le Maître. Quand on pique ma curiosité, il faut la satisfaire. Plus on accumule d’obstacles devant moi, plus je me sens disposé à en triompher. J’explorerai cette cuvette polaire… et s’il y a quelque chose à découvrir, je le découvrirai.
Sa résolution étant prise, il rassembla ses compagnons et leur fit part de sa détermination.
— Nous allons descendre là-dedans, annonça-t-il en montrant du geste l’étendue mystérieuse sur laquelle moutonnait la mer de nuages.
— Descendre ? Comment ? se hasarda à questionner le mécano. Je ne vois pas d’échelle.
En effet, la couronne de rocher sur laquelle se trouvaient nos voyageurs semblait figurer le sommet d’un mur de ronde ou d’une contrescarpe, et présentait des parois à pic. Presque lisses, elles plongeaient dans l’abîme de brume sans offrir aucun élément d’escalade ou de descente. Laridon avait donc raison de constater l’absence de tout équivalent d’escalier.
Jean Chapuis approuva.
— Il faudrait faire un fameux saut pour toucher le fond de cette cuvette, dit-il à son tour. Et nous nous romprions le cou puisque nous ne sommes pas des oiseaux…
— Inexactitude ! coupa Oronius. Nous avons des ailes. Et il désigna l’avion, tout en se dirigeant vers lui.
Laridon fit la grimace.
— M’sieu Oronius n’y pense pas ! grommela-t-il entre ses dents, mais de façon à être entendu du Maître. Allez donc faire une descente en vol plané au milieu de cet « abrouart ». Nous ne verrons seulement pas s’il y a un terrain d’atterrissage. On mettra « l’Alcavyavon(4) » en bouillie.
— Y a-t-il un fond, seulement ? demanda Cyprienne.
— Nous l’avons vu tantôt, répliqua l’ingénieur.
— Comme les tours !… Mais tours et fonds ont été subtilisés, s’ils existent, ce dont nous ne sommes pas sûrs du tout, mon cher Jean. Depuis notre déjà si lointain départ de la Villa féerique, à Belleville, combien de fois n’avons-nous pas été obligés de douter du témoignage de nos sens…
— Nous ne sommes sûrs de rien, approuva Oronius. Cette incertitude même me pousse à aller voir ce qu’il y a réellement sous ce brouillard… Si c’est un puits sans fond, nous en serons quittes pour remonter. Et si on peut se poser quelque part, nous nous poserons.
— À l’aveuglette ? insista Jean Chapuis. C’est bien hasardeux. Cet insupportable brouillard doit absorber la totalité de la clarté. Le jour polaire n’est déjà pas par lui-même très lumineux. Il y a donc de grandes chances pour qu’on n’y voie goutte.
— Nous éclairerons… Nous avons nos projecteurs.
— Et s’ils ne parviennent pas à percer la muraille opaque de ces lourdes nuées ?
Oronius recevait ces objections comme des piqûres. Elles l’impatientaient et l’irritaient. Il trancha :
— Eh bien, l’Alcyon se posera au hasard… à l’aveuglette comme tu dis !
— Pauvre canard ! risqua le mécano à mi-voix. Qu’est-ce qu’il va prendre !
Tout casse-cou qu’il fût, il désapprouvait nettement, cette fois, l’imprudence méditée par le Maître. Il en voyait trop les risques.
Jean Chapuis les redoutait aussi. Il voulut donc appuyer avec plus de précision la réflexion de son second :
— Victor est dans le vrai. Si nous nous trouvions au-dessus d’un terrain d’atterrissage soigneusement repéré d’avance, une descente en vol plané serait peut-être possible : mais le peu que nous en avons pu deviner n’est pas engageant… Et, d’abord, Maître, pensez à ces monstrueuses tours… Si l’Alcyon venait à s’y heurter, il se briserait les ailes.
— Pour l’instant, la réalité de ces tours ne m’est pas démontrée, riposta Oronius sur un ton bourru.
— Il peut exister d’autres obstacles ; leur rencontre serait pareillement néfaste pour votre avion.
Agacé, Oronius éclata.
— Petit inconséquent, serais-tu donc d’avis de renoncer ? Comment, le pôle est là, sous ton nez, plus mystérieux que personne n’aurait su l’imaginer. Et tu te contenterais de le regarder de loin, sans chercher à fouiller son secret. Ah ! par ma foi, je te renierai pour mon élève, si la voix de la prudence parle en toi plus haut que toute autre voix !
L’ingénieur réfléchissait.
— Maître, ne pourrait-on allier la prudence à la curiosité ? Si le vol plané serait une folie, il y a un autre moyen moins dangereux de risquer l’aventure.
La physionomie d’Oronius s’éclaira.
— Lequel ?
— Oui, lequel ? Je serais curieux de le connaître ? répéta Laridon, en se rapprochant.
— La descente en pierre ! Ne sommes-nous point parés pour oser cette chute sans casser du bois ?
Oronius et le mécano applaudirent.
Avec le merveilleux avion, l’acrobatie proposée par Jean Chapuis ne présentait pas l’ombre d’un danger.
Il s’agissait tout bonnement de s’enfermer dans la carlingue et de se laisser tomber au sein du brouillard, les ailes repliées et mises à l’abri de la carapace.
En effet, cette chute verticale – analogue à celle d’une pierre, ce qui lui valait son nom – pouvait être sans cesse modérée par des émissions de contre-courants ralentisseurs. Toutes les dix secondes, ces courants passant sous l’avion, devaient retarder sa chute en absorbant sa vitesse, qui se trouvait ramenée à zéro. C’était donc, pratiquement la suppression de l’accélération. Et l’avion devait toucher le sol sans qu’il pût en résulter aucun dommage, pour lui, ou pour ses équipiers.
Adoptée d’enthousiasme, la proposition de Jean Chapuis fut aussitôt mise à exécution. Tous reprirent leurs places à bord et, déployant ses ailes, l’Alcyon s’élança au-dessus de la mer de nuages.
Pendant quelques secondes, il la survola, ce qui permit aux passagers de se rendre un compte approximatif de l’étendue considérable de la plaine enfermée par la cuvette polaire.
Puis, soudain, les ailes se replièrent et le rideau métallique de l’enveloppe protectrice se déroula, emprisonnant l’avion. La chute verticale dans le brouillard commença aussitôt, coupée de dix en dix secondes, d’arrêts ralentisseurs.
Au bout de trois minutes et sans avoir encore touché le sol, l’avion sortit du brouillard.
Presque aussitôt il se posait mollement au milieu d’un océan de verdures.
Les trois femmes poussèrent des cris d’émerveillement et les hommes s’extasièrent.
Ils retrouvaient le jour – la lumière et la chaleur solaire des contrées les plus favorisées de la terre.
Sous le ciel de brume, un été perpétuel régnait et faisait éclore la végétation tropicale. L’air embaumait ; sous des voûtes de fougères géantes – aussi hautes que des peupliers – un tapis de fleurs délicates s’étendait à perte de vue pour la joie des regards. Des sources chantaient sous la chevelure du gazon. De toutes parts des buissons de feuillages mettaient à portée des convoitises les merveilleux fruits qu’une nature prodigue y suspendait.
Sorties les premières de l’aéroplane, les jeunes filles respiraient avec délices cet air tiède et parfumé. Elles avaient rejeté leurs vêtements protecteurs et leurs masques. Revêtues seulement de leurs gracieuses tuniques de fil d’amiante, elles couraient parmi les buissons et les fleurs.
Moins prompts à se laisser aller au ravissement des sensations, disciplinés par leur raison qui prétendait toujours et avant tout analyser les causes au lieu de s’abandonner aux effets, les hommes contemplaient avec stupéfaction cet été artificiel, qui fleurissait à la surface du pôle austral.
Ainsi, sous le couvercle de nuages maussades qui les séparaient de la demi-nuit polaire, et du terrible froid, meurtrier des germes, la vie, la lumière et la chaleur, miraculeusement reconstituées, régnaient !
Miraculeusement reconstituées !… D’une phrase, Oronius expliqua et constata le miracle.
— Le Soleil ! Car c’est lui, c’est bien lui ! Ce sont ses rayons, sa chaleur, sa lumière, tous ses principes vivifiants dont devrait être sevrée la nuit glaciale du pôle, qui se retrouvant ici, réadaptés, après avoir été captés et dissociés à des milliers de lieues. Voilà à quoi servent les faisceaux de radiations décomposées que nous avons vu aspirer par les tours… Le résultat du travail des tours est devant vous, nous l’avons sous les yeux !
Il conclut avec logique :
— Donc, les tours existent. Nous n’avons été les jouets d’aucune illusion… Et les intelligences qui les ont imaginées, édifiées et utilisées existent tout aussi nécessairement… Il nous reste à les découvrir et à entrer en communication avec elles.
Débordant d’enthousiasme, il reporta ses regards autour de lui.
Mais il ne put apercevoir le foyer ou les foyers d’où partaient les rayons solaires reconstitués. La lumière capturée baignait tout le paysage, se glissait entre les feuilles, tombait par les jours de la voûte de fougères. Et précisément parce que ces arceaux cachaient le ciel et que, dans toutes les directions des écrans de verdure arrêtaient les regards, il était impossible de se rendre compte de la façon dont se diffusaient les rayons.
— Avançons, ordonna brièvement le Maître.
Il frappa dans ses mains pour rassembler les jeunes filles et prit la tête de la troupe.
— On lâche le canard ? demanda Laridon, désapprobatif.
— L’Alcyon n’a rien à craindre des ingénieux habitants de ce paradis, affirma Oronius. D’ailleurs, dans ce puits de feuillage, il est aussi dissimulé qu’on peut l’être… Il nous suffira, au cours de notre marche, d’établir quelques points de repère pour nous faciliter le retour… Peut-être auriez-vous préféré rouler en auto, mais il vaut mieux mener pédestrement à cette première reconnaissance. À nous montrer trop armés, au moment d’entrer en contact avec les insoupçonnés colonisateurs du pôle austral, nous ne gagnerions rien, c’est à prévoir. Jaloux de leurs secrets, ils se montreront d’autant plus défiants et moins disposés à nous accueillir qu’ils pourront voir en nous plus de force. La force entraîne l’ambition qui fait l’esprit de conquête. Nous venons en admirateurs et en simples visiteurs, courtois et discrets. Affirmons-le par notre attitude et donnons l’exemple de la confiance.
Ce discours du Maître parvint-il à convaincre tous ses auditeurs. Rien n’est moins certain ; cependant ; nul ne s’avisa d’y opposer une objection.
Flanqué de Pipigg et de Kukuss, dans l’instinct desquels il avait confiance, Oronius partit à la découverte, suivi de tout son monde.
Ils avançaient dans des sentiers sinueux, capricieusement tracés et dont les contours masquaient constamment la vue, ne laissant au regard qu’un champ des plus restreints. À la longue, la promenade y devenait aussi irritante que dans un labyrinthe – et particulièrement pour des gens qui, comme Oronius, étaient dévorés de curiosité impatiente et ignoraient tout des dispositions topographiques du pays qu’ils exploraient.
Le Maître pestait et bougonnait contre l’uniforme platitude du sol. Ce qu’il eût désiré rencontrer, c’était une éminence, afin de pouvoir dominer un peu le paysage et d’en avoir une vue d’ensemble.
— Peut-être tournons-nous le dos aux centres habités ! grogna-t-il à un moment. Ou bien passons-nous à deux pas des fameuses tours sans les voir. Cette façon de marcher entre des murailles de verdure est stupide !
Il n’en existait cependant pas d’autre.
Pour l’apaiser et tenter de le renseigner, Victor Laridon avait eu l’idée de se hisser jusqu’à la cime d’une des fougères géantes. Leur élévation devait en faire d’appréciables observatoires. Mais le tronc-tige de ces végétaux hypertrophiés s’était montré d’une telle flexibilité que le mécano avait dû renoncer à son entreprise. Les fougères les plus vigoureuses en apparence se courbaient sous le moindre poids.
Bon gré mal gré, il fallut donc continuer à avancer au hasard et sans y voir plus loin qu’à une vingtaine de pas.
La solitude demeurait complète. En dépit de la multiplicité des sentiers qui s’enchevêtraient sous le couvert de cette singulière forêt, et de toutes les marques d’aménagement par la main de l’homme qu’elle portait, jamais aucune silhouette ne se montra.
Ou bien les polaires fréquentaient peu cette partie de leur domaine, ou bien avertis de la présence de leurs visiteurs, évitaient-ils de se laisser apercevoir.
Cela ne faisait pas le compte du savant.
— Sommes-nous donc dans une forêt enchantée et nous a-t-on condamnés à y errer perpétuellement sans en trouver le bout ?
Il parlait encore, quand, à l’extrémité d’une ramification du sentier, il lui sembla apercevoir une masse sombre, une sorte de rempart élevé en travers du passage.
Son cœur battit d’émotion.
— Nous y sommes ! s’exclama-t-il.
Et il s’élança à toutes jambes vers l’obstacle, suivi d’abord de Jean Chapuis et de Laridon, puis par tous les autres.
La muraille contre laquelle il alla donner, était une paroi lisse et sonore, évidemment métallique. Elle s’étendait à droite et à gauche à perte de vue, en s’infléchissant insensiblement. Cela donnait à penser qu’elle devait être courbe. Mais alors, combien considérable pouvait être son rayon.
Oronius pensa aux immenses tours et leva le nez.
La paroi s’élevait verticale ; elle se perdait dans le feuillage.
— C’est bien le pied d’une des tours ! murmura-t-il. Il s’agit maintenant d’en trouver la porte. Ce sera chose facile.
Ayant partagé sa troupe en deux groupes, il envoya l’une longer la muraille vers la droite, sous la direction de Laridon et gardant avec lui Cyprienne et Jean Chapuis, il entreprit la même reconnaissance dans la direction opposée.
Une heure durant, les deux groupes marchèrent, surpris d’avoir toujours, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, l’interminable muraille. Au bout de ce temps, ils se retrouvèrent nez à nez, ayant chacun longé la moitié de la périphérie de la tour. À l’allure dont ils avaient marché – environ cinq kilomètres à l’heure – cela donnait donc pour le tour entier une bonne dizaine de kilomètres.
Et sur tout ce parcours, ils n’avaient pas rencontré la moindre ouverture. La tour métallique, tout au moins à sa base et aussi haut que le regard pouvait atteindre n’était percée d’aucune porte, d’aucune fenêtre.
— Retournons vers l’Alcyon ! gronda le guide exaspéré. Les indigènes polaires ont une bizarre façon de construire.
— C’est moins accueillant qu’à Paname, c’pas, vieux frère ? murmura le mécano en poussant son coude dans les côtes de Julep.
Sur les pas du Maître, ils rebroussèrent chemin et voulurent refaire le trajet déjà parcouru, en utilisant les marques faites aux tiges des fougères.
Mais au bout de quelques détours, ils durent s’arrêter, confondus et découragés.
À l’entrée de tous les sentiers, tous les troncs portaient des marques identiques à celles qu’ils avaient faites. Une main invisible et malicieuse les avait multipliées après leur passage, de manière à brouiller la route.
Alors, ils se rappelèrent avoir entendu, dans le feuillage, de singuliers bruits, des froissements de branches, des battements d’ailes. Ils ne s’en étaient pas inquiétés au moment, les ayant attribués à quelques oiseaux.
Maintenant, ils ne pouvaient accuser les oiseaux d’avoir brouillé leur voie, se rappelant le vol d’ailes qui les avait entourés en haut du rocher, quand la nuit les enveloppait ; ils eurent, pour la seconde fois, une impression de malaise – l’impression d’une présence hostile et échappant à leurs sens.
Anxieusement, ils jetèrent les yeux autour d’eux et sondèrent les profondeurs vertes.
Ils ne découvrirent aucune forme suspecte. Et, cependant, dans toutes les allées, le feuillage semblait agité sous d’invisibles frôlements.
Aucune brise ne soufflait. L’air était absolument calme. Qu’est-ce donc qui faisait plier les branches ? Et pourquoi se redressaient-elles ensuite d’elles-mêmes, comme après le passage d’êtres animés ?
Le même bruit d’ailes presque silencieuses émut leurs oreilles…
Or, ils ne voyaient rien…, rien…
Oronius fit un signe. Ils se remirent en marche, errèrent au hasard, ne comptant plus que sur une chance favorable pour les ramener dans le voisinage de l’avion.
Ils revirent la même tour… ou d’autres… puis ils rencontrèrent d’autres constructions, pareillement métalliques et closes à la base, immuablement.
Sans aucun doute, on avait voulu les rendre inaccessibles par le sol. Si ceux qui les habitaient n’y demeuraient pas perpétuellement prisonniers, ils ne pouvaient en sortir ou y rentrer que par la voie des airs.
Cela – joint aux singuliers bruits perçus par ses oreilles – commençaient à donner beaucoup à penser à Oronius.
Ils poursuivirent leur exploration, sans rencontrer aucun être animé. Et, cependant, partout, ils découvrirent des preuves d’une civilisation ingénieuse : ce paradis portait des traces de culture ; il y avait des routes géométriquement dessinées, des canaux d’irrigation.
Ils arrivèrent enfin sur la lisière de l’interminable forêt, au bord d’une étendue d’eau…
C’était la mer : des vagues l’agitaient. Mais tout le rivage était aménagé en vue de la captation et de l’utilisation de leur énergie motrice... Les polaires ne dédaignaient pas la houille verte.
Certains instruments abandonnés semblaient indiquer que le travail avait été récemment et brusquement interrompu en cet endroit. Il y avait eu comme une fuite de travailleurs, causée par une alerte.
— Ce ne peut être que notre approche, s’étonna Oronius. Je ne m’explique pas pourquoi nous leur causons une telle frayeur ! Pourquoi refusent-ils de se laisser apercevoir !… d’entrer en contact avec nous ?… Il est cependant impossible qu’ils se croient inférieurs à nous en force. Je voudrais bien avoir le mot de cette énigme.
— En tout cas, ce jeu ne saurait se prolonger, fit observer Jean Chapuis. Il va bien falloir qu’ils prennent une décision à notre égard. Ils ne peuvent longtemps continuer à suspendre leurs travaux, leur existence, et nous abandonner la jouissance de leur paradis pour se livrer aux émotions de cette partie de cache-cache… Tôt ou tard, bon gré mal gré, nous en attraperons un, et alors…
Penché sur une cuve dont il examinait le contenu avec curiosité, Oronius y trempa négligemment sa main droite et demanda sans se retourner.
— Mais pouvons-nous les apercevoir ? Peut-être rôdent-ils autour de nous en ce moment… Peut-être sont-ils à deux pas, nous observant et attendant que nous quittions la place pour se remettre au travail… S’il en est ainsi, nous ne pouvons les gêner beaucoup et nous nous lasserons du jeu plus vite qu’eux.
— Comment serait-ce possible ? s’exclama Jean Chapuis interloqué. S’ils étaient là, nous les verrions… Je ne comprends pas ce que vous voulez dire…
— C’est cependant clair… et fort simple, riposta le Maître en se relevant. Nous avons affaire à des êtres qui possèdent le pouvoir de se rendre invisibles. Il leur suffit de se baigner dans cette solution…
Et Oronius tendit vers ses auditeurs son bras droit.
— Père, ta main ? On a coupé ta main ! pleura Cyprienne désolée.
Effectivement, au bout du bras tendu par le savant, ne se voyait qu’un moignon.
— Mais non, fillette, rétorqua le Maître en souriant. Ma main est bien à sa place, mais elle a cessé d’être visible depuis l’instant où j’eus l’idée de la tremper dans cette cuve.
CHAPITRE IIIUN MONSTRUEUX INSECTE
Incommensurablement stupéfaits – et presque incrédules, malgré l’affirmation du Maître – tous s’étaient élancés et palpaient sa main. Ils la sentaient sous leurs doigts ; ils pouvaient la presser. Mais ils avaient cessé de la voir. À l’extrémité du poignet d’Oronius, il y avait comme une cassure irrégulière, dont les dentelures marquaient la limite de l’action du liquide.
— Mince d’inconnobré(5) ! laissa tomber le mécano. Quel genre de jus est-ce là ? Le savez-vous, patron ?