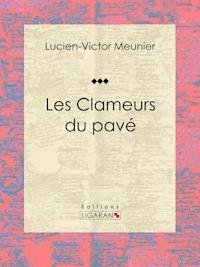
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le ciel est gris, orageux, sinistre. Des nuages amoncelés, lourds, noirs, cuivrés par places, fouaillés par un vent furieux, courent, déchiquetés, laissant prendre après eux comme de sales haillons. On entend, au loin, un mugissement sourd, un râle. Parfois, un clapotement. Et une gerbe d'écume s'élève, blanche, au-dessus de la ligne des eaux qui se confond là-bas, sombre, avec l'horizon sombre..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050714
©Ligaran 2015
Mars 1884.
Dans un des chapitres de son livre, l’auteur raconte que pendant les jours de la semaine sanglante, il vécut en pleine tempête du canon. Quand la bataille agonisait, se glissant jusqu’à la fenêtre, le gamin vit fusiller un insurgé debout sur une barricade démolie où saignait le dernier drapeau rouge. Il se rejeta en arrière, glacé de terreur, et il en a encore le frisson en y songeant.
Qui a vu ces choses, si jeune, prend vite la haine du massacreur et le goût du combat.
D’autre part, Meunier est le fils d’un excommunié qui ne fit jamais baptiser ses moutards.
C’est une chance d’avoir gigoté dans un berceau auquel on n’a accroché ni médailles ni scapulaires. Les libres-penseurs les plus farouches ne sont souvent que des religiosâtres à l’envers, n’ayant fait que changer de cierge, parce qu’il leur est resté malgré tout dans le sang la goutte d’eau bénite qu’infiltre l’éducation frottée de catéchisme.
Meunier ne s’est pas laissé prendre à l’hypocrisie des jésuites tricolores ou rouges, n’ayant pas commencé par le respect des jésuites noirs, et il est entré dans la mêlée sans avoir le culte d’aucun pontife ni d’aucune relique.
Il n’est arrêté par rien. Il va droit devant lui et se jette au secours de tous les sacrifiés, même quand les clous du sacrifice ont la rouille du crime. Il explique la faute, il excuse le mal. Il ne demande pas aux écrasés des brevets de vertu.
Par ce hardi, le juge est traîné sur la sellette à côté de l’accusé, le mariage civil est fouetté comme le mariage religieux – à tour de bras. Il est contre toutes les tyrannies celles qui lient les mains comme celles qui veulent souder les cœurs. Bravo, mon gas !
Il serait une exception, une sorte de phénomène s’il n’avait pas son estampille de servage quelque part sur la peau.
Il est le serf de son Hugolâtrie. Le romantisme lui sort par tous les pores, empâte son encre et gêne la libre allure de sa phrase.
Il faudra se débarrasser de ça, mon camarade. – Et, pour commencer, si vous m’aviez consulté avant d’attacher une enseigne à votre bouquin, je vous aurais conseillé de ne pas l’appeler : Les Clameurs du Pavé.
Mot déclamatoire ! – Quand on serre de si près que vous la réalité des souffrances humaines, il faut mettre au-dessus d’une étude sur la douleur des simples, un titre simple.
D’entre les pavés il ne sort de clameurs qu’aux époques de grandes tueries ; des clameurs qui déchirent le ciel pendant le premier jour de la bataille. Mais dans le cours ordinaire des choses, celui qui colle son oreille à terre n’entend que des soupirs et des sanglots, des soupirs qu’on étouffe, des sanglots qu’on étrangle. La misère ne hurle pas – la faim bâille !
Les douleurs n’arrivent à se masser, à trépigner sur la place publique qu’après de longues marches dans l’obscurité, pieds nus.
C’est ainsi qu’on les voit passer, isolées et mornes, dans le livre – dont le titre seul a tort.
L’œuvre est honnête, sincère, vivante. Elle fait honte aux livres de ce genre signés de noms célèbres où il n’y a jamais que la flatterie pour les vainqueurs, et toujours le dédain ou l’oubli des vaincus.
Voici un jeune homme qui s’engage à fond dans la lutte ; sans regarder à se faire des parrains ou des ennemis. Il faut remercier ces gaillards-là – surtout quand, chez eux, l’ironie emboîte le pas à la colère. Meunier, né natif de Paris, garde le rire aux lèvres. Il ne me déplaît pas de voir repasser l’eustache de Gavroche sur la faulx de Vindex.
JULES VALLÈS
Le ciel est gris, orageux, sinistre. Des nuages amoncelés, lourds, noirs, cuivrés par places, fouaillés par un vent furieux, courent, déchiquetés, laissant pendre après eux comme de sales haillons.
On entend, au loin, un mugissement sourd, un râle.
Parfois, un clapotement. Et une gerbe d’écume s’élève, blanche, au-dessus de la ligne des eaux qui se confond là-bas, sombre, avec l’horizon sombre.
Sur la grève on se presse, on attend. C’est la grande marée.
Le vent fait voler en pluie fine le sable. Un grain : des gouttes d’eau bousculées, rageuses ; on s’abrite tant bien que mal sous des parapluies qui se courbent, gémissent. On regarde.
La mer s’avance. Par petites lames d’abord qui meurent sur le sable, étalées, lançant devant elles des rouleaux d’écume qui semblent ramper pour gagner quelques centimètres de plus, et que l’aquilon enlève en larges flocons. Puis les grosses vagues arrivent.
Poussant de formidables clameurs. On les voit accourir pressées, se bousculant, jetant vers le ciel gris d’éblouissantes envolées d’écume. Le vent hurle.
Des montagnes d’eau, énormes. Elles arrivent dans un bercement rapide, soudainement se dressent, effroyables, gigantesques, puis se creusent et retombent en cascade dans un rejaillissement superbe de blancheur écumante. Et après une autre, une autre. Une autre encore après. Elles se suivent, grimpent les unes sur les autres, se précipitent, se ruent, comme si la mer donnait l’assaut à la terre.
Les curieux rassemblés sur la plage, se taisent. Pas une plaisanterie. Pas un rire bête. Cette majesté sublime emplit tous les cœurs d’une sorte de recueillement.
L’ouragan infatigable chasse les vagues en avant. Elles montent. Toujours plus effrayantes, hautes ainsi que des maisons, s’écrasant sur le sable, roulant les galets, emportant dans leur irrésistible remous les algues marines et les épaves de toute sorte amenées du large.
L’homme, en contemplant cette puissance, se sent petit.
Par une éclaircie des nuages qui, craquelés, se frangent d’adorables tons roses, le soleil déjà bas, envoie, en gloire, ses rayons pâles sur l’Océan déchaîné. Il semble que les flots aient rompu toute entrave. Encore, encore des vagues, qui balayent tout et se retirant, sont ramenées par d’autres, acharnées. Pas une voile à l’horizon. La réverbération du couchant, pourprée, sur la mer verte.
La lune, à l’autre bout du firmament, se lève, ronde et rouge.
Et l’on pense à l’autre marée qui viendra, que nous verrons.
Car déjà on entend au loin, le mugissement sourd, le râle fait de pleurs, de cris de colères, de gémissements, d’imprécations désespérées ; le râle de ceux qui souffrent ; le râle des prolétaires à bout d’agonie.
Ah ! ils viendront. Regardez : ils viennent. Leur formidable phalange s’ébranle. Ils accourent en bandes pressées, tumultueuses, vers ceux qui les grugent, les exploitent, les volent, les tuent. Et ceux-là essayent de fuir, d’échapper à la marée montante. Peine inutile. Le peuple soulevé submerge tout. Le déluge. Il fait justice des traîtres et courbe les imbéciles sous son talon puissant. Regardez. Qu’importent que les premières vagues soient brisées et que des corps sanglants soient rejetés au large, mutilés ? D’autres combattants arrivent, invincibles, et, sous leurs coups répétés, voyez les bastilles géantes qui croulent et s’effondrent !
Maintenant la mer est montée, « bat son plein. »
Une tranquillité sereine sous le regard ami des astres resplendissants. Tout à tous. La force unie au droit victorieux. Cherchez les têtes qui s’élevaient naguère, ambitieuses, pleines de coupables pensées. Plus rien ne dépasse le tranquille niveau des eaux souveraines. Plus de cris de haine ou de fureur. Un chant calme monte vers le ciel, d’harmonie, de bonheur et de paix.
Seulement, lorsque l’Océan a atteint son plus haut point, il se retire, abandonne le terrain si péniblement conquis ; le peuple, lui, une fois la bataille commencée, ne marchera plus qu’en avant.
Je compulse les journaux. Voici ce que j’y trouve :
Rue Villejust, une famille meurt de faim. Le père, balayeur, phtisique au dernier degré, s’épuise à gagner trois francs par jour. Six enfants malades, presque tous poitrinaires comme le père. La mère malade depuis quinze mois. Pas de pain, – c’est à la lettre.
Rue Haxo, autre famille. Le père malade, la mère enceinte, cinq petits enfants. Le père, à bout de forces, meurt. La femme presque au même moment accouche de deux jumelles. Huit personnes. Pas de pain.
Rue de la Clef, une veuve, cinq enfants en bas âge. Depuis plus d’un an, elle lutte contre la misère sans cesse grandissante. La voilà terrassée par l’impitoyable maladie. Pas de pain.
Rue du Chemin-Vert, une femme, quatre enfants. Le mari depuis plusieurs semaines à l’hospice. Dénuement absolu. Pas de pain.
Rue Amelot, encore une veuve. Depuis longtemps elle soutient de son travail son enfant et sa vieille mère aveugle et infirme. Mais son faible gain a toujours été insuffisant. Ses forces maintenant déclinent. Pas de pain.
Refrain lugubre.
On pourrait appeler cela : promenade dans les quartiers ouvriers de Paris,
Et, à côté de celles-ci, que de misères encore ! Et de plus effroyables ! – On reste muet. Le cœur se tord…
C’est un homme riche que le duc de Westminster. Son capital se monte à quatre cent millions de francs. Jolie somme. On peut vivre avec cela. Qu’en pensez-vous ?
Pourtant ne prodiguez pas vos cris d’admiration. Le sénateur américain Jones compte cent millions de plus. Un demi-milliard, peste ! Cela lui fait quelque chose comme soixante-quinze mille francs à dépenser par jour. À la bonne heure, cela vaut la peine.
Pas trop ! penserait Rothschild. En effet ce banquier possède, lui, le milliard tout entier, indemne, et, comme on dit, – sans doute par une sanglante ironie, – ne devant rien à personne.
Westminter n’a eu que la peine de naître, Jones et Rothschild se sont enrichis dans des jeux de Bourse. Fortunes légitimement acquises. Parbleu !
Combien d’êtres humains ont, tout le cours de leur misérable vie, peiné, souffert, sué sang et eau, sont morts, le désespoir au cœur, dans les mines d’argent du yankee Mackay pour lui procurer les treize cent soixante-quinze millions dont il jouit à présent ! Voilà une fortune !
Tenons compte des non-valeurs. Tout le capital ne rapporte pas au même taux. Soyons modestes. N’accordons à celui-ci que cent vingt-cinq mille francs de revenu par jour. Cela représente le produit du travail de plus de cinquante-cinq mille hommes.
Mais tout cela n’est rien encore.
Place au nabab ! Place à Vanderbilt !
Celui-là, c’est le bouquet. Capital : un milliard cinq cent millions. Bravo ! Applaudissez donc. Cela vaut la peine d’être admiré. Revenu : soixante-quinze millions par an ; par jour : deux cent mille francs ; par heure : huit mille trois cents francs ; par minute : cent trente-huit francs ; par seconde : vingt francs. Un louis ! – Ça, voyez-vous, ç’a été gagné dans des spéculations sur les chemins de fer, – avec le secours de l’État. Bon État. – Tirons l’échelle. C’est là l’homme le plus riche du globe. Cela suffit » n’est-ce pas ?
Voilà.
D’un côté, misère, deuil, faim ; de l’autre, richesse, opulence à n’en savoir que faire.
D’un côté, ceux qui crèvent de besoin ; de l’autre, les repus, les gavés.
Maintenant étonnez-vous de voir des lueurs saignantes traverser les yeux hagards du prolétaire las de souffrances, de sa haine et de ce que, parfois, sa main laisse tomber l’outil impuissant à le nourrir, et cherche une arme.
La salle est petite, oblongue, toute de boiseries brunes, pleine de monde. Au fond, le public. Entassement de têtes, profils perdus, contours mal accusés, mous.
Le rayon de soleil entré par les hautes fenêtres se pose çà et là sur un bijou, un bouton de métal, pique de points brillants la masse sombre.
Les hommes sont nu-tête ; devant la justice.
Sur les bancs, des gardiens de la paix, les témoins, effilant leurs moustaches et regardant avec des yeux ronds, sans rien voir.
La cour. Ici, pas de ces robes sanglantes comme en étale le sinistre appareil des assises ; tout est noir, tout est deuil. Trois juges, l’air ennuyé et sinistre, bâillant. Le ministère publie qui écrit, écrit toujours. Dessous, l’audiencier, gras, avec des favoris en côtelettes, un triple menton bleuâtre.
Puis, pressés sur une banquette, ayant derrière eux les gendarmes impassibles, attendant leur tour, les « flagrants délits ».
Le défilé de la misère.
Oh ! qui que vous soyez, vous, qui jamais n’êtes descendus dans les bas-fonds sociaux, pour qui ce mot : la Misère, ne présente qu’un aspect vague et conventionnel, allez-là, asseyez-vous une heure, écoutez. Et la sueur perlera sur votre front, des frissons courront, froids, le long de vos reins, l’émotion vous prendra à la gorge, l’angoisse.
Un enfant, seize ans. Il en paraît huit, dix au plus. En haillons. Bruni par le soleil. Des cheveux noirs, luisants, plaqués sur les tempes, des yeux de bête, égarée et troubles. Vagabond.
Un témoin. La mère. – C’est à vous cet enfant-là ? – Oui, monsieur, malheureusement. – Ce n’est rien de bon, n’est-ce pas ? – Oh ! non, monsieur, allez ; rien à en faire. – Trois mois de prison. À un autre.
Un vieillard. Blanc de cheveux. Soixante ans. Déjà treize fois condamné pour mendicité et vagabondage. Il pleure. En prison. À un autre.
Celui-ci avait faim. Il a mangé ; n’a pu payer. Le restaurateur l’a fait arrêter. Il a dépensé vingt-deux sous, n’en possède que dix. En prison pour douze sous. À un autre.
Une fille, coiffée à la chien ; un maigre bout de dentelle au bord de son pauvre corsage bleu. Jeune encore, elle a dû être jolie. L’alcool et la débauche ont flétri ses traits. Elle a résisté aux agents, s’est roulée par terre. À celle-ci des velléités de révolte viennent. Elle veut parler.
– Quand ces messieurs vous arrêtent, dit-elle, ils se conduisent tellement qu’on est bien forcée…
– De les insulter, finit le président, ironique. – Trois mois de prison. À un autre.
Encore un enfant. Vagabond récidiviste. Dix-sept ans. Petit et maigre. Hailloneux. L’air inconscient, hébété. En prison. À un autre.
Un vieux, face plombée. Hier ramassé par la police, il se débat, hurle. Ne se rappelle plus rien maintenant. Un mois de prison. À un autre.
Une femme, avec sa petite fille. Elle a aussi insulté les agents. Elle nie. Quand le gardien de la paix qui l’a arrêtée fait sa déposition, elle invoque le ciel. On rit. En prison. À un autre.
Ils sont deux. Un a quinze ans, l’autre vingt. Sans domicile. Ils ont mangé, dépensé quatre francs vingt centimes. N’ont pu payer. En prison, l’aîné. L’autre, mineur, est gardé. On tâchera de retrouver ses parents. À un autre.
Une prostituée, vieille, laide, descendue bien bas dans l’abîme de la misère et du vice. Raccrochée par un homme peu difficile, elle est partie pendant que celui-ci dormait, lui emportant vingt-cinq francs et sa montre : – De quelle valeur était cette montre ? demande le président. – Oh ! répond le plaignant bonasse, elle m’a bien coûté soixante ou soixante-dix francs, mais je l’ai depuis quatre ou cinq ans. – Circonstance atténuante. En prison. À un autre.
Un ouvrier sans travail qui, la faim au ventre est entré chez un marchand de vin, a mangé pour trente-six sous, sans payer, pour cause. En prison. À un autre.
Un vagabond, Dix-huit ans. Pâle et maigre. Déjà condamné pour le même délit. En prison. À un autre.
L’air devient lourd, écœurant ; comme si ce remuement atroce de misères remplissait la salle d’émanations putrides. Il fait chaud. Les fronts s’épongent. Des journalistes entrent, s’asseyent, écoutent un moment. Rien d’intéressant. Reparlent. Des avocats viennent s’accouder aux balustrades, causent tout bas en riant. L’audiencier crie : Silence. Le bruit confus des conversations couvre parfois la voix des accusés. Une toux résonne. Un éternuement.
Et, à mesure que les uns sortent condamnés, d’autres arrivent, poussés par les gendarmes. Il y en a toujours. Enfants, vieillards, hommes, femmes, les uns abattus, d’autres cyniques, la plupart sans paraître rien comprendre, quelques-uns avec une flamme mauvaise au fond de leurs yeux creux.
J’étouffe. Il me faut de l’air. Il me semble voir tous ces misérables, spectres, autour de moi. Je les repousse, je me sauve.
Et pendant que je traverse, en hâte, les rangs pressés du public, la voix monotone du président répète derrière moi : – Le tribunal en ayant délibéré, conformément à la loi… condamne… – Toujours. Toujours. Interminablement.
Voici l’été fini. – Les théâtres rouvrent, Paris se repeuple et les plages, que déserte le monde chic, prennent un aspect vide et désolé.
Devons-nous être contents ! Ils reviennent les belles dames et les beaux messieurs. Dans peu les bals vont recommencer et les journaux mondains se remettront à nous décrire par le menu la toilette que portait Mme Z… à la sauterie de Mme K… – Quelle satisfaction !
Tous les endroits où se donne rendez-vous le Paris qui s’amuse, déjà se réveillent. Les revoici les jolis gommeux, décorés de gardénias. Bien contentes, ces demoiselles. C’est dans toute l’allée des Philosophes un frissonnement de plaisir. Allons ! à l’amour ! Allons ! au bac ! Les louis dansent. Parbleu ! pour ce qu’ils leur ont coûté, à ces fils d’enrichis !
On a passé tout l’été à Luchon, à Dieppe, à Deauville ; on s’est promené le long des grèves ;’on a, une demi-douzaine de fois, trempé son maigre corps dans l’eau salée ; on a regardé la mer du haut de la falaise ; on se serait ennuyé à mourir si le Casino n’avait pas été là.
De bonne foi, la mer, quoi de plus assommant ? C’est toujours la même chose. Des vagues, puis des vagues et encore des vagues ; elles avancent et reculent avec un bruit monotone. Quand on a vu ça une fois, on en a assez. Alors ces messieurs du vlan cherchent des distractions.
Une seule est à la portée de leur intelligence éteinte et de leurs muscles amollis.
Le jeu. Toujours le jeu.
Le soir, parbleu ! il y a le bac, puis les petits chevaux et le mât de cocagne, où l’on peut encore facilement faire fondre la galette gagnée par les ouvriers de papa. Mais le jour, il fallait absolument trouver quelque chose. On a trouvé.
Il y a des génies dans la gomme. Témoin ce duc de Morny qui, avant de se faire une célébrité par le suicide de sa maîtresse, s’en était faite une par la manière d’attacher sa cravate.
On a donc inventé de nouveaux petits jeux, exquis, idiots à souhait.
Est-ce que vous n’auriez pas encore entendu parler du jeu des huîtres ? C’est tout à fait charmant. Chaque joueur fait choix d’un mollusque et dépose sur le bord de la coquille l’enjeu convenu, le louis traditionnel. Puis on attend avec émotion. Celui dont l’huître se ferme la première a gagné. Que voilà donc un passetemps délicieux ! Vous comprenez : le crocket, le lawn-tennis, c’est bien, oui, mais trop fatigant. Et puis il faut encore une certaine adresse. – Tandis qu’on peut être parfaitement abruti et jouer aux huîtres.
Ce qui explique la faveur dont jouit ce joli jeu auprès des boudinés.
Ceux, pourtant, qui ne craignent pas de se donner un peu d’exercice, aiment assez la course aux grenouilles. Très ingénieux, cela. Chaque joueur est en possession d’une brouette plate sur laquelle sont placées trois grenouilles. Il s’agit d’arriver au but avec ses trois batraciens. Naturellement, le premier mouvement des grenouilles est de sauter par terre. – Sans doute pour fuir la mauvaise société où elles se sentent compromises dans leur dignité d’animaux.
Il faut courir après, les replacer sur la brouette. Souvent, toutes les trois se sauvent à la fois et de côtés différents. On parie là-dessus de fortes sommes. Seulement on ne joue pas longtemps. On s’échauffe trop. On pourrait s’enrhumer.
Aussi, ce qu’on aime encore le mieux, c’est la course aux crabes.
On sait que, posés sur le sable, les crabes ont une propension naturelle à regagner l’eau par le plus court chemin. C’est sur cet instinct que se base le jeu en question. Chaque joueur prend un crabe. On en place une demi-douzaine sur la même ligne, et en avant ! Le premier arrivé à la mer, bien entendu, fait gagner son propriétaire. Une façon comme une autre de remplacer Longchamps et la Marche. Et l’argent roule. On se passionne. On a « son » crabe. Déjà quelques-uns sont devenus célèbres. Ils ont des noms tout comme Gladiateur et Fille-de-l’Air. Attendons-nous à voir, l’an prochain, ce nouveau genre de sport prendre une grande extension. Il y aura des entraîneurs de crabes. Les courses auront pour but avéré d’améliorer la race carcinienne. Les crabes porteront les couleurs de leurs « écuries ». Des bookmakers apparaîtront. Et peut-être un jour on apprendra que monsieur un tel, pschutteux distingué, s’est fait sauter le peu de cervelle qu’il possédait, ruiné par la faute de son crustacé favori.
Et voilà comment « tue le temps » la jeunesse bourgeoise de France. N’est-ce pas qu’on est fier d’être de la même race que ces gens-là ?
De la même race, ai-je dit ? Ah ! non ! non ! Nos semblables, ces mièvres bonshommes, rachitiques, anémiques, exsangues, têtes vides et bras mous ? Allons donc ! Nous, un sang chaud coule dans nos veines et dans nos cerveaux s’agitent de viriles pensées. Ils ne valent pas, eux, la peine qu’on s’irrite de leurs sottises et leurs niais amusements amènent tout au plus sur nos lèvres un court sourire de dédain. Leurs prédécesseurs, au moins, la jeunesse dorée du Directoire, défiaient les patriotes, gourdins au poing ; on pouvait lutter avec eux ; mais ceux-là ! il suffira d’un geste du peuple enfin dressé pour les faire s’évanouir comme des ombres, et, l’ouragan passé, on cherchera en vain les traces de leur existence.
Amèrement, l’autre jour, un instituteur-adjoint s’est plaint à moi de n’être pas suffisamment rétribué.
Il n’a pas tout à fait tort. Sept cents francs par an. Cinquante-huit francs trente centimes par mois. Sa nourriture – et on ne l’accusera pas d’être gourmand – lui coûte mensuellement quarante-cinq francs : trente sous par jour. Maigre chère assurément. Pour se loger, vêtir, blanchir, etc., il lui reste donc la somme de treize francs trente centimes. Que deviendrait-il, seul ? À vrai dire, il a encore ses parents qui, de temps en temps lui viennent en aide. Mais ils sont pauvres eux-mêmes, l’éducation de leur fils leur a déjà coûté bien de l’argent. Celui-ci – il a dix-huit ans – voudrait pouvoir se suffire à lui-même. Il adresse au ministre de l’instruction publique une demande de poste en Algérie, où les appointements plus élevés lui permettront de vivre. Mais comme il a peur que sa demande, confondue dans un tas d’autres, ne soit pas exaucée, faute de protections, il me demande la mienne… Bonne plaisanterie.
Ce malheureux, en effet, n’est pas seul de son espèce ; ils sont beaucoup, beaucoup, les jeunes maîtres d’école à qui le gouvernement alloue un traitement de sept cents francs par an.
C’est-à-dire qu’il les condamne absolument à la misère, qu’il les force pour ainsi dire au découragement, qu’il les dégoûte inévitablement de leur métier ; car vous avouerez qu’il faut avoir l’âme solidement trempée pour envisager sans défaillance de longues années à sept cents francs, l’une dans l’autre, et, au bout de celles-ci un lent et graduel avancement de quelques sous.
On peut, il est vrai, rappeler que pendant la Restauration, par exemple, il n’était point rare de voir un jeune sous-maître nourri et logé par son instituteur, recevoir pour toute rétribution, la somme de cinq francs par mois. C’était alors, dans toute sa splendeur, le gouvernement des curés. Il faut convenir que depuis les choses ont changé. La République a fait beaucoup pour l’instruction publique. Elle n’a pas fait assez.
Non. Car cet homme si dérisoirement payé, c’est le principal fonctionnaire de la République. Nous avons énormément de fonctionnaires en France. Trop. Assurément, on pourrait réduire de beaucoup le nombre des plumitifs bureaucratiques » ; à coup sûr, le besoin des préfets et des sous-préfets ne se fait pas partout également sentir ; certes, il vaudrait mieux se passer de ministres que de maîtres d’école. Les seuls « maîtres » que nous soyons encore en humeur de souffrir. S’il est un personnage dont les mains renferment une partie de l’avenir du peuple, à coup sûr, c’est l’instituteur primaire. La nation devrait honorer celui qui apprend à lire à ses enfants.
Est-ce l’honorer : le mettre dans une condition tellement inférieure, tellement misérable, que les élèves rient forcément de ses vêtements râpés et de sa triste mine ? Il ne faut tolérer chez lui aucune négligence dans l’accomplissement de ses devoirs. Mais peut-on demander tout son temps, tout ses soins, un zèle continu, constant, à l’homme à qui l’on ne donne pas de quoi manger ? La France est-elle pauvre à ce point ? Ou, s’il n’y a vraiment plus d’argent dans les coffres, ne peut-on en prendre à ceux qu’on paye trop pour le donner à ceux qu’on ne paye pas assez ? Non, ce n’est pas pauvreté, c’est mauvais emploi des fonds. Holà, dites donc, là-bas, vous ! les prélats, curés, vicaires, toute la clique, rendez donc un peu l’argent qui appartient aux maîtres d’école !
Ceci se fera. Qu’on y songe, et se hâte. L’école est le chantier où s’échafaude l’avenir. Et comment voulez-vous qu’il soit bon et qu’il se dévoue tout entier à sa noble tâche, et qu’il inspire aux enfants l’amour de la République et de la France, l’instituteur, s’il a contre la République et la France la rancune des malheureux que leur mère laisse mourir de faim ?
J’étais seul, l’autre soir, sur l’impériale de l’omnibus. Il était tard, plus de minuit. Les rues se faisaient désertes, silencieuses. Du ciel gris que ne trouait aucune étoile tombaient de temps à autre quelques larmes froides. Par moments on apercevait un passant attardé dont les pas hâtifs sonnaient dans le silence. Les débits de boissons se fermaient. Tout devenait noir. La flamme des becs de gaz tremblait au vent.
Le cocher, un vieux, tout gris, s’est mis à me parler. Il n’était pas de bonne humeur, – Vous verrez que ça va encore dégringoler, me dit-il en désignant les nuages du bout de son fouet. Et comme je répondais : – C’est bien possible, – il s’est tourné vers moi. La conversation était engagée.
– Ma foi ! lui dis-je, je suis encore heureux d’avoir pu vous pincer. C’est le dernier omnibus, n’est-ce pas ? – Oui, répondit-il, c’est moi le « balai » aujourd’hui ; celui qui ramasse les voyageurs en retard ; chien de service ! Va falloir encore conduire la voiture au dépôt. Alors j’aurai mes dix-sept heures bien comptées. Malheur !
Je vis que notre causerie ne serait pas précisément folâtre, mais c’est un soulagement pour les malheureux que d’énumérer leurs misères, je le sais. Bonne chose aussi pour nous autres. Rien n’attise la colère comme la contemplation d’une plaie vive. J’ai donc laissé grogner le cocher, décidément de mauvaise humeur.
Il m’a raconté sa vie, sa vie de travailleur accablé. Depuis vingt ans, il est cocher de la Compagnie ; depuis vingt ans, hiver comme été, tantôt gelé sur son siège, tantôt brûlé de soleil, il conduit le même omnibus dans les mêmes rues. Six francs par jour. Encore est-il heureux. Les jeunes, ceux qui entrent, n’ont que cinq francs. Et bien qu’il ait toujours été d’une ponctualité scrupuleuse, sobre, ne buvant jamais, il n’a pas évité les punitions. Comment les éviter ? Des mi ères, tout le temps. Pas de semaines sans anicroche. Des dénonciations parties on ne sait d’où, venant des mouchards que la Compagnie fait voyager sans cesse sur ses lignes, et que les employés ne connaissent pas.
Vingt ans. À la lueur rapide des réverbères devant lesquels nous passions, je regardais la figure usée du vieux, ses traits fatigués, flétris, où se lisaient toutes les privations subies. Six francs, quand il y a des mioches à la maison, c’est pas bien lourd. Sa vie ? Oh ! elle était courte à raconter. Une lutte de tous les instants contre la misère. Des angoisses périodiques au moment du terme. Les pauvres nippes au clou. Les danses devant le buffet les jours où les amendes avaient donné. Pas une échappée de lumière dans toute cette nuit.
– Tant que je pourrai tenir mon fouet, me disait-il, ça ira. Mais, voyez-vous, la vue baisse, la main tremble. Un beau jour, on va me flanquer à pied. Qu’est-ce que nous deviendrons, la vieille et moi, avec mes deux cent cinquante francs de retraite, et les vingt sous par jour qu’on me donnera si je ne peux rien faire du tout ? Ça sera dur.
Un long soupir sortit de sa poitrine rétrécie. Les chevaux trottaient, tête basse, glissant sur le pavé gras. Il ne les frappait pas, les encourageait de la voix, doucement. Entre les bêtes et l’homme, il y avait fraternité de malheur.
Il m’a appris bien des choses, le vieux cocher. Comment lui et ses pareils, en entrant au service de la Compagnie, versent un cautionnement de cent francs, qui – naturellement – ne leur rapporte aucun intérêt. Comment, chaque quinzaine, – le jour de la paye, – on leur retient tant pour l’habillement, tant pour la retraite, tant pour la caisse de secours. Comment, en entrant, ils signent – sans le lire – un engagement qui les livre pieds et poings liés à la Compagnie ; qui, par exemple, – pour ne citer qu’un seul détail, – les soumet à un règlement que l’administration se réserve le droit de modifier à sa guise. Comment ils vivent ainsi sous le poids de l’arbitraire le plus odieux. Comment, s’ils sont malades, on leur alloue deux francs par jour. D’autres choses encore.
Et pendant qu’il me parlait, tristement, lentement, certains chiffres me revenaient en mémoire. Je me souvenais qu’en 1880, notamment, les bénéfices réalisés par la Compagnie générale des Omnibus avaient approché de cinq millions.
Nous arrivions à la station.
– Je parlerai de vous, dis-je au cocher.
– Faites-le, répondit-il. Mais à quoi bon ? On l’a déjà fait. On nous a exhortés à nous réunir, à nous grouper. Comment ? Est-ce que nous avons le temps ? Se mettre en grève ? Et manger ? C’est terrible, voyez-vous, quand les moutards pleurent. La Compagnie est trop forte contre nous. Si nous refusions de marcher, elle en trouverait vite d’autres pour nous remplacer. Les malheureux ne manquent pas. Et l’on resterait là, bras croisés, ventre vide. Eh ! oui, nom de Dieu ! – et sa voix montait, – le sais bien qu’on nous exploite, qu’on nous vole ! Que des gueux s’enrichissent de notre travail à nous, qui mourrons misérables comme nous avons vécu ! Oui ! nous le savons. Que faire ?
– Calmez-vous ! lui dis-je.
Il me serra longuement la main.
Pauvre vieux cocher ! Il se peut que ces lignes tombent sous tes yeux. Écoute ! Tu peines, tu souffres, tu ahanes sous le joug. Ne désespère pas. L’avenir est à nous, les prolétaires, écrasés aujourd’hui, debout et triomphants demain.
En dépit des rectifications nombreuses envoyées à la presse par une préfecture de police désireuse de nous faire croire que les attaques nocturnes existent seulement dans nos imaginations épeurées, et que les souteneurs sont un mythe auquel le républicanisme de M. Jules Ferry peut le disputer en fantaisisme, les agents de M. Camescasse ont l’autre soir arrêté un mec authentique, constaté, impossible à nier.
Ce personnage à écailles, demeure à Paris, au Gros-Caillou, et sa marmite, c’est sa propre femme, oui, messieurs.
Une famille réussie. Deux enfants tout petits. Le père atteint d’une flemme chronique et ne retrouvant un peu d’énergie que pour rosser sa femme. La mère qui fait le trottoir.
Une grande blonde, grasse à souhait, de taille fine, aux yeux bleus. Pleine de courage à la besogne. Excusant son mari que l’âge affaiblit soi-disant, et rend inapte au travail. Vous pouvez la rencontrer chaque soir du côté de l’École militaire.
Le mari l’accompagne, à cinquante pas derrière, veillant sur la recette. Et quand celle-ci n’a pas été bonne, la pauvre femme passe un vilain quart d’heure. Il est là aussi pour la défendre, la protéger au besoin. L’autre jour des agents arrêtaient son épouse. Il s’est élancé, a injurié les représentants de la force publique. On l’a coffré, lui aussi.
C’est ainsi que cette édifiante histoire, connue, a fait son petit tour de presse, agrémentée par chaque chroniqueur de réflexions variées.
D’aucuns ont plaisanté agréablement, quittes à s’indigner de façon convenable à la fin de l’article. J’avoue ne rien voir là de précisément folâtre.
Je considère ces faits navrants avec une sorte d’étonnement triste. À mon sens, cette mère de famille n’est ni plus ni moins digne de respect que bien d’autres.
Aurais-je dit une énormité ? Je ne crois pas. Considérez, je vous prie, sa situation. Deux enfants en bas-âge. Pour mari, une « gouape » qui ne veut rien faire. C’est à la femme de nourrir tout ce monde. Vous dites, monsieur ?
Ah ! qu’elle peut travailler ? Fort bien. Vous voulez rire ? Soit. Une femme nourrissant, habillant, logeant quatre personnes du produit de son travail honnête, je serais curieux de voir cela. On compte les femmes qui gagnent plus de deux francs ou deux francs cinquante par jour, l’ignorez-vous ? Vous m’en citerez qui arrivent à quatre francs. Oui. Celles qui se livrent au travail assassin des mécaniciennes, par exemple. Du reste, peu nombreuses. Et puis, après ?
Croyez-vous sincèrement qu’un ménage de quatre personnes puisse vivre avec quatre francs par jour ?
En ce cas, je vous apprendrai qu’il faut au minimum, cinq francs à ce ménage pour ne pas mourir de faim. Voulez-vous compter ? Je prends les chiffres les plus bas.
Un logement : deux cent cinquante francs : quatre livres de pain par jour : soixante-quinze centimes ; un peu de viande, laquelle, dans les bas morceaux, vaut soixante centimes la livre ; deux litres de pommes de terre : trente centimes ; un litre de vin : soixante centimes. Total, y compris la graisse et le charbon : trois francs soixante, en comptant cinquante centimes d’éclairage et de menus frais. En somme, pendant l’année : quinze cent soixante-quatre francs. Mais on ne peut aller tout nu ; estimons vêtements, chaussures, linge et blanchissage à deux cent trente-six francs, pour nous faire un compte rond de dix-huit cents francs.
Cette somme, ils sont rares, en tenant compte des dimanches et des mois de chômage, les ouvriers qui la gagnent. Aussi combien, au lieu du logement convenable que nous avons fait figurer dans notre compte, s’entassent dans un taudis sans air et sans lumière ; combien ne mangent jamais de viande et ne boivent jamais de vin ; combien simplifient la question du vêtement en retenant sur leur corps les habits qui tombent d’usure !
J’espère que vous voudrez bien me pardonner ces chiffres que peu de personnes s’avisent d’aligner ; instructifs pourtant.
Je crois vous avoir convaincus de ceci : que par son travail honnête cette femme dont nous parlons ne pouvait espérer subvenir à ses besoins.
Quant au mari, il m’intéresse peu. Est-il né détraqué, pervers ? Sont-ce de mauvaises fréquentations ou les angoisses de la misère qui l’ont amené au point de dégradation morale où il est arrivé ? La chose n’a pas d’importance. Il est cynique, s’enivre, pousse sa femme à la débauche. Supposez-le tout autre, malade, infirme, incapable de travail ; sa femme n’aurait pas davantage échappé à l’obligation de se prostituer.
Les petits, ventres creux, crient la faim. Pas un sou à la maison, pas un morceau de pain. Représentez-vous cette mère. Que devenir ? Elle aussi entend la chanson lugubre de ses entrailles vides. Ah ! croyez-vous qu’en cette circonstance, les idées d’honneur, de vertu, de morale, seront assez fortes pour la faire crever là, à côté de ses enfants expirants ? Elle est belle. Un métier existe où l’on est relativement bien payé. Métier horrible ! est-ce qu’on a le temps de penser à cela ? Elle descend dans la rue, arrête un homme par le bras… Ce soir les affamés ne se coucheront pas sans souper.
Et qu’on ne m’accuse pas, moi dont l’âme, tandis que j’écris ces lignes, est pleine d’une noire tristesse, qu’on ne m’accuse pas de faire en quelque sorte l’apologie d’une prostituée. Il en est, oui, parmi les « tendresses » dont le grand monde se dispute les faveurs, qui sont contentes de leur état, heureuses dans leur abjection : je vous les abandonne ; – mais celles qui rôdent la nuit dans les quartiers pauvres, à peine vêtues, misérables, et pour qui la pièce de monnaie que leur jette un passant en échange d’une caresse, est la vie, celles-là, croyez-vous qu’elles n’aimeraient pas mieux être honnêtes ; que, si elles l’avaient pu, elles n’auraient pas tout préféré à leur abominable existence ; et que, vraiment, nous avons le droit de les mépriser ?
Elle, cette femme, arrêtée trois fois déjà pour prostitution clandestine, pourra-t-elle échapper encore à l’inscription ? C’est peu probable. Dès lors la chaîne sera rivée, impossible à rompre.
Dites : est-ce que sa mère ne lui aurait pas rendu service en lui brisant, quand elle est venue au monde, le crâne sur le pavé ?
En janvier dernier, des enfants qui jouaient dans un fossé des anciennes fortifications d’Avesnes, découvrirent, dissimulé sous de grosses pierres et dans un état avancé de putréfaction, le cadavre d’un nouveau-né. On rapprocha cette découverte d’une de même, nature faite, non loin de là, quinze mois auparavant. Les soupçons se portèrent sur une jeune ouvrière qui vivait en concubinage avec un chef d’atelier d’une des usines de la ville, et passait en outre pour se livrer à la prostitution. Arrêtée, la femme avoua. Le témoignage des médecins légistes établit, autant que peut le faire une expertise médicale, que les deux enfants étaient venus au monde viables.
La mère coupable a comparu devant la cour d’assises du Nord. On a raconté sa triste vie. Toute jeune, domestique, c’est-à-dire sans famille autour d’elle pour la préserver du mal, elle était devenue la maîtresse d’un officier de la garnison. Celui-ci, son caprice assouvi, s’en était allé. Vieille histoire. Oh ! je ne le blâme pas, cet officier ; il a fait… ce que quatre-vingt-dix-neuf sur cent jeunes gens feraient ; c’est triste, voilà tout. Et la domestique ? Ah ! dame ! quand une fois on a commencé…





























