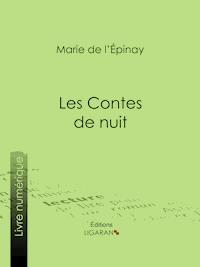
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je venais d'éprouver un de ces violents chagrins après lesquels il semble qu'il ne reste plus qu'à mourir. Tout manque : l'air, le soleil, la vie. Ce chagrin est la déception du coeur, l'illusion de l'amour perdu pour jamais, l'idole créée qu'il a fallu briser. Une grande foi chrétienne donne seule la force et la résignation nécessaires à ces mauvais jours. Cette foi, je ne l'avais pas sans doute, car je ne me sentais ni force, ni résignation contre le malheur..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les amoureux et les malades ne dorment guère. Une malade qui ne dort pas du tout a écrit les petites histoires que voici. Puissent-elles amener le sommeil à ceux qui les liront !… Il est si doux de dormir !… Bonsoir.
Je venais d’éprouver un de ces violents chagrins après lesquels il semble qu’il ne reste plus qu’à mourir. Tout manque : l’air, le soleil, la vie. Ce chagrin est la déception du cœur, l’illusion de l’amour perdu pour jamais, l’idole créée qu’il a fallu briser.
Une grande foi chrétienne donne seule la force et la résignation nécessaires à ces mauvais jours. Cette foi, je ne l’avais pas sans doute, car je ne me sentais ni force, ni résignation contre le malheur qui me frappait. Fuyant l’étude, mes amis, dont les consolations me paraissaient des blasphèmes ; Paris, dont les joies tumultueuses me semblaient des insultes ; je ne trouvais de soulagement à mes cruelles souffrances que dans l’isolement des campagnes. Là, marchant au hasard, sans but et sans projets, comme je marchais dans la vie, sans espoir et sans avenir, mon âme ulcérée s’endormait quelquefois bercée par la fatigue. Alors, mon esprit, égaré dans des pensées incohérentes, incapable d’apprécier les objets, confondait tout autour de moi, le ciel, la terre, le parfum des fleurs , le chant des oiseaux. J’avais l’ivresse de la douleur !
On était au mois de juillet. J’avais quitté Paris de grand matin et pris la route qui, en passant par Rueil, conduit à Bougival. En suivant le petit sentier qui côtoie les murs de la Malmaison, je songeais à toutes les gloires qui étaient venues s’y éteindre, à tous les cœurs qui y avaient souffert ; la pitié qu’on accorde aux maux d’autrui semble réagir sur ceux qu’on ressent soi-même et les adoucir comme une caresse amie. Si, au lieu de se déchirer entre eux, les hommes s’unissaient pour se consoler les uns les autres, la vie à tous serait bien plus, douce.
Absorbé dans ces réflexions, j’avais fait beaucoup de chemin sans m’en être aperçu et gravi à moitié la côte rapide qui conduit aux hauteurs de Bougival, cette route charmante, sinueuse, ombragée par de verts châtaigniers, dont les pieds se baignent dans un océan de mousse et de violettes.
Midi sonnait à une petite église du voisinage ; le ciel, entièrement dégagé de nuages, laissait au soleil toute sa force ; la chaleur était accablante. Aussi fatigué de corps que d’esprit, j’éprouvais un invincible besoin de repos. L’ombre était engageante, je m’étendis au pied d’un arbre. Un demi-sommeil commençait à s’emparer de mes sens, lorsque le bruit agaçant d’une voiture roulant sur le sable me tira de l’engourdissement où j’étais plongé. Un wurst élégant, attelé de deux superbes chevaux, montait lentement la côte.
Le conducteur de ce riche équipage était un homme d’une trentaine d’années, remarquable par la régularité de ses traits et la noblesse de sa tournure. Son visage, empreint d’une pâleur puissante et passionnée, avait une expression de gravité que tempérait la douceur de son regard. À ses côtés était assise une jeune femme dans tout l’éclat de la jeunesse et de la beauté, tenant, sur ses genoux, un petit garçon de deux ou trois ans. Je ne saurais dire lequel était le plus blanc, le plus frais, le plus adorablement gracieux de cette mère ou de cet enfant. Tous deux vêtus de rose, tous deux avec de grands yeux d’azur, de longs cheveux dorés épars sur la figure, les joues animées des mêmes nuances de la santé, on les confondait l’un dans l’autre. De l’un de ses bras passé-autour du corps de son fils, la jeune femme le retenait avec amour sur son cœur, tandis que l’enfant, tout fier du grand fouet que lui avait abandonné son père et croyant frapper bien fort, effleurait à peine la croupe luisante des chevaux fringants qui le traînaient. C’étaient alors des joies, des éclats de rire, naïfs et charmants, puis des baisers échangés entre chaque cri de victoire.
Au moment où la voiture passait devant moi, le jeune Phaéton laissa échapper son arme ; les chevaux s’arrêtèrent un instant, mais avant que le domestique assis derrière ses maîtres eût mis pied à terre, j’avais ramasse le fouet tombé dans la poussière, et je le remettais entre les petites mains suppliantes qui se tendaient vers moi pour le saisir. Avec une bonne grâce pleine de distinction, le père se leva pour me remercier.
– Paul, envoie un baiser à monsieur, dit la mère, et appuyant elle-même sa main délicate sur ses lèvres de corail, elle donna à son fils sa première leçon d’amour. Au lieu d’un baiser, l’enfant m’en envoya quatre.
– Voyez, comme Paul est sage, aujourd’hui, Dominique, dit la jeune femme.
Un regard ineffable de tendresse avait accompagné ces paroles ; mais celui auquel elles s’adressaient était devenu pâle comme un mort et ne répondit pas.
Ils parurent… Longtemps je les suivis des yeux, et quand le dernier pli transparent du voile de l’enchanteresse, le dernier ruban flottant de son chapeau, eurent disparu à travers les arbres, je croyais la voir encore.
Je tombai à terre… Il me semblait qu’un nouveau malheur venait de me frapper. Ah ! m’écriai-je, en serrant avec rage ma tête brûlante entre mes mains, à cet homme le bonheur, la richesse, la femme qu’il aime, le fruit de ses amours… À moi, le malheur, l’abandon, la solitude, le désespoir !
On l’a dit : quand la coupe est pleine, il suffit d’une dernière goutte d’eau pour la faire déborder. La scène que je viens de décrire, bien simple en apparence, pourtant, fut pour mon cœur, rempli d’amertume, la dernière goutte de fiel. Je pris la résolution de fuir tout à fait les hommes et les lieux fréquentés par eux. Après avoir arrangé mes affaires de manière à ne point avoir à m’en occuper pendant plusieurs années, je partis sans dire adieu à personne, sans laisser derrière moi aucun indice de la direction que je prenais. Le savais-je moi-même ?
Ce fut au bord du Rhin, un peu avant d’entrer en Suisse, que je m’arrêtai pour la première fois. Sur les rives du fleuve, un pêcheur avait sa cabane : il y vivait seul ; partait le matin pour ne rentrer que le soir ; je lui demandai à partager sa demeure. Pendant deux ans je vécus là dans l’isolement le plus complet, usant ma douleur à force de m’en repaître, l’amoindrissant, si on peut s’exprimer ainsi, par l’excès que j’en faisais. Au bout de ce temps, j’étais parvenu à maîtriser mes souvenirs, de manière à ne leur laisser prendre sur mon esprit que la part que je voulais bien leur donner.
Alors le besoin de distractions se fit sentir ; il me fallait du mouvement, du bruit, sinon des plaisirs. Je quittai ma retraite pour voyager en Suisse, en Allemagne, en Italie. Insensiblement, je redevins impressionnable aux beautés de la nature, aux arts, à la musique. La société seule me resta odieuse, et je passai ainsi cinq nouvelles années, sans former aucune relation, sans lire un journal, sans prendre aucun souci de mes intérêts privés ou des intérêts politiques de l’Europe. Je sentais qu’un mot, un nom prononcé, pouvaient raviver toutes mes souffrances. Mon âme n’était encore qu’assoupie, un long sommeil pouvait seul la guérir.
L’amour de la patrie, que j’avais si souvent répudié, alors que je croyais à l’amour de la créature, vint tout à coup mettre un terme à ma vie errante. Un beau matin, à Naples, je m’éveillai avec le mal du pays. Deux heures après, je voguais vers la France.
À Paris, je descendis provisoirement dans un hôtel garni de la rue de Richelieu. Le soir même de mon arrivée je fis comme font presque tous les étrangers, je m’en allai dîner au Palais-Royal. Dans le restaurant où j’entrai, il y avait foule, et je ne pus trouver de place que dans un petit salon reculé, où ne se trouvaient, à ma grande satisfaction, que deux dîneurs.
Le service se faisant lentement, j’eus tout le loisir d’examiner mes deux voisins, dont l’un était évidemment le père, l’autre le fils. Le père, dont il eût été difficile de préciser les années, laissait deviner une beauté native que les chagrins ou les passions avaient flétrie avant l’âge. Ses joues creuses, ses yeux éteints, son crâne dépouillé et sa haute taille voûtée, annonçaient un passé de souffrances ou de poignants chagrins. Des habits d’un drap fin, usés, mal soignés, mis sans art, trahissaient pourtant une ancienne splendeur et une distinction qu’en dépit de l’air d’abandon répandu sur sa personne, ne démentaient pas ses manières. L’enfant, qui entrait dans l’adolescence, portait le costume des collégiens. Au désordre qui régnait dans toute sa toilette on pouvait juger qu’aucune main amie n’avait essayé, par une ingénieuse addition, d’en atténuer l’aspect disgracieux. C’était, en dehors de cela, un beau garçon, bien fait, bien venu, avec de grands yeux bleus, un teint de jeune fille, les cheveux blonds, frisés comme ceux d’un chérubin. Cette luxuriante nature contrastait péniblement avec une expression triste et craintive, avec un visage morne, impassible, sur lequel ne passait jamais un sourire. Quoiqu’il m’eût été impossible de me rendre compte, dans ce moment, de l’intérêt magnétique qui m’attirait vers ces deux personnages, toutes mes observations se concentraient sur eux et je ne pouvais m’en distraire. Leurs figures, qui m’étaient parfaitement inconnues, n’étaient pourtant pas nouvelles pour moi. Dans le passé, dans le présent, rien ne semblait les rattacher à ma vie, et cependant elles se liaient à mes souvenirs comme ces images décevantes qui peuplent les songes et dont il ne reste au réveil que la forme vague et insaisissable.
Le temps employé par les deux étrangers pour leur dîner, fut en harmonie avec toute leur manière d’être. Le père distrait, préoccupé, servait son fils en silence, gardant pour lui quelques débris des mets placés sur la table et auxquels il touchait à peine. Quant au pauvre enfant, on voyait qu’il mangeait sans cet appétit réjouissant d’un échappé des bancs, heureux d’échanger le maigre régime du collège contre un succulent repas. De temps en temps il levait ses grands yeux sur son compagnon, mais, ne rencontrant jamais le regard de celui-ci, il baissait sa longue paupière voilée, au bord de laquelle perlait une larme.
J’en étais là de mes observations, lorsque la porte du restaurant s’ouvrit avec violence, et une société de trois jeunes gens et de trois jeunes femmes entra en parlant haut, en riant à gorge déployée, avec un laisser-aller de mauvais goût dans un lieu public.
Comme je l’ai, dit déjà, le restaurant était plein du haut en bas, et il n’y avait plus de libre que l’arrière-petite salle où j’étais. Une des nouvelles arrivantes, belle créature s’il en fut, et qui marchait la première avec un regard assuré, avisa cette retraite et la désigna du doigt à ses compagnons. En un instant la salle fut envahie.
– Ah ! nous voilà pourtant casés ! s’écria un des jeunes gens, il n’y a que Mysa qui sache toujours nous sortir d’embarras.
À peine cette phrase était-elle achevée, que mon voisin, qui jusqu’alors était reste absorbé, la figure cachée dans sa main, bondit sur sa chaise comme s’il eût été frappé par l’électricité, un tremblement universel agita ses membres, la pâleur d’un mort couvrit ses traits.
– Maman ! s’écria l’enfant en se levant de sa place.
– Paul, si tu fais un pas, je te tue, murmura le père d’une voix qui râlait, et ses doigts crispés s’étaient accrochés au bras de son fils comme des crampons de fer.
Mais cette étreinte n’eut que la durée d’un instant ; le malheureux homme, épuisé, brisé par une secousse aussi violente, tomba à la renverse, en proie à une horrible crise nerveuse. Je le reçus dans mes bras.
Tandis que, penché vers lui, je m’efforçais de lui faire reprendre connaissance, j’entendis comme le frôlement léger d’une robe de soie qui passait derrière moi, puis un souffle effleura mes cheveux.
– Pauvre Dominique, dit une voix douce, il ne sera jamais raisonnable !
Je me retournai, nue femme s’enfuyait… Nous étions seuls dans la salle, le père, l’enfant et moi. Mes souvenirs revinrent en foule… Bonheur envié qui m’aviez fait quitter mon pays, chaste et touchant tableau de Bougival, qu’étiez-vous devenus ? Combien d’ombres avaient passé sur vos fraîches et brillantes couleurs !
La désertion subite de cette compagnie bruyante, l’état effrayant où se trouvait Dominique, avaient fait évènement dans le restaurant ; on nous entourait, on m’accablait de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Cependant la crise se prolongeait ; aux convulsions avait succédé un anéantissement total qui semblait le précurseur de la mort. Je priai un des assistants d’aller chercher un médecin.
– Non, non, s’écria l’enfant reste jusqu’alors témoin silencieux de cette scène, vous feriez beaucoup de peine à mon père. Ne vous effrayez pas, je l’ai vu bien souvent dans cet état, ajouta-t-il avec un triste soupir. Puis, s’approchant du malade et lui posant sa main sur le front :
– Mon père ! m’entends-tu ? dit-il.
Un imperceptible mouvement des lèvres nous apprit que la connaissance revenait ; peu à peu les membres s’assouplirent ; à la sueur glacée succéda une tiède moiteur, et les yeux se rouvrirent en laissant échapper d’abondantes larmes.
Le premier regard de Dominique se porta avec une vive anxiété autour de la salle ; en voyant toutes les tables vides il sembla respirer plus à l’aise et murmura quelque, chose que je ne pus comprendre. J’avais gardé une de ses mains dans les miennes ; dans cette étreinte il devina, sans doute, toute la compassion qu’il m’inspirait, car, levant sur moi des yeux remplis d’une touchante expression de reconnaissance :
– D’où vient que j’ai rencontré un ami ? dit-il.
– J’accepte ce titre, répondis-je avec empressement ; et, pour vous prouver tout le prix que j’y attache, laissez-moi vous conduire hors d’ici.
Dominique hésita un instant ; puis, se levant tout à coup :
– Allons, partons ! dit-il.
Plusieurs personnes présentes offrirent leurs services. Dominique ne voulut accepter que le bras de son fils et le mien.
– Votre adresse ? lui demandai-je.
– Conduisons d’abord cet enfant, me répondit-il.
Le jeune Paul était élève du collège Stanislas. Nous prîmes une voiture sur la place du Palais-Royal.
Pendant toute la durée du trajet, pas un seul mot ne fut échangé entre nous. Dominique, enfoncé dans un coin de la voiture, semblait livré au plus profond sommeil. Voulait-il, par ce moyen, éviter une conversation embarrassante, ou la fatigue du corps l’avait-elle emporté sur les préoccupations de l’esprit ?
De temps en temps, son fils prenait une de ses mains, la portait à ses lèvres ; mais cette main restait immobile et retombait inerte à ses côtés.
– Pourtant, il m’aime, monsieur, murmura le pauvre Paul, en se penchant à mon oreille ; il m’aime, croyez-le bien !
Nous arrivâmes ainsi à la porte du collège.
Au moment où la voiture s’arrêta, Dominique sortit de sa torpeur.
– Où sommes-nous ? demanda-t-il d’un air effaré.
– Au collège, mon père, répondit l’enfant.
– Au collège ! au collège ! s’écria Dominique. Jamais… je ne veux pas me séparer de mon enfant.
Son fils passa ses deux bras autour de son cou et l’embrassa.
– Allons, mon père, lui dit-il avec tendresse, calme-toi, soigne-toi et viens me voir.
– Mon Dieu ! murmura d’une voix étouffée Dominique, j’avais tout oublié…, tout… Oui, oui, le collège, c’est vrai… Il a bien fallu t’y mettre, je devenais fou.
Ces derniers mots furent prononcés avec une exaltation qui me fit craindre une nouvelle crise. J’engageai le Jeune Paul à rentrer ; il me quitta.
– Où vous conduirai-je maintenant ? demandai-je à Dominique.
– Monsieur, me répondit-il d’une voix sombre, vous m’avez rendu un grand service, rendez-m’en un second en me quittant ici.
– Comment ! et nous ne nous reverrons plus ?
– Les malheureux comme moi doivent vivre seuls.
– Les chagrins ne me sont point étrangers, repris-je, et j’adoucirai peut-être les vôtres en les partageant.
– Oh ! mes chagrins à moi, dit-il avec amertume, personne ne peut les comprendre.
– Vous me refusez ?
– Votre insistance ferait mon désespoir.
Je cédai à son désir, quoique avec un vif regret.
– Adieu, me dit-il en me tendant la main, je ne vous oublierai jamais.
Il s’éloigna… ; longtemps je le suivis des yeux, jamais personne ne m’avait inspiré plus d’intérêt que cet homme. Qu’avait-il été ? Qu’était-il aujourd’hui ? Ce profond et mystérieux chagrin, qui le causait ? la charmante ; femme que j’avais vue, sans doute. Par quelle succession de malheurs cette existence brillante, remarquée par moi sur la route de Bougival, s’était-elle éclipsée ?
Pendant plusieurs jours ces idées occupèrent mon esprit ; mais les soins que nécessitèrent mes affaires après une absence aussi longue que celle que je venais de faire, finirent par affaiblir ces tristes souvenirs. D’ailleurs, j’avais le pressentiment que je reverrais Dominique.
Six mois s’étaient écoulés depuis les évènements que je viens de conter. Nous étions à la fin de l’été. Après une demi-soirée dépensée en flâneries aux Tuileries, aux Champs-Élysées, l’envie me prit d’aller au théâtre pour y attendre l’heure du coucher. L’Opéra-Comique se trouvait sur mon passage. J’y entrai. Je savais qu’on y entendait dans ce moment une cantatrice de passage en France, dont le talent et la beauté attiraient tout Paris. La salle était remplie jusqu’aux combles, et j’eus beaucoup de peiné à trouver un tabouret dans un des petits couloirs qui descendent vers l’orchestre. On donnait le Pré aux Clercs ; le premier acte était joué, on allait commencer le second. J’étais à peine assis, qu’un homme, dont j’avais entendu des pas rapides retentir dans le corridor, entra, passa près de moi comme un éclair, et sans que j’eusse pu distinguer ses traits et sa tournure, alla se placer dans une des stalles les plus rapprochées de la scène. La toile se leva pour le second acte. C’est le moment où Isabelle, entrant en scène je chante cet air charmant : Jours de mon enfances, Ô jours d’innocence, Votre souvenir est pourmoi le bonheur. Cette phrase était à peine achevée, que de la salle, un : « Ô mon Dieu ! » prononcé d’une voix accentuée par l’expression du désespoir, attira l’attention des spectateurs ; la chanteuse, les traits contractés, les yeux étrangement fixés devant elle, s’était tue comme frappée d’effroi. Bientôt, autour de moi, il se fit une vive rumeur ; on se leva, on entoura un homme qui venait d’être pris d’affreuses convulsions. Alors, une idée soudaine traversa mon esprit ; me frayant un passage au milieu des assistants, j’approchai… Mon pressentiment ne m’avait pas trompé, Dominique était là sans connaissance, il lui fallait de l’air : on le transporta au foyer.
La crise fut en tout semblable à celle dont j’avais été témoin au Palais-Royal ; seulement, dès qu’il revint au sentiment de l’existence, au lieu de rester immobile et inerte, il chercha violemment à s’échapper de mes bras, criant sourdement avec rage :
– Laissez-moi, laissez-moi aller la tuer.
– Et votre fils ? lui dis-je.
Je ne sais si ce mot eût suffi à le retenir dans sa fureur, mais ses forces ne secondant pas son désir, il retomba sur sa chaise. Dans cet instant, les applaudissements frénétiques de toute la salle arrivèrent à nos oreilles ; Dominique se leva, jeta au loin un poignard caché sous ses vêtements.
– Je ne suis qu’un lâche ! murmura-t-il.
Puis, prenant mon bras, qu’il serra de manière à le casser :
– Partons, ajouta-t-il.
En quelques minutes nous fûmes hors du théâtre.
– Aujourd’hui, lui dis-je, rien ne m’empêchera de vous suivre ; je ne le demande pas, je l’exige, au nom du hasard providentiel qui, deux fois, m’a mis sur votre chemin pour vous secourir.
Sans me répondre, Dominique continua à marcher, et nous arrivâmes ainsi rue Feydeau ; c’était là qu’il demeurait.
La maison était de chétive apparence ; on y entrait par une allée sombré conduisant à un étroit escalier, éclairé seulement par la lampe fumeuse du concierge, perché à mi-côte de l’entresol au premier étage.
L’appartement de Dominique était au quatrième ; il était composé de deux ou trois pièces où régnait un désordre impossible à décrire. Quelques débris d’un mobilier jadis luxueux, dont la poussière rongeait l’étoffe et les dorures, garnissaient à peine les murs. Sur les tables, et les consoles gisaient pêle-mêle des babils, des livres, des tableaux, des instruments de musique. Le lit était froissé sans avoir été défait ; sur la cheminée de la pièce où nous nous arrêtâmes on voyait une magnifique pendule qui ne marquait plus les heures ; de hauts candélabres portaient encore les traces de leurs services passés ; une bougie y était restée intacte, Dominique l’alluma. À cette lueur bleuâtre et vacillante éclairant tant de faste et tant de misère, je compris encore bien mieux que je ne l’avais fait jusqu’alors tout ce qu’il devait y avoir de désolation et de désespoir dans l’âme de l’homme qui, avec la plus froide indifférence et sans en paraître touché, vivait au milieu de cet abandon de toutes choses.
Après avoir à grand peine débarrassé un petit canapé de trois ou quatre in-folio dont le poids avait réduit en lambeau le satin cerise qui les supportait, d’un signe Dominique m’engagea à m’y asseoir.
– Non, lui dis-je, je reviendrai demain ; vous êtes plus calme, je vais vous laisser dormir.
Dominique frissonna comme s’il avait reçu une blessure et, se plaçant en face de moi, avec les bras croisés sur sa poitrine :
– Vous n’avez donc jamais été malheureux, vous, monsieur, s’écria-t-il, que vous me dites de dormir ?
Ses yeux lançaient des éclairs ; je pris ses deux mains dans les miennes, et le contraignis à s’asseoir.
Le paroxysme était passé, il se laissa faire comme un enfant.
– Pourquoi êtes-vous venu ici, monsieur ? dit-il avec un accent de tristesse mêlé de honte, vous le voyez, je suis fou !
– Le chagrin n’est pas la folie.
– Non, mais il la donne.
– C’est quelquefois un soulagement, repris-je.
– Oui, quand la folie amène l’oubli de ses maux, ou l’oubli de ceux qui les causent, alors c’est une bénédiction du ciel ; mais quand cette folie vous montre les êtres que vous avez aimés, chastes et purs comme ils étaient autrefois, ou flétris, méprisables, comme ils sont aujourd’hui, alors, je dis que cette folie est échappée de l’enfer.
En achevant ces mots, Dominique laissa tomber sa tête sur sa poitrine, d’où s’échappa un douloureux sanglot.
– N’avez-vous rien essayé pour vous distraire ? lui dis-je.
– Tout, monsieur, tout, les voyages, le jeu, le vin, les orgies.
– Et l’amour ?
– L’amour ! il faudrait pour cela ne plus l’aimer, elle ! murmura Dominique d’une voix sourde.
Nous arrivions aux confidences : c’était ce que je désirais.
– C’est donc une femme qui cause vos chagrins ?
– Elles seules peuvent faire souffrir ainsi, dit-il.
– Et… repris-je en hésitant, car je savais que j’allais plaider le faux pour connaître le vrai, cette femme, vous l’avez perdue… elle est morte ?
– Morte ! s’écria-t-il en se levant et en parcourant la chambre à grands pas, plût à Dieu qu’elle fût morte ! alors j’aurais été heureux dans ma douleur, j’aurais pleuré sur elle, j’aurais réchauffé son corps glacé contre mon cœur, je l’aurais implorée comme une sainte… Non, non, continua-t-il en s’exaltant toujours davantage, elle n’est pas morte… elle est comédienne !
Ici, Dominique poussa un grand éclat de rire.
– Oui ! oui ! répéta-t-il avec une expression effrayante, comédienne, ma femme, comédienne ! cette beauté voilée, ce sein qui avait nourri notre enfant, tout cela jeté chaque soir en pâture aux libertins d’un parterre de théâtre…
– Je comprends votre désespoir, dis-je, mais qui a causé ce malheur ? La misère…
– Je l’avais couverte d’or et de fleurs, interrompit Dominique, je lui avais donné toutes les richesses, toutes les jouissances de la terre.
– Comment expliquer alors ?…
– Ah ! monsieur, elle était belle comme les anges du ciel, et j’étais seul à le lui dire… elle chantait comme une fauvette, et j’étais seul à l’entendre… voilà ce qui l’a perdue…
– Elle n’a donc jamais eu d’amour pour vous ?
– Un seul jour, celui où elle m’a quille.
– Quelle bizarrerie ! Contez-moi votre histoire, Dominique.
– Je ne sais si je le pourrai, répondit-il.
– Tâchez d’en avoir le courage, ajoutai-je ; en s’épanchant, la douleur est moins cruelle.
– Le feu qu’on attise devient plus vif, dit Dominique.
– Oui, mais il dure moins longtemps. Croyez-moi, j’ai l’expérience du malheur. Si j’ai su souffrir en silence alors que j’ai eu le cœur brisé, c’est qu’il n’y avait, pas un autre cœur près de moi, digne de partager les tortures du mien. On m’aurait dit : consolez-vous, moi je vous dirai : pleurons ensemble.
Dominique jeta sur moi un regard attendri.
– Allons, dit-il, puisque vous le voulez. NOUS nous assîmes l’un près de l’autre sur le canapé.
Je suis né en Amérique. Mon père, dont les parents avaient émigré lors de la révolution de 89, eut le bonheur d’y refaire une brillante fortune dans le commerce. Un riche mariage, où l’amour eut autant de part que les convenances, vint encore augmenter l’opulence de sa maison, et lorsque je vins au monde, tout annonçait pour moi un avenir heureux.
Deux années, pourtant, s’étaient à peine écoulées que la mauvaise destinée commença à me frapper. Je perdis mon père ; restée veuve, ma mère, jeune et riche, vit sa main recherchée par un grand nombre de prétendants. Aucun ne fut écouté.
Elle avait juré à mon père de ne plus vivre que pour moi ; elle tint parole et se retira à la campagne, afin que rien ne vînt la distraire du pieux devoir auquel elle voulait se consacrer tout entière.
Hélas ! qui croirait que ce fut à cette tendresse maternelle si passionnée que je dus une partie de mes maux ? Concentrant en moi tout l’amour qu’elle avait eu pour son époux, ma mère m’entoura de ces soins délicats, de ces prévenances ingénieuses dont les femmes seules ont le secret, et qui ouvrent l’âme à toutes les sensations aimantes et douloureuses de la vie. Jalouse de la moindre parcelle de mon affection, elle éloigna de moi toutes les occasions qui pouvaient me mettre en contact avec des compagnons de mon âge. Né faible et nerveux, une éducation virile, en développant mes forces physiques, aurait atténué ce que la nature avait mis en moi de trop impressionnable ; au lieu de cela, tout ce qui pouvait former mon esprit, ou aguerrir mon corps contre les maux qui sont le partage de l’humanité, était éloigné de moi. Ma, mère aurait regardé comme un crime d’assombrir mes pensées ou d’attrister mon cœur par le récit d’une souffrance ou d’une action répréhensible. J’arrivai donc à l’âge de dix-huit ans, ne croyant qu’au bien, au bonheur, à la vérité. Tous les hommes étaient bons et sincères, toutes les femmes savaient aimer comme aimait ma mère.
Ce fut à peu près vers cette époque que nous quittâmes l’Amérique. La santé de ma mère, altérée depuis longtemps, commença à donner de sérieuses inquiétudes. Les médecins conseillèrent un changement de climat. Le désir de voir la patrie de son mari décida ma mère pour la France ; ce n’était pas sans une grande appréhension que je voyais approcher le moment où j’allais être arraché à mes habitudes, à la douce solitude dont je jouissais depuis ma naissance. L’idée de quitter le toit où j’avais vu le jour, les beaux arbres qui tant de fois m’avaient abrité de leur ombre, le ruisseau où, enfant, j’allais tremper mes pieds, me brisait le cœur et m’arrachait des larmes ; nos vieux amis, nos bons serviteurs, dont il fallait se séparer, les reverrions-nous jamais ? Ce pays inconnu que nous allions chercher aurait-il pour nous le même ciel, les mêmes fleurs, les mêmes sourires, que celui auquel nous allions dire adieu pour toujours ?
Beaucoup de gens appelleront cela des puérilités, et pourtant ce sont souvent d’elles que découlent nos plus grandes joies ou nos plus grandes souffrances. L’homme a ordinairement l’esprit hardi, envahissant ; il est dans sa nature d’aimer à voir, à conquérir, à posséder ; moi, différent des autres, craintif, concentré, facile à émouvoir, je redoutais tout ce qui se trouvait au-delà de mon horizon ; ce qui différait des choses que je voyais habituellement me causait un sentiment de frayeur.
Je connaissais trop la faiblesse du cœur de ma mère pour lui laisser voir l’état de mon âme ; elle n’aurait plus voulu partir. L’effort que je fis alors, et qui fut la première contrainte que je m’imposai, me causa comme une blessure cachée, dont chaque goutte de sang, versée dans le mystère, enlève une parcelle de l’existence…
La nuit qui précéda notre départ ressembla pour moi à une douloureuse agonie. Je la passai tout entière à errer dans nos bois, dans nos jardins ; j’avais besoin de respirer seul, encore une fois, la fraîcheur de nos ombrages ; je voulais exhaler dans le silence mes plaintes et mes regrets ; enlaçant de mes bras mes arbres préférés, pleurant sur nos bancs de mousse, jetant mon nom aux échos comme pour le leur faire répéter toujours, j’errai pendant plusieurs heures, en homme qui a perdu la raison. Le lendemain, on me porta sans connaissance sur le vaisseau qui devait nous transporter en France.
Nous arrivâmes à Paris vers le commencement du printemps. Après y être restés à peine le temps nécessaire pour visiter toutes ses merveilles, ma mère, que la chaleur, le tumulte, le bruit de la ville fatiguaient, désira aller passer à la campagne les derniers mois de l’été. J’accueillis cette proposition avec bonheur. Depuis mon arrivée en France, je portais en mon âme une tristesse profonde, un ennui de toutes choses qui me faisait désirer la solitude avec l’ardeur la plus vive. Il me semblait que le silence, le calme des champs, me rendraient un peu des joies que j’avais perdues, qu’assis sur une pierre solitaire, les yeux tournés vers le soleil couchant, j’apercevrais au loin, dans l’espace, derrière les bois et les collines, ses derniers rayons porter l’aube naissante à ma chère patrie. Paris m’étouffait, j’y mourais, je croyais alors qu’on ne pouvait pas souffrir davantage.
Ne pouvant, à cause de l’état de santé de ma mère, nous éloigner beaucoup de la capitale, il nous fallut trouver dans ses environs une habitation à notre convenance. Pendant plusieurs jours, mes recherches furent infructueuses. La banlieue ne m’avait offert que de mesquins cottages, des chalets dégradés, des jardins remplis de fleurs étiolées, des arbres sans feuillage se mourant entre quatre murs humides sous un nuage de poudre grise.
Cette misère de la nature, cet appauvrissement des créations de la Providence au profit de l’exploitation me serraient le cœur ; moi, le fils des forêts vierges, du sol plein de fantaisie, ou la main de l’homme se fait à peine sentir, je souffrais pour ces belles végétations torturées par la cupidité.
Nous étions presque décidés à renoncer à nos projets, lorsqu’un jour, arrivé à la barrière de Vaugirard, j’eus l’idée bizarre de m’abandonner à l’humeur vagabonde du cheval que je montais. Bien m’en prit ; au bout d’une demi-heure, l’animal s’arrêtait devant la grille d’une des dernières maisons de la grande rue qui traverse le village d’Issy.
L’homme tire souvent d’heureux présages d’évènements gros pour lui de malheurs et de peines ; le voile brillant du moment lui cache les sombres teintes de l’avenir. C’est ainsi que je pris pour une bonne fortune le hasard qui m’avait enfin offert l’objet de mes désirs.
La maison dont je viens de vous parler était de belle apparence. Son principal corps de logis, flanqué de deux ailes en pavillons, aurait pu porter le nom de château. La cour, très vaste, plantée sur les côtés de deux rangées d’acacias, était bordée d’une grille en fer très aristocratique, et ouvrant sur la rue. Derrière la maison, une superbe terrasse sablée et garnie d’une profusion de fleurs, donnait accès, par une pente douce, sur une vaste et large pelouse, autour de laquelle s’étendait un bois touffu rempli d’allées sombres, de hautes charmilles et formant un parc de plusieurs arpents. Au-delà, une autre terrasse dominant les plaines qui avoisinent la Seine et qu’on apercevait au loin comme un sillon argenté, donnait à tout ce paysage un aspect magique.
En contemplant ce riche panorama, cet horizon immense, je sentis ma poitrine se dilater ; mon cœur avait des pulsations plus calmes, mes yeux regardaient sans fatigue, j’avais des pensées de bonheur… j’allais vivre !
Bien certain du consentement de ma mère, j’arrêtai cette maison pour une année. L’intérieur, meuble avec un luxe antique, avait besoin de quelques additions pour en achever le confort. Le lendemain, au point du jour, j’étais à Issy avec des ouvriers ; au bout d’une semaine nous y étions installés.
Mon premier réveil y fut un enchantement : en voyant le soleil ruisseler dans les plis de mes rideaux, en écoutant le chant des oiseaux, le bruit d’un vent léger agiter les arbres, je me crus un instant dans ma chère patrie. Immobile, les yeux fermés, les mains jointes, je priais Dieu d’arrêter la marche des heures et de faire que le printemps durât toujours.
Le premier mois que nous passâmes à Issy s’écoula rapide et sans secousses. De longues courses à cheval occupaient mes matinées ; les journées se passaient auprès de ma mère, en lectures, en promenades, pendant lesquelles l’appui de mon bras lui était nécessaire. Le soir, lorsque sa faiblesse habituelle l’avait forcée à rentrer chez elle, je descendais dans le parc, et là, seul, rêvant au passé, je rappelais un à un mes souvenirs d’enfance, les caressant de ma pensée comme des amis que l’on revoit après une longue absence. Le visage, les gestes de ceux que j’avais connus, je les revoyais ; j’entendais le son de leur voix ; ils cheminaient à mes côtés sous les mystérieuses allées du parc ; ils me disaient leurs peines, leurs plaisirs ; ils pleuraient ou riaient, selon que la lune brillait au ciel ou que l’atmosphère était chargée de nuages. Puis, quand l’heure avancée de la nuit me forçait à rentrer dans la maison, il n’y avait pas jusqu’à notre vieux chien Tommy que je ne crusse entendre japper de joie sur le seuil de la porte.
Si j’avais confié ces rêveries, si j’avais dit le bonheur que me faisaient éprouver ces évocations du passé, on m’aurait pris pour un fou, ou qui pis est pour un comédien romanesque. Il me fallait donc taire ces retours de mon cœur vers un lointain évanoui, et concentrer en moi ce vagabondage d’idées, fantasmagorie hallucinante, qui surexcitait mon esprit, agaçait mes nerfs et allumait mon sang.
Mes traits s’altérèrent sous cette fatigue morale ; le malaise qu’éprouvait mon corps se trahissait dans ma démarche, dans le son de ma voix. Ma mère s’aperçut de cet état de langueur. Elle l’attribua à l’ennui de la solitude, à l’isolement d’une société de mon âge ; elle désira que nous vissions du monde. Je commençai par combattre cette volonté de ma mère ; changer notre genre de vie, n’était-ce pas rompre mes rêveries, n’était-ce pas me séparer de ces ombres si chères, anciens amis du foyer ? Mais ma mère insista.
Près de notre maison, s’en trouvait une autre habitée par une famille anglaise très nombreuse. La conformité des usages anglais et américains, la parité du langage et les avances empressées qui nous furent faites par nos voisins ne laissaient aucun prétexte à mon refus de les voir ; je cédai… Alors, au mal inconnu qui consumait mes jours, en succéda un autre non moins cruel pour moi ; obligé de vivre hors de mes pensées, au milieu du bruit, de la dissipation, au milieu de gens dont le seul but était de chercher le plaisir et la distraction, ma paresse songeuse ne m’était plus permise. Sans cesse dérangé par mes jeunes compagnons, il fallait courir les fêtes, les bals des environs, prendre part à leurs danses, à leurs jeux bruyants, abandonnant le négligé commode de ma toilette pour la gêne d’un costume à la mode. Dieu sait où m’aurait conduit l’irritation causée par la nouvelle contrainte qui m’était imposée, lorsqu’une circonstance bien simple en apparence vint donner une autre direction à mes idées.
Il était question, dans le pays, d’organiser, au profit des pauvres, un concert auquel devaient concourir tous les virtuoses amateurs habitant les environs. Ce concert faisait le sujet de tous les entretiens ; on ne s’occupait plus d’autre chose. Quoique bon musicien, et malgré les instances qui m’en avaient été faites, je m’étais refusé à grossir le nombre des exécutants. J’espérais par ce moyen recouvrer un peu de liberté ; d’ailleurs l’idée de me mettre en spectacle me causait un effroi insurmontable. Mais le malheur qui me poursuivait voulut que notre maison fût la seule du village où il se trouvât des salons assez vastes pour la solennité musicale qu’on se proposait, et pour le bal qui devait lui succéder.
Je me vis donc obligé de m’occuper des préparatifs de cette fête à laquelle j’espérais pouvoir échapper. Pendant plus d’une semaine, notre habitation, que j’avais souhaitée si paisible, fut la proie de la multitude la plus agitée, la plus bruyante et la plus harmonieuse à la fois. Au bruit du marteau succédait l’accord des instruments ; au grincement de la scie, les roulades des chanteuses ; il n’était pas un coin dans la maison, pas un bosquet dans le parc, qui ne servît d’écho à un trille ou à un rabot.
Enfin, nous arrivâmes à la veille du concert si impatiemment attendu par ceux qui m’entouraient, et dont pour mon compte je hâtais la fin de tous mes vœux. Tout était prêt et un peu de calme avait remplacé le tohu-bohu des autres jours. Sauf une répétition qui devait avoir lieu le soir, la journée promettait de s’écouler dans le silence. Harassé de corps et d’esprit par les ennuis de mon rôle de maître de maison, privé depuis longtemps de mes chères solitudes, je saisis comme un bonheur inespéré l’occasion d’aller faire une longue promenade dans la campagne.
Nous étions à la fin de juillet ; il était huit heures du matin ; un vent léger chassait sur l’azur du ciel de gros nuages blancs, dont les ombres passagères tempéraient l’ardeur du soleil. Après avoir traversé le parc où s’échelonnaient de distance en distance les ifs déjà chargés de lampions, destinés à l’illumination du lendemain, j’arrivai à une petite porte percée dans le mur de clôture, et qui s’ouvrait sur les champs. Un sentiment de joie parcourut tout mon être quand je me trouvai en face du vide de la plaine, quand mes yeux purent errer au hasard dans l’espace, mes oreilles n’être plus heurtées que par le bruit de mes pas sur l’herbe du chemin.
La moisson approchait ; les épis, mollement balancés sur leur tige flexible, ondulaient comme les vagues d’une mer doucement agitée, laissant apercevoir sous leur nappe dorée le saphir du bluet, le rubis du coquelicot. Une alouette, en chantant, s’élevait dans les airs.





























