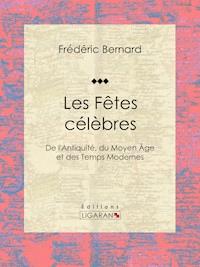
Extrait : "Dans les temps les plus reculés, l'histoire nous fait assister à des solennités, à des fêtes instituées ou sanctionnées par les lois, ayant pour la plupart un caractère religieux, et montrant chez tous les peuples une tendance naturelle à se réunir pour faire trêve au labeur de chaque jour, et pour mettre en commun leurs joies et leurs douleurs, leurs prières ou leurs actions de grâces à la Divinité..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054637
©Ligaran 2015
Dans les temps les plus reculés, l’histoire nous fait assister à des solennités, à des fêtes instituées ou sanctionnées par les lois, ayant pour la plupart un caractère religieux, et montrant chez tous les peuples une tendance naturelle à se réunir pour faire trêve au labeur de chaque jour, et pour mettre en commun leurs joies et leurs douleurs, leurs prières ou leurs actions de grâces à la Divinité. On célébrait le retour des saisons, les souvenirs glorieux d’un peuple ou d’un héros : on prenait le deuil en mémoire de désastres ou de calamités publiques. Les inégalités sociales s’effaçaient, ou du moins s’atténuaient pour quelques heures ; un même but, une même idée, rapprochaient les différentes classes de citoyens et développaient en elles le sentiment d’unité qui fait la force des nations.
Telles étaient, en Égypte et en Grèce, les fêtes de l’antiquité. À Rome, les jeux du cirque paraissent avoir été d’abord un moyen de soutenir le moral du peuple dans les moments de crise. C’était à la fois une distraction et comme une invocation religieuse que prescrivaient les livres sibyllins, interprétés par les ministres du culte. Plus tard, les fêtes ne furent plus qu’une sorte de courtisanerie des souverains envers les peuples. Sous les Ptolémées, l’Égypte connut ces pompes fastueuses dont la glorification du prince était le seul but ; et toutefois les Ptolémées encourageaient dans Alexandrie la culture des sciences. Mais quand Rome se fut asservi le monde, quand les vertus civiques et la liberté furent étouffées par le luxe et le despotisme, les maîtres d’un peuple dégénéré songèrent uniquement à développer et à satisfaire, dans l’intérêt de leur pouvoir, ses appétits matériels. Il fallait aux soldats le donativum, la haute paye du nouveau César ; il fallait au peuple des banquets dans la rue, des bêtes féroces et le sang des gladiateurs dans le cirque.
Au Moyen Âge, dit un historien, les fêtes que donnaient les souverains, à l’occasion d’évènements qui ne concernaient que leurs familles, n’étaient pas destinées au peuple, qui, la plupart du temps, n’y prenait aucune part. Cependant les rois l’en dédommageaient de temps en temps par divers jeux, entre autres par des représentations scéniques, pantomimes burlesques, satiriques, ou pièces muettes à grand spectacle jouées en plein air. Telle fut, par exemple, cette fête somptueuse que Philippe le Bel donna en 1313 à Paris, à l’occasion de la promotion de ses fils à l’ordre de la chevalerie. Pendant les quatre jours que durèrent les réjouissances, on vit différents spectacles qui représentaient des Ribauds dansant en chemise, la Vie du Renard, un Roi de la fève, un Tournoi d’enfants, Adam et Ève, les Trois Rois, le Massacre des Innocents, la Décollation de saint Jean-Baptiste, Hérode, etc. Ces diverses représentations, réunissant tout ce que le luxe, les ressources et l’imagination du temps pouvaient produire de merveilles, furent jusqu’au temps de Henri II, pour le moins, consacrées à rehausser l’éclat des entrées solennelles des rois et des reines.
La misère de ce peuple, auquel on daignait ainsi jeter de temps en temps quelques divertissements, n’empêcha à aucune époque le roi et les seigneurs de lui extorquer l’argent nécessaire à leurs fêtes. Le lendemain de ces fêtes on haussait l’impôt, et l’on pouvait déjà, au quatorzième siècle, dire comme un ambassadeur vénitien en 1635, que « Sa Majesté peut augmenter les tailles à plaisir, et plus ses peuples sont grevés, plus ils payent gaiement. » Malgré la maladie de Charles VI et l’épuisement du royaume, Paris était, à cette époque funeste, la ville de l’Europe où l’on s’occupait le plus de plaisirs et où l’on étalait le plus de luxe. Les princes du sang ne songeaient qu’à enivrer de plaisirs la jeunesse brillante dont ils étaient entourés. Ils avaient en cela, jusqu’à un certain point, un but politique. Ils espéraient pouvoir, en retour, compter sur le dévouement et la bravoure de ceux qu’ils amusaient. Les rois de Sicile et de Navarre préféraient leur qualité de princes français à leurs souverainetés étrangères ; les ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon, aimaient mieux fixer leur résidence dans la capitale que de se reléguer dans leurs gouvernements, où il n’eût tenu qu’à eux de se rendre indépendants. Sismondi va même jusqu’à dire que, si la France ne fut pas démembrée au commencement du quinzième siècle, elle en fut surtout redevable à ces fêtes qui rendaient chez les grands la vanité plus forte que l’ambition, et qui, au milieu de leurs guerres civiles, leur faisaient désirer le moment de remettre l’épée dans le fourreau. Ainsi cette supériorité d’élégance, cet attrait que, par ses fêtes, Paris offrait aux princes étrangers, exercèrent déjà, dès le quatorzième siècle, une influence signalée sur la politique. (Le Bas, Dictionnaire historique de la France.)
Dans son ouvrage sur la Bienfaisance publique, de Gérando regrettait que nos fêtes populaires n’eussent plus le caractère élevé que les peuples antiques avaient donné à quelques-unes de leurs solennités. « Ces fêtes, dont l’intérêt était si bien compris des législateurs de l’antiquité, sont, disait-il, beaucoup trop négligées de nos jours ; elles ne sont pas assez multipliées, on en varie trop peu les programmes ; on étudie trop peu leur objet ; on méconnaît trop leur effet moral. Pourquoi n’y reproduit-on pas le souvenir des mémorables faits de l’histoire nationale, de ceux qui peuvent nourrir un vrai et sage patriotisme ? Pourquoi n’y fait-on pas revivre l’image des grands hommes ? Pourquoi ne saisit-on pas cette occasion de distribuer de hautes récompenses ? Pourquoi ne célèbre-t-on pas mieux les présents que le ciel verse sur la terre ? Pourquoi laisse-t-on aux seuls bateleurs le soin de faire les frais de ces réunions populaires ?… Que d’occasions favorables pour instituer des fêtes semblables ! Que de moyens de les animer, de les embellir !… Nous voudrions, dans chaque village, leur donner un caractère tout nouveau, qui exciterait l’admiration et les transports sans entraîner de grandes dépenses. On sèmerait des vertus en répandant le contentement.
« … Élevez le caractère moral de l’homme voué aux travaux manuels, pour qu’il résiste à l’influence fâcheuse attachée aux travaux monotones qu’introduisent les nouvelles combinaisons de l’industrie, pour que son activité ne dégénère pas en irritation, pour que son bien-être lui-même ne serve pas à le corrompre.
Loin d’être étranger aux jouissances de la sociabilité, l’homme laborieux aime à sortir quelquefois de l’isolement auquel le condamnent son malheur ou sa profession ; il se plaît dans les réunions qui lui font éprouver de douces sympathies ; il se retrouve avec plaisir au milieu de ses frères dans les temples, dans les fêtes, dans les promenades publiques. Les hommes aiment à se sentir dans une communauté de but, d’émotions, d’intérêts, même de dangers, et à se retrouver dans les assemblées qui les leur rappellent ; c’est une partie de la joie des soldats sous leurs drapeaux, des marins à leur bord. »
À l’époque, déjà loin de nous, où de Gérando écrivait ces lignes, on avait banni de nos fêtes certaines scènes révoltantes pour un peuple civilisé. À ces cohues ignobles où le vin coulait d’un tonneau dans la bouche de malheureux qui se disputaient la place, où le sort partageait des victuailles à la foule, on avait, en 1830, substitué des distributions de secours au domicile des indigents qui, ce jour-là du moins, ne souffraient pas de la faim ; mais on offrait encore à la multitude des spectacles soi-disant militaires qui ne pouvaient lui donner que des idées fausses et des préjugés funestes.
En instituant la fête nationale du 14 juillet, la France semble avoir voulu suivre le programme et réaliser les aspirations du grand économiste que nous citions à l’instant. Elle a voulu, en effet, célébrer, avec l’avènement de la Liberté, les grandes idées et les grandes réformes de 1789.
Ce sont aussi des fêtes que ces concours où les sciences, l’agriculture, l’industrie et les arts viennent révéler à tous leurs progrès merveilleux. Joignons-y les luttes pacifiques auxquelles une éducation physique bien dirigée prépare la jeunesse. Telles sont les fêtes qui conviennent à notre pays.
Une fois l’an, pendant vingt-quatre heures, les femmes, tenues le reste du temps dans un état voisin de l’esclavage, devenaient maîtresses absolues. Il leur était permis de demander ce qu’elles voulaient à leurs maris, qui ne pouvaient le leur refuser. Ce jour-là aussi les filles avaient la liberté de désigner celui qu’elles voulaient prendre pour époux. C’étaient en quelque sorte les Saturnales de la Perse.
Les fêtes de la Grèce étaient nombreuses ; on en comptait plus de deux cents. Chaque province, chaque ville ou village avait les siennes. La plupart était restreintes à la contrée qui les célébrait ; d’autres étaient le rendez-vous de tous les Grecs et attiraient un grand nombre d’étrangers. On fêtait le retour des saisons et les dieux qui les personnifiaient ; les évènements heureux ou glorieux avaient leurs anniversaires ; les néoménies solennisaient le premier jour du mois lunaire, et chaque mois avait, de plus, une fête attitrée qui lui donnait ou qui prenait son nom. Dans l’Attique, plus de quatre-vingts jours étaient enlevés par les fêtes à l’industrie et à l’agriculture, sans parler de celles qui n’entravaient ni le travail ni les affaires. Il semble que le fabuliste de la Grèce aurait pu dire comme le nôtre :
Mais un certain nombre de ces solennités étaient, au contraire, pour les villes qui les célébraient, une source de richesse ; on y venait en foule, même des pays éloignés. Elles avaient, en outre, l’avantage d’exciter l’émulation dans les arts. Toutes les fêtes religieuses avaient pour accessoire obligé un chœur dont le chant et la danse tenaient une place importante dans la cérémonie. À Athènes ce chœur était nombreux, ou plutôt il y avait dix chœurs, fournis, ainsi que leurs chefs respectifs ou chorèges, par chacune des dix tribus. Le chorège devait être âgé d’au moins quarante ans. Il choisissait lui-même ses choristes, enfants ou adolescents pour l’ordinaire ; un bon joueur de flûte et un maître à régler les pas et les gestes étaient chargés de les conduire et de les exercer. C’était de ces deux hommes que dépendait le succès dans le concours, ouvert à chaque fête entre les chœurs ; aussi les tirait-on au sort en présence d’un magistrat, des choristes et des chorèges. On exerçait les choristes plusieurs mois avant la fête. Les frais étaient à la charge du chorège ; mais ces fonctions onéreuses lui valaient beaucoup de considération ; des hommes illustres, comme Aristide et Epaminondas, n’avaient pas dédaigné de les remplir. Le chorège paraissait à la fêle, ainsi que les choristes, avec une couronne dorée et des vêtements magnifiques. Il n’épargnait ni l’intrigue, ni même l’argent, pour se rendre les juges favorables. L’émulation était des plus vives entre les tribus, comme entre les maîtres, car l’honneur de la victoire était partagé entre la tribu qui fournissait le chœur, le chorège et les maîtres qui l’avaient instruit. Le prix était, dans certaines occasions, un trépied que la tribu victorieuse consacrait dans un temple ou dans un édicule construit exprès. Quelquefois le chorège élevait un monument à sa propre gloire. On voit encore à Athènes, dans la rue des Trépieds, un gracieux édifice, le seul échappé à la ruine parmi ceux qui ornaient cette rue dans l’antiquité. C’est une rotonde en marbre blanc surmontée d’un fleuron sculpté ; une inscription indique sa destination et la date de sa construction. Elle fut élevée, par les soins et aux frais du chorège Lysicrate, 355 ans avant notre ère.
Les lois déclaraient inviolables, pendant le temps des fêtes, la personne du chorège et celle des acteurs.
Les fêtes les plus importantes étaient annuelles ou revenaient à des intervalles de deux, trois ou quatre années. Parmi ces grandes solennités, plusieurs ont été chantées par les poètes les plus illustres ; elles ont fait naître une foule de chefs-d’œuvre sous la main de Phidias et des autres maîtres ; enfin quelques-unes, et surtout celles d’Olympie, sont restées célèbre dans l’histoire, dont elles ont pendant des siècles marqué les périodes. Aussi, pour nous, les fêtes de la Grèce se présentent toujours avec le prestige des merveilles de l’art, des grands hommes et des grandes actions, dont la mémoire ne saurait périr.
Toutes les fêtes de la Grèce étaient considérées comme des cérémonies religieuses, car elles avaient pour objet le culte d’une divinité ; mais chacune d’elles recevait de cette divinité même un caractère particulier : celles de Minerve et de Cérès, par exemple, étaient remarquables par une gravité solennelle qui n’excluait ni la pompe ni la magnificence, tandis que le désordre et la licence régnaient dans les fêtes de Bacchus. Les Panathénées, consacrées à Minerve, les Éleusinies, fêtes de Cérés Éleusine, et les Dionysiaques ou fêtes de Bacchus, étaient les trois fêtes religieuses les plus importantes. Nous nous bornerons à parler des deux premières.
Nommées d’abord Athénées (Athènaia), les fêtes de Minerve (Athènè) avaient, disait-on, été fondées par Érichton, fils de Vulcain, ou, suivant d’autres, par Thésée, lorsqu’il réunit au point de vue politique tous les bourgs ou dêmes de l’Attique à la ville d’Athènes ; elles reçurent alors le nom de Panathénées (Panathènaia), comme pour exprimer l’union de tous en un seul État.
On distinguait les petites et les grandes Panathénées ; les petites étaient annuelles, les grandes revenaient tous les cinq ans. On n’y consacrait d’abord qu’un jour, car Thucydide nous apprend que le jour des grandes Panathénées était le seul où, sans exciter le soupçon, plusieurs citoyens pouvaient se réunir armés pour se mêler au cortège. Plus tard on les prolongea, pour en augmenter la pompe et la solennité. Il était interdit de s’y présenter vêtu d’étoffes teintes.
Les petites Panathénées commençaient le vingtième jour du mois de Thargélion, correspondant à la fin d’avril et au commencement de mai. Elles suivaient immédiatement les Bendidies, fête de Diane Bendis qui tenait, à certains égards, des Dionysiaques. Elles consistaient en un triple concours équestre, gymnique et musical, suivi d’un grand sacrifice et d’un festin donné au peuple. Le soin du concours était confié à dix juges ou athlothètes, choisis en nombre égal dans les dix tribus et nommés pour quatre ans.
La fête commençait le soir par des courses aux flambeaux qui se prolongeaient une partie de la nuit. Ce fut d’abord une course à pied, plus tard une course équestre. Elle se faisait dans l’Académie, qui se trouvait comprise dans le Céramique extérieur séparé par le mur d’enceinte du Céramique proprement dit. La carrière, longue de six à sept stades (environ 1 200 mètres), s’étendait depuis l’autel de Prométhée jusqu’au mur de la ville, et des jeunes gens y étaient placés à distances égales. Au signal donné, le plus rapproché de l’autel y allumait un flambeau et, courant de toute sa vitesse, le portait au coureur suivant, qui le transmettait au troisième et ainsi de suite. Ceux qui le laissaient s’éteindre étaient exclus du concours ; ceux qui ralentissaient leur course étaient livrés aux railleries et même aux coups de la foule des spectateurs. Il fallait, pour obtenir le prix, avoir parcouru les différentes stations. Cette course avait lieu aussi pendant les fêtes de Vulcain, suivant Hérodote.
Le concours gymnique comprenait les différents exercices de la palestre, et notamment le pancrace et le pentathle ; on l’appelait le combat de la force et du courage. Il avait lieu dans le stade Panathènaïque, creusé dans une des collines de la rive gauche de l’Ilissus, sur le territoire du dôme d’Echélide, près d’Ardettos et non loin du Pirée » suivant Meursius. Ce stade, de 255 mètres en longueur sur environ 41 de largeur à l’une de ses extrémités et 85 à l’autre, fut embelli par Lycurgue, l’orateur, qui fit niveler l’arène et construire un podium ou soubassement. Les spectateurs étaient assis sur le sol en pente des collines, Hérode Atticus, dit le Sophiste, couvrit ces pentes de gradins en marbre pentélique, et le stade d’Athènes devint un des plus beaux de la Grèce.
Le concours musical, fondé par Périclès, avait lieu dans l’Odéon. On entendait d’abord les joueurs de flûte (sunaulia) exécutant un chant rythmé sans paroles, puis les chanteurs s’accompagnant de la lyre, ensuite des chœurs. Venait enfin le concours des poètes. Leur œuvre comprenait quatre drames, dont le dernier devait être satirique et dont l’ensemble était appelé tétralogie. On ajouta plus tard à ces jeux des danses pyrrhiques, exécutées par des adolescents, en mémoire de la danse de Minerve, victorieuse des Titans.
Ce fut à l’occasion d’un concours analogue qu’Hérodote, suivant quelques auteurs, lut à la fête des Panathénées son admirable histoire, embrassant tout ce qu’on savait alors de l’antiquité. Les Athéniens lui décernèrent pour récompense la somme considérable de dix talents.
Les vainqueurs donnaient un festin à leurs amis. Ils recevaient comme prix une couronne d’olivier et une cruche d’huile provenant de certains oliviers qui végétaient près de l’Académie. Cette huile, donnée en prix, était la seule qu’il fût permis d’exporter hors de l’Attique.
La fête se terminait par un grand sacrifice, auquel toutes les villes de l’Attique et les colonies d’Athènes contribuaient en envoyant chacune un bœuf. Le sacrifice était suivi d’un festin donné au peuple, et pendant lequel on se servait de vases à boire dits panathénaïques. Ces vases contenaient, suivant Meursius, au moins deux conges, c’est-à-dire plus de six litres.
Sous la domination romaine, on ajouta aux Panathénées des combats de gladiateurs, assaisonnement de haut goût dont les Romains ne pouvaient se passer dans aucune circonstance, banquets, fêtes religieuses, funérailles, etc. Ces gladiateurs d’Athènes étaient, au dire des historiens, des misérables sortis de la lie sociale, chargés de tous les crimes, et qu’on achetait à grand prix dans la citadelle. Il en fut ainsi jusqu’au temps d’Apollonius de Tyane, qui persuada aux Athéniens de faire cesser les combats de gladiateurs, disant qu’il était impie de substituer des hécatombes humaines aux sacrifices de bœufs.
Les grandes Panathénées se célébraient tous les cinq ans, le 23 Hécatombéon, mois qui correspondait à la fin de juin et au commencement de juillet. C’était, de toutes les fêtes quinquennales, la seule, au dire de Meursius, dont l’organisation ne fût pas attribuée aux hieropoioi, fonctionnaires chargés des cérémonies sacrées.
Elles comprenaient les mêmes cérémonies que les Panathénées annuelles, et, de plus, le transport solennel du péplum de Minerve. Cette draperie, analogue au vêtement du même nom que portaient les femmes grecques, figurait la voile du vaisseau panathénaïque. Elle était blanche, parsemée de clous ou boutons d’or, ornée de broderies en or représentant le combat, de Minerve contre les Titans et les exploits des grands hommes.
Plus tard la flatterie y fit mettre les images d’Antigone et Démétrius, qui ne pouvaient rappeler aux Athéniens que l’envahissement de leur patrie.
Le péplum était porté en grande pompe et suivi d’une foule immense formant un long cortège. Cette procession, dont les admirables bas-reliefs de Phidias nous montrent les principaux détails, se formait hors de la ville, près du temple de Cérès, entre la porte du Pirée et la porte Sacrée, dans un édifice attribué à cet usage pour les Panathénées comme pour toutes les cérémonies analogues.
Ce fut pendant qu’il organisait le cortège des Panathénées qu’Hipparque fut tué par Harmodius et Aristogiton.
Voici comment les auteurs décrivent la procession des grandes Panathénées :
On suspendait le péplum, comme une voile, au mât d’un vaisseau de construction particulière et disposé de manière à se mouvoir sur le sol comme un chariot, et non à flotter sur les eaux ; c’était le vaisseau panathénaïque, spécialement consacré à Minerve. On le conservait, suivant Pausanias, dans un lieu voisin de l’Aréopage. Quand le cortège se mettait en marche, le vaisseau, traîné par des chevaux, suivant les uns, mû, suivant d’autres, par un mécanisme intérieur, semblait obéir à l’impulsion de ses avirons et au vent qui gonflait sa voile. Il parcourait ainsi le Céramique jusqu’au temple de Cérès Éleusinienne, faisait le tour du temple, puis, dépassant le mur Pélasgique et le temple d’Apollon Pythien, revenait à sa place. Plus tard, on porta le péplum dans la citadelle, au-delà des Hermès. Quand la partie inférieure du péplum se trouvait souillée de poussière pendant le trajet, il était nettoyé par des gens chargés de ce soin religieux, puis on en revêtait la statue de Minerve.
Des personnes de tous les rangs et de tout âge prenaient place dans le cortège. En tête marchaient des vieillards des deux sexes, tenant à la main un rameau d’olivier, et appelés à cause de cela tallophores. Venaient ensuite des hommes dans la force de l’âge, portant des armes ; puis les métèques (metoicoi), c’est-à-dire les étrangers établis en Attique, portant des vases qui contenaient le miel et les gâteaux destinés aux sacrifices : c’étaient les scaphéphores ; quelques-uns, suivant Meursius, portaient des hoyaux. Après eux venaient les femmes athéniennes, suivies des femmes métèques qui portaient des urnes pleines d’eau : c’étaient les hydriophores.
Les éphèbes s’avançaient ensuite, vêtus de la chlamyde, couronnés et chantant le Pæan, l’hymne de la déesse. Leur chlamyde était noire, en signe de deuil pour la mort du héraut Copreus, tué par les Athéniens tandis qu’il arrachait aux autels les Heraclides. Hérode Atticus fit cesser ce deuil et porter des chlamydes blanches.
Les canéphores suivaient les éphèbes ; c’étaient des jeunes filles d’Athènes qui portaient les corbeilles sacrées, contenant les objets nécessaires au culte, et que recouvraient des voiles dits istrionides. Ces corbeilles, comme tout ce qui servait à la cérémonie, étaient confiées à la garde des archithéores, qui les distribuaient aux jeunes filles en ne touchant qu’avec respect les corbeilles et les voiles sacrés. Les canéphores étaient choisies dans les familles les plus nobles, et ces fonctions ne s’accordaient pas indifféremment ; aussi, quand Hipparque refusa d’admettre à cet honneur la sœur d’Harmodius, comme indigne par sa naissance de l’obtenir, ce fut une insulte pour la famille. Les canéphores étaient suivies par les diphrophores et les skiadéphores, ou porteuses d’escabeau et de parasol ; c’étaient les filles des métèques que la loi forçait, aussi bien que leurs parents, à remplir dans le cortège ces humbles fonctions. Meursius pense que des enfants vêtus de tuniques fermaient la marche, parce que c’était l’usage dans toutes les cérémonies analogues.
On appelait nomophylaques les ordonnateurs de la cérémonie. Ils avaient la tête ceinte d’une bandelette blanche.
Pendant la marche du cortège, des rhapsodes récitaient les vers d’Homère ; cet usage avait été institué par Hipparque en l’honneur du grand poète et pour lui seul. C’était aussi la coutume de décerner, en cette occasion, une couronne d’or aux citoyens qu’on voulait honorer d’une manière exceptionnelle. Leur nom était proclamé par le héraut dans l’enceinte du concours gymnique. On sait qu’un décret, rendu sur la proposition de Ctésiphon, avait accordé cette récompense à Démosthène. Eschine voulut faire annuler le décret, et Démosthène obtint qu’il fût maintenu en prononçant devant le peuple assemblé le Discours pour la couronne.
Enfin, pendant les Panathénées, comme dans toutes les fêtes quinquennales, le héraut implorait la faveur des dieux pour les Athéniens et pour les Platéens, en mémoire de la belle conduite de ces derniers à la bataille de Marathon.
Telle était la procession ou, comme le disaient les Grecs, la pompe des grandes Panathénées. Phidias l’avait représentée dans la frise de la Cella du Parthénon.
Les Éleusinies, fête de Cérès Éleusine, appelées par les Grecs Eleusinia ou Mysteria (lesmystères) ; étaient la plus vénérée des fêtes de l’antiquité.
Leur fondation était attribuée à Érechthée par les uns, par d’autres à Cérès. Érechthée, disait-on, ayant apporté d’Égypte à Athènes de grandes quantités de blé pendant une famine, fut fait roi par les Athéniens en reconnaissance de ce bienfait, et les initia au culte de Cérès.
On disait aussi que Cérès parcourant le monde, à la recherche de sa fille Proserpine, enlevée par Pluton, s’arrêta dans un lieu qu’elle nomma Éleusis (arrivée), et, succombant à la fatigue, s’assit près d’un puits appelé Callichoros. Une vieille, nommée Baubô, la reçut dans sa demeure et lui offrit un potage que Cérès refusa. Baubô, pour la distraire de son chagrin, s’avisa d’une mimique fort saugrenue, mais qui réussit à faire rire la déesse, et Cérès, un peu consolée, prit le potage.
Suivant une autre légende, Cérès, ayant été accueillie par Célée, roi d’Éleusis, guérit Triptolème, son fils ; puis, quand elle eut retrouvé Proserpine, institua les Mystères et donna aux Athéniens le froment, dont elle avait enseigné la culture à Triptolème. Quelques auteurs attribuent à Orphée l’institution des Éleusinies. D’autres enfin disent qu’elles furent instituées par les Athéniens comme témoignage de leur reconnaissance envers Cérès, qui leur avait donné, avec l’agriculture, les premiers éléments de la civilisation.
Ce que l’on sait des rites usités en Égypte dans la célébration des fêtes d’Isis ne permet pas de douter que les Éleusinies, comme beaucoup d’autres cérémonies religieuses de la Grèce, aient été importées d’Égypte, ainsi que le dit Hérodote. Le culte égyptien, toujours austère et mystérieux, prit un autre caractère chez un peuple artiste, léger et ami des plaisirs ; mais l’idée première et le but de l’initiation restèrent les mêmes : épurer les croyances religieuses, en les dépouillant de la forme toute matérielle dont les enveloppait le culte vulgaire ; présenter les mythes sous un jour nouveau qui permettrait, comme le dit Cicéron, de mieux connaître la nature des choses et les principes de la vie… « Les mystères, dit M. A. Maury, atteignirent graduellement la forme systématique sous laquelle ils ont fini par constituer une religion distincte de la religion populaire. La pensée religieuse a été se dégageant sans cesse, dans cette doctrine, des éléments et des idées matérielles par lesquels elle s’était exprimée à l’époque antique, et elle les a remplacés par des conceptions plus pures et plus élevées, auxquelles les mythes ne servirent plus que d’enveloppe. On peut donc considérer les mystères non comme le résultat d’une révélation première, mais comme celui du travail de l’esprit religieux, de l’épuration du sentiment de la divinité. Aussi est-ce dans leur sein que le polythéisme revêtit sa forme la plus rapprochée des idées spiritualistes dont le christianisme assura le triomphe ; ils furent le dernier effort du paganisme vers le monothéisme. »
On regardait les mystères comme devant avoir un effet de moralisation. L’initiation était appelée télétè, c’est-à-dire la plus haute dignité, l’état le plus parfait que l’homme pût atteindre. Elle rendait la vie plus heureuse, disait-on, et assurait le bonheur après la mort. Les Grecs, les Romains, les gens de tous les pays recherchaient l’initiation éleusinienne ; les Athéniens la faisaient donner à leurs enfants encore jeunes, et, si on l’avait négligée jusqu’aux dernières années de la vie, on tenait du moins à la recevoir avant la mort. Quelques hommes, même des plus illustres, s’y refusèrent cependant, et quand les adeptes, dans leur enthousiasme, assuraient à Diogène qu’après leur mort ceux qui n’étaient pas initiés restaient aux enfers, plongés dans la fange, le Cynique leur répondait qu’il était ridicule de supposer qu’Agésilas et Epaminondas fussent enfouis dans le fumier, tandis que des lâches pourraient s’ouvrir par l’initiation le séjour des bienheureux.
On distinguait les petits et les grands mystères. Les petits se célébraient tous les ans à Agra, près d’Athènes, dans le mois d’Anthestérion (fin de novembre et commencement de décembre). Les grands mystères avaient lieu tous les cinq ans à Éleusis, dans le mois de Boédromion (fin d’août et commencement de septembre).
L’origine des petits mystères passait pour moins ancienne que celle des grands ; elle remontait, disait-on, au temps d’Hercule. Ayant reçu d’Eurysthée l’ordre d’aller chercher Cerbère chez Pluton, Hercule, avant de partir pour ce dangereux voyage, eut l’idée de se faire initier. Peut-être croyait-il s’acquérir ainsi la bienveillance de Proserpine et se donner un vernis d’homme comme il faut dans une maison dont il allait voler le chien, dit Aristophane. Il se présenta donc à l’initiation ; mais, dans ces temps reculés, les étrangers n’y pouvaient prétendre, et Hercule était de Thèbes. Cependant les Athéniens désiraient lui être agréables, car il avait déjà rendu bien des services aux pays environnants, et, quoique l’importation du taureau de Marathon ne fût certes pas un bienfait pour l’Attique, c’était peut-être une raison de plus pour qu’on craignît de désobliger le héros qui l’y avait amené de Crète. Hercule avait pour lui la force, il était la force personnifiée, et déjà, comme on peut croire, le droit était, contre la force, un pauvre argument. Pour sortir d’embarras, on fit adopter le fils d’Alcmène par un Athénien nommé Pylius, puis on l’initia, suivant les uns à Éleusis, suivant d’autres à Mélité, dême de l’Attique, mais, en tout cas, aux petits mystères seulement ; et ce fut leur origine. Ils étaient consacrés à Proserpine.
À l’exemple d’Hercule, Bacchus, Thébain comme lui par sa mère, se fit initier. Vinrent ensuite les Dioscures, adoptés par Aphidmes, comme Hercule l’avait été par Pylius ; puis Esculape, puis Hippocrate. Plus tard on admit tous les étrangers, sauf les Barbares, en haine des Perses et des Mèdes, quoiqu’un Thrace, Eumolpus, eût été le premier fondateur des mystères, ou du moins le premier qui eût rempli les fonctions d’hiérophante.
Les petits mystères étaient une préparation aux grands, un premier degré dans l’initiation, ce qui a fait dire à Euripide que le sommeil était les petits mystères de la mort. L’initié y apprenait les fondements secrets de la doctrine qui devait lui être complètement révélée dans les grands mystères.
On désignait l’initiation par le mot de muèsis (enseignement, révélation). Les initiés aux petits mystères recevaient le titre de mystes, du verbe muô (fermer), parce que l’interdiction de rien révéler leur fermait la bouche. Initiés aux grands mystères, ils prenaient le titre d’époptes (contemplateurs). Les mystes ne dépassaient pas le vestibule du temple, dont la porte s’ouvrait pour eux quand, devenus époptes, ils étaient admis à contempler les mystères du culte, ou du moins ce qu’on leur en montrait, car il paraît que certains secrets étaient réservés à des adeptes exceptionnels ou aux ministres, de qui mystes et époptes recevaient l’initiation. Le grade d’épopte n’était conféré que pendant les grands mystères, en sorte que, si l’on était reçu myste dans l’année qui les suivait, il fallait attendre quatre ans l’initiation complète, et un an seulement quand on était devenu myste l’année qui les précédait. C’était le moindre intervalle permis entre la petite et la grande initiation ; mais ce que la légende raconte à propos d’Hercule, l’histoire le rapporte de Démétrius Poliorcète. Maître d’Athènes par la conquête, il voulut être initié en une seule fois à tous les grades, et il fallut bien faire ce qu’il voulait.





























