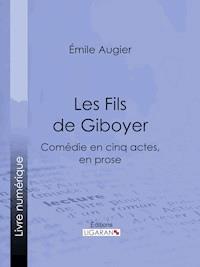
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quoi qu'on en ait dit, cette comédie n'est pas une pièce politique, dans le sens courant du mot: c'est une pièce sociale. Elle n'attaque et ne défend que des idées, abstraction faite de toute forme de gouvernement. Son vrai titre serait les Cléricaux, si ce vocable était de mise au théâtre. Le parti qu'il désigne compte dans ses rangs des hommes de toutes les origines, des partisans de l'empire comme des partisans des Bourbons."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUX ARTISTES
QUI INTERPRÈTENT MA COMÉDIE AVEC UNE SI RARE PERFECTION
HOMMAGE D’AFFECTUEUSE RECONNAISSANCE
ÉMILE AUGIER
Quoi qu’on en ait dit, cette comédie n’est pas une pièce politique, dans le sens courant du mot : c’est une pièce sociale. Elle n’attaque et ne défend que des idées, abstraction faite de toute forme de gouvernement.
Son vrai titre serait les Cléricaux, si ce vocable était de mise au théâtre.
Le parti qu’il désigne compte dans ses rangs des hommes de toutes les origines, des partisans de l’empire comme des partisans de la branche aînée et de la branche cadette des Bourbons. Maréchal, actuellement député, le marquis d’Auberive, Couturier de la Haute-Sarthe, ancien parlementaire, représentent dans ma comédie les trois fractions du parti clérical, unies dans la haine ou la peur de la démocratie ; et si Giboyer les englobe toutes trois sous la dénomination de légitimistes, c’est qu’en effet les légitimistes seuls sont logiques et n’abdiquent pas en combattant l’esprit de 89.
L’antagonisme du principe ancien et du principe moderne, voilà donc tout le sujet de ma pièce. Je défie qu’on y trouve un mot excédant cette question ; et j’ai l’habitude de dire les choses assez franchement pour ne laisser à personne le droit de me prêter des sous-entendus.
D’où viennent donc les clameurs qui s’élèvent contre ma comédie ? Par quelle adresse cléricale soulève-t-on contre elle la colère de partis auxquels elle ne touche pas ? Par quelle falsification de mes paroles arrive-t-on à feindre de croire que j’attaque les gouvernements tombés ? Certes, c’est une tactique adroite de susciter contre moi un sentiment chevaleresque qui a un écho dans tous les cœurs honnêtes ; mais où sont-ils ces ennemis que je frappe à terre ? Je les vois debout à toutes les tribunes ; ils sont en train d’escalader le char de triomphe ; et quand j’ose, moi chétif, les tirer par la jambe, ils se retournent indignés en criant : Respect aux vaincus !
En vérité, c’est trop plaisant !
Un reproche plus spécieux qu’ils m’adressent, c’est d’avoir fait des personnalités.
Je n’en ai fait qu’une : c’est Déodat. Mais les représailles sont si légitimes contre cet insulteur, et il est d’ailleurs si bien armé pour se défendre !
Quant à l’homme d’État considérable et justement honoré qu’on m’accuse d’avoir mis en scène, je proteste énergiquement contre cette imputation : aucun de mes personnages n’a la moindre ressemblance avec lui, ni de près ni de loin. Je connais les droits et les devoirs de la Comédie aussi bien que mes adversaires : elle doit le respect aux personnes, mais elle a droit sur les choses. Je me suis emparé d’un fait de l’histoire contemporaine qui m’a paru un symptôme frappant et singulier de la situation troublée de nos esprits ; je n’en ai pris que ce qui appartient directement à mon sujet, et j’ai eu soin d’en changer les circonstances pour lui ôter tout caractère de personnalité. Que peut-on me demander de plus ?
Répondrai-je à ceux qui reprochent à ma comédie d’avoir été autorisée, c’est-à-dire d’exister ? Le point est délicat. S’il est permis de comparer les petites choses aux grandes, je demanderai à ces puritains qui ont jamais songé à reprocher au Tartufe la tolérance de Louis XIV ?
ÉMILE AUGIER.
LE MARQUIS D’AUBERIVE : M. SAMSON.
LE COMTE D’OUTREVILLE : M. LAROCHE.
M. MARÉCHAL : M. PROVOST.
GIBOYER : M. GOT.
MAXIMILIEN GÉRARD : M. DELAUNAY.
LA BARONNE PFEFFERS : Mme ARNOULD-PLESSY.
MADAME MARÉCHAL : Mme NATHALIE.
FERNANDE : Mme FAVART.
DUBOIS, valet de chambre du Marquis : M. BARRÉ.
M. COUTURIER DE LA HAUTE-SARTHE : M. MIRECOUR.
LE VICOMTE DE VRILLIÈRE : M. VERDELLET.
LE CHEVALIER DE GERMOISE : M. RAYMOND.
MADAME DE LAVIEUXTOUR : Mlle COBLENTZ.
La scène est à Paris, de nos jours
Le cabinet du marquis. – Porte au fond. À droite de la porte une petite bibliothèque ; à gauche, une armoire d’armes. – Au premier plan, à gauche, une cheminée, à côté de laquelle une causeuse et un guéridon. – Au milieu de la scène, une table.
Le Marquis, achevant de déjeuner sur le guéridon ; Dubois, la serviette sur le bras, tient à la main une bouteille de Xérès.
Je crois que l’appétit est tout à fait revenu.
Oui, monsieur le Marquis, et il est revenu de loin. Qui dirait, à vous voir, que vous sortez de maladie ! Vous avez un visage de nouveau marié.
Tu trouves ?
Et je ne suis pas le seul. Toutes les commères du quartier me disent : « M. Dubois, cet homme-là… (sauf votre respect, monsieur le Marquis) cet homme-là se remariera, et plus tôt que plus tard. Il a du conjungo dans l’œil. »
Ah ! elles disent cela, les commères ?
Elles n’ont peut-être pas tort.
Apprenez, monsieur Dubois, que quand on a eu le malheur de perdre un ange comme la marquise d’Auberive, on n’a pas la moindre envie d’en épouser un second. – Verse-moi à boire.
Je comprends cela ; mais monsieur le Marquis n’a pas d’héritier, c’est bien pénible.
Et qui te dit que j’en aurais ?
Oh ! j’en suis bien sûr.
L’entendez-vous comme Corvisart ?
Corvisart ?
Je ne me soucie pas d’être père in partibus infidelium ; c’est pourquoi veuf je suis et veuf je resterai : vous pouvez en faire part aux commères.
Mais votre nom, monsieur le Marquis ! Cet antique nom d’Auberive, le laisserez-vous s’éteindre ? Permettez à un vieux serviteur d’en être navré.
Que diable, mon bon ami, ne soyez pas plus royaliste que le roi !
Et que voulez-vous que je devienne, moi ? S’il n’y a plus d’Auberive au monde, qui voulez-vous que je serve ?
Tu as des économies : tu vivras en bourgeois, tu seras ton maître.
Quelle chute ! Je ne m’en relèverai pas. Votre vieux serviteur vous suivra dans la tombe.
À quinze pas, s’il vous plaît ! – Tu m’attendris, Dubois ; sèche tes larmes, tout n’est pas désespéré.
Quoi ! mon maître se rendrait à mes humbles prières ?
Non, mon ami ; j’ai fait mon temps et je ne reprendrai pas de service. Mais je tiens à mon nom autant que tu peux y tenir toi-même, sois-en persuadé, et j’ai trouvé une combinaison extrêmement ingénieuse pour le perpétuer sans m’exposer.
Quel bonheur ! je n’ose pas demander à monsieur le Marquis…
Tu fais bien ! Reste dans cette modestie, et qu’il te suffise de savoir que je te prépare des Auberive. J’attends aujourd’hui même… j’attends beaucoup de monde aujourd’hui.
Oh ! le meilleur des maîtres !
Tu es un bon garçon, je ne t’oublierai pas.
J’y compte bien.
Enlève le couvert ; je monterai à cheval à deux heures.
À cheval !
Mme la baronne Pfeffers. Il sort.
Le Marquis, la Baronne.
Eh ! chère Baronne, qui peut valoir à un vieux garçon comme moi l’honneur d’une si belle visite ?
En vérité, Marquis, c’est ce que je me demande. En vous voyant, je ne sais plus pourquoi je suis venue et j’ai bien envie de m’en retourner du même pas.
Asseyez-vous donc, méchante femme.
Non pas ! – Comment, vous fermez votre porte pendant huit jours, vos gens ont des mines tragiques, vous tenez vos amis dans les transes, on vous pleure déjà, et quand on pénètre jusqu’à vous, on vous surprend à table !
Je vais vous dire : je suis une vieille coquette et je ne me montrerais pas pour un empire quand je suis de mauvaise humeur ; or, la goutte me change entièrement le caractère ; elle me rend méconnaissable, c’est pourquoi je me cache.
À la bonne heure ! Je cours rassurer nos amis.
Ils ne sont pas si inquiets que cela. Donnez-moi un peu de leurs nouvelles.
C’est qu’il y en a un dans ma voiture qui m’attend.
Je vais lui envoyer dire que je le prie de monter.
C’est que je ne sais si… si vous le connaissez.
Son nom ?
Je l’ai rencontré par hasard…
Et vous l’avez amené à tout hasard. Il sonne. Vous êtes une mère pour moi. À Dubois. Descendez, vous trouverez un ecclésiastique dans la voiture de Mme la baronne ; vous lui direz que je le remercie beaucoup de son aimable empressement, mais que je ne suis pas disposé à mourir ce matin.
Ah ! Marquis, que diraient nos amis, s’ils vous entendaient ?
Bah ! je suis l’enfant terrible du parti, c’est convenu – et son enfant gâté. Dubois, vous ajouterez que madame la Baronne prie M. l’Abbé de se faire reconduire et de lui renvoyer sa voiture ici.
Permettez…
C’est comme cela. – Allez, Dubois. – Vous voilà ma prisonnière.
Mais, Marquis, c’est à peine convenable.
Flatteuse ! – Asseyez-vous, cette fois, et causons de choses sérieuses, madame Égérie. Prenant un journal sur la table. La goutte ne m’a pas empêché de lire notre journal. Savez-vous que la mort de ce pauvre Déodat s’y fait cruellement sentir ?
Ah ! Quelle perte ! Quel désastre pour notre cause !
Je l’ai pleuré.
Quel talent ! Quelle verve ! Quel sarcasme !
C’était le hussard de l’orthodoxie… Il restera dans nos fastes sous le nom du pamphlétaire angélique… Conviciator angelicus… Et maintenant que nous sommes en règle avec sa grande ombre…
Vous en parlez bien légèrement, Marquis.
Puisque je l’ai pleuré !… Occupons-nous de son remplaçant.
Dites son successeur. Le ciel ne suscite pas deux hommes pareils coup sur coup.
Et si je vous disais que j’ai mis la main sur un second exemplaire ? Oui, Baronne, j’ai déterré une plume endiablée, cynique, virulente, qui crache et éclabousse ; un gars qui larderait son propre père d’épigrammes moyennant une modique rétribution, et le mangerait à la croque-au-sel pour cinq francs de plus.
Permettez, Déodat était de bonne foi.
Parbleu ! c’est l’effet du combat ; il n’y a plus de mercenaires dans la mêlée ; les coups qu’ils reçoivent leur font une conviction. Je ne donne pas huit jours à notre homme pour nous appartenir corps et âme.
Si vous n’avez pas d’autres garants de sa fidélité…
J’en ai ; je le tiens.
Par où ?
N’importe ! je le tiens.
Et qu’attendez-vous pour nous le présenter ?
Lui d’abord, son consentement ensuite. Il habite Lyon ; je pense qu’il arrivera aujourd’hui ou demain. Le temps de lui faire un bout de toilette et je l’introduis.
En attendant, j’avertirai le comité de votre trouvaille ?
Je vous prie. – Et à propos du comité, chère Baronne, vous serez bien aimable d’user de votre influence sur lui dans une affaire qui me touche personnellement.
Mon influence sur lui n’est pas grande.
Est-ce de la modestie ou l’exorde d’un refus ?
S’il faut absolument que ce soit l’un ou l’autre, c’est de la modestie.
Eh bien ! ma belle amie, apprenez, si vous ne le savez pas, que ces messieurs vous sont trop obligés pour vous rien refuser.
Parce que mon salon leur sert de parloir ?
D’abord ; mais le vrai, le grand, l’inestimable service que vous leur rendez tous les jours, c’est d’avoir des yeux superbes.
C’est bon pour vous, mécréant, de faire attention à ces choses-là.
C’est bon pour moi ; mais c’est encore meilleur pour ces hommes graves, leurs chastes vœux n’allant pas au-delà de cette sensualité mystique qui est le dévergondage de la vertu.
Vous rêvez !
Soyez sûre de ce que je vous dis. C’est par ce motif et non autre que toutes les coteries sérieuses ont toujours élu pour quartier général le salon d’une femme tantôt belle, tantôt spirituelle : vous êtes l’un et l’autre, Madame ; jugez de votre empire !
Vous me cajolez trop ; votre cause doit être détestable.
Si elle était excellente, je suffirais à la gagner.
Voyons, ne me faites pas languir.
Voici la chose : nous avons à choisir notre orateur à la Chambre pour la campagne que nous préparons contre l’université ; je voudrais que le choix tombât…
Sur M. Maréchal.
Vous l’avez dit.
Y songez-vous, Marquis ? M. Maréchal !
Oui, je sais bien… mais nous n’avons pas besoin d’un foudre d’éloquence, puisque nous fournissons les discours. Maréchal lit aussi couramment qu’un autre, je vous assure.
Nous l’avons fait députer à votre recommandation, c’était déjà beaucoup.
Permettez ! Maréchal est une excellente recrue.
Cela vous plaît à dire.
Vous êtes bien dégoûtée ! Un ancien abonné du Constitutionnel, un libéral, un voltairien, qui passe à l’ennemi avec armes et bagages… Comment vous les faut-il ? M. Maréchal n’est pas un homme, ma chère ; c’est la grosse bourgeoisie qui vient à nous ! Je l’aime, moi, cette honnête bourgeoisie qui a pris la Révolution en horreur depuis qu’elle n’a plus rien à y gagner, qui voudrait figer le flot qui l’apporta et refaire à son profit une petite France féodale. Laissons-lui retirer nos marrons du feu, ventre-saint-gris ! Pour ma part, c’est ce réjouissant spectacle qui m’a remis en humeur de politiquer. Vive donc M. Maréchal et tous ses compères, messieurs les bourgeois du droit divin ! Couvrons ces précieux alliés d’honneur et de gloire, jusqu’au jour où notre triomphe les renverra à leur moulin !
Mais nous avons plusieurs députés de la même farine ; pourquoi choisirions-nous le moins capable pour notre orateur ?
Encore un coup, ce n’est pas une question de capacité.
Vous protégez beaucoup M. Maréchal.
Que voulez-vous ? Je le regarde un peu comme un client de ma famille. Son grand-père était fermier du mien ; je suis subrogé tuteur de sa fille ; ce sont des liens.
Et vous ne dites pas tout.
Je dis tout ce que je sais.
Alors, permettez-moi de compléter vos renseignements. Le bruit court que vous n’avez pas été insensible jadis aux charmes de la première madame Maréchal.
Vous ne croyez pas, j’espère, à cette sotte histoire ?
Ma foi ! vous dédommagez tant M. Maréchal…
Que j’ai l’air de l’avoir endommagé ? Eh ! Mon Dieu ! qui peut se croire à l’abri de la malignité ! Personne… Pas même vous, chère Baronne.
Je serais curieuse de savoir ce qu’on peut dire de moi.
Des sottises, que je ne vous répéterai certainement pas.
Vous y croyez donc ?
Dieu m’en garde ! L’apparence que feu votre mari ait épousé la demoiselle de compagnie de sa mère ? Cela m’a mis d’une colère !
C’est faire trop d’honneur à de pareilles pauvretés.
J’ai répondu de la belle façon, je vous assure.
Je n’en doute pas.
C’est égal, vous avez raison de vouloir vous remarier.
Et qui vous dit que je le veuille ?
Ah ! C’est mal ! vous ne me traitez pas en ami. Je mérite d’autant plus votre confiance que je n’en ai pas besoin, vous connaissant comme si je vous avais faite. L’alliance d’un sorcier n’est pas à dédaigner, Baronne.
Montrez votre sorcellerie.
Volontiers ! Donnez-moi votre main.
Vous me la rendrez ?
Et je vous aiderai à la placer, qui plus est. Examinant la main de la baronne. Vous êtes belle, riche et veuve.
On se croirait chez mademoiselle Lenormand.
Avec tant de facilités, pour ne pas dire de tentations à mener une vie brillante et frivole, vous avez choisi un rôle presque austère, un rôle qui demande des mœurs irréprochables, et vous les avez.
Si c’était un rôle, vous avouerez qu’il ressemblerait fort à une pénitence.
Pas pour vous.
Qu’en savez-vous ?
Je le vois dans votre main, parbleu ! J’y vois même que le contraire vous coûterait davantage, vu le calme inaltérable dont la nature a doué votre cœur.
Dites tout de suite que je suis un monstre.
Tout à l’heure ! – Les naïfs vous prennent pour une sainte ; les sceptiques pour une ambitieuse de pouvoir ; moi, Guy-François Condorier, marquis d’Auberive, je vous prends simplement pour une fine Berlinoise en train de se construire un trône en plein faubourg Saint-Germain. Vous régnez déjà sur les hommes, mais les femmes vous résistent ; votre réputation les offusque, et ne sachant par où mordre sur vous, elles se retranchent derrière ce méchant bruit que je vous disais tout à l’heure. Bref, votre pavillon est insuffisant, et vous en cherchez un assez grand pour tout couvrir. Paris vaut bien une messe, disait Henri IV… c’est aussi votre avis.
On dit qu’il ne faut pas contrarier les somnambules ; permettez-moi cependant de vous faire observer que, si je voulais un mari, avec ma fortune et ma position dans le monde, j’en aurais déjà trouvé vingt pour un.





























