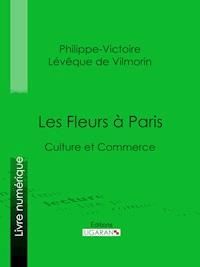
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Un commerce aussi actif que celui des fleurs fraîches, dont les transactions se renouvellent chaque jour pendant toute l'année, exige des installations spéciales dont le développement et l'importance sont en raison de la faveur dont les fleurs jouissent dans les différents pays. Paris, avec ses nombreux marchés aux fleurs partiellement couverts, a pu longtemps se regarder comme mieux partagé qu'aucune autre ville sous ce rapport..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le développement prodigieux pris depuis quelques années par le commerce et l’emploi des fleurs fraîches n’a pu échapper même aux observateurs les plus superficiels.
À plus forte raison devait-il attirer l’attention de ceux qui par goût et par devoir observent, constatent et enregistrent les faits économiques et sociaux.
D’où viennent toutes ces fleurs ? qui les cultive, les expédie, les reçoit, les distribue ? À combien de personnes la production et le commerce des fleurs donnent-ils le moyen de vivre et parfois de faire fortune ? Autant de questions auxquelles il était intéressant de chercher réponse.
C’est sous l’empire de cette préoccupation que, en janvier dernier, l’Association française pour l’avancement des Sciences m’a fait l’honneur de m’inviter à prendre les fleurs coupées comme sujet d’une des conférences qu’elle est dans l’habitude de donner à Paris pendant l’hiver.
C’est par la même recherche de l’actualité qu’un article plein de détails curieux et pittoresques a paru au mois de mai dernier, publié par un écrivain qui jouit d’une autorité littéraire et artistique incontestée et que le nom de plume de marquis de Villemer ne cache que d’un voile transparent.
C’est, répondant encore à la même pensée que MM. J.-B. Baillière et fils ont bien voulu me demander de grouper en un volume les renseignements que j’avais dû réunir pour préparer ma conférence sur un sujet que depuis quelque temps ils désiraient voir traité dans leur Bibliothèque scientifique contemporaine.
Des occupations déjà trop nombreuses, des engagements pris antérieurement allaient me forcer de me désintéresser complètement de ce travail, pourtant si tentant, lorsque j’ai eu la bonne fortune de trouver tout près de moi, dans mon fils aîné, encore étudiant, le collaborateur que cherchaient MM. J.-B. Baillière.
On comprendra facilement avec quel empressement et quelle légitime satisfaction j’ai mis non seulement le travail déjà fait, mais tout ce que je pouvais donner de conseils et de concours à la disposition d’un débutant soucieux de faire son entrée dans le monde par un travail utile, et de prendre rang à la suite de quatre générations d’hommes passionnés pour l’étude des choses agricoles et horticoles.
Le plan suivi dans la rédaction de l’ouvrage est des plus simples, et je vais l’exposer en quelques mots.
L’auteur constate d’abord la généralité du goût et de l’emploi des fleurs à notre époque ; puis il conduit rapidement le lecteur à travers le monde pour comparer les divers pays entre eux au point de vue de l’importance et de l’installation du commerce des fleurs. Ensuite, s’attachant particulièrement à la ville de Paris, il décrit successivement les procédés et l’organisation de la vente aux Halles, dans les marchés aux fleurs, chez les revendeurs et dans les boutiques de fleuristes ; puis il indique la provenance des principales fleurs vendues à Paris et passe en revue à cette occasion les cultures sous verre et celles du Midi d’où, grâce au soleil de Provence, tant d’envois frais et parfumés, viennent égayer nos hivers parisiens.
Quittant alors la description du commerce des fleurs, l’auteur énumère les principales plantes qui font l’objet des soins du producteur, et signalant les mérites des diverses espèces en même temps qu’il en indique sommairement la culture, il traite successivement des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre, puis il parle des plantes de serre, consacrant un chapitre spécial aux orchidées, des arbres et arbustes fleurissant, des rosiers en particulier, enfin des plantes spéciales aux cultures du Midi et des accessoires des bouquets, verdures diverses, mousses et fougères.
Familiarisé dès l’enfance avec les cultures florales des environs de Paris et avec celles de la Provence ; formé par quelques voyages en Europe et en Amérique à l’observation et à la comparaison, l’auteur pouvait, à la rigueur, entreprendre sans trop de présomption la tâche qu’on lui faisait l’honneur de lui confier. Les lecteurs jugeront si l’inexpérience n’est pas trop apparente dans le travail qui leur est offert. Au moins voudront-ils bien être indulgents en pensant que le vingtième anniversaire de l’auteur n’avait pas encore sonné à la date où son livre a vu le jour.
HENRY L. DE VILMORIN.
15 janvier 1892.
Les figures dont ce volume est illustré nous ont été pour la plupart prêtées par leurs propriétaires et nous tenons à leur en exprimer nos remerciements. M. R. Veitch, de Londres, nous a communiqué quatre figures d’orchidées, M. Boudet trois vignettes, dessinées par Léon Lhermitte, pour La Vie Rustique, d’André Theuriet.
MM. Vilmorin, Andrieux, ont mis obligeamment à notre disposition plus de cent cinquante de leurs jolies et surtout fidèles illustrations des plantes cultivées. Nous avons pu de la sorte accompagner le plus grand nombre des descriptions de plantes d’une vignette donnant quelque idée de leur port et de leur mérite ornemental.
J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.
On dit quelquefois et à tort que les fleurs sont à la mode. La faveur qu’elles ont prise depuis quelques années auprès du public et la façon extrêmement rapide dont elles se sont introduites dans nos habitudes, ne suffisent pas pour autoriser cette expression ; une mode est essentiellement arbitraire et variable, c’est un engouement venant on ne sait d’où, ni pourquoi, ni comment, un entraînement qui, soudainement s’empare de l’opinion et des goûts pour y faire régner un objet ou une habitude souvent sans valeur ni raison d’être. Son règne est toujours éphémère, et la chose à la mode retombe dans l’oubli d’où elle n’aurait jamais dû sortir.
L’amour des fleurs n’est pas chose récente, et il faudrait remonter bien haut dans l’histoire des peuples pour en trouver le premier germe.
Le prodigieux développement qu’il a pris parmi nous à la fin de ce siècle, tient à des causes multiples et complexes ; mais on peut mettre en première ligne ce retour spontané vers la nature qui se manifeste chez tous les peuples arrivés à un haut degré de civilisation. C’est un instinct qui nous pousse à ne nous pas laisser absorber par la vie surchauffée toute matérielle et artificielle qui nous entoure à cette grande époque où l’art si vulgarisé se propage à la machine.
Au milieu des grandes villes, nous sentons le besoin de nous retremper dans des beautés moins manufacturées. La facilité sans cesse croissante de la production et des transports permettant d’offrir à très bon marché au public des articles auxquels il n’a jamais été insensible, mais dont le prix très élevé l’effrayait, a largement contribué à la popularité des fleurs. Il y a trente ans, elles étaient un luxe ; en les regardant comme des merveilles, on disait : « Où vont-elles ? » – « Où ne vont-elles pas ? » pourrait-on dire aujourd’hui ; je les vois partout.
Du berceau à la tombe, elles nous accompagnent et nous entourent, et l’on peut dire qu’en France elles sont intimement liées aux moindres actes de notre vie individuelle, familiale et sociale.
Un salon sans fleurs nous paraîtrait presque aussi nu qu’un salon sans meubles ; les bouquets, les corbeilles, les jardinières ornent les tables, les cheminées, les encoignures ; en un mot forment au reste de l’ameublement un accompagnement indispensable (fig. 1), et la manière harmonieuse dont leurs couleurs sont assorties ou opposées à celles des tentures et des meubles, constitue un art véritable dénotant un talent qui n’est pas l’apanage de tout le monde.
L’éloge des ornementations florales n’est plus à faire, et chacun de nous peut voir tous les jours les merveilles qu’enfantent les doigts de nos fleuristes, depuis le simple bouquet jusqu’à la décoration complète et artistique d’une salle de bal, ces combinaisons toujours variées de fleurs et de verdure s’unissant aux lumières et aux fraîches toilettes.
Les fleurs ont élu domicile sur les tables de nos salles à manger et parfois les recouvrent tout entières. La corbeille, au milieu de la table, indispensable dans les dîners d’apparat se trouve bien souvent aussi dans les simples repas de famille, même dans les intérieurs les plus modestes, avec l’infinie variété de ses formes ; il semble que nous voulions satisfaire à la fois tous nos sens.
On s’étonne souvent de la faveur dont jouissent les fleurs parmi les classes laborieuses. Le contraire serait remarquable. On a, d’ailleurs, constaté que ce goût est très constant, et ce ne sont pas les brillants fleuristes récemment établis sur les boulevards, qui fournissent des pots de fleurs aux fenêtres du cinquième étage.
L’ouvrier, ordinairement campagnard ou fils de campagnard, séquestré dans les grands centres, a toujours aimé ce qui lui rappelle le pays, ce pays qu’il n’a quitté que poussé par l’appât du gain, et que bien souvent il regrette. En rentrant chez lui après une journée de travail, il aime trouver autre chose que la correcte propreté de son logis ; un bouquet sur la table, un pot de fleurs à la fenêtre, c’est un rayon de soleil des champs dans la monotonie de sa vie de labeur.
On peut affirmer que l’amour des fleurs dénote presque sûrement, dans les familles ouvrières, une conduite régulière et l’attachement à la vie de famille.
Une des innovations que nous devons le plus admirer, c’est l’ornementation en fleurs naturelles que nous voyons dans les églises aux jours de fête. Quelques bouquets sur l’autel font rarement défaut, surtout dans les églises de Paris ; mais quand arrive une grande solennité, nous voyons avec plaisir les roses fraîches ou les pivoines remplacer les fleurs massives et faites d’or et d’argent, entourer et recouvrir l’autel, aider l’homme à bénir Celui qui les a créées.
Et quand cette solennité est celle d’un saint, les fleurs semblent se répandre hors de l’église sous la forme de ces bouquets que nous offrons à nos amis en leur souhaitant leur fête, touchant usage qui consiste à présenter un objet tangible, image des vœux qu’on ne voit pas (fig. 2).
Et ces fêtes se souhaitent d’un bout à l’autre de l’année jusqu’au jour de l’an qui est le signal d’une véritable avalanche de fleurs et l’époque de grande activité pour les fleuristes.
Pendant toute l’année aussi, se succèdent les fiançailles et les mariages, qui sont l’occasion d’offrir de nombreux bouquets blancs ; et également, hélas ! les deuils et services funèbres où les fleurs accompagnent toujours, et parfois en véritables montagnes, jusqu’à la tombe celui que nous perdons.
Puisque notre vie est si intimement liée à celle des fleurs, il est donc intéressant d’étudier celles-ci. Dans les pages qui vont suivre, je m’efforcerai de montrer comment elles sont produites, cueillies, expédiées, mises en œuvre et enfin offertes et vendues à chacun de nous.
Un commerce aussi actif que celui des fleurs fraîches, dont les transactions se renouvellent chaque jour pendant toute l’année, exige des installations spéciales dont le développement et l’importance sont en raison de la faveur dont les fleurs jouissent dans les différents pays.
Paris, avec ses nombreux marchés aux fleurs partiellement couverts, a pu longtemps se regarder comme mieux partagé qu’aucune autre ville sous ce rapport ; mais, depuis quelques années, Londres a consacré à la vente des fleurs et des plantes fleuries un véritable palais, beaucoup plus spacieux et beaucoup mieux aménagé qu’aucune des installations parisiennes. C’est la grande salle des fleurs à Covent-Garden où le marché se tient, trois fois par semaine, depuis cinq heures du matin jusqu’à midi, et où passent des millions de potées et de bottes de fleurs. En plus de ce marché public, Londres possède de nombreux fleuristes établis en boutique dans les différents quartiers de la ville, car le goût des fleurs est très développé chez nos voisins d’outre-Manche, plus peut-être encore que chez nous.
La plupart des grandes villes d’Angleterre ont un local réservé aux fleurs dans leur grand marché aux fruits et aux légumes.
Dans les pays du Midi où les fleurs sont partout, elles ne se rencontrent guère en un endroit spécial et aménagé à leur intention. Ni en Algérie, ni en Andalousie où pourtant on en vend de grandes quantités, il n’y a de marchés spéciaux bien définis. À Séville, dans le grand marché, quelques échoppes, entremêlées avec celles des marchands de légumes frais ou secs, sont consacrées à la vente des roses, œillets ou autres fleurs de la saison.
Des marchands pourvus de larges paniers presque plats colportent les mêmes fleurs à travers la ville, faisant halte suivant l’heure et les circonstances, tantôt sur un point, tantôt sur un autre.
À Madrid, c’est à la porte des églises et des théâtres que sont les principaux établissements de fleuristes, limités en général à quelques étagères garnies de plantes en pots et de fleurs coupées. Des ânes ou des mules, portant de chaque côté une sorte de tablette garnie de pots de fleurs, parcourent les rues dont ils occupent presque toute la largeur.
Barcelone est certainement la ville d’Espagne où la vente des fleurs possède l’installation la plus pittoresque. La Rambla de las Flores est un de ces grands boulevards des villes méridionales, planté de grands arbres et réservé aux piétons entre deux voies parcourues par les voitures (fig. 4).
Des deux côtés de la promenade, sont disposées des étagères à deux ou trois gradins surmontant une sorte de buffet dans lequel, après les heures de vente, peuvent être serrés jusqu’au lendemain les plantes ou les bouquets qui restent.
Tous les matins, mais plus spécialement trois fois par semaine, toutes les places sont occupées et toutes les étagères garnies des plus jolies fleurs.
En Italie aussi, la vente des fleurs se fait surtout par des marchands ambulants, souvent des enfants ou des jeunes filles, munis de légères corbeilles ouvertes.
Le goût des fleurs est général dans ce pays, mais le commerce est loin d’atteindre les mêmes proportions que dans les pays du Nord.
Marseille possède, entre la Canebière et la rue de Rome, un marché aux fleurs coupées, où les vendeuses dominent, de leur siège surélevé, la foule qui s’empresse autour de leurs étalages.
Aux États-Unis, la production et le commerce des fleurs se sont développés avec la même impétuosité que les autres genres d’industrie.
Les grandes forceries de roses de New-York opèrent par centaines de mille plantes, les cultivateurs de Glaïeuls, de Tubéreuses ou de Lis, par hectares de plantation.
Toute cette immense production est cependant écoulée par les fleuristes établis en boutique. L’Américain n’a guère le temps d’aller visiter un marché. Il faut que le produit soit amené à sa porte. Aussi les grandes villes sont-elles abondamment fournies de boutiques consacrées à la vente des fleurs, boutiques qui, très souvent, débordent largement sur les trottoirs.
Les fleurs sont employées jusqu’à la profusion dans toutes les circonstances de la vie, et, dans les maisons élégantes, elles constituent un article important de la dépense. Il n’est pas rare qu’on donne 5 000 dollars (25 000 fr.) à un fleuriste pour entretenir toute l’année les décorations florales d’une seule maison. On m’a cité un ou deux abonnements de ce genre allant même à 10 000 dollars.
J’ai vu, sur un des grands vapeurs de la Compagnie transatlantique, l’immense salon où les passagers prennent leurs repas, à moitié rempli par les bouquets, corbeilles, et diverses compositions florales, offerts à un seul ménage qui venait faire en Europe son voyage de noces.
Des fleurs, toujours des fleurs, pendant la canicule aussi bien que pendant les dures gelées d’hiver : voilà ce qu’il faut à l’exigence du public parisien. Tant que l’inclémence de la température ne s’oppose pas, sous nos latitudes, à la végétation et à l’épanouissement des fleurs, les horticulteurs des environs de Paris sont à peu près les seuls fournisseurs du marché ; mais, dès qu’arrivent les froids, une chaleur artificielle doit, dans les serres, remplacer l’ardeur diminuée du soleil, et cette coûteuse culture, si elle était seule pratiquée, mettrait ses produits hors de prix ; heureusement, depuis que la rapidité des transports s’est accrue d’une si merveilleuse façon, une partie de l’approvisionnement forcé de Paris lui vient du midi de la France, des bords de la Méditerranée, de cette région chaude et privilégiée où l’on ne connaît que par ouï-dire les rigueurs de nos hivers.
Que les fleurs viennent du voisinage immédiat de Paris ou de provinces plus lointaines, elles convergent toutes, en arrivant dans la capitale, vers un point central et intéressant à étudier, d’où elles reprennent ensuite leur course dans différentes directions, suivant l’acheteur auquel elles ont été dévolues : ce centre du commerce des fleurs se trouve aux Halles.
Toutes les nuits, à Paris, abritent de leurs ombres un spectacle bien digne de s’étaler au grand jour, mais auquel les profanes n’assistent que rarement. Il faut cependant avoir vu cette vente, ce marché, le plus considérable du monde entier, pour se faire une idée de l’importance du commerce des fleurs et du nombre de personnes qu’il occupe.
Dans aucune ville étrangère, si ce n’est à Londres, le trafic des fleurs n’atteint le développement qu’il a pris à Paris, et, cependant, nous ne possédons pas encore un Pavillon des Fleurs. Il est bien question de construire aux halles centrales un pavillon spécialement affecté au commerce des fleurs, ou même de créer un marché tout à fait indépendant, mais cette réforme si utile est encore à l’état de projet, dans cette longue période de préparation d’où les meilleures innovations ne sortent parfois jamais.
Pour le moment donc, l’installation est fort rudimentaire et tout à fait insuffisante.
Le marché aux fleurs se tient dans un vaste courant d’air, sous l’abri de la rue couverte qui sépare les pavillons 7 et 8 des halles centrales et rejoint la rue Rambuteau à la rue Berger.
Dans ce passage froid et ouvert à tous les vents glacés, dès le commencement de la nuit, commence l’arrivage des fleurs. D’abord les lourds camions du chemin de fer apportent les envois du Midi, dans des caisses et des paniers très légers d’osier ou de roseaux fendus et tressés.
Puis viennent les horticulteurs des environs de Paris, apportant leurs produits dans des charrettes à deux roues, couvertes de bâches ; partis de chez eux à des heures diverses, suivant la distance qu’ils ont à parcourir, ils s’efforcent d’arriver le plus tôt possible pour avoir de bonnes places, ou encore envoient un représentant leur en retenir une, et arrivent eux-mêmes à des heures plus tardives, peu avant le commencement de la vente.
Les marchandises, déchargées des camions et des voitures, sont étalées sur les trottoirs et sur une partie de la rue bitumée ; chaque vendeur paie, par jour, la place qu’il occupe 0 fr. 40 ou 0 fr. 30 le mètre, suivant qu’il est à l’abri ou en plein air. Une trentaine d’abonnés paient leur place au mois. Des passages sont ménagés entre les différents étalages pour permettre la libre circulation des acheteurs.
Lorsque la température s’abaisse, pendant les longues et sombres nuits d’hiver, l’attente est longue et le vent est bien froid. Les fleurs, couvertes de chaudes couvertures et protégées avec sollicitude contre tout ce qui pourrait diminuer leur valeur commerciale, sont moins à plaindre que leurs malheureux propriétaires, grelottant au souffle piquant de la bise.
Quand la température est trop rude, la vente se fait dans de vastes sous-sols ; l’aspect du marché est alors très pittoresque : des installations provisoires et volantes sont établies, des tables dressées sur des tréteaux, et sur ces tables sont étalées les fleurs peu variées en ces temps de grandes gelées ; des Violettes, des Coucous, des Giroflées jaunes, avec les Roses et les Mimosas de Cannes.
La vente commence à trois heures du matin en été, à quatre heures en hiver. C’est alors que l’activité et l’animation du marché sont vraiment remarquables. Peu d’amateurs, en général, à cette heure matinale ; tout se passe entre gens d’affaires se connaissant ordinairement, et la vente marche bon train. Les acheteurs aux halles ne sont, d’ordinaire, que des intermédiaires et revendent eux-mêmes, en ville, ce qu’ils se procurent le matin. Nous en parlerons plus tard.
Sans sortir des halles, pour le moment, nous voyons des industriels qui se livrent, sur le commerce des fleurs, à des spéculations rapides et paraît-il, rémunératrices. Ils achètent, dès le commencement de la vente, alors que la marchandise abonde, des fleurs à bas prix, puis, louant une place de vendeur, ils attendent que la valeur des fleurs ait monté, disposent leur marchandise avec art et la revendent avec profit. Cette catégorie de revendeurs porte aux halles le nom élégant de regrattiers.
La vente à la criée n’est pas libre aux halles ; deux individus seuls ont le droit de l’exercer et déposent, pour ce droit, un cautionnement de 10 000 francs. La vente est, d’ailleurs surveillée, et tout s’y passe en bon ordre.
Cette étude sur le commerce des fleurs aux halles n’a pas la prétention d’être sans lacune ; elle serait cependant par trop incomplète si je ne parlais de deux institutions qui rendent aux halles les plus grands services : ce sont les Commissionnaires en fleurs et les Forts. Les commissionnaires en fleurs sont quarante et remplissent une double fonction : d’abord ils facilitent l’accès du marché parisien aux produits lointains.
L’horticulteur de Provence ne peut pas toujours avoir à Paris un représentant qui reçoive les envois faits et les porte aux halles ; il s’adresse alors à un commissionnaire qui se charge de la vente des fleurs en gardant naturellement pour lui une certaine part du bénéfice. Placé au centre de l’activité commerciale, il voit les tendances du marché et informe son client, dès qu’une hausse semble prête à se produire sur un certain article, de forcer les envois sur ce point, et, au contraire, de cesser d’expédier certaines fleurs quand leur grande affluence sur la place leur fait perdre de leur valeur.
Le Commissionnaire opère, en outre, une œuvre très utile de sélection. Parmi les quantités énormes de fleurs qu’il reçoit, les unes, rares et recherchées, sont séparées du reste de l’envoi, vendues aux grands fleuristes, et payées des prix considérables par les amateurs. Les frais de culture et d’expédition de tout l’envoi se trouvent ainsi parfois couverts par quelques articles de choix, le très beau midi, comme on les appelle dans le métier. De sorte que le midi ordinaire porté aux halles, peut y être vendu à vil prix, et nous le retrouvons dans les charrettes des marchands ambulants où nous les payons moins cher qu’à Cannes ou à Nice.
Ces quarante Commissionnaires sont loin de recevoir et de vendre, tous, les mêmes quantités de fleurs ; il y en a de grands et de petits, mais, dans l’ensemble, ils se partagent chaque jour 1 000 à 1 200 paniers, provenant pour la plupart du Midi, surtout pendant l’hiver.
Les horticulteurs et maraîchers qui apportent leurs fleurs aux halles sont en nombre très variable suivant la saison, et leur activité diminue sensiblement après l’automne. En moyenne, ils sont de deux à trois cents, déposant quotidiennement 800 paniers de fleurs sur le carreau, ce qui porte à 2 000 environ le nombre de paniers journellement vendus aux halles de Paris.
Les Forts des halles sont célèbres ; chacun connaît la probité de cette vieille corporation, mais, d’ordinaire, on ne se rend pas compte des services qu’elle rend sur le marché en facilitant la vente des marchandises et en soulageant l’horticulteur d’une partie des tracas qu’il aurait à subir. Le Fort décharge les voitures qui arrivent et remet au propriétaire un billet de stationnement. Celui-ci va donc tranquillement mettre son véhicule à l’abri, à la place qui lui est indiquée dans une des rues circonvoisines, tandis que sa marchandise est transportée par le Fort, sous le marché couvert. Le Fort qui a perçu le prix de l’emplacement occupé par les fleurs, est responsable de ces dernières, et veille sur elles avec sollicitude jusqu’à l’heure de la vente.
L’horticulteur, d’ailleurs, n’est pas obligé de garder lui-même sa voiture. Une entreprise très prospère de gardage fonctionne depuis plusieurs années et, moyennant 0 fr. 50 par voiture et par nuit, se charge de surveiller ces longues files immobiles de charrettes, dont les chevaux fatigués dorment sur trois pieds en attendant l’heure de reprendre le chemin de l’écurie.
Neuf heures. La vente est finie. Les petites voitures, les ambulants, leur chargement complet, se dispersent dans les rues ; les fleuristes emportent leur butin dans des charrettes à bras ; les horticulteurs reprennent, les grandes routes et dorment du sommeil du juste, sous leurs grandes bâches vertes, laissant leurs chevaux encombrer le milieu de la chaussée au grand détriment de la circulation.
Les marchés aux fleurs, au nombre de onze à Paris, ne font pas double emploi avec les halles. Bien qu’il s’y vende aussi une bonne quantité de bouquets faits et de fleurs coupées, ils ont surtout pour objet la vente des plantes vivantes en pots ou en mottes.
Plusieurs d’entre eux sont fort anciens. Celui de la Cité, qui occupe depuis 1809 son emplacement actuel, dit quai aux Fleurs, existait au siècle dernier sur le quai de la Mégisserie. Il a été réglementé pour la première fois en l’an VII (1799).
Le marché de la Madeleine date de 1834 (fig. 5) ; celui du Château-d’Eau, aujourd’hui place de la République, date de 1836 ; celui de la place Saint-Sulpice, de 1845 ; les sept autres ont été ouverts depuis 1870.
C’est un tableau bien parisien et qu’on n’échangerait pas volontiers, même pour une installation plus perfectionnée, que cette réunion d’abris ouverts sur les côtés ou partiellement clos contre le vent et la pluie, tout garnis, à terre et sur les gradins, de potées enveloppées de leur feuille de papier blanc, comme d’un cornet gigantesque. Au milieu, la marchande, bien abritée sous une chaude pèlerine de fourrure commune, les pieds sur sa chaufferette, invite de la voix et du geste, les clients à fixer leur choix sur ses produits, toujours plus frais et plus avantageux que ceux d’à côté.
Avec quelques variantes dans le décor, la scène se répète tous les jours de la semaine et en plusieurs endroits, dans les quartiers du centre et dans les communes annexées, conformément au tableau ci-contre.
Par les belles journées de printemps, avant que Paris se vide, ces marchés sont dans toute leur splendeur, les amateurs sont nombreux et empressés, et n’ont que l’embarras du choix entre les plantes bulbeuses fleuries, les roses printanières, les Deutzia gracilis, ornement favori des mois de Marie, les premiers Œillets, les Primevères de Chine et les Cinéraires dont la floraison se prolonge encore, les innombrables Giroflées, les Myosotis des Alpes, les Azalées de l’Inde qui sont en pleine saison, les Hoteïa, les Gardenias, les Mignardises et cent autres plantes variées. En même temps, les fleurs de Lilas à pleines brassées, le Réséda, les Narcisses des poètes appellent l’attention par leurs parfums, et les bourriches de Pensées, de Pâquerettes doubles, d’Anémones et de Renoncules invitent à garnir les jardinets de ville et les caisses juchées sur les fenêtres.
En plein été, les Reines-Marguerites tiennent le haut du pavé avec les Œillets de toutes nuances, les Glaïeuls aujourd’hui si prodigieusement variés de couleurs, les Agapantes, les Gaura Lindheimeri semblables à des papillons blancs, les Amarantes de toutes formes, les Perilla de Nankin au feuillage brun foncé, les Lilium speciosum (lancifolium des jardiniers) avec leurs variétés blanches et rouges, les Lis dorés du Japon à l’odeur si puissante, les Tubéreuses non moins parfumées, les Plumbago Capensis aux bouquets d’un bleu si tendre, les Rhodanthes, les Pervenches de Madagascar, le Gypsophyle et le Stevia qui donnent de la légèreté aux bouquets. Puis, dans les bourriches, les Mimulus, les Verveines, les Balsamines, les Agérates, les Lobélias, les Némophiles, toutes les charmantes fleurs annuelles de pleine terre.
L’automne est maintenant tout aux Chrysanthèmes.
En pots, en touffes arrachées, en fleurs coupées, ce sont elles qui tiennent toutes les places, et nul ne songerait à s’en plaindre tant elles sont jolies, variées et décoratives. Depuis les petites fleurs en pompon jusqu’aux larges têtes aux fleurons contournés, dites japonaises, elles ont toutes les formes régulières, symétriques, échevelées, en cocarde ou en aigrette, elles se prêtent à tous les emplois et présentent toutes les nuances les plus fraîches et les plus originales. Elles sont naines ou élancées, grêles ou touffues ; le savoir-faire de nos cultivateurs fait varier les fleurs de la grosseur d’un bouton d’or à celle d’une pivoine, la taille des plantes, de 30 centimètres à 2 mètres. On les groupe en massifs, en gerbes, en corbeilles ; on les emploie en fleurs isolées, et elles se prêtent à tous les usages, avec le mérite de se conserver longtemps : rien d’étonnant, par conséquent à ce qu’elles soient les reines de la saison.
Auprès d’elles cependant se voient encore quelques Asters en touffes ou coupées, ou en boutures de têtes, charmantes miniatures ; puis des Lauriers-tins, des Ellébores roses de Noël, et bientôt les Cyclamens de Perse qui commencent la série des plantes de serre à floraison hivernale. Vers Noël, on voit paraître les feuillages et baies d’hiver, le Mahonia bronzé par les froids, le Houx avec ses jolies graines rouges, le Fragon épineux, les touffes de Gui portant leurs baies visqueuses et, venant du Midi, les rameaux de Fusain du Japon et de Poivrier d’Amérique (Schinus Molle) avec ses grappes de graines roses.
Les plus grands froids ne découragent pas toutes les vendeuses de nos marchés en plein air. On en voit qui, avec des toiles épaisses, ferment leur boutique nomade et, au moyen d’un poêle en fonte, y maintiennent une température assez adoucie pour que les fleurs et les plantes vivantes s’y conservent sans dommage. D’autres s’installent simplement auprès de leurs voitures fermées et chauffées. Ce sont les intrépides du marché.
Revendeurs. – La création de nouveaux marchés aux fleurs est une nécessité imposée par le goût sans cesse croissant que manifeste le public pour ces gracieuses productions de la nature. Mais il ne faut pas oublier non plus d’aller chercher à domicile, de relancer jusque chez lui l’acheteur, à qui le temps ou l’occasion font souvent défaut pour se rendre même au marché le plus proche, et qui, sans le passage quotidien des ambulants, ne connaîtrait pas les suaves agréments d’un bouquet sur sa cheminée ou d’un pot de fleurs sur sa fenêtre.
Un type qui commence à se perdre, c’est le marchand de fleurs muni seulement d’un panier ou d’un éventaire ; mendiant plutôt que commerçant, il vous offre des Narcisses jaunes, des Violettes, fleurs communes et sauvages, cueillies dans les bois des environs de Paris et qui sont à la portée des bourses les plus modestes. Dans la hiérarchie des vendeurs de fleurs, ce déshérité de la fortune occupe la position sociale la plus inférieure.





























