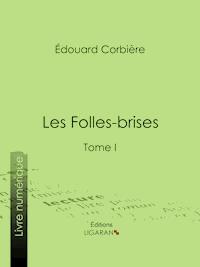
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "En l'année 1803 ou 1804, quelque temps après le commencement de la guerre acharnée qui venait de se rallumer entre la France et l'Angleterre, on vit arriver à Brest un jeune homme auquel d'abord personne ne prit garde, et qui bientôt sut se venger du dédain avec lequel on l'avait accueilli en se faisant, par son seul mérite, une des réputations les plus populaires que l'ont ait vu briller dans les fastes de notre marine."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les marins nomment folles-brises ces légères bouffées de vent qui, pendant les calmes plats, naissent de tous les points de l’horizon pour venir effleurer la surface de la mer, et pour disparaître aussitôt sans laisser après elles la trace de leur passage sur les flots, ou l’indice de la direction qu’elles ont prise en s’évanouissant dans les airs.
Cette définition explique la raison pour laquelle on a donné le titre de Folles-Brises aux différentes pièces qui composent l’ouvrage que nous mettons aujourd’hui sous les yeux de nos lecteurs.
En l’année 1803 ou 1804, quelque temps après le commencement de la guerre acharnée qui venait de se rallumer entre la France et l’Angleterre, on vit arriver à Brest un jeune homme auquel d’abord personne ne prit garde, et qui bientôt sut se venger du dédain avec lequel on l’avait accueilli en se faisant, par son seul mérite, une des réputations les plus populaires que l’on ait vu briller dans les fastes de notre marine.
Le jeune étranger dont nous avons à nous occuper, en se présentant au bureau des classes pour obtenir la très mince faveur de naviguer en qualité de novice ou de matelot sur un des bâtiments en partance, avoua qu’il n’avait pas encore vu la mer, quoique la vocation qu’il croyait se sentir l’eût toujours porté à embrasser la profession de marin. Il était grand et robuste, vif, délié et joli garçon ; sa physionomie intelligente et sa mise assez recherchée semblaient annoncer qu’il appartenait à une famille aisée ; et, à la manière dont il s’exprimait, on pouvait même supposer qu’il avait déjà reçu une certaine éducation, ou tout au moins acquis quelque petite habitude du monde. Le citoyen chef de l’inscription maritime à qui il avait fallu qu’il s’adressât en premier lieu lui demanda d’un ton protecteur et quelque peu aristocratique, mais pourtant assez bienveillant, quel était son nom et quel âge il avait. Le jeune volontaire répondit qu’il allait bientôt avoir dix-huit ans et qu’il se nommait tout simplement Ernestin Taillebois. Après avoir posé ces deux petites questions préliminaires au futur amiral, le commissaire jeta un coup d’œil distrait sur les papiers dont notre nouvel enrôlé avait eu soin de se munir en partant de chez lui. Les papiers se trouvèrent en règle, et dans moins d’un quart d’heure Ernestin Taillebois, ou M. de Taillebois, si mieux vous semble pour le moment, se vit inscrit, à sa grande satisfaction, sur le rôle d’équipage de la corvette de la République la Prévoyante, avec le grade de novice citoyen à la paye de 4 francs 50 centimes par décade.
La malle, ou, pour mieux dire, le sac de nuit du petit navigateur ne fut ni long ni difficile à faire : un paletot bleu, une demi-capote brune, deux pantalons, six chemises, deux paires de souliers et un chapeau de cuir bouilli composèrent toute sa garde-robe de voyage. Cependant, outre ce bagage, réduit aux strictes conditions du nécessaire et aux minces proportions de l’austérité républicaine dont on faisait parade alors, Taillebois eut soin d’ajouter un petit coffret fort propre, fermant à clef et qui devait contenir, selon toute apparence, des effets ou des ustensiles à l’usage du bord.
En mettant pour la première fois le pied sur le pont de la corvette la Prévoyante, le beau novice alla saluer l’officier de quart, et il se rendit ensuite, selon l’usage prescrit en pareil cas, aux ordres du capitaine sous le commandement duquel il allait bientôt faire ses premières armes à la mer.
Le capitaine, qui depuis quelques jours voyait arriver pêle-mêle à bord de sa corvette les volontaires que le bureau des classes trouvait bon de lui envoyer en masse pour compléter de façon ou d’autre son équipage, toisa d’abord Taillebois des talons à la tête en fronçant un peu le sourcil. Taillebois, qui ne manquait pas plus d’assurance que de zèle, se tint raide et droit, le chapeau à la main et l’œil fixe, pour subir avec autant d’avantage que possible la rigueur de ce premier examen muet d’où dépend si souvent la destinée des nouveaux venus. Le capitaine de la Prévoyante, qui jusque-là n’avait pas eu lieu, à ce qu’il paraît, de se montrer très satisfait du choix des recrues qui lui avaient été jetées en pâture par le bureau des classes, s’oublia jusqu’à sourire de satisfaction en passant l’inspection de l’extérieur du jeune novice qu’on venait de lui mettre sous la main.
– Parbleu ! s’écria-t-il, je crois qu’aujourd’hui le citoyen commissaire du bureau des armements s’est trompé ! il vient de m’envoyer, Dieu me pardonne ! un homme tout comme un autre !
– Et que sais-tu faire de bon, mon garçon ? ajouta le commandant en s’adressant à Ernestin, et en laissant un sourire de contentement se mêler à la parole brève et saccadée qui sortait de sa bouche.
– Rien encore, mon commandant, répondit Ernestin, mais, avec un peu de patience de votre côté et beaucoup de bonne volonté du mien, cela viendra peut-être.
– Eh bien ! voilà, s’écria le capitaine à ces mots, un luron au moins qui ne se flatte pas, et qui promet peut-être plus qu’il n’en a l’air.
– Et qui tiendra peut-être plus qu’il n’en promet, reprit vivement Ernestin en rougissant un peu de plaisir et de timidité.
– Lieutenant, citoyen lieutenant, ordonna aussitôt le capitaine à son second, colloquez-moi vite ce grand gaillard-là au poste des pilotins. Il ne faut pas qu’il se gâte avec les mauvais gars du gaillard d’avant. L’égalité républicaine me le perdrait en moins de quinze jours de confraternité démocratique.
– Mais, mon commandant, fit observer Taillebois avec modestie, c’est qu’il faut vous dire que je n’ai jamais navigué.
– Eh ! mais, reprit vivement le capitaine, ne navigueras-tu pas aussi bien pour la première fois au poste des pilotins, avec lesquels tu vas manger la soupe, que parmi les brebis galeuses qui broutent la galette de biscuit de la République sur l’avant du mât de misaine de la corvette ? Ton billet d’embarquement porte que tu es des environs de Saint-Brieuc, n’est-ce pas ? tu dois par conséquent avoir déjà vu la mer, quand ce ne serait qu’à la longue-vue : c’est donc un commencement ; laisse-moi faire le reste. Je te la montrerai de la bonne manière en seconde édition dans notre prochaine campagne, va, cette lame du ouest que tu as la franchise d’avouer que tu n’as jamais vue. Et en attendant, fais-moi le plaisir d’aller t’arrimer en long ou en travers au poste de la timonerie avec ton sac et ton petit coffre. Ton commandant, pour le moment, a bien l’honneur de te souhaiter le bon soir.
La corvette la Prévoyante appareilla bientôt de la rade de Brest pour aller croiser sur les côtes de l’île de Saint-Domingue qui venait de nous échapper, à nous, sa métropole, par tous les bouts à la fois. Dans les premiers coups de cape que la corvette eut à essayer Taillebois se sentit gagner par le mal de mer, et il l’éprouva, mais à la façon des marins qui l’ont encore, c’est-à-dire sans être malade, sans se laisser vaincre par la douleur, et sans cesser de faire le service que le devoir prescrit aux bien portants. Après deux mois de croisière on se battit, et le courageux pilotin fut un des premiers à sauter à bord d’un fort brick anglais, que le commandant jugea à propos de couler pour ne pas perdre de temps en route. Cette action prompte et décisive, dans laquelle Taillebois s’était distingué aux yeux de tout l’équipage, lui Valut les félicitations de ses chefs et l’honneur plus positif de passer d’emblée, du grade de novice à 15, au grade de matelot à 21 francs par mois.
Cet avancement si subit, cet enjambement si rapide du grade de novice à 45 à la paye de matelot à 21, sans passer par le grade intermédiaire de novice à 18, fit bien quelques jaloux parmi ceux des prétendants qui croyaient pouvoir invoquer la loi contre ce qu’ils appelaient un passe-droit évident ; mais aucun des envieux n’osa murmurer tout haut, car Taillebois possédait par bonheur pour lui, au bout des bras vigoureux dont la nature l’avait doué, une poigne assez large et assez solide pour imposer silence à la jalousie. C’était, à dix-huit ans, un des plus rudes distributeurs de coups de poings de tout l’équipage de la Prévoyante.
Au retour de la corvette à Brest le jeune volontaire, qui avait quitté le port quelques mois auparavant pour la première fois, était déjà devenu matelot, non pas peut-être matelot fini, mais matelot admirablement commencé. Une autre campagne devait suffire pour lui donner le poli, le velouté et la grâce professionnelle qui manquaient encore à son peu d’expérience des choses les plus exquises du métier.
En ce beau temps de bons coups à recevoir et à donner, la course, cette noble industrie des courages aventureux, était en grand honneur dans tous les ports de la République, et il ne se passait guère alors de jour que l’on ne vît atterrir sur nos côtes, et à la barbe des croiseurs anglais, les riches prises que nos heureux corsaires parvenaient sans beaucoup de peine à amariner au large. Brest, comme on le pense bien, le magnifique port de Brest n’avait eu garde de rester en arrière des autres cités maritimes, qui, comme Saint-Malo, Nantes et Bordeaux, avaient déjà fait jaillir de leur sein belliqueux une foule de bâtiments légers, devenus la terreur des convois anglais. Un corsaire avait été construit dans ce célèbre arsenal de Brest, sur une des places de la ville. Ce navire, ainsi bâti, pour ainsi dire, des mains du peuple et au milieu de la rue, avait reçu sur le carrefour qu’on lui avait choisi pour chantier le nom du Cent-Pieds ; et, lorsque le Cent-Pieds se trouva disposé à être envoyé à la mer, on vit tous les Brestois s’attacher avec enthousiasme à sa svelte carène, pour lui faire parcourir sur des rouleaux la rue inclinée qui séparait encore le ber où il avait été construit des eaux sur lesquelles il devait majestueusement flotter pour la plus grande gloire de ses armateurs.
Pendant les trois ou quatre semaines que dura l’armement de ce beau lougre tous les habitants, les enfants et les femmes même de la ville de Brest, ne cessèrent d’admirer le navire bien-aimé que, dans sa sollicitude maritime, toute une cité semblait avoir adopté comme l’enfant gâté du pays.
Les formes, l’élégance du Cent-Pieds, et surtout la hasardeuse navigation qu’il allait entreprendre, séduisirent la jeune et inflammable imagination de Taillebois, qui s’éprit tout de bon d’amour pour un corsaire plus qu’il n’eût fait pour la plus belle et la plus jolie fille de la terre. Le belliqueux matelot, voulant en finir avec cette passion nouvelle en la satisfaisant au plus vite, alla trouver le capitaine de la Prévoyante, ce chef dont il avait déjà éprouvé toute la paternelle bienveillance, et il lui dit :
– Mon commandant, j’ai une envie du diable de faire la course !
– Eh bien, mon ami, fais la course si telle est ta fantaisie, et fais-toi porter sur le rôle d’un fin corsaire, et surtout avec un vaillant capitaine, puisque tu crois que c’est là ta vocation, lui répondit de capitaine de la corvette.
– Qui, mon commandant, reprit Taillebois, c’est là mon intention, et, je crois aussi, ma destinée ; mais, avant de disposer de moi selon mon caprice, je suis venu savoir ce que me conseillerait votre expérience. Grâce aux bontés que vous avez eues pour moi et à la protection dont vous m’avez honoré, je suis devenu déjà un petit brin matelot, et maintenant, après avoir vu la mer au large et l’ennemi d’assez près pour le compte de la République, j’ai le désir de travailler un peu en grand pour mon compte particulier. Un corsaire neuf est là dans le port ; vous l’avez vu ; il faut des hommes de bonne volonté à ce corsaire : je suis homme, la bonne volonté ne me manque pas plus que la force, et, ma foi ! j’ai pris mon parti, et je contenterai mon désir moyennant votre permission et votre assistance.
– Ma permission tu l’as d’avance, car je ne la refuse jamais aux jeunes gens qui veulent me quitter pour aller plus vite ou pour faire mieux qu’avec moi ; mon assistance tu l’auras aussi, car je l’accorde toujours aux braves garçons de ton échantillon. Ainsi donc, de quelque côté que tu me prennes, tu peux compter sur moi de tous les bords et en toute occasion. Mais, puisque maintenant il est à peu près décidé que nous allons nous séparer, fais-moi, je t’en prie, le plaisir de me dire, avant que chacun de nous prenne son point de départ, ce que peut renfermer le petit coffre mystérieux que tu portes sans cesse à la suite de ton sac, et qu’il t’a pris fantaisie de me donner à garder dans ma chambre le jour où nous avons eu affaire avec le brick anglais.
– Ce petit coffre, mon commandant, il est bon de vous le dire, renferme un secret, puisque vous tenez à savoir ce qu’il contient.
– Moi j’avais d’abord supposé qu’il contenait un trésor.
– Et un secret, que je ne veux confier qu’à vous seul, car c’est pour moi plus qu’un trésor. Tenez, voici la clef de cette boîte : ouvrez-la, voyez et devinez.
Le commandant prit la clef, ouvrit la cassette, et, après avoir jeté les yeux sur les objets qu’elle renfermait, il s’écria, tout étonné et en riant presque aux éclats :
– Eh ! Dieu me pardonne ! c’est là un habit complet de marquis !
– Commandant, c’est vous qui l’avez dit : c’est en effet un équipement entier de marquis de l’ancien régime ; et c’est le costume que ma naissance, qui est venue trop tard, m’avait destiné à porter avant la révolution, qui pour moi est arrivée un peu trop tôt.
– Bah ! tu plaisantes ! Est-ce que, par hasard, tu serais né marquis, là, sans farce ?
– Sans farce, comme j’ai déjà eu l’honneur de vous l’affirmer, mon commandant.
– Ah ! c’est donc ça, je m’en souviens à présent, que l’on m’a si souvent rabâché que tu appartenais à une ancienne famille du pays ! Mais, en admettant l’illustration passée, et, malheureusement pour toi, très passée de ton origine, fais-moi la grâce de m’expliquer ce qu’il peut y avoir de commun entre la noblesse de ton extraction et ce costume que tu trinqueballes dans une boite comme une relique, toi qui n’as pas cru déroger à tes ancêtres en venant servir la République en qualité de simple novice à 15 ?
– Ceci est encore un mystère, ou plutôt une histoire, mon commandant ; et, comme je vous ai déjà confié mon premier secret, je ne vois pas pourquoi je ne vous conterais pas toute mon histoire. Il faut d’abord vous apprendre que dans mon pays, près de Saint-Brieuc, comme vous savez, j’aimais la fille d’un riche baron créole. Elle avait quinze ans, cette noble fille, et malgré la révolution il lui restait 1 500 000 livres de dot à l’Île-de-France, où ses parents étaient nés. Après lui avoir fait pendant six mois une cour des mieux conditionnées je lui demandai sa main, et elle répondit à mon amour et à mon empressement en me déclarant tout net et tout sec qu’elle n’épouserait jamais qu’un marquis réintégré dans ses titres et possessions, ou bien qu’un héros à défaut de marquis.
– Quelle singulière idée pour une petite fille de quinze ans !
– Cette idée me plut par sa singularité même, qui s’accordait au reste assez bien avec la bizarrerie de mon caractère. Je savais combien il était difficile, pour plaire à ma maîtresse, de redevenir marquis aujourd’hui que l’on ne veut plus entendre parler de marquisat : il me parut moins difficile, en y réfléchissant un peu, de devenir un héros, car de ceux-là on en permet encore ; et, pour commencer à mériter la main de ma prétendue, je suis venu à Brest m’enrôler en qualité de novice à 15 sur votre corvette. Voilà jusqu’ici mon histoire.
– Pas mal pour un début, quoique tu aies commencé d’un peu loin le chemin qu’il te reste encore à faire. Mais comment, dis-moi donc, mon cher marquis, puisque marquis il y avait, peux-tu espérer de devenir un jour un héros aux yeux d’une petite baronne en t’embarquant à bord d’un corsaire, et à la basse paye du poste que l’on pourra te confier ?
– Eh ! n’y a-t-il pas des héros de toute espèce et à toute paye ? Pourvu qu’un jour on cite mon nom comme celui des Barberousse, des Doria, des Duguay-Trouin ou des Surcouf, ne serai-je pas dans les conditions rigoureuses du concours ?
– Si, ma foi ! et, selon moi, bien au-delà des règles de la convention ; mais, aux yeux de ta baronne, cela sera peut-être bien différent : une baronne, vois-tu ? quoique je ne m’y connaisse guère, doit être, à mon avis, assez difficile sur l’article. Au surplus, puisque le dé en est jeté et que ta vocation paraît être tracée par le doigt du sort dans le ciel, où sont, dit-on, écrites toutes nos destinées, navigue tant que tu pourras, mon cher ami, navigue le cap sur ton étoile et l’avant toujours en route. En attendant, commence par reprendre ton coffret, et viens avec moi au bureau des classes pour que je te donne l’autorisation, avec une bonne note au bout, de passer de la corvette la Prévoyante sur le corsaire à bord duquel il te plaira de mettre ton sac de matelot et ton costume de marquis.
– Merci mille fois, mon commandant ! Je n’en attendais pas moins de vous, et jamais de ma vie je n’oublierai…
– Oui, oui, c’est cela. N’oublie pas surtout de dire de ma part, si quelque jour tu revois ta petite princesse, qu’elle peut se flatter d’avoir eu là la plus drôle d’idée qu’une femme ait pu encore se fourrer en long ou en travers dans la cervelle.
Taillebois se trouva bientôt embarqué, avec son sac, son coffret et un trait de plume du commissaire de marine, sur le lougre le Cent-Pieds, qui n’attendait plus pour partir que le reste de son équipage et le bon vent qu’il plairait au ciel de lui envoyer. Le brave commandant de la Prévoyante fit tant et si bien en cette circonstance pour le jeune matelot dont il avait encouragé les premiers efforts qu’il réussit à le faire placer comme sous-lieutenant à bord du corsaire sur lequel il allait faire sa seconde campagne. Les bonnes gens à la façon du capitaine de la Prévoyante n’étaient pas rares alors dans notre marine militaire. Les gens de science et de tenue l’étaient beaucoup plus, malheureusement ; et ce furent les trop bonnes gens qui perdirent notre marine. Mais c’est moins de tout cela qu’il s’agit aujourd’hui que de la petite histoire que nous avons à raconter à nos lecteurs.
La veille du départ du fameux Cent-Pieds le jeune Taillebois fit en se rendant à bord, son mince paquet sous le bras, une rencontre à laquelle il était bien loin de s’attendre : au détour d’une rue le malheureux se trouva face à face avec une jolie demoiselle que conduisait un vieux gentilhomme qui ne lui était déjà que trop bien connu. La belle étrangère, en reconnaissant le marquis sous de gros habits de marin, s’écria : – C’est lui, mon père ! c’est lui… Le jeune marquis, de son côté, en se rencontrant nez à nez avec sa prétendue et son futur beau-père, se dit en lui-même : – C’est la petite et cruelle baronne et monsieur le baron… L’aimable baronne faillit s’évanouir de ce coup inattendu ; et, pendant que monsieur son père employait tous ses efforts pour la tenir raide sur son bras lassé, le marquis de Taillebois, à qui son émotion n’avait pas heureusement ravi l’usage des jambes, se servit de toute sa vigueur ambulatoire pour aller se jeter à bord du Cent-Pieds, qui, la nuit suivante, appareilla avec une forte brise de nord-est pour vider le goulet de Brest et courir quelques longues bordées à l’ouvert de la Manche.
La belle et fière Isoline, la petite baronne enfin, que nous venons de rencontrer avec son noble père dans les rues de Brest, ne s’était pas rendue dans cette ville pour y retrouver, comme on pourrait d’abord le supposer, le jeune Ernestin de Taillebois. Le soin avec lequel le romanesque marquis avait su dérober les traces de sa fuite en partant, il y avait quelques mois, de son pays natal pour venir s’embarquer sur un bâtiment de l’État, aurait rendu inutiles toutes les recherches de la fille du baron, quand bien même on aurait pu penser qu’un sentiment secret eût conduit cette beauté altière à se mettre à la poursuite de l’homme dont elle avait repoussé les premiers vœux. Un motif plus vulgaire, mais aussi plus raisonnable qu’un entraînement amoureux, avait amené Isoline dans le lieu même que, depuis quelque temps, habitait à son insu l’amant dont elle avait dédaigné ou plutôt ajourné les hommages. Les biens que possédait le baron, et dont sa fille devait hériter un jour, se trouvaient être en partie situés à l’Île-de-France. La nécessité de surveiller ces propriétés éloignées, qui pendant la révolution s’étaient trouvées abandonnées aux soins d’un économe, avait déterminé le noble habitant à se rendre dans la colonie, sur laquelle avait cessé de gronder le tonnerre des dissensions civiles et des troubles intestins ; et comme, à la veille d’entreprendre ce long voyage, le baron avait vu sa fille manifester le désir de partager les dangers auxquels il allait s’exposer pour lui assurer une riche succession, le baron ne s’était pas senti la force de partir sans sa chère Isoline. C’était deux ou trois jours après être arrivés tous deux à Brest pour s’embarquer sur un bâtiment qui allait faire voile pour l’Île-de-France qu’Isoline et le baron s’étaient heurtés avec le fugitif marquis.
Cette rencontre soudaine, imprévue ne laissa pas que de produire sur l’âme de la noble fille une impression des plus vives, malgré l’indifférence apparente avec laquelle elle avait, quelques semaines auparavant, accueilli la déclaration d’amour du beau jeune homme. – Comment, se disait-elle, le marquis a-t-il pu fuir ainsi sa famille pour venir se cacher ici sous des habits de marin ? et quel motif assigner à cette étrange retraite et à ce déguisement encore plus inconcevable ? Aurait-il, par hasard, couru, dans quelque complot terrible, un danger qui l’eût forcé à se dérober, sous ce costume d’emprunt, à la vigilance de ceux qui le poursuivent ? ou plutôt, oubliant son rang et son origine, aurait-il, en se plongeant dans l’abjection d’une classe dont il était né si éloigné, cherché à se venger de mes rigueurs par le mépris du rang auquel je voulais l’appeler à force de mérite et de réputation ?… Ah ! s’il en était ainsi, combien il se serait mépris, le malheureux, sur la pureté et l’élévation de mes sentiments ! Moi qui voulais lui tracer, à force d’amour, une carrière de gloire et de renommée au bout de laquelle il eût trouvé ma main, je n’aurais peut-être réussi qu’à le perdre en cherchant à trop l’élever au-dessus de lui-même et de moi… Pauvre Ernestin ! combien ses traits sont changés et comme il m’a paru souffrant ! Avec quelle promptitude surtout il nous a évités… Oh ! n’en doutons plus, il est coupable ou il s’est senti avili, et il n’y a plus aujourd’hui entre lui et moi aucun lien qui puisse rapprocher deux cœurs si peu faits pour se comprendre… Partons, et parlons vite s’il se peut, pour fuir loin, bien loin, le plus loin possible, cette terre où je désire ne pas même laisser un souvenir. L’absence amènera l’oubli, et l’éloignement deviendra mon refuge contre de trop tardifs et de trop inutiles remords.
Le bâtiment qui allait arracher Isoline à cette terre qui lui rappelait tant de sujets de douleur partit pour l’Île-de-France. Le lougre le Cent-Pieds, qui devait emporter Taillebois à la gloire, était déjà bien loin. Nous ne suivrons sur les mers aucun de ces deux navires entraînés, à une si grande distance l’un de l’autre, vers des buts si différents. Seulement, pour rappeler ici tout ce qu’il n’est pas permis d’omettre dans une narration fidèle, nous dirons qu’après sept à huit mois de courses, de chasses, de relâches, d’appareillages et de combats, le corsaire le Cent-Pieds fit tant et si bien des siennes qu’il parvint à assurer la fortune de ses heureux armateurs, et un peu aussi celle de son vaillant équipage.
Durant ce temps de rudes épreuves et de succès péniblement conquis, on doit bien penser que le courageux Taillebois ne laissa guère passer les occasions de se distinguer dans la profession qu’il avait embrassée avec tant d’ardeur et au prix de tant de sacrifices d’amour-propre. À la mer, et surtout en temps de guerre, les circonstances favorables au développement des hautes facultés du marin ne manquent que rarement aux hommes dévoués : ce sont presque toujours les hommes, au contraire, qui manquent aux grandes circonstances ; mais notre intéressant marquis ne fit pas plus faute aux bonnes aubaines qui s’offrirent sur sa route que les bonnes aubaines ne lui firent défaut à lui-même. À la première sortie du Cent-Pieds il n’était que sous-lieutenant ; à la seconde croisière il se trouvait déjà en état et en position de commander une prise ; à la troisième course il se trouva pourvu d’une des quatre premières lieutenances du bord, place restée vacante par la mort du titulaire, tué dans un abordage. Les abordages alors entraient pour les trois quarts au moins dans l’avancement des jeunes sujets. Les intrigues de salon aujourd’hui ont remplacé les chances qu’offraient alors les périls de l’abordage ; et aux abordages de navires ont succédé, pour le temps présent, les abordages de cour.
Au commencement du printemps le Cent-Pieds, accablé du poids de ses nombreux succès, et surtout des chasses qu’il lui avait fallu appuyer ou essuyer pendant l’hiver, alla désarmer ou se reposer, comme un vieil athlète époumoné, dans le port de Saint-Malo ; de Saint-Malo, entendez-vous bien ? cet Alger de la France, moins la piraterie et les Bédouins, et plus le courage et la générosité.
Au moment où le glorieux Cent-Pieds allait mettre à terre son équipage mutilé et son gréement haché par la mitraille ennemie, un autre corsaire se disposait à prendre bientôt la mer pour se rendre dans l’Inde, et chercher fortune dans ce pays des gros vaisseaux de la compagnie anglaise et des lourds galions chargés encore des richesses du Bengale et de la Chine.
Le nouveau corsaire malouin, avec lequel nous allons bientôt faire connaissance, se nommait le Revenant et son capitaine Surcouf, ou Robert Surcouf si vous voulez, ou mieux encore, comme plus tard le baptisa Napoléon, le brave Surcouf. C’est là le titre et le nom qui sont restés à cet intrépide homme de mer, baptisé de la bouche du plus grand homme de guerre que les braves aient jamais pu avoir pour parrain. Taillebois, en apprenant le nom du capitaine du Revenant, eut envie d’embarquer sur le navire qu’allait commander le marin célèbre.
Le capitaine, en s’informant de ce qu’avait fait le jeune lieu tenant à bord du Cent-Pieds, désira l’emmener dans l’Inde avec lui. Les deux Bretons se virent, et Surcouf dit à Taillebois dès la première entrevue qu’ils eurent ensemble : – Vous êtes un brave jeune homme, et j’aime les jeunes gens comme vous parce qu’il m’en faut, et que j’en consomme passablement à l’occasion.
Le lieutenant du Cent-Pieds répondit au capitaine du Revenant : – Je vous aime, capitaine, parce que j’aime la gloire, et je suis à vos ordres de la tête aux pieds comme votre corsaire est à vous de la car lingue à la pomme du grand mât.
– Ce que vous me dites là n’est pas mal, reprit le capitaine, et je vous prends pour second, non pas, entendez-vous bien ? parce que vous savez faire de l’esprit, mais parce que je suis certain que vous saurez faire votre métier encore mieux que de beaux compliments et de jolies phrases.
Le jeune homme, à ces mots, sentant la rougeur lui gagner le visage du menton jusqu’au bout des oreilles, s’essuya du dos de la main une larme d’attendrissement et d’orgueil, et salua avec les marques du plus profond respect et de la plus vive reconnaissance le glorieux et nouveau capitaine qu’il venait de se donner et de conquérir.
Tout fut dit dès-lors entre les deux officiers. Il y a des hommes qui s’entendent et qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup se parler, ni même de se voir ou de s’étudier bien longtemps ; et cela doit arriver toutes les fois que ces hommes ont beaucoup plus de franchise et de valeur réelle que d’éloquence à faire valoir et de temps à perdre en verbiage.
L’affaire étant réglée de la sorte entre le capitaine et son lieutenant, le trois-mâts le Revenant prit le large en envoyant pour adieu un coup de canon à poudre à la terre natale de Saint-Malo, et en lançant toute une volée à mitraille à une frégate anglaise qui avait cru pouvoir le bloquer dans le port où il venait d’être armé.
Quoique fort neuf dans la pratique d’un métier très difficile, le nouveau second du Revenant sut bientôt, à force de dévouement et d’intelligence, suppléer si bien à l’expérience qui lui manquait encore qu’au bout de quinze à vingt jours de mer il entendit le capitaine Surcouf lui dire qu’il n’était pas trop mécontent de lui. Une mention honorable au Moniteur universel aurait fait cent fois moins de plaisir au jeune officier que ce compliment presque négatif, car c’était quelque chose, savez-vous bien ? que d’avoir trouvé le moyen de ne pas mécontenter un homme comme Surcouf ! Il ne fallait plus à Taillebois qu’une bonne occasion de se distinguer sous les yeux de l’illustre chef, dont il eût payé le moindre suffrage au prix de toute sa vie. Cette occasion se présenta bientôt toute seule, et avec toutes les circonstances accessoires qui pouvaient la rendre précieuse pour celui qui la désirait le plus vivement.
Aux environs des îles du Cap-Vert, et entre les gros rochers dont les sommets escarpés sortent des flots pour former ce petit archipel, on découvrit sur l’avant du Revenant une voile, une voile haute et blanche qu’arrondissait la brise, et qui semblait chercher à se cacher parmi les îlots que continuait de son côté à approcher le corsaire français. Le Revenant orienta à courir sur la voile aperçue ; c’était son métier. Surcouf après une heure de chasse devina, avec cet instinct qu’ont acquis comme un sixième sens tous les vieux marins, qu’il faudrait encore deux heures avant que le Revenant pût joindre le bâtiment poursuivi.
– Avertissez nos gens, dit-il à son second, que la moitié de l’équipage peut aller se coucher pendant une bonne heure et demie, pour être plus disposée ensuite à se brosser convenablement si, comme je l’espère, nous devons nous donner une poillée avec le navire en vue.
L’avis fut transmis à l’équipage, qui profita en partie de la permission qui venait de lui être donnée de faire un somme préparatoire.
Quant à Taillebois, qui avait passé la moitié de la nuit précédente sur le pont et qui aurait pu user du bénéfice de la trêve octroyée par le capitaine aux hommes un peu fatigués, il jugea à propos de mieux employer son temps qu’à dormir comme les autres. Il avait depuis près d’un an conçu et mûri un projet, et ce projet il songea à l’exécuter en demandant à Surcouf l’autorisation de s’habiller en marquis dans le cas où le corsaire viendrait à se mesurer avec le bâtiment chassé.
– Quelle drôle de fantaisie avez-vous donc là ? s’écria le capitaine tout étonné. Vous habiller en marquis ! Et pourquoi cette mascarade ?
– Pour contenter un caprice que j’ai depuis longtemps, répondit le second, et pour un autre motif que je n’ai pas le temps de vous expliquer aujourd’hui.
– Mais, mon bon ami, ne craignez-vous pas, en vous déguisant ainsi, de faire mourir de rire tout l’équipage à vos dépens ?
– Si l’équipage meurt aujourd’hui, ce ne sera pas de rire à mes dépens, je vous le promets, capitaine, quand il me verra au feu sous mon costume de gentilhomme ; car le cœur d’un vaillant garçon continuera à battre dur sous cet habit de fantaisie, et surtout au moment de se donner la peignée que vous nous aurez préparée.
– Allons, mon cher ami, habillez-vous, déguisez-vous, travestissez-vous enfin comme vous l’entendrez, pourvu que vous vous frottiez à mon idée sous l’uniforme que vous prendrez. L’habit, vous comprenez bien, ne fait pas grand-chose pour moi à l’affaire ; mais vous conviendrez que vous avez choisi pour costume de combat un accoutrement diantrement baroque !





























