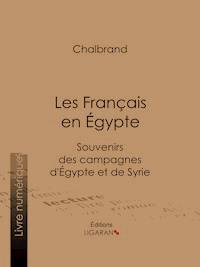
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le 17 octobre 1797, le jour même où fut signée la glorieuse paix de Campo-Formio, j'obtins un congé de semestre, ou plutôt de convalescence ; car plusieurs blessures, et surtout la fatigue des dernières campagnes, avaient altéré ma santé. C'était la première fois, depuis que j'avais quitté la maison paternelle, c'est-à-dire depuis quatre ans, qu'il m'allait être enfin permis de revoir mon pays natal et d'embrasser mes parents."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On lisait dans quelques-uns des grands journaux de Paris du mois de décembre 1854 l’article suivant :
« Encore un des rares débris de nos grandes guerres de la révolution et de l’empire qui vient de descendre dans la tombe. M. le colonel Chalbrand, qui avait fait avec distinction les campagnes d’Italie, d’Égypte, d’Austerlitz, d’Iéna, d’Espagne, de Russie, vient de mourir à l’âge de quatre-vingt-un ans dans la commune de…, département de…, où il vivait retiré depuis plus de quarante ans. Après avoir employé la première partie de sa longue existence à la défense de sa patrie, il en consacra le reste à l’exercice de ces vertus paisibles qui distinguent l’homme de bien et le véritable philosophe chrétien. Toujours prêt à aider ceux qui avaient recours à lui, soit de sa bourse, soit des conseils de sa vieille expérience, il s’est montré jusqu’à ses derniers jours le bienfaiteur des pauvres, le consolateur des affligés, l’ami dévoué de tous ceux qui avaient eu le bonheur de mériter son estime et sa confiance. Aussi a-t-il emporté en mourant les regrets de tous ses concitoyens, et sa perte a-t-elle été une véritable calamité pour le pays qu’il habitait. »
Nous ajouterons à cette notice des journaux que le colonel Chalbrand n’avait pas été seulement un guerrier remarquable par sa bravoure et ses talents militaires, il était aussi distingué par la profondeur de son instruction et la variété de ses connaissances. Il avait mis à profit avec une rare persévérance tous les instants de loisir qu’il pouvait se procurer pendant ses nombreuses campagnes, pour étudier sous tous les aspects les diverses contrées où le conduisaient les chances de la guerre. Les monuments des arts, les restes d’antiquités, comme les mœurs et les usages des peuples, étaient également l’objet de ses investigations. Il avait rapporté de tous les lieux qu’il avait parcourus des objets de curiosité dont il avait composé un véritable musée. L’Égypte surtout avait fourni la plus complète et la plus riche partie de sa collection ; il lui avait consacré une salle entière de sa maison. On y voyait des statues, des momies parfaitement conservées, et sous des vitrines une foule de petites statuettes de toutes formes, des meubles, des ustensiles, à l’usage des anciens Égyptiens. La plupart de ces objets provenaient des fouilles faites dans les tombeaux de Thèbes. Les murs étaient tapissés de feuilles de papyrus couvertes d’hiéroglyphes ou de caractères de l’écriture usuelle ou démotique. À côté de ces précieux restes de l’antiquité, on voyait des armures de chevaliers, des cimeterres recourbés, souvenirs des croisades et des combats livrés entre les chrétiens et les soldats de Saladin ou de Malek-Adel.
Il faisait les honneurs de sa collection avec affabilité et complaisance. Sa mémoire, toujours fraîche, était aussi bien ornée que sa maison ; ce qui rendait sa conversation aussi variée qu’instructive. Souvent ses amis l’ont engagé à écrire ses mémoires ; toujours il s’en est défendu en disant que tous les grands faits historiques dont il avait été témoin avaient été racontés par des plumes beaucoup plus exercées que la sienne, et que, quant aux évènements particuliers ou aux anecdotes qui lui étaient personnelles, il n’avait pas la prétention de les croire assez intéressantes pour exciter la curiosité d’autres que de ses amis.
Ses amis jugeaient bien différemment ; mais, ne pouvant le décider à écrire, quelques-uns d’entre eux se sont entendus pour recueillir ses conversations sur tous les principaux évènements de sa vie. C’était chose facile ; car, ainsi que tous les vieillards, il aimait à raconter ; puis, si l’on avait omis quelques détails, il était aisé de lui faire recommencer plusieurs fois le même récit ; ce qui permettait à ses auditeurs de l’écrire en quelque sorte sous sa dictée.
C’est ainsi qu’on s’est procuré les mémoires complets ou plutôt les souvenirs du colonel Chalbrand. Seulement ils ne forment pas un ouvrage suivi et régulier ; ce que l’on comprendra facilement, parce que les récits du colonel ont été recueillis par diverses personnes, et que lui-même ne suivait aucun ordre pour les faire, et traitait tel ou tel sujet selon qu’il y était déterminé par ses interlocuteurs ou par des circonstances fortuites. Quand nous avons voulu extraire de ces mémoires ce qui concernait telle ou telle expédition, telle ou telle campagne, nous avons eu besoin de réunir les divers récits sur le même sujet, de les coordonner ensemble de manière à en former un tout régulier. Pour donner aux faits racontés plus de précision, nous y avons joint les dates, que, malgré la lucidité de sa mémoire, le colonel avait souvent omises ; nous y avons aussi ajouté dans le même but quelques documents historiques, tels que proclamations, ordres du jour, actes officiels qu’il ne faisait qu’indiquer sans en reproduire le texte.
De cette manière, à l’aide des renseignements que nous avons puisés à cette source, nous pouvons publier une série de récits intéressants, sous les titres suivants : Les Français en Italie, les Français en Égypte, les Français en Allemagne, les Français en Espagne, les Français en Russie, etc.
Nous commencerons par les Français en Égypte, ou Souvenirs des campagnes d’Égypte et de Syrie, parce que c’est un des épisodes les plus remarquables de cette grande époque militaire qui suivit la révolution française, une de ces expéditions qui portèrent le plus loin la gloire du nom français, et dont les résultats, quoique différents de ceux qu’on s’en était promis, n’en ont pas été moins utiles aux intérêts de la France, aux progrès des peuples du Levant vers la civilisation, au développement des sciences et des arts, et à des découvertes qui ont éclairé d’un jour nouveau une des parties les plus obscures de l’histoire ancienne.
Le colonel Chalbrand était du petit nombre de ces hommes, dont il parle lui-même dans ses mémoires, qui avaient conservé les principes religieux dans lesquels ils avaient été élevés, malgré le philosophisme du XVIIIe siècle, malgré la révolution, malgré la vie des camps. Chaque fois qu’il en trouve l’occasion, il ne manque jamais de manifester ses principes et ses sentiments sur la religion, et ce ne sera pas, nous en sommes convaincu, la partie de ces souvenirs qui touchera le moins nos jeunes lecteurs.
Le congé de semestre. – Retour dans ma famille. – Mes occupations pendant mon congé. – La lettre du docteur Marchand. – Départ pour Toulon. – Spectacle que présente l’armée. – Arrivée de Bonaparte. – Sa proclamation. – Départ de la flotte. – Notre-Dame-de-la-Garde. – Route de la flotte. – Sa disposition pendant la marche. – Arrivée devant Malte. – Préparatifs pour s’emparer de cette île. – Réflexions. – Situation de l’île de Malte. – Coup d’œil sur son histoire. – Bonaparte demande l’entrée du port pour faire de l’eau. – Réponse du grand maître. – Réponse de Bonaparte. – Attaque de l’île sur tous les points. – Capitulation. – Occupation de l’Île et des forts par l’armée française. – Visite dans l’île. – Sa description. – La cité Lavalette. – Appareillage de la flotte. – Départ du général Baraguay-d’Hilliers pour la France.
Le 17 octobre 1797, le jour même où fut signée la glorieuse paix de Campo-Formio, j’obtins un congé de semestre, ou plutôt de convalescence ; car plusieurs blessures, et surtout la fatigue des dernières campagnes, avaient altéré ma santé. C’était la première fois, depuis que j’avais quitté la maison paternelle, c’est-à-dire depuis quatre ans, qu’il m’allait être enfin permis de revoir mon pays natal et d’embrasser mes parents. Aussi ma joie était-elle à son comble, et je n’aurais pas changé mon bonheur pour celui que dut éprouver Bonaparte lui-même dans cette journée où il vit l’Autriche forcée, dans son humiliation, de céder à toutes les exigences de son vainqueur.
Quinze jours après, j’étais au milieu de ma famille, et, grâce à ma jeunesse, à ma vie régulière, et surtout aux soins de mon excellente mère, ma santé se raffermit rapidement, et bientôt je ne ressentis plus rien de mes souffrances passées.
J’avais rapporté d’Italie une assez grande quantité d’objets rares, tels que camées antiques, vases étrusques, médailles et statuettes de bronze, d’argent et d’or, quelques petits tableaux de diverses écoles, et jusqu’à des fragments de pierres détachées du Colisée et de l’arc de triomphe de Trajan. C’étaient là mes trophées et les plus précieux souvenirs de mes campagnes. J’avais toujours eu la passion des voyages, et, si j’eusse été libre, j’aurais aimé à visiter en amateur les contrées célèbres de l’Italie, de la Grèce et de l’Orient. Mais la révolution était venue interrompre mes études et faire évanouir mes rêves d’avenir. Puis, comme le dit un poète de cette époque :
Et voilà comment je fus incorporé dans un des bataillons de volontaires de la Côte-d’Or. Malgré mon peu de vocation pour l’état militaire, je finis peu à peu par m’accoutumer au métier de soldat, et j’en remplis tous les devoirs, sinon avec goût, du moins avec une exactitude qui m’attira la bienveillance de mes chefs. Bientôt j’obtins de l’avancement, et, après avoir passé rapidement par tous les grades inférieurs, je reçus les épaulettes de sous-lieutenant à l’entrée de l’armée en Italie, et celles de lieutenant sur le champ de bataille de Rivoli.
Un des plus précieux avantages que me procura l’état militaire fut de me permettre quelquefois de profiter des voyages forcés qu’il me faisait faire, pour étudier les pays que je parcourais les armes à la main. C’est ainsi que j’avais visité déjà une partie de l’Allemagne, de la France et de l’Italie ; et de toutes ces contrées j’avais rapporté quelques souvenirs intéressants ou quelques dessins pris à la hâte ; car, malgré la multiplicité des travaux qui enlèvent presque tout son temps au soldat, j’avais toujours su trouver quelques instants pour me livrer à mes goûts favoris ; mais c’était surtout depuis que j’avais été nommé officier qu’il m’avait été accordé plus de facilité de les satisfaire, et c’était là ce qui donnait à mes yeux plus de prix à mon nouveau grade. Quand nous étions en garnison dans une ville, au lieu d’imiter la plupart de mes camarades, qui passaient presque tout leur temps au café et dépensaient leur argent en orgies, je visitais les ruines des anciens monuments, les musées, les églises ; je tâchais de lier connaissance avec quelques savants ou avec des artistes, et j’employais mes économies à l’achat de quelques tableaux de maîtres ou de quelque objet précieux d’antiquité. C’est ainsi que j’avais formé la collection que j’avais rapportée avec moi d’Italie.
Une de mes occupations pendant mon séjour dans ma famille fut de ranger ces objets par ordre et avec soin, et de commencer ainsi la formation du petit musée que je devais bientôt enrichir au prix de nouvelles fatigues et de nouveaux dangers.
J’employai à ce travail tout l’hiver de 1797-1798, ou de l’an VI de la république, pour parler le langage du temps. Mais au commencement du printemps, mon congé étant près d’expirer, il fallut songer à rejoindre mon corps. Une seule chose me préoccupait : c’était de savoir où s’ouvrirait la campagne de 1798. On était en paix avec toute l’Europe continentale ; l’Angleterre seule restait armée. On parlait, il est vrai, depuis longtemps d’une descente dans cette île ; cent cinquante mille hommes étaient rassemblés sur les côtes de la Manche ; cette armée avait reçu le nom d’armée d’Angleterre, et Bonaparte en avait été officiellement nommé général en chef. Cependant ma demi-brigade, que j’avais ordre de rejoindre, se trouvait à Toulon avec un grand nombre de troupes de toutes armes, formant une autre armée prête à s’embarquer pour une destination inconnue, mais qui, à coup sûr, ne pouvait être les îles Britanniques. Bientôt je reçus d’un de mes amis, aide-major de mon bataillon, une lettre qui souleva le voile dont ce mystère était encore enveloppé.
En voici quelques passages :
« Au moment où votre congé va expirer, vous vous demandez sans doute de quel côté vous serez obligé de diriger vos pas : sera-ce au nord ou au midi, à l’est ou à l’ouest ? car, Dieu merci, par le temps qui court, nous sommes habitués à promener nos étendards vers les quatre points cardinaux. Je crois pouvoir dissiper votre incertitude en vous faisant connaître, ce qui est encore un secret pour tout le monde, le but de l’expédition qui se prépare ici. Je dois vous déclarer d’abord que ce secret ne m’a pas été révélé confidentiellement, car je ne pourrais alors vous en faire part ; mais de même que pour arriver, dans les sciences, à la solution d’un problème, on passe successivement du connu à l’inconnu, je suis parvenu, à l’aide de renseignements positifs, à acquérir la certitude que notre expédition est destinée pour l’Orient, et probablement pour l’Égypte. – Comme je vous connais amateur passionné de l’histoire et des monuments de l’antiquité, j’espère que vous apprendrez cette nouvelle avec plaisir, et que vous serez enchanté de venir avec nous visiter la vieille terre de Pharaon et de Ptolémée. Du reste je dois vous prévenir que vous serez en bonne compagnie, et qu’une nombreuse réunion de savants a été enrôlée, sous le nom de Commission scientifique, pour suivre l’armée. On y remarque des académiciens, des ingénieurs, des mathématiciens, des astronomes, des chimistes, des naturalistes, des dessinateurs, etc. etc. J’ajouterai encore que l’on a embarqué un matériel complet d’imprimerie, avec des caractères français et arabes sortant de l’imprimerie nationale, et que des interprètes arabes et turcs ont été attachés à l’état-major. Ces détails, je pense, suffiraient pour justifier mes présomptions ; il en est d’autres qui ont eu moins de publicité, parce qu’ils regardent plus spécialement mon service, mais qui sont à mes yeux des preuves encore plus certaines de l’intention du gouvernement. Desgenettes et Larrey ont été préposés au service médical de l’armée, l’un comme médecin, l’autre comme chirurgien en chef. Un arrêté de la commission d’armement les a chargés de recruter des médecins et des chirurgiens qui aient voyagé en Orient, et surtout en Égypte ; on a demandé des rapports sur la nature des maladies endémiques de l’Égypte et de la Syrie, et l’on a fait embarquer en grande quantité, avec les provisions générales des pharmacies, les médicaments propres au traitement de ces maladies… Je pense que vous voilà suffisamment édifié pour n’être pas pris au dépourvu… »
Cette lettre, ainsi que l’avait pensé le docteur Marchand (c’était le nom de mon correspondant), me causa un plaisir indicible. L’Égypte, la Syrie, et surtout la Palestine, avaient toujours été l’objet de mes rêves de voyages, et voilà que j’allais être appelé à visiter ces contrées, non pas comme un voyageur isolé, exposé aux avanies et au brigandage des Arabes, mais les armes à la main, comme au temps de Godefroy de Bouillon ou de saint Louis. Je profitai du peu de temps qui me restait encore avant mon départ pour relire tous les auteurs anciens et modernes qui avaient écrit sur l’Égypte et la Palestine. Hérodote, Strabon, Homère, Diodore de Sicile, Pline l’Ancien, furent tour à tour l’objet de mes élucubrations ; mais par-dessus tous je lus et je relus la Bible, et les récits naïfs et touchants de la Genèse et de l’Exode, depuis le voyage d’Abraham en Égypte, depuis l’histoire si intéressante de Joseph, jusqu’à la sortie du peuple hébreu de ce pays, sous la conduite de Moïse. J’ai eu souvent occasion dans la suite, comme on pourra le voir, de reconnaître la vérité des récits de l’écrivain sacré et l’exactitude de ses descriptions. Je parcourus aussi les historiens des croisades, surtout le recueil intitulé Gesta Dei per Francos, et les curieuses chroniques du sire de Joinville ; puis je terminai cette étude par la lecture de deux voyageurs contemporains, Savary et Volney, qui avaient publié leurs ouvrages depuis une dizaine d’années. De tous ces livres je n’emportai avec moi qu’une petite Bible latine contenant l’Ancien et le Nouveau Testament. Quant aux autres auteurs, je me contentai d’en faire quelques extraits manuscrits.
Quand j’eus ainsi complété ce que j’appelais ma cargaison morale, je me mis en route après de touchants adieux à ma famille. J’arrivai à Toulon dans les premiers jours de mai. Il serait difficile de se faire une idée du spectacle qu’offrait l’armée réunie dans cette ville. Elle n’était point encore instruite officiellement du point où elle devait porter ses armes ; mais tous les chefs pensaient, comme mon ami le docteur Marchand, que ce serait en Égypte. Quant aux soldats, ils s’en inquiétaient fort peu. Avec un général en chef comme Bonaparte, avec des généraux de division ou de brigade comme Desaix, Kléber, Murat, Lannes, Junot, Davout et tant d’autres, peu leur importait le lieu où on les conduisait ; les eût-on menés au bout du monde, ils y seraient allés avec confiance. – Puis, au milieu de tout ce tumulte qui précède et accompagne le départ d’une armée, que de projets rêvés par des esprits ambitieux ou avides de richesses ! Les uns fondaient sur cette expédition tout un avenir de gloire et d’honneurs, les autres y voyaient la fortune ; et la plupart n’ont recueilli que de cruelles déceptions. Combien sont morts soit par le fer ennemi, soit par les maladies, soit par le chagrin ! Combien d’autres, dont le moral avait pu résister aux dégoûts et aux privations de toute espèce, se sont estimés heureux de revoir leur patrie plus pauvres qu’ils ne l’avaient quittée, mais du moins la vie sauve ! Du reste, ces tristes réflexions ne venaient alors à l’esprit de personne. On riait, on chantait, on s’étourdissait sur les privations et les dangers de l’avenir ; on attendait avec impatience le signal du départ.
Bonaparte arriva à Toulon le 9 mai. Le lendemain il adressa à l’armée de terre et de mer une proclamation où l’on remarquait les passages suivants :
« Soldats !
Vous êtes une des ailes de l’armée d’Angleterre. Vous avez fait la guerre des montagnes, des plaines et des sièges ; il vous reste à faire la guerre maritime.
Les légions romaines, que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter les fatigues, disciplinées et unies entre elles.
Soldats, l’Europe a les yeux sur vous ; vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des fatigues à vaincre…
Soldats, matelots, fantassins, canonniers, soyez unis ; souvenez-vous que le jour d’une bataille vous avez tous besoin les uns des autres.
Soldats, matelots, la plus grande sollicitude de la république est pour vous ; vous serez dignes de l’armée dont vous faites partie… »
Un tel langage dans la bouche d’un homme environné de tout le prestige de la gloire transporta toutes les âmes. Officiers et soldats furent également électrisés, et un cri général d’enthousiasme et d’impatience appela le moment du départ.
Il avait été fixé d’abord au 15 mai ; mais un violent coup de vent d’est retint l’escadre encore cinq jours sur ses ancres. Enfin elle appareilla le 19 au soir, et le 20 au matin elle sortit toutes voiles déployées, aux acclamations de la foule accourue sur le rivage, au bruit de l’artillerie des forts qui saluaient notre départ. Jamais spectacle plus imposant ne s’offrit à mes regards, et le temps n’a pas effacé l’impression qu’il produisit sur mon âme. Mes regards se portaient tour à tour sur le rivage de la patrie que nous quittions peut-être pour toujours, sur ces innombrables vaisseaux dont les blanches voiles resplendissaient au soleil levant, sur cette mer unie comme un miroir, que nos proues sillonnaient en tout sens, tandis qu’autour de moi j’entendais les chants joyeux des soldats, les fanfares guerrières des musiques militaires, et les sons aigus et prolongés du sifflet des contremaîtres commandant la manœuvre. Au milieu de tout ce mouvement, de toute cette agitation, mes pensées se reportaient sur le passé : je songeais à la flotte de saint Louis, non moins nombreuse que la nôtre, non moins enthousiaste, partant des mêmes rivages pour la même destination. Là s’arrêtait la ressemblance ; car la foi qui animait les croisés, l’espérance qui les soutenait, le but qu’ils se proposaient n’avaient guère de rapport avec les divers mobiles qui nous dirigeaient en ce moment. Cependant cette foi de nos pères n’était pas encore entièrement éteinte dans le cœur de ces milliers de braves qui allaient avec tant d’insouciance affronter des dangers inconnus ; c’est une remarque que j’ai eu plus d’une fois occasion de faire dans la suite, et qui me frappa le jour même de notre départ ; car je vis plus d’un matelot provençal tourner pieusement les regards vers le rocher de Notre-Dame-de-la-Garde, dont la cime apparaissait à l’horizon, et adresser vers ce sanctuaire, alors dévasté, une humble et fervente prière à celle que l’Église appelle l’Étoile de la mer.
Pour moi, la grandeur de ce spectacle, les souvenirs qu’il éveillait en moi, me jetèrent dans une profonde rêverie. Loin de partager la joie bruyante de mes camarades, j’éprouvais un sentiment indéfinissable de tristesse ; pour me livrer sans contrainte à mes pensées, je m’appuyai sur le bastingage du vaisseau, et, absorbé dans mes réflexions, je regardais, presque sans la voir, la côte de Provence qui fuyait devant nous.
Nous longeâmes cette côte jusqu’à Gênes, où nous ralliâmes le convoi réuni dans ce port par le général Baraguay-d’Hilliers. La flotte cingla ensuite vers le cap Corse, qui fut signalé le 23 mai au matin. Elle resta en vue du côté oriental de l’île jusqu’au 30, pour attendre le convoi d’Ajaccio, qui était sous les ordres du général Vaubois. Quand il eut rejoint, l’escadre louvoya quelques jours à la hauteur de l’île de Sardaigne, où devait la rejoindre le convoi de Cività-Vecchia, commandé par le général Desaix. Le 3 juin, le convoi ne paraissant pas encore, Bonaparte donna l’ordre à l’amiral Brueys de continuer la route.
Le 7 juin, l’armée navale longeait la Sicile. Nous passâmes à une portée de canon de la jolie ville de Massara. Le rivage était couvert d’une foule nombreuse qui regardait avec inquiétude cet immense armement dont la destination était inconnue. Un aviso fut envoyé pour rassurer le gouverneur de l’île, qui était lui-même fort alarmé.
La marche de l’escadre était admirable ; elle s’avançait dans le plus bel ordre sur trois colonnes, et ses quatre cents voiles présentaient l’aspect d’une ville flottante. L’intérieur des bâtiments offrait à l’œil de l’observateur un tableau non moins intéressant. Trois fois par jour les troupes étaient exercées à la manœuvre du canon. Le soir, les musiques des régiments se faisaient entendre sur différents bords, et rien ne saurait rendre l’effet que produisait, par un temps calme, cette harmonie guerrière qui semblait sortir du sein des flots. On distinguait surtout la musique des guides de Bonaparte, qui jouait ordinairement la Marche des Tartares de Kreutzer, air alors fort en vogue et que le général en chef affectionnait beaucoup.
Le plus beau temps favorisait notre route ; l’armée se tenait, suivant les circonstances, au vent ou sous le vent du convoi. Les changements de position, les avis des bâtiments en découverte nécessitaient quantité de signaux, qui devenaient les nouvelles de l’armée et qui étaient pour nous une sorte de spectacle et de sujets à conjectures. Cette variété d’exercices, de travaux, de délassements, entretenait l’ardeur et l’enthousiasme des troupes, et faisait disparaître la monotonie et l’ennui inséparable d’une navigation lente et prolongée.
Le 8 juin nous quittâmes les côtes de Sicile, et le 9 au matin nous arrivâmes en vue de l’île de Malte, où le convoi de Cività-Vecchia nous attendait depuis le 6. Notre armée navale se trouvait alors au complet ; aussitôt elle reçut l’ordre de se former en ligne de bataille et de s’avancer vers l’île ; car Bonaparte était résolu à s’en emparer, et à employer la force pour y parvenir, si les voies moins hostiles qu’il allait tenter d’abord ne réussissaient pas. En un clin d’œil, les cinq cents voiles françaises, décrivant un immense demi-cercle, menacèrent tous les points attaquables.
La possession de cette île devenait indispensable pour mener à bonne fin nos projets sur l’Égypte. Située dans le canal qui sépare la Sicile de l’Afrique, à environ deux cent soixante lieues sud-est de Toulon, Malte offrait une position intermédiaire qu’il aurait été dangereux de laisser à des ennemis, ou même à des neutres. Elle allait certainement tomber au pouvoir des Anglais, si nous ne nous hâtions de les prévenir. C’étaient là, j’en conviens, des nécessités de la politique que je ne discute pas ; ce qui ne m’empêchait pas de déplorer les malheurs des temps qui forçaient une armée française, allant à la conquête de l’Égypte, de commencer ses exploits par s’emparer d’une île qui fut si longtemps le boulevard de la chrétienté contre l’islamisme, et par détruire un ordre religieux fondé pour résister à ces mêmes infidèles que nous allions combattre. Mais, dira-t-on, l’ordre de Malte était bien dégénéré ; comme la plupart des institutions du Moyen Âge, il en était venu à perdre son objet, à perdre en même temps toute sa dignité, toute sa force : il n’était plus qu’un abus, profitable à ceux-là seulement qui l’exploitaient. Ce sont là les raisons, ou d’autres équivalentes, qui sont toujours au service des révolutions pour détruire des institutions anciennes et utiles, plutôt que de réformer les abus introduits avec le temps, et qu’il eût été plus sage de faire disparaître que d’abolir les institutions elles-mêmes. Puis vient un temps où l’on regrette cette destruction ; mais il est trop tard, parce qu’il est toujours plus facile de démolir que d’édifier. C’est ce qui arriva à Bonaparte lui-même à l’égard de l’ordre de Malte. Après l’avoir détruit en 1798, comme général de la république française, trois ans plus tard, en 1801, quand il fut parvenu au pouvoir sous le titre de premier consul, il stipula formellement dans le traité d’Amiens le rétablissement de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et sa réintégration à Malte ; mais l’Angleterre, après avoir signé ce traité, refusa d’en exécuter les clauses, et d’évacuer l’importante station qu’elle occupait au milieu de la Méditerranée. Ce fut une des causes qui amenèrent bientôt la rupture de la paix, et entraînèrent cette longue et terrible guerre de quinze ans, terminée par la chute de Napoléon et sa captivité sur le rocher de Sainte-Hélène. Mais laissons cette digression, qui nous mènerait trop loin, et revenons à notre récit.
L’île de Malte est située par les 35° 54’ de latitude et 11° 10’ de longitude est du méridien de Paris. Elle est la principale d’un groupe composé des trois îlots de Gozzo, Cumino et Cuminetto. Elle est située à vingt lieues de la Sicile et à soixante des côtes d’Afrique.
Il paraît certain que l’île désignée dans l’Odyssée sous le nom d’Hypérie n’est autre que Malte. Ce premier nom fut remplacé par celui d’Ogygie, et c’était là que résidait Calypso, et que les vents conduisirent Ulysse après le siège de Troie.
Les Phéniciens restèrent maîtres de cette importante station jusqu’en 736 avant Jésus-Christ. À cette époque les Grecs, pour faciliter leur commerce avec la Sicile, expulsèrent les Phéniciens de l’île, et lui donnèrent le nom de Melita, à cause de l’excellent miel qu’on y recueille : de là l’origine du nom de Malta, que lui donnèrent les Sarrasins et qui fut conservé jusqu’à nos jours. Cette île fut successivement occupée par les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Arabes, les Normands, et depuis ces derniers elle eut toujours les mêmes maîtres que la Sicile, jusqu’en 1530, que Charles-Quint, désireux d’établir un puissant boulevard entre l’Afrique musulmane et l’Europe chrétienne, fit don des îles de Malte et de Gozzo aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui, expulsés de Rhodes, leur chef-lieu, erraient, sans savoir où se fixer, sur les côtes d’Italie. L’ordre prit dès lors le nom de sa nouvelle résidence.
Ils établirent d’abord leur ville capitale à Cività-Vecchia, dans le milieu de l’île ; mais, attaqués en 1565 par toutes les forces de l’empire ottoman, ils reconnurent pendant le siège tous les désavantages de leur position dans les terres, et ne durent leur salut qu’à une persévérance et à un courage surnaturels. Après leur délivrance, leur ville n’offrant plus qu’un amas de ruines incapable de résister à une nouvelle attaque dont ils étaient menacés, quelques voix proposèrent d’abandonner Malte, trop exposée, et de transporter ailleurs la résidence de l’ordre. Mais le grand maître Lavalette, qui avait signalé sa bravoure pendant le siège, résolut de rester dans l’île et de remplacer l’ancienne capitale par une forteresse construite sur le bord de la mer. À sa voix s’éleva la cité actuelle qui porte son nom, et que les grands maîtres ses successeurs se sont plu à fortifier par des travaux admirables et parfaitement entendus. Toutes les fortifications sont construites en pierres de taille ou creusées dans le roc ; tous les magasins sont à l’abri de la bombe. Les ouvrages, les batteries et les forts sont entassés les uns sur les autres, croisant leurs feux de manière à rendre cette place imprenable. Aussi, le lendemain de sa reddition, le général Caffarelli, en visitant avec Bonaparte les fortifications, lui dit en plaisantant : « Ma foi, général, il est heureux qu’il y ait eu du monde dans cette forteresse pour nous en ouvrir les portes ; autrement il nous eût été impossible d’y entrer. »
Nous avons dit que le 9 juin au matin l’armée française s’avançait en ordre de bataille sur les différents points de l’île. À midi, Bonaparte envoya un de ses aides de camp demander l’entrée du port pour faire de l’eau et renouveler quelques provisions. Le grand maître Hompech fit répondre par le sieur Carasson, consul de France à Malte, que les statuts de l’ordre ne permettaient l’entrée du port qu’à quatre navires au plus à la fois, et qu’il ne pouvait enfreindre cette règle. À dix heures du soir, le consul vint apporter cette réponse à Bonaparte. Il reçut aussitôt l’ordre de répondre au grand maître dans les termes suivants :
« Le général en chef a été indigné de ce que vous ne vouliez accorder la permission de faire de l’eau qu’à quatre bâtiments à la fois : et, en effet, quel temps ne faudrait-il pas à quatre ou cinq cents voiles pour se procurer de cette manière l’eau et d’autres choses dont elles ont un pressant besoin ? Ce refus a d’autant plus surpris le général, qu’il n’ignore pas la préférence accordée aux Anglais. Le général est résolu à se procurer de force ce que l’on aurait dû lui accorder en suivant les principes de l’hospitalité qui sont la base de votre ordre. J’ai vu les forces considérables qu’il commande, et je prévois l’impossibilité où se trouve l’île de résister… Le général n’a pas voulu que je retournasse dans une ville qu’il se croit obligé désormais de traiter en ennemie… Il a donné des ordres pour que la religion, les mœurs et les propriétés des Maltais fussent respectées. »
Le 10, dès trois heures du matin, et tandis que Brueys se chargeait d’imposer silence aux batteries du port, nos troupes, conduites par les généraux Desaix, Belliard, Reynier, Vaubois, Lannes et le chef de brigade Marmont, descendirent non seulement dans l’île de Malte et sur quatre points à la fois, mais encore sur les deux petites îles voisines de Gozzo et de Cumino. Cette opération s’effectua sans aucune difficulté, car les Maltais fuyaient sur tous les points. À dix heures toute la campagne et tous les forts du côté de la mer étaient en notre pouvoir. À midi, la ville de Lavalette était cernée de tous côtés. À une heure, on débarqua douze bouches à feu et tout ce qui était nécessaire pour l’établissement de trois plates-formes de mortiers ; en même temps plusieurs frégates prenaient position devant le port. Le général en chef, accompagné du général du génie Caffarelli, alla reconnaître l’emplacement des batteries, qu’il fit tracer sous ses yeux. En ce moment les assiégés tentèrent une sortie, qui fut vigoureusement repoussée par le détachement que commandait Marmont. Cet officier enleva de sa propre main un drapeau, et fut fait à cette occasion général de brigade. Pendant le reste de la journée, le canon des remparts ne cessa de tirer sur les troupes françaises, mais sans leur causer la moindre perte.
Vers le soir, plusieurs chevaliers appartenant à la langue française déclarèrent au grand maître que leur devoir comme chevaliers était de faire la guerre aux Turcs, et non à leurs compatriotes ; qu’en conséquence ils ne voulaient plus se battre. On en jeta quelques-uns en prison ; mais le trouble était dans toutes les têtes. Il régnait une telle confusion dans la place, et les alertes y étaient si continuelles, que les patrouilles se fusillaient les unes les autres. À minuit, les principaux habitants se rendirent au palais du grand maître et l’invitèrent à capituler. Ferdinand de Hompech, qui avait peu d’énergie, et qui songeait à sauver ses intérêts du naufrage, tira de prison trois des chevaliers français qu’il y avait jetés, et le lendemain 11 les envoya négocier avec Bonaparte. De son côté, Bonaparte désigna pour régler les préliminaires de la capitulation son aide de camp Junot ; le sieur Poussielgue, autrefois secrétaire d’ambassade à Gênes, et qui déjà avait été envoyé en mission secrète à Malte sur la fin de l’année précédente ; enfin un des savants attachés à la commission d’Égypte, M. Dolomieu, ancien commandeur de l’ordre avant la révolution.
Le traité, bientôt conclu, portait en substance que les chevaliers remettraient le 12 la ville et le port de Malte à l’armée française, et qu’ils renonceraient en faveur de la France à leurs droits de propriété et de souveraineté sur l’île de Malte et ses dépendances. En retour, Bonaparte promettait au grand maître de demander pour lui au congrès de Rastadt une principauté équivalente en Allemagne. À défaut, il lui assurait une rente viagère de trois cent mille francs, et devait, dans tous les cas, lui faire payer six cent mille francs comptants pour indemnité de son mobilier. Bonaparte garantissait en outre sept cents francs de pension à chaque chevalier de la langue française reçu avant 1792, mille francs aux sexagénaires, et engageait sa médiation pour que les chevaliers des autres langues fussent mis, dans leur patrie respective, en jouissance des biens de l’ordre. Telles furent les conditions principales au moyen desquelles la France devint maîtresse du premier port de la Méditerranée et l’un des mieux fortifiés qui soient au monde. Trente mille fusils, douze cents pièces de canon, douze mille barils de poudre, des vivres pour six mois, un vaisseau, deux frégates, trois galères et d’autres petits bâtiments de guerre, enfin le trésor de l’église Saint-Jean, estimé trois millions de francs : tels étaient les avantages matériels de cette importante acquisition.
Le 12, aussitôt après la signature de la convention, le drapeau tricolore remplaça sur l’île toutes les bannières de l’ordre, et Bonaparte fit son entrée à Lavalette à la tête des troupes débarquées.
Du 13 au 19, Bonaparte s’occupa d’organiser sa conquête. Il nomma Vaubois gouverneur militaire de Malte, de Gozzo et de Cumino, avec quatre mille hommes de garnison ; il donna à Regnault de Saint-Jean-d’Angély la qualité d’agent du gouvernement français, et confia l’administration centrale à une commission de cinq membres. Il prit tous les arrêtés nécessaires à l’établissement du régime municipal dans les trois îles ; il organisa la garde nationale, créa plusieurs compagnies de canonniers pour la défense des côtes, et publia une foule de règlements pour l’administration et la police intérieure de l’île.
Tandis qu’il préludait ainsi au rôle de souverain et de législateur, qu’il devait bientôt continuer en Égypte et qu’il prévoyait peut-être déjà ne pas tarder à remplir en France et en Europe, je profitai de la tranquillité qui régnait dans l’île, grâce à la présence de l’armée française, pour la parcourir d’un bout à l’autre, et chercher, selon mon habitude, ce qu’elle pouvait offrir de curieux.
En me rappelant que Malte était l’île d’Ogygie habitée autrefois par Calypso, je pensais à cette description enchanteresse qu’en a tracée Fénelon dans les premières pages de son Télémaque. Quoique bien persuadé d’avance que ce délicieux tableau n’avait jamais existé que dans l’imagination poétique de l’illustre écrivain, j’éprouvai un vif désappointement en me trouvant en présence de la réalité. L’aspect général de Malte est d’une monotonie désespérante. Le sol forme un plan incliné, avec des escarpements de quatre cents mètres d’élévation au-dessus des flots dans la partie sud et sud-est, et une plage au niveau de la mer dans la partie opposée. Des montagnes arides, aux flancs desquelles pendent de rares arbrisseaux, sont séparées par des vallées poudreuses, où la végétation serait nulle sans l’opiniâtre travail des habitants, qui sont allés chercher en Sicile de la terre végétale pour en couvrir leurs rochers, et leur faire produire des récoltes insuffisantes encore pour les nourrir.
Ce qu’il y a de plus curieux à Malte, c’est sa capitale, la cité Lavalette. Cette ville est située sur deux magnifiques ports, l’un appelé le Grand-Port, l’autre le Marsat-Musciet. Pour se faire une idée de l’étendue du premier, toute notre armée navale avec son convoi, formant en tout près de cinq cents voiles, s’y était rangée sans confusion, et n’en occupait guère que le tiers. Le mouillage est si sûr et si facile, que nos plus gros vaisseaux étaient amarrés à portée de pistolet des quais.
La ville se compose de cinq grands quartiers, qui forment autant de villes distinctes, séparées l’une de l’autre, et formant cependant un ensemble qu’on peut embrasser d’un regard : ce sont la cité Lavalette proprement dite, la Florianne, la cité la Sangle, la Burmola et le Bourg ou cité Victorieuse ; on peut y ajouter le bourg Vilhena, groupe de maisons assez considérable.
Ces différentes parties de la ville sont baignées ou séparées entre elles par la Marsa-Musciet, qui enferme l’île du lazaret, et par les cinq ports secondaires entre lesquels se subdivise le Grand-Port. Ce que la ville offre de plus remarquable, ce sont ses formidables fortifications, dont les plus importants ouvrages sont le château Saint-Elme le fort Ricazoli, le château Saint-Ange, le fort Manoël, le fort Sainte-Marguerite et les fortifications de Florianne. Les rues, formant pour la plupart une pente rapide et disposées en escaliers, présentent un aspect étrange et original. Elles sont bordées de maisons construites en belles pierres blanches, terminées en terrasses, et ornées de balcons couverts. Les principaux édifices sont le palais des Grands-Maîtres





























