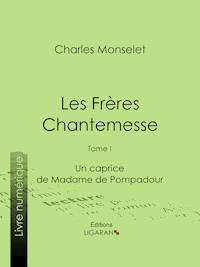
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "— Le chevalier de Chantemesse, s'il vous plaît ? Cette question était adressée par un fort bel homme en habit brodé, à l'aubergiste du Soleil-d'Or, barrière des Sergents. Assis dans le première pièce de son bureau, auprès d'une table sur laquelle il y avait un registre et une bouteille de ratafia, l'aubergiste répondit sans retourner la tête : M. le chevalier de Chantemesse a perdu tous ses droits à mon estime, depuis qu'il est parti de mon hôtel."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– Le chevalier de Chantemesse, s’il vous plaît ?
Cette question était adressée par un fort bel homme en habit brodé, à l’aubergiste du Soleil-d’Or, barrière des Sergents.
Assis dans la première pièce de son bureau, auprès d’une table sur laquelle il y avait un registre et une bouteille de ratafia, l’aubergiste répondit sans retourner la tête :
– M. le chevalier de Chantemesse a perdu tous ses droits à mon estime, depuis qu’il est parti de mon hôtel en me devant cinq mois de logement.
L’homme à l’habit brodé fronça légèrement le sourcil.
– Je suis le comte de Chantemesse, dit-il sur un ton parfait de modération, le frère aîné du chevalier, et je suis prêt à acquitter la dette de mon frère.
– C’est différent, reprit l’aubergiste en ôtant son bonnet ; j’ai précisément sous la main le mémoire de M. le chevalier.
Le comte de Chantemesse jeta à peine les yeux sur le papier que lui tendait le propriétaire du Soleil-d’Or, et posant sur la table une bourse suffisamment dodue :
– Payez-vous, dit-il.
L’hôtelier obéit avec une vivacité où le ravissement le disputait à la surprise.
– À présent, continua le comte, vous allez m’indiquer le nouveau logis de mon frère.
– Diable ! murmura l’hôtelier en se grattant l’oreille ; cela n’est pas aussi aisé que vous semblez le croire. M. le chevalier a des habitudes de déplacement qui déroutent toutes les pistes ; et, même lorsqu’il demeurait ici, il n’était pas rare de le voir s’absenter pendant des semaines entières.
– Il faut cependant que je le trouve aujourd’hui même.
– Je ne puis, à mon grand regret, vous renseigner d’une façon positive ; cependant je vous conseille de vous informer au Gaillard-Bois ou au Cormier-Fleuri, qui sont, après la mienne, les deux hôtelleries les plus achalandées du quartier.
Le comte de Chantemesse se rendit à ces deux adresses. On ne l’y renseigna pas mieux qu’au Soleil-d’Or.
On l’envoya successivement à la Croix-de-Fer, rue Saint-Denis ; à l’Écu, rue Pierre-à-Poisson ; au Berceau, rue des Arcis ; au Treillis-Vert, rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel ; à la Corne, rue des Enfants-Rouges ; au Cygne-de-la-Croix, rue du Pas-de-la-Mule ; au Chapelet, derrière Saint-Eustache.
Partout le chevalier de Chantemesse était parti sans dire où il allait, adorable inconséquence ! Partout il avait laissé derrière lui, sans doute par mégarde, quelques dettes, dont l’ensemble prenait des proportions effrayantes pour la bourse du comte.
Celui-ci, après le dixième ou douzième hôtel, ne put s’empêcher de s’écrier en s’essuyant le front :
– Je dois avouer que monsieur mon frère a des allures bien singulières ! Il paraît que le changement est indispensable à son existence. J’aurai beau jeu à lui laver la tête dès que je l’aurai retrouvé…
En attendant, il ne le retrouvait pas, et la journée s’avançait.
Un espoir lui restait cependant : un des domestiques de l’hôtel du Chapelet, prêtant l’oreille à ses interrogations, l’avait pris à part et lui avait dit d’un air moitié riant, moitié sérieux :
– Il y a peut-être une personne auprès de qui l’on aurait des nouvelles de M. le chevalier… C’est la petite Toinon, la ravaudeuse du pont Saint-Michel.
Et le comte de Chantemesse, prompt à recueillir le moindre indice, se dirigea vers le pont Saint-Michel.
Au coin qui regarde la Cité, il s’arrêta devant une jolie fille assise dans un tonneau.
Coiffée d’une cornette, habillée d’un casaquin couleur citron, les yeux espiègles, le nez retroussé, Toinon cousait, en chantant une chanson du genre poissard :
Toinon s’interrompit en voyant un beau monsieur planté devant elle.
– Qu’est-ce qu’il y a pour votre service, monseigneur ? dit-elle avec son sourire le plus gai ; avez-vous besoin d’une reprise à l’un de vos bas ? Tendez votre jambe avant que le jour ne baisse tout à fait.
Elle enfilait déjà une aiguille, tout en fredonnant de sa voix fraîche :
– Mademoiselle, dit le comte, je n’ai point de trous à mes bas ; sans cela, je vous donnerais ma pratique, assurément. Je viens tout uniment m’informer auprès de vous d’une personne qui me touche de fort près.
– Et comment s’appelle cette personne ? dit Toinon étonnée.
– Le chevalier de Chantemesse.
– Hi ! hi ! hi ! fit tout à coup la jeune fille en fondant en larmes. Le chevalier… Ah ! le traître ! le perfide ! le monstre !
– Remettez-vous, mademoiselle.
– Hi ! hi ! continuait Toinon.
– Je ne savais pas que ce nom réveillerait en vous un tel chagrin.
– Excusez-moi, monsieur, mais on ne se commande pas ; c’est plus fort que la volonté. Le chevalier de Chantemesse est le plus grand affronteur de la terre, sauf votre respect. Tout cet été qui a été si beau, comme vous savez, il me répétait qu’il m’aimait, qu’il m’adorait ; il ne bougeait pas d’auprès de mon tonneau, que tout le monde en jasait d’ici au Pont-au-Change. Il m’apportait aussi des fleurs nouées avec des rubans ; et le soir, nous allions nous promener le long du port Saint-Paul, en manière d’amitié, comme qui dirait vous et moi. Ah ! comme il savait bien dégoiser de belles paroles dorées ! il n’y a pas de docteur ou de maître d’école pour vous entortiller aussi bien que cela. Et puis, un beau matin, bernique ! envolé le chevalier ! Va-t’en voir si Toinon reverdit dans sa cage ! N’est-ce pas, monsieur, que les jeunesses sont bien malheureuses d’avoir affaire à de pareils freluquets ?
– Est-ce que vous ne l’avez pas revu ? demanda le comte après avoir essuyé ce déluge de paroles.
– Si fait, monsieur, mais je n’en ai guère été plus avancée ; il a pris la chose en badinant, disant que les amours en plein vent se fanent plus vite que les autres… et qu’on lui avait fait des histoires sur mon compte par rapport à mon cousin La Chamade, le soldat aux gardes. Une vraie menterie, monsieur, je vous le jure !
– Allons, mon enfant, consolez-vous. À votre âge…
– Me consoler ! voilà qui est facile à dire ! Est-ce que vous avez un moyen de me consoler, vous, par hasard ?
Le comte fit, en souriant, un mouvement de tête négatif, et ajouta mentalement :
– Je veux bien payer les dettes d’argent de mon frère ; mais ses dettes de cœur, c’est autre chose.
– Vous voyez que vous ne pouvez rien pour moi, dit Toinon recommençant à sangloter.
– Je peux du moins parler au chevalier, qui est de mes parents.
– Au fait…
– Lui reprocher sa conduite, le faire convenir de ses torts envers vous.
– Oui… oui, dit la petite en essuyant ses yeux avec le coin de son tablier.
– Dites-moi seulement où je peux le voir.
– Il va presque tous les soirs rue de la Vieille-Monnaie, dans un endroit où l’on donne à jouer et à boire.
– Très bien.
– Car vous ne savez pas qu’il a tous les défauts, le parjure !
– Je commence à être édifié sur ce chapitre.
– Vous reconnaîtrez aisément la maison à sa lanterne.
– Adieu, Mlle Toinon. Je vais de ce pas rue de la Vieille-Monnaie.
– Dites-lui bien, je vous prie, que je suis outrée contre lui, que je me vengerai…
– Soyez tranquille.
– Que je lui arracherai les yeux à la première occasion !
– C’est convenu.
– Et que…
– Quoi encore ?
– Et que je l’aime plus que ma vie ! ! s’écria-t-elle comme suffoquée.
Le comte avait tourné le pont Saint-Michel, et il entendait encore les recommandations de la petite ravaudeuse.
La rue de la Vieille-Monnaie était comprise entre la tour Saint-Jacques-la-Boucherie et la place de Grève.
C’était une ruelle étroite, courte et laide. Il faisait nuit lorsque le comte s’y engagea.
Le tripot qui y était installé s’annonçait par une lueur rougeâtre.
Ces maisons de jeu, décorées du nom pompeux d’académies, étaient assez nombreuses à Paris en ce temps-là ; elles servaient de souricières au lieutenant de police.
Dès que le comte de Chantemesse eut poussé la porte de celle-ci, il se vit dans une grande pièce où plusieurs tables de jeu étaient dressées sous de larges lampes de fer-blanc. Autour de ces tables se tenaient des hommes et des femmes de toutes conditions, les uns assis, les autres debout. Des laquais circulaient en portant des liqueurs sur des plateaux.
En ce moment l’attention des joueurs était un peu distraite par un incident qui se passait dans le fond de la salle, auprès du comptoir orné de draperies où trônait la maîtresse du logis, la Gombaud.
Sept ou huit individus s’agitaient en poussant des cris et en proférant des menaces.
Tout à coup de ce groupe sortit un homme d’une mine assez commune, pâle, les vêtements déchirés, qui s’élança vers le comte en disant :
– Au secours ! à moi ! on veut m’assassiner !
Le comte empoigna cet homme, et, d’un rapide et puissant revers de bras, il le fit passer derrière lui.
Puis il s’avança vers le groupe aboyant.
– À bas la mouche ! criaient les furieux.
– La mouche, à mort !
– Ne le laissez pas échapper !
– Assommons-le !
– Assommons la mouche !
On sait que le terme de « mouche » servait à désigner les agents de la police dépourvus de caractère officiel.
Étourdi, sans être déconcerté par ces clameurs, le comte faisant face à tous :
– Allons donc ! leur dit-il, depuis quand est-ce qu’on assomme les gens comme cela ? Vous n’y pensez pas, mes maîtres !
– C’est un espion ! répétèrent-ils.
– C’est pire encore, ajouta l’un d’eux : je l’ai surpris, depuis plusieurs jours, remettant des lettres à la fille de la Gombaud… une enfant de seize ans. Et ce n’était pas pour son compte évidemment.
– C’est le messager de quelque grand seigneur libertin !
– Il faut l’empêcher d’exercer son honteux métier.
– Faisons un exemple.
– Oui ! oui !
Le comte sentit le danger, et n’eut que le temps de dire à l’individu tout tremblant derrière lui :
– Sauvez-vous !
Celui-ci ne fit qu’un bond vers la porte, au grand désappointement de ses adversaires, dont la colère s’exhala en vociférations nouvelles.
Quelques-uns voulurent se lancer à sa poursuite.
Mais le comte leur barra résolument le passage et porta à demi la main vers son épée. !
– Laissez-le aller, dit-il en haussant les épaules. Il est déjà bien loin… Et quand même vous réussiriez à le rattraper, vous risqueriez fort de vous faire un mauvais parti avec le guet.
Il y eut un moment d’indécision parmi la petite troupe ; les plus irrités s’entre-regardèrent et se parlèrent bas.
Personne ne connaissait le nouveau venu ; mais son costume annonçant un état au-dessus de l’aisance, et surtout son sang-froid extraordinaire, leur imposaient.
Ce pouvait être un agent supérieur ; dans ce cas ils n’avaient rien à gagner à se mettre en hostilité contre lui.
D’ailleurs, puisque leur proie venait de leur échapper, ils n’avaient plus de motif de continuer leur tapage.
Pour ces causes, et après deux minutes de délibération, ils se replièrent en bon ordre, non sans jeter des regards de rancune à l’intrus en habit brodé.
Resté maître du terrain, le comte de Chantemesse fit tranquillement plusieurs fois le tour des tables de jeu sans apercevoir son frère.
Une femme lui offrit à côté d’elle un siège qu’il refusa.
Un laquais lui offrit un verre de vin d’Alicante qu’il accepta.
Après quoi, n’ayant plus rien à voir ni à faire dans ce bouge, il sortit.
Il n’était pas au milieu de la rue qu’il s’aperçut qu’il était suivi par une ombre.
C’était l’homme dont il venait de sauver la vie.
– Ah ! monsieur, lui dit cet individu en s’approchant avec tous les signes d’une extrême humilité, quelle obligation ne vous ai-je pas !
– Tout autre en aurait fait autant à ma place, répondit le comte.
– Je ne crois pas, répliqua l’autre avec un accent singulier.
– N’importe, dit le comte en essayant de continuer sa marche, je suis aise de vous avoir rendu ce service.
– Aussi n’ai-je pas voulu m’éloigner avant de vous avoir exprimé toute ma gratitude.
– N’en parlons plus. Je vais de ce côté ; vous de cet autre, sans doute. Adieu.
Il était visible que le comte ne se souciait pas de prolonger l’entretien avec un homme qu’il venait d’entendre traiter d’espion.
Celui-ci devina cette répugnance, car il s’empressa d’ajouter :
– Je ne suis pas ce que vous croyez… et ce que je parais peut-être. Je n’appartiens pas à la police.
– Tant mieux pour vous.
– On est trop mal rétribué dans cet état… J’occupe à la cour un emploi… assez important… J’espère m’élever. J’ai des protecteurs… et surtout des protectrices. Je sais me rendre utile ; je me débarrasse, au besoin, de tous les sots préjugés. On m’apprécie à Versailles…
Le comte ne se sentait pas à l’aise en écoutant ces étranges paroles.
Cet homme lui donnait froid.
– Pourquoi me dites-vous cela, à moi ? lui demanda-t-il brusquement.
– Parce que je n’ai jamais rencontré personne qui fût capable de faire pour moi ce que vous avez fait ce soir.
Décidément le pauvre diable avait la bosse de la reconnaissance.
Mais le comte ne tenait qu’à se débarrasser de lui.
– Encore une fois, adieu ! dit-il.
– Au moins que je sache le nom de mon sauveur.
– À quoi bon ?
– Qui sait ?… ne me refusez pas.
– Soit ; je suis le comte de Chantemesse.
L’homme sembla chercher dans sa mémoire.
Le comte de Chantemesse, répéta-t-il.
– Je ne crois pas que vous me connaissiez, dit son interlocuteur avec un sourire méprisant.
– Non, mais je connais un chevalier de Chantemesse, un jeune et brillant compagnon, ardent au plaisir et brave comme vous.
– Mon frère, parbleu ! s’écria le comte, s’arrêtant court cette fois.
– Je vous en fais mon compliment.
– Par tous les saints ! si, comme vous le dites, vous croyez me devoir quelque reconnaissance, vous avez une belle occasion de vous acquitter à l’instant même.
– Comment cela ?
– En me fournissant l’occasion de rencontrer le chevalier après qui je cours depuis ce matin.
– Que ne le disiez-vous tout de suite ?
– En vérité !
– Depuis trois semaines, le chevalier de Chantemesse ne bouge pas des coulisses de l’Opéra.
– Quelque nouvelle liaison, murmura le comte.
– Assurément.
– Ce chevalier a le diable au corps ! Et nomme-t-on l’objet de ses vœux ?
– Oh ! ce n’est un mystère pour personne… Mlle Bénard, une délicieuse femme… vingt-quatre ans au plus.
– Une sauteuse ?
– Non, une chanteuse ; un premier sujet, s’il vous plaît.
– Y a-t-il spectacle ce soir à l’Opéra ?
– Oui ; on donne la deuxième représentation de la Mort d’Adonis, une pièce dont on vante beaucoup les machines.
– Et Mlle Bénard joue dans la Mort d’Adonis ?
– Je le crois bien ! elle y joue le rôle de Vénus, au grand plaisir des yeux et des oreilles.
– Alors vous pensez que le chevalier sera là ce soir ?
– Il n’aurait garde d’y manquer… La Bénard est serrée de près par une foule d’adorateurs, et le chevalier est trop au début de sa passion pour n’être pas horriblement jaloux.
– Très bien. À votre tour, soyez remercié, dit le comte en reprenant sa route.
– Un mot encore.
– Oh ! oh ! fit le comte d’un ton d’impatience ; dites vite, mon cher.
– Il se peut que tôt ou tard le hasard nous remette en présence l’un de l’autre…
– J’en doute, répondit le comte de Chantemesse.
– Ne répondez de rien. Nous nous mouvons dans le même monde… aux extrémités les plus opposées, j’en conviens, – ajouta-t-il en surprenant un mouvement du gentilhomme, – mais les évènements se jouent des distances et des situations. Il se peut que vous vous trouviez un jour dans une de ces circonstances difficiles ou délicates qu’aucune prudence humaine ne saurait prévoir…
– Finissons, je vous prie.
– Dans ce cas, si jamais vous avez besoin d’un dévouement… j’entends un dévouement caché, agissant dans l’ombre… mais absolu, constant, efficace… souvenez-vous de Lebel… c’est mon nom.
– Est-ce tout, M. Lebel ?
– C’est tout, M. le comte.
– Adieu donc, et bien décidément cette fois.
– M. le comte, à revoir.
Chacun tira de son côté.
– Hum ! se disait le comte de Chantemesse en marchant ; j’aurais peut-être aussi bien fait de laisser assommer ce Lebel, qui décidément me produit l’effet d’un drôle. Il y a des bonnes actions dont on est presque tenté de se repentir.
Vingt-cinq minutes après, le comte de Chantemesse mettait le pied sur le seuil de l’Opéra.
Bien que ce ne fût pas dans la salle que M. de Chantemesse comptât trouver son frère, il y entra cependant, pour l’acquit de sa conscience.
Le public était nombreux, paré, élégant, célèbre, de bonne humeur. On était en 1755, une date pleine de riants souvenirs, une période d’amabilité, de luxe, de plaisirs de toute espèce. La France se reposait de quelques guerres en manchettes de dentelles, entreprises à l’extérieur uniquement pour ne pas laisser s’éteindre la tradition des pompes militaires. Le Parlement revenait de Pontoise. Un peu de prestige et beaucoup d’habitude s’attachaient encore à la royauté, qui s’était reléguée elle-même derrière les charmilles de Versailles, et dont l’existence ne se révélait, de temps en temps, que par le bruit de quelques fanfares de chasse. On ne parlait presque plus politique. Les philosophes faisaient leur œuvre à petit bruit, fort décemment encore. La galanterie était la grande affaire de cette époque et de cette société, l’unique affaire de tous les jours et de tous les instants ; galanterie en haut, galanterie en bas, dans les salons de la noblesse, dans les petites maisons de la finance, – et à l’Opéra.
L’Opéra était le temple par excellence de cette galanterie ; c’était un lieu de rendez-vous préférable à tout autre : on s’y saluait de l’amphithéâtre à la galerie ; on y allait en visite de loge en loge.
Le comte de Chantemesse promena son regard dans la salle, – minutieuse et inutile inspection, – et il le reporta ensuite sur la scène, où l’on jouait la Mort d’Adonis.
Comme il était encore d’assez bonne heure, il s’assit et il écouta.
La Mort d’Adonis, aujourd’hui complètement tombée dans l’oubli, était un drame lyrique d’une monotonie insupportable. Sur un canevas poudreux de Jean-Baptiste Rousseau, un poète des bureaux de la Marine avait recousu quelques rimes nouvelles ; et un compositeur quelconque, du nom insignifiant de Raoux, avait étendu sur le tout cette sorte de mélopée entrecoupée de cris qui faisait le fond de la musique d’alors.
Le premier acte venait de commencer. Le décor représentait, comme dans tous les premiers actes, un « rivage, » avec un temple sur le côté. Dans ce temple, un autel.
À cet autel, sur lequel brûlait et tremblotait une petite flamme, des habitants d’Amathonte, car l’action se passait à Amathonte, – accouraient suspendre des guirlandes et mêler leurs accents d’allégresse à l’occasion de la prochaine arrivée de Vénus :
Et des attitudes ! Et des bras arrondis ! Et des houlettes agitées, des rubans envolés, des fleurs semées ! Puis encore des petits pas et des demi-pirouettes.
Les bergers partis, – comme partent les bergers, en sautant, le sourire aux lèvres et un baiser au bout des doigts, – une princesse se montrait, de blanc et de bleu vêtue ; elle congédiait du geste sa suivante à mi-chemin. C’était la princesse Cidipe, une longue, longue princesse. Elle se présentait lentement jusqu’au bord de la rampe, les yeux baissés, le sein soulevé.
Une bouche immense s’ouvrait :
Cela s’appelait : Confier aux échos son douloureux martyre… Les échos ne paraissaient point compatir aux souffrances de la longue princesse. Elle se retirait avec sa courte honte, lorsque Adonis apparaissant, un arc à la main, la ramenait devant le public et l’interrogeait avec affabilité ;
CIDIPE.
Hélas !
ADONIS.
CIDIPE.
ADONIS.
CIDIPE.
Ici le comte de Chantemesse se prit à bâiller.
Il espéra que l’entrée de Vénus l’égayerait un peu.
En effet, il y eut un cortège, une troupe de nymphes, des thyrses, des cymbales, des danses.
Mais cet intermède fut de courte durée.
Le comte de Chantemesse jugea qu’il n’y pourrait pas tenir, et il abandonna la place.
Son nom et son titre lui donnèrent accès dans les coulisses.
Il eut quelque peine d’abord à s’orienter au milieu de cette population de sylvains, de dryades, de rois, de régisseurs, de guerriers, de dieux, de gentilshommes de la chambre, de machinistes, de princesses et d’allumeurs qui s’agitaient derrière le rideau.
Tout ce monde, frivole avec conviction, allait, venait, se croisait, s’accostait, s’interpellait, riait, fredonnait.
Il se heurta d’abord au dieu Mars en personne, coiffé d’un casque gigantesque, vêtu d’une armure à soleil et d’une jaquette à écailles, chaussé de brodequins rouges, armé d’une lance. Ainsi fait, le dieu Mars s’apprêtait à répandre la terreur autour de lui.
Le comte se rangea pour laisser passer une troupe d’hommes et de femmes échevelées, habillées de robes rouges et noires, agitant des chaînes et des serpents. C’étaient la Jalousie, la Haine, le Désespoir, la Fureur, personnifiés par messieurs et mesdames du corps du ballet.
Le Dépit faillit l’éborgner avec sa torche.
– Excusez-moi, monsieur, lui dit le Soupçon qui lui avait effleuré le pied.
Un joli petit Soupçon de dix-huit ans, bien éveillé, bien alerte.
Ce n’était pas là ce que cherchait le comte de Chantemesse ; il avait des visées plus ambitieuses : il voulait approcher de Vénus.
Vénus, c’est-à-dire Mlle Bénard.
Il supposait avec raison que là où était Mlle Bénard devait se trouver le chevalier.
En conséquence, il évolua sans plus tarder vers la reine des Amours, qu’il reconnut bientôt à son diadème, à la magnificence de son costume, à la noblesse de son port, et, mieux que cela, à la cour nombreuse dont elle était environnée.
Imposante, sans rien perdre de sa grâce, elle recevait les hommages de sept ou huit personnages fort importants.
– Vous êtes à ravir ! lui disait M. de Beauchamp, receveur général des finances.
– Que de malheureux vous allez faire ce soir ! ajoutait M. Bertin, trésorier des parties casuelles.
– Sans compter ceux qui sont déjà faits, soupirait M. de Fondpertuis, intendant des menus.
– Ce n’est pas pour rien que vous avez emprunté sa ceinture à Cythérée, prononçait le jeune marquis de Ponteuil.
– Les flèches de Cupidon ont été forgées au feu de vos beaux yeux, bégayait le vieux conseiller du Troussay.
Mlle Bénard s’enivrait de cet encens, et souriait à ces propos « fils de la flatterie. »
Alors M. de Beauchamp de reprendre :
– Serez-vous donc toujours inexorable ?
Et M. Bertin de continuer :
– N’abjurerez-vous jamais votre rigueur ?
M. de Fondpertuis à son tour :
– Ne vous lasserez-vous point de me faire sentir le poids de vos fers ?
Puis le jeune marquis de Ponteuil :
– Prenez en pitié ma disgrâce !
Enfin le vieux conseiller du Troussay :
– Je me consume à vos pieds !
Ce qui faisait beaucoup rire Mlle Bénard, et ce qui déterminait chez le chœur des financiers une explosion d’apostrophes :
– Cruelle !
– Barbare !
– Inhumaine !
Le comte de Chantemesse s’étonna de ne point voir son frère dans ce cercle.
La première personne auprès de laquelle il s’en enquit lui répondit :
– Je le quitte à l’instant.
Une autre lui dit :
– Il vient de prendre par le corridor qui mène au foyer.
Une troisième :
– Tenez, le voici de l’autre côté du théâtre… Ne le voyez-vous pas ?
– Non… Jouons-nous donc à cache-cache ?
Le comte allait traverser la scène, mais il en fut empêché par le deuxième acte qui commençait.
Le dieu Mars, brandissant sa lance, chantait en arpentant les planches :
Vainement son confident essayait de le calmer par ces conseils à l’eau de rose :
Le dieu Mars l’envoyait promener, et méditait déjà une vengeance sans péril pour lui-même et qui devait étonner l’univers.
Cette vengeance, indigne du dieu de la guerre, consistait, comme on sait, à lâcher un énorme sanglier à travers les jambes de son rival.
Et comme il se félicitait de cette brutale inspiration ! Comme sa rage s’exhalait dans ce couplet :
Tout cela touchait médiocrement le comte de Chantemesse, qui attendait lui-même avec une certaine impatience que le monstre furieux eût décousu Adonis, pour continuer ses explorations fraternelles.
La malignité que semblait mettre le hasard à l’écarter de son but lui paraissait inconcevable.
Vingt fois, en effet, depuis une heure, il aurait dû se trouver nez à nez avec son frère.
Et cette rencontre tant désirée allait être encore retardée de quelques instants par une idée qui venait d’éclore tout à coup dans l’amoureux cerveau du chevalier.
Voici quelle était cette idée.
À un certain moment, Mlle Bénard devait descendre sur la terre, – pour chanter l’oraison funèbre d’Adonis, – dans un char attelé de deux colombes.
Ne pouvant lui parler à son aise sur la terre, le chevalier imagina d’aller lui parler dans les cieux.
– Veux-tu gagner vingt pistoles ? demanda-t-il à un aide-machiniste.
– Que faut-il faire pour cela ?
– Me conduire dans l’Olympe… je veux dire dans les combles du théâtre.
– Hum ! je risque ma place…
– Je te garderai le secret.
– Venez donc, mais évitez qu’on vous voie.
Le chevalier suivit de loin son conducteur et s’engouffra derrière lui dans un escalier masqué qui le conduisit à une espèce de plate-forme.
– Par ici, dit le machiniste.
– Quel casse-cou !
– Faites doucement…
L’endroit où ils étaient parvenus était obstrué de cordages, de toiles, de planchers suspendus, et donnait assez l’idée de la mâture d’un navire.
Il y régnait une demi-obscurité – ou une demi-lueur qui enveloppait tous les objets d’une teinte étrange.
Le chevalier marchait avec précaution.
Il pénétra dans la région où s’assemblent les nuages et où se forment les éclairs. De ses mains profanes il s’amusa même à toucher la foudre de Jupiter et à la faire gronder, ce qui fut accueilli en bas par un religieux frémissement.
– Attendez ici, lui dit son conducteur en le poussant dans un retranchement qui servait à serrer les accessoires.
Le chevalier obéit sans répliquer.
À côté de lui, il apercevait dans un pêle-mêle bizarre le dragon volant de Médée, le cerf de Diane, le paon de Junon, le trident de Neptune, les ailes de Mercure, la baguette de Circé, le bouclier de Pallas, toute la garde-robe de la mythologie.
Un léger bruit détourna bientôt son attention.
Une forme féminine passa rapidement près de lui et se dirigea vers un plancher supérieur, par une échelle étroite et roide.
C’était Mlle Bénard qui allait prendre possession de son char.
Cette machine, d’une assez grande dimension, assez compliquée et solidement amarrée, offrait, malgré sa légèreté apparente, toutes les garanties de sécurité.
Mlle Bénard y était à peine installée que le chevalier la rejoignit par le même chemin et vint se précipiter à ses genoux.
Un cri d’effroi échappa à la chanteuse.
– Êtes-vous fou ! s’écria-t-elle ; que venez-vous faire ici ?
– Vous le voyez, mon adorable : vous entretenir de mon amour, ce qu’il m’est impossible de faire dans votre loge, ni au foyer, ni sur le théâtre.
– Mais vous perdez la tête !
– Ce n’est pas de ce soir, ô divinité ! Et à qui la faute ?
Il lui prenait les mains, les genoux.
– Allez-vous-en, disait-elle, je vous en conjure…
– Encore un instant !
– L’acte va commencer… les musiciens préludent déjà… Vous me faites frémir !
– Que ne puis-je couler mes jours ainsi… toujours… comme le plus humble de vos esclaves.
– Ciel ! le rideau se lève.
En effet, le rideau se levait majestueusement pour le troisième acte.
Mais la Bénard et le chevalier étaient trop haut perchés pour être vus.
Plongés dans l’ombre, ils avaient sous les pieds un gouffre de lumière.
– Chevalier, hâtez-vous de fuir ! dit Mlle Bénard effarée.
– J’ai encore le temps… Vous ne descendez qu’à la scène troisième.
– C’est une extravagance sans nom… Je meurs de frayeur…
– Laissez-moi une minute à mon illusion : je crois être le rival des dieux en voyant s’agiter au-dessous de moi les faibles mortels.
– Ne vous penchez pas au moins ! Vous vous tueriez !
– Soyez tranquille, ma belle, un seul de vos regards dispense l’immortalité.
– Eh bien ! si vous m’aimez, dit-elle suppliante, allez-vous-en !
Cet appel à son amour décida le chevalier.
– Adieu donc ! s’écria-t-il, mais jurez-moi, promettez-moi…
– Oui ! oui !… Adieu !
Il voulut une dernière fois baiser ses mains divines.
– Partez vite ! répéta-t-elle avec angoisse.
Il était trop tard.
Sur un coup de sifflet lancé par le machiniste en chef, le char s’abaissait, mollement balancé, comme au gré des deux colombes qui semblaient le guider.
Mlle Bénard n’eut que le temps de jeter la moitié de son long manteau sur le chevalier, qui dut reprendre vivement son humble posture abandonnée à regret.
Il saisit au hasard quelques bouts de nuage pour s’en envelopper. Une douzaine d’étoiles rangées à propos sur son visage lui formèrent une sorte de masque.
Ainsi accoutré, le chevalier échappait aux regards de la salle ; mais en revanche, il demeurait complètement exposé aux regards des coulisses.
Ce fut une exclamation mal réprimée, suivie d’un rire général, à l’aspect de ce groupe inattendu et volant.
Pour surcroît de contrariété, le char ne devait pas toucher le sol ; il s’arrêtait entre ciel et terre, et c’était à cette demi-hauteur que Vénus chantait un air sur le trépas d’Adonis.
Il y avait de quoi mourir de confusion.
Les soupirants de la Bénard ne dissimulaient pas leur fureur contre le chevalier ; mais ils ne pouvaient s’empêcher d’envier son heureuse et scandaleuse témérité.
M. de Beauchamp lui montrait le poing.
M. Bertin écumait.
M. de Fondpertuis parlait du For-l’Évêque.
Le jeune marquis de Ponteuil caressait l’espoir d’un bon duel.
Le vieux conseiller du Troussay demeurait muet de stupeur.
Pendant ce temps, l’opéra allait toujours son train. Sur le devant de la scène, un peuple prosterné saluait le char apparu au bruit des instruments.
Vénus, – ou plutôt Mlle Bénard, – comprit qu’il n’y avait pas à hésiter. Il y allait de sa réputation, de son emploi. Elle se leva, et, debout dans son char, elle attaqua le morceau suivant :
– Pas un mouvement ! dit-elle bas au chevalier, qui, mal à son aise, risquait de déranger les draperies.
Elle continua :
LE CHŒUR.
VÉNUS.
– Cet efflanqué d’Adonis, le plus beau des mortels ! murmura le chevalier, essayant de se retourner.
– Restez donc tranquille…
Le chœur reprenait :
VÉNUS.
– Qu’importe si je vous reste, ma toute belle ! Le chevalier est à Vénus pour la vie !
LE CHŒUR.
VÉNUS ET LE CHŒUR.
Surexcitée par l’extraordinaire de sa situation, Mlle Bénard donna à ces pauvres vers une telle expression de pathétique que toute la salle éclata en applaudissements.
– Vous n’avez jamais si bien chanté ! dit le chevalier en partageant l’enthousiasme unanime.
Mais il était temps cependant que la machine remontât dans les airs, car le public commençait à remarquer le désordre et l’hilarité qui régnaient parmi les spectateurs du théâtre.
Ce fut à ce moment que le comte de Chantemesse, attiré par les rires, aperçut le chevalier s’envolant dans les frises.
– Eh ! mon frère ! s’écria-t-il en tendant les bras vers lui.
Une chaise de poste galope sur la route de Picardie.
Elle emporte à travers la nuit le comte et le chevalier de Chantemesse.
Peut-être le moment est-il venu de placer ici les portraits des deux frères.
Ils sont de la même taille ; l’aîné, le comte Hector de Chantemesse, a quarante-deux ans, et il les porte bellement. Tout est correct en lui, réfléchi, posé : physionomie, démarche, geste. Mais il y a de la bonté sous la gravité de son regard, comme sous la fermeté de sa parole. On respire à son contact un air de saine province.
Autre chose est du chevalier. Celui-ci n’a que vingt-sept ans. De la jeunesse il possède tout ce qui justifie les caprices amoureux dont nous l’avons vu être l’objet : la distinction, les manières ouvertes, la souplesse de mouvements, la jambe fine, la séduction involontaire. Mais ces dons naturels sont gâtés par une fatigue physique et morale : les lignes délicates de son visage sont altérées par l’orgie ; il est pâle d’une veille continuelle. L’éclat des yeux s’efface sous la rougeur des paupières ; le sourire erre entre les lèvres décolorées. La main, restée admirable sous les marbrures de la fièvre, est agitée d’un léger tremblement. Son costume même, quoique marqué au coin de l’élégance, porte les traces de la négligence ; la poudre de ses cheveux est éparse ; son jabot est froissé ; ses dentelles sont d’un prix rare, mais d’une blancheur équivoque. Tel est le chevalier Pierre de Chantemesse.
Le comte le regarde en silence, à la dérobée, et aucune de ces nuances n’échappe à son regard observateur et triste.
C’est le chevalier qui rompt le premier ce silence, et qui s’exprime sur le ton d’enjouement qui lui est habituel.
– Savez-vous, mon frère, dit-il, que vous venez de commettre un véritable enlèvement, un rapt dans toutes les règles, à l’égard de ma personne ? J’en suis encore tout étourdi. Vous m’apparaissez, vous m’entraînez, vous me forcez de monter en chaise de poste… et fouette cocher ! Tout cela sans presque me dire un mot, sans me permettre de vous sauter au cou. D’honneur, je crois être le jouet d’un songe. Que n’attendiez-vous au moins jusqu’à demain matin ?
– Demain matin vous ne seriez pas parti.
– C’est peut-être vrai.
– Et pourtant le séjour de Paris vous eût été dangereux au réveil. J’ai entendu murmurer autour de moi les mots de prison, de For-l’Évêque, à propos de votre escapade à l’Opéra. Vous avez des ennemis, Pierre.
– Des rivaux tout au plus.
– Ils auraient pu vous nuire, croyez-moi, et nous avons bien fait de mettre quelques longueurs de poste entre eux et vous.
– C’est égal, mon frère, dit le chevalier, il a fallu toute votre autorité pour me décider à vous suivre.
– Vous avez agi sagement… une fois dans votre vie.
– Oh ! ne faites pas trop honneur à ma sagesse de ce bon mouvement. J’ai cédé surtout au piquant et à l’imprévu de l’aventure. Tout m’intriguait et tout m’intrigue encore là-dedans : votre air de mystère, votre refus de me donner des explications…
– Je ne vous ai pas refusé des explications, Pierre, je les ai remises à plus tard.
– Alors, maintenant vous allez pouvoir me dire…
– Tout ce que vous voudrez.
– D’abord où allons-nous ?
– À Arras.
– À Arras ! s’écria le chevalier avec un soubresaut, dans notre famille ?…
– Dans notre famille. N’êtes-vous pas content, Pierre, de revoir notre père, ce vieillard, qui demande tous les jours de vos nouvelles ?
– Mon pauvre père ! murmura le chevalier avec attendrissement ; quel souvenir et quelle figure vous évoquez là ! Voilà six ans que je n’ai contemplé ses traits nobles et doux, ses traits que vous me rappelez si bien, Hector ! Voilà six ans que je n’ai serré ses mains vénérables ! Comment oserai-je supporter sa vue après six ans d’ingratitude ?
– Le cœur de notre père a des trésors d’indulgence.
– Ah ! je vous en veux de me ramener à Arras ! Je vous en veux de me remettre en face de mon remords ! J’aurais dû me méfier davantage de vos projets.
– Paris vous est donc bien cher ? dit le comte.
– Paris ! répéta le chevalier.
Et il tomba dans une rêverie, d’où il sortit pour s’écrier avec un accent singulier :
– Eh bien ! oui, j’aime Paris, et je sens bien que je suis rivé à lui pour la vie. Le pli est pris désormais. Paris m’a volé à la province, comme ces bohémiens qui font métier de voler les enfants. À présent, le bohémien Paris est devenu mon second père, et insensiblement j’ai fini par l’aimer, autrement que le premier, cela va sans dire, d’un amour composé moitié d’habitude et moitié de rancune. Paris est bon diable après tout, Paris est sans façon ; il vous prend comme vous êtes, sans exiger de reconnaissance. Vive Paris ! vive sa joie facile, sa gaieté toujours prête, son bonheur argent comptant !
– Donc, vous êtes heureux ?
– Le sais-je ? Je n’ai pas le temps de le savoir, à peine ai-je le temps de vivre.
Le comte reprit, comme en faisant un effort sur lui-même :
– Pardonnez à mes interrogatoires, Pierre. Il ne m’a guère été possible, dans l’unique journée que j’ai passée à votre recherche, de me rendre compte de votre existence à Paris. Pourtant, d’après ce que j’en ai entrevu, j’ai deviné plus de soucis, plus de tracas que vous ne voulez en avouer. Je ne vous parle pas de vos dettes, je n’ai aucune observation à vous adresser à ce sujet. La pension que vous fait notre père est insuffisante, je le comprends. Vous avez demandé des ressources au jeu… Ne vous en défendez pas, – ajouta-t-il en surprenant un mouvement du chevalier.
– Je ne me défends de rien, répondit vivement celui-ci ; mon vice marche la tête haute. Mais ne dites pas de mal du jeu, Hector ; c’est la reine des passions, et celle qui les résume toutes. Le jeu, c’est la guerre, c’est le commerce, avec leurs résultats immédiats, grâce à une carte relevée ou à un dé assis.
– Le jeu, c’est le désordre, dit brusquement le comte.
Le front du chevalier se rembrunit ; puis, secouant la tête, il essaya de sourire.
– J’attendais ce mot, dit-il avec amertume. C’est vrai, le désordre s’est peu à peu emparé de moi ; peu à peu j’ai abandonné les solides et honnêtes sociétés que je devais à notre nom et aux relations paternelles. Que voulez-vous ? Je n’ai pas consenti à m’ennuyer vertueusement. La curiosité m’a pris : j’ai regardé au-dessous de moi, et du salon je suis glissé au cabaret. Mais, dans ma chute, l’Opéra s’est trouvé comme intermédiaire. Paris et l’Opéra, tout est là pour moi maintenant.
– Et n’avez-vous jamais rêvé d’une autre existence ?
Le chevalier le regarda fixement, et lui répondit :
– Si… quelquefois.
– Eh bien ! dit le comte avec émotion, il en est temps encore, peut-être…
– Non ; je ne suis apte à rien, je n’ai rien appris. S’il existait une armée véritable, je serais depuis longtemps dans ses rangs ; mais traîner dans les antichambres un uniforme inutile, à quoi bon ? Un emploi à la cour ? une charge ? Le moindre travail m’est odieux. Aussi je vous admire, vous, mon frère, je vous laisse soutenir seul l’honneur de notre blason, ce dont vous vous acquittez à merveille. Au milieu de cette époque épuisée, corrompue, vous avez su embrasser la seule carrière digne, non seulement d’un gentilhomme, mais d’un homme : l’agriculture.
– Nous sommes plusieurs comme cela, dit le comte en souriant.
– Vous me montrerez vos fermes, vos prairies ; vous n’initierez à vos travaux, vous me présenterez vos paysans.
– De grand cœur, Pierre !
– Ce n’est pas tout, dit le chevalier.
– Quoi donc ?
– Il me reste encore une chose à vous demander, celle par laquelle j’aurais dû commencer.
– Demandez, dit le comte.
– Qu’est-ce que nous allons faire à Arras ?
– C’est juste. Vous venez à mes noces, Pierre.
Le chevalier fit un geste d’étonnement.
– Vous vous mariez, Hector ?
– Oui. Cela vous surprend ?
– Non, dit le chevalier après un moment de réflexion ; seulement, je n’étais pas préparé à cette nouvelle, excusez-moi. J’avouerai même que je ne croyais pas vos idées tournées vers le mariage. Il me souvient de vous avoir entendu exprimer jadis des opinions entièrement opposées à votre détermination d’aujourd’hui.
– On se dément avec l’âge.
– Vous avez toujours été et vous serez toujours un homme raisonnable. Votre dessein a sans doute été longuement et profondément mûri. Et puis vous vous devez à notre famille, qui ne doit pas s’éteindre.
– Vous l’avez dit, Pierre, reprit vivement le comte ; tel est là le principal, le seul mobile de mon mariage.
– Le seul ? répéta le chevalier avec un accent d’inquiétude.
– Tout vous sera expliqué en temps et lieu, mon frère ; quoi qu’il en soit, un acte de ma vie aussi important ne pouvait s’accomplir sans votre présence. Voilà pourquoi je suis allé vous arracher à Paris et à ses pompes.
– Que votre volonté soit faite ! dit le chevalier en riant.
On approchait d’Arras, et déjà le chevalier Pierre de Chantemesse, qui avait tant paru regretter Paris, manifestait un contentement qui croissait de relais en relais.
Il se penchait sans cesse à la portière pour reconnaître la campagne et désigner les villages.
Lorsqu’on entra dans le faubourg d’Amiens, il s’écria, les yeux humides :
– Ô ma bonne vieille ville d’Arras ! Chère ville qui me semblait si grande, lorsque je n’en connaissais pas d’autres ! Univers de mon enfance, je te revois donc !
Et ses souvenirs lui revenaient en foule ; il nommait les rues, les places.
– Tout à l’heure, annonçait-il à son frère, nous allons passer devant le couvent des Ursulines… Au détour, c’est l’auberge du Cœur-Joyeux… Sa belle enseigne en fer existe-t-elle toujours ?… Et le chapelier du coin ? Et la petite boutique de mercerie des demoiselles Minard ?… Voici le marché où j’accompagnais la servante Catherine… Mais, au fait, ma vieille Catherine ?…
– Vous allez la retrouver, répondit le comte : vous retrouverez tout le monde, grâce à Dieu.
Le chevalier aperçut sur la grande place les innombrables pigeons dont l’espèce n’est pas encore perdue aujourd’hui. Il vit passer, fièrement campées sur des ânes les femmes d’Achicourt, avec leur écorcheu sur le dos et leur collinette sur la tête.
Son cœur ployait sous une joie enfantine.
Il salua successivement l’hôtel de M. de la Vacquerie, l’hôtel de Canettemont, l’hôtel d’Aoust.
Enfin, rue des Portes-Cochères, la voiture s’arrêta.
On était arrivé à l’hôtel de Chantemesse.
– Laissez-moi monter seul l’escalier… l’escalier à rampe de bois, dit le chevalier en s’élançant hors de la chaise de poste.
En haut de l’escalier il trouva son père qui l’attendait les bras ouverts.
C’était un de ces beaux vieillards aux longs cheveux blancs, comme Greuze en a mis dans ses toiles et Diderot dans ses drames.
– J’avais promis de vous le ramener, mon père, dit le comte, suivant de près.
Après les effusions qu’on devine, le chevalier voulut visiter l’hôtel du haut en bas. À chaque pièce, à chaque meuble, c’était une exclamation. Il s’arrêtait devant un portrait, ou un trumeau, ou un dessus de porte qui lui rappelait un monde d’impressions. Il s’asseyait dans les bergères à sujets ; – ou bien il ouvrait précipitamment un secrétaire et respirait à pleines narines les odeurs intimes et pénétrantes qu’il y retrouvait.
Derrière lui se tenait la vieille servante Catherine, qui le regardait en riant et en pleurant.
Il coucha dans sa chambre de jeune homme, dont la fenêtre donnait sur la rue Saint-Jean-en-Ronville ; mais, malgré de bons draps gros et frais, il ne put trouver le sommeil que fort tard. Il repassa son enfance, sa jeunesse, tous ces petits évènements qui occupent une si grande place dans la vie.
Ce soir-là, Paris fut un peu oublié.
Le lendemain, de bonne heure, il fut réveillé par le comte.
– Comment avez-vous dormi, Pierre ?
– Mal, bien mal, répondit le chevalier en souriant ; je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.
– Est-ce possible ?
– Mais je ne m’en plains pas, au contraire.
– Vous savez que c’est aujourd’hui dimanche, reprit le comte.
– Non ; mais puisque vous me le dites… C’est donc cela, ce bruit de cloches que j’ai entendu…
– Habillez-vous, Pierre, nous allons sortir ensemble.
– Où me conduisez-vous ?
– À l’église Saint-Nicolas-sur-les-Fossés-et-du-Vivier.
– Chaque dimanche, en effet, j’allais y entendre la messe.
À son tour le comte sourit.
– Ce n’est pas uniquement pour vous faire entendre la messe que je vous emmène à Saint-Nicolas ; c’est aussi pour vous faire rencontrer avec les parents de la jeune fille que je dois épouser, et avec cette jeune fille elle-même.
– Je serai bientôt prêt, dit le chevalier.
– Mlle de Crespy appartient à une des plus anciennes et des plus honorables familles de l’Artois. Les Crespy ont été toujours liés d’amitié avec les Chantemesse.
– Les Crespy ! s’écria Pierre, mais je me souviens d’eux parfaitement. Tout enfant, ma mère me conduisait dans leur hôtel, après vêpres ; on se rangeait cérémonieusement en demi-cercle dans un grand salon tout rouge, et l’on causait à voix discrète en laissant venir la nuit, sans se presser d’allumer les lampes. Dieu ! que je m’y suis ennuyé !
– Ce sont d’excellentes gens, d’une dévotion un peu outrée seulement.
– Les Crespy ! je crois encore les voir… un homme sec, long, ridé, enfermé dans un habit raide comme une tapisserie.
– Le grand-père… Hugues-Perrin-Guillaume de Crespy.
– Puis une dame, un peu sourde, continua le chevalier.
– La mère.
– Et encore une autre vieille dame, très aimable, très gaie, mais ne remuant pas, celle-là, toujours dans un grand fauteuil.
– La tante Sidonie, dit le comte ; une femme d’esprit, en effet, ayant voyagé, plus mondaine. Peste ! quelle mémoire, mon frère ! Et dans cette famille Crespy, ne voyez-vous pas d’autres visages encore ?
– Attendez donc, reprit le chevalier ; une petite fille de huit ou neuf ans, avec laquelle je jouais…
– Mlle Marthe de Crespy.
– Marthe, c’est cela… une charmante enfant, toute vive, toute mignonne, toute…
– Ma future femme, dit le comte.
– Quoi ! cette petite fille ?…
– Cette petite fille est devenue une jeune fille. Marthe a dix-sept ans aujourd’hui. Vous la verrez tout à l’heure : c’est une personne d’une beauté remarquable et de l’esprit le mieux cultivé. Je serais étonné qu’elle ne vous plût pas.
– Elle me plaisait déjà beaucoup autrefois.
En descendant l’escalier, ils se croisèrent avec la vieille Catherine.





























