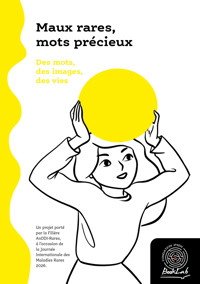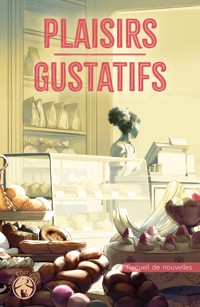Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Aire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
La poésie de la vie selon vingt-sept auteurs romands : leurs moments de bonheur offerts aux lecteurs
L’état du monde a toujours été chaotique, mais la période que nous vivons en ce moment l’est particulièrement. Le racisme et l’antisémitisme se développent comme de la mauvaise herbe, le fanatisme religieux sévit sous toutes les latitudes, les virus fleurissent sous les Tropiques, l’Afghanistan est devenu un vaste champ d’expériences militaires, les Occidentaux organisent des guerres intestines au Moyen-Orient afin d’exploiter au mieux les champs pétrolifères, les nantis sont toujours aussi tristes de devoir payer des impôts, l’eau et le pain font défaut sur une bonne partie de la planète.
Que nous reste-t-il ? L’amour, l’amitié, la beauté, le vin et la culture sous toutes ses formes. Nous avons pensé que le moment était propice pour se remémorer quelques instants de bonheur, raison pour laquelle nous avons demandé à une trentaine d’auteurs d’évoquer les heures étoilées de leur vie. La plume est souvent porteuse d’espérance. Rappelons-nous cette phrase célèbre du poète cubain José Marti :
Les livres renferment les plaies ouvertes par les hommes.
Des pages étoilées pour se remplir les yeux et le cœur
EXTRAIT
Chers citoyens, chères citoyennes d’ici et d’ailleurs, chers amis rassemblés, chers amateurs de fanfares, de flonflons, de pétards et de vin bon, chers amis des artifices, chers musiciens et musiciennes, chers danseurs, chères danseuses, bonsoir et merci d’être là.
J’aime les fêtes, j’aime le Nouvel An et les anniversaires. J’aime compter les années en additionnant les carnavals, les défilés et les cortèges.
Combien de lunes ? Combien d’années ? A chaque printemps, une de plus. Chaque automne nous rapproche de la fin et pourtant on se réjouit des vendanges, du comptoir de Martigny, de la brisolée.
On fait la fête.
LES AUTEURS
Tous vivent, écrivent et travaillent dans le Pays romand.
Ont contribué :
Gabriel Bender, Xochitl Borel, Alain Campiotti, Yasmine Char, Françoise Choquard, Laurence Deonna, Marie-Claire Dewarrat, Philippe Dubath, Isabelle Falconnier, Jon Ferguson, Bastien Fournier, Valérie Gilliard, Blaise Hofmann, Jean-Dominique Humbert, Brigitte Kuthy-Salvi, Yves Laplace, Alphonse Layaz, Manon Leresche, Annik Mahaim, Béatrice Monnard, Michel Moret, Baptiste Naito, Cédric Pignat, Gilbert Pingeon, Jacques Roman, Marie-Jeanne Urech, Laurence Verrey.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
La sauce du livre
« Placée en tête d’un livre, la préface en fait connaître les vues, le plan, prévient des objections, répond à des critiques ou encore donne une idée sur le message que veu[lent] transmettre le[s] auteur[s] à travers ce livre (exemple : la pauvreté de la société, l’inégalité, la prostitution, la violence, etc.) », m’apprend Wikipedia, Encyclopædia Internetalis (1’562’879 articles en français à l’heure de la rédaction de ces lignes, excusez du peu).
Soit. Il s’agit donc apparemment de résumer ici vingt-sept points de vue aussi disparates que personnels. De parer à d’hypothétiques, mais assez improbables critiques – à part quelques cris isolés venant de misanthropes dépressifs, j’ai sincèrement du mal à imaginer un soulèvement populaire contre un livre sur le bonheur. Et de dévoiler le message que sous-tend tout cet ouvrage et qui, heureusement, n’a rien à voir avec la pauvreté de la société, l’inégalité, la prostitution, la violence, etc.
Remplir ces critères de préfacier : entreprise laborieuse, tant pour les quelques lecteurs consciencieux qui liront ces lignes que pour leur auteure. Entreprise redondante surtout, le titre exprimant déjà formidablement bien à lui tout seul ce dont il sera question au cours des pages qui suivront. Vingt-sept auteurs du cru, de tous âges et de tous sexes confondus, vont, majoritairement, relater ce qui pour eux s’apparente à des moments ou des sentiments de félicité. Sans vouloir couper court à tout suspens, il est ainsi de ma prérogative de révéler que le terme « étoile » de l’intitulé a plus généralement été saisi comme un astre brillant et chaleureux que comme un corps céleste mort à la lumière fantôme.
Ces remarques préambulaires mises à part, de quoi est-il donc question dans cette (trop longue) introduction, se demande alors le consciencieux, mais impatient lecteur. Question parfaitement légitime. Devrais-je moi aussi faire l’apologie des lectures qui ont changé ma vie, comme une partie de nos auteurs ? Transmettre un moment doré de l’enfance, dont je viens tout juste de sortir ? Rejoindre le clan de ceux qui ont choisi de faire part d’une anecdote, qui n’en est plus une tant elle les a marqués, au point de devenir une pierre cardinale de leur Histoire ?
Raconter les moments ou les sensations les plus heureux n’est pas chose aisée. Le choix paraît si vaste, comment élire et introniser quelques spécimens en particulier ? L’expérience semble si intime, comment la transmettre sans la tronquer, sans l’affaiblir, sans l’affadir en oubliant un ou plusieurs grains qui en ont fait tout le sel ? Le monde, en dépit de ses travers guerroyants et parfois cruels, est si envoûtant, comment le réduire à la simple dimension de l’écriture ? Comment dire les odeurs, les bruits, les battements du cœur, les souffles sur la peau ? Comment répondre à la consigne : « Nous aimerions que vous participiez à cet ouvrage collectif, Les Heures étoilées, en nous donnant un texte de 3 à 8 pages de 1’500 signes chacune, dans lequel vous nous narrez avec la fantaisie qui vous caractérise vos moments de bonheur vécus au cours de votre existence » ?
Vingt-sept plumes ont su surmonter leur indécision. Ont bravé leur appréhension. Ont trouvé le moyen, chacune à sa façon, de transmettre l’intransmissible et de s’ouvrir au lecteur, en espérant lui apporter, dans cette période troublée où les extrémismes sont rois, un peu d’évasion et de répit. Et même un peu de baume pour panser les plaies, qui sait ?
Mais si le pouvoir de la lecture est sans fin, que dire de la force de l’écriture ? Nul ne doute aujourd’hui qu’elle est capable de soulever des montagnes, de faire tomber des murs, de construire des ponts, de venir à bout des esprits les plus étroitement barricadés, et, puissant remède, de guérir les plaies de l’âme – et même du corps, s’écrieront ses défenseurs les plus assidus.
Et quoi qu’on en dise, quoi que l’on prétende, aussi fort que l’on paraisse, tout le monde a un jour besoin de s’asseoir, de respirer, de prendre le temps de récupérer et de lécher ses plaies. Et à mon sens, l’amour, les souvenirs les plus brillants et un bon livre doté d’une couverture rassurante sont les meilleurs remèdes.
C’est dans cette optique altruiste et curative que nous avons laissé quelques pages blanches à la fin de cet ouvrage, afin que le lecteur, impatient, consciencieux, mais avant tout infiniment humain, puisse lui aussi se saisir de ses astres brillants et de son meilleur stylo pour mettre par écrit ce qu’il considère comme « les heures étoilées de sa vie ». Il n’y a bien sûr aucune obligation à utiliser cela comme un quelconque palliatif, et la personne la mieux portante et la plus heureuse est également invitée à tenter l’exercice.
« Les Italiens appellent la préface la salsa del libro : la sauce du livre. Marville dit que, si elle est bien assaisonnée, elle sert à donner de l’appétit, et qu’elle dispose à dévorer l’ouvrage », continue de m’enseigner la plus vaste source de connaissances accessibles à portée de clics (1’563’064 articles à l’heure actuelle). J’espère avoir rempli mon devoir et laisse à présent le consciencieux, impatient, infiniment humain et aimable lecteur se plonger avec délice dans les magnifiques heures étoilées que nous ont offertes Gabriel Bender, Xochitl Borel, Alain Campiotti, Yasmine Char, Françoise Choquard, Laurence Deonna, Marie-Claire Dewarrat, Philippe Dubath, Isabelle Falconnier, Jon Ferguson, Bastien Fournier, Valérie Gilliard, Blaise Hofmann, Jean-Dominique Humbert, Brigitte Kuthy Salvi, Yves Laplace, Alphonse Layaz, Manon Leresche, Annik Mahaim, Béatrice Monnard, Michel Moret, Baptiste Naito, Cédric Pignat, Gilbert Pingeon, Jacques Roman, Marie-Jeanne Urech et Laurence Verrey.
Merci à vous, merci à eux.
Gaëlle Kovaliv
GABRIEL BENDER
Né à Fully en 1962, Gabriel Bender a tout d’abord opté pour une carrière de travailleur social, avant de reprendre ses études et de se réorienter vers la sociologie. Professeur à la Haute Ecole du Valais, il a publié plusieurs travaux en micro-histoire et en sociologie du quotidien aux éditions Monographic dans les années 2000 et de nombreux articles scientifiques ou pas. Touché par le virus de la littérature, il a également publiés deux ouvrages de fiction, Couleurs de Sarvient, Editions Monographic, 2003 et Bretelles d’arc-en-ciel, Editions de l’Aire, 2003. En marge de son activité auctoriale et professionnelle, il a en outre été élu au Grand Conseil valaisan entre 1996 et 2004, sous les couleurs du parti socialiste.
Premier Août La Tsoumaz / orage
Voici un discours que je devais prononcer à La Tsoumaz, en Valais. Je suis monté sur le podium, j’ai déplié le papier, j’ai ajusté le micro, je me suis raclé la gorge. A cet instant précis un éclair déchire le ciel tandis qu’un tonnerre atomique le fait exploser. Panne de courant immédiate, déluge. Fuite.
Annulée la fête, à l’eau le discours. Si le ciel m’avait laissé parler j’aurais dit à peu près ceci :
Chers citoyens, chères citoyennes d’ici et d’ailleurs, chers amis rassemblés, chers amateurs defanfares, de flonflons, de pétards et de vin bon, chers amis des artifices, chers musiciens et musiciennes, chers danseurs, chères danseuses, bonsoir et merci d’être là.
J’aime les fêtes, j’aime le Nouvel An et les anniversaires.
J’aime compter les années en additionnant les carnavals, les défilés et les cortèges.
Combien de lunes ? Combien d’années ?
A chaque printemps, une de plus. Chaque automne nous rapproche de la fin et pourtant on se réjouit des vendanges, du comptoir de Martigny, de la brisolée.
On fait la fête.
Les fêtes sont rassurantes, elles reviennent, année après année, elles changent peu, dans l’idéal, elles ne changent pas. Les mêmes gestes, les mêmes rites, le même décor ou presque… Les mêmes mots, aussi…
Il n’y a pas de fête sans parole. Il n’y a pas de mariage sans discours. Peu importe que personne n’écoute, il faut que quelqu’un parle, pour dire le temps qui passe, dire qu’on est vivant, et qu’on est content d’être là : ensemble.
Oui, les fêtes sont là pour rassurer : « Tu vieillis, mais rien ne change. Tout est sous contrôle et tout continuera pareil après ton départ. »
En automne, on prend une année de plus. On devrait être terrorisé de filer ainsi à la mort, mais non, on le fête, avec des copains et des copines, au comptoir de Martigny.
J’aime les fêtes qui se fêtent le premier.
Premier janvier, on se dit bonne année, bonne santé, tous mes vœux, bon dzon, bon an, le premier mars, les Neuchâtelois se souviennent qu’ils ont été révolutionnaires, le premier mai on fête les travailleurs, les 3 huit, réclamés depuis un siècle et qui vont bien finir par arriver…, j’aimerais une fête des fainéants le premier avril: grasse matinée, une sieste et puis dodo mais la journée est réservée aux rigolos qui se moquent des grincheux, les dindons de la farce, le premier novembre on pense aux morts et un peu aux vivants.
Et le premier août, on fête nationale.
J’aime le Premier août et j’aime mon pays. Ah, mon pays… La Suisse. On l’a tellement vantée, tellement critiquée. On a tellement affiché ses symboles. Vaches et montagnes, sur des boîtes de chocolat, l’arbalète sur les montres, Guillaume Tell ou un paysan qui lui ressemble sur les pièces de monnaie. On en a fait une marque de fabrique, un logo, un truc pour vendre des trucs. On lui a tressé des couronnes glorieuses. On a chanté ses monts indépendants. On a dit la virginité des Alpes. Mais on l’a tellement salie, aussi. Maquereaux. Encensée, critiquée, raturée, ravalée, polie, égratignée, repolie. On a raconté des demi-vérités aux enfants, des demi-mensonges aux vieillards, des balivernes aux touristes.
On a mélangé la vérité à la fiction, la fiction à la vérité. On a dit ceci, puis cela, et plus tard le contraire, et le lendemain bien pire… On a tellement parlé qu’à la fin, on ne sait rien de rien, on ne sait rien du tout.
On oublie tout. C’est tout.
Je suis à chaque fois ému quand je lis, sur la façade d’un grand magasin genevois du quartier de Saint Gervais, cette phrase de Rousseau : «Mon père, en m’embrassant, fut saisi d’un tressaillement que je crois sentir et partager encore. Jean-Jacques, me disait-il, aime ton pays. » Facile à dire mais pas facile à aimer, lorsqu’on ne sait plus ce qu’il en est. J’ai parfois l’impression que la Suisse est une coquille de noix sur une mer hostile, ballottée, secouée, filant à la dérive, et parfois au contraire, je la devine comme un roc inébranlable, une balise dans la nuit. Des jours, ce pays, ce tout petit pays minuscule me paraît une prison, d’autres fois un refuge. Parfois la Suisse m’angoisse, d’autres jours, elle me console.
Cette année, j’ai voulu en savoir un peu plus. J’ai voulu retourner un peu au cœur. J’ai pris mes deux enfants, le grand garçon qui est bien parti pour devenir un homme et la petite, si vivante et si drôle. Je les ai pris les deux et un billet de train. Et je leur ai dit, on va aller voir la Suisse de près, voir à quoi ça ressemble. Faisons le tour du sujet, une fois pour toutes.
Je voulais approcher le cœur du pays par la frontière, par les bordures, car la marge éclaire le centre. Toujours et partout. Lugano, Rorschach, Bâle, La Chaux-de-Fonds, Genève.
Départ de Martigny ; premier arrêt Brigue.
Brigue, ce n’est pas bien loin, mais c’est déjà si exotique qu’on remercie Stockalper d’avoir mis des oignons à la mode turque sur son château. Brigue, c’est déjà un peu Istanbul. En tout cas, c’est sur le chemin… Aux Centovalli, le train grinçait et s’essoufflait, il se tortillait entre des villages qui font le bonheur des peintres. De là, le soir au soleil couchant, on a une vue splendide sur les Weissmies. Et je voudrais qu’on m’explique la joie enfantine de dire en italien que les montagnes qui brillent au loin sont en Valais… Les Weismies, c’est chez nous, le Fendant c’est chez nous, Federer c’est chez nous, Sepp Blatter aussi et l’avion solaire et le reste, l’hospice avec les chiens, la Croix-Rouge, la croix blanche, Nestlé, UBS… Tout ça, c’est chez moi. Tout ça, c’est à moi. Enfin un peu, quand même.
Le lendemain, à Locarno, j’ai vu des ouvriers aligner les chaises sur la Piazza Grande pour le festival du film : des chaises noires, des chaises jaunes comme le pelage du léopard. Ça grouillait de monde à Locarno. Normal, c’est l’été… A l’heure de l’apéro, on a laissé les pédalos du lac Majeur pour rejoindre Bellinzone. De là, on a sauté dans l’interCity Chiasso-Bâle. Au wagon-restaurant, on a commandé du gaspacho, une assiette valaisanne et un bon verre de Dôle du Valais. A l’heure du café, on avait dépassé le Gothard et à peine le temps de siffler une grappa du Tessin, on était à Zurich. Pas à la Paradelplatz du Monopoly, ni à la love parade des technophiles. Zürich Hauptbahnhof : gare centrale. On a acheté pour deux francs trente de bonbons et de chocolat au kiosque et nous avons pris le premier convoi pour Konstanz, ville frontière. Allemagne, terminus.
Je résume : le lac Majeur, le lac des Quatre-Cantons, le lac de Zurich, le lac de Constance. Quel pays de pédalos ! Je résume une seconde fois. A 10 heures, nous étions en Italie à admirer les ex-voto de la basilique de Re, à 11 heures, nous mangions des glaces à Locarno, à 15 heures nous étions parmi les bobos zurichois avec iPod, iPhone, iBook et en bandoulière un sac Freitag. Et entre les deux, nous avions vu entre les nuages – parce qu’il pleuvait – nous avions vu, éclairée d’une lumière céleste, la prairie du Grütli qui brillait comme une apparition de la Sainte Vierge.
Je résume une troisième et dernière fois. En une petite demi-journée, tu traverses le pays de part en part… Départ de Chiasso à huit heures moins douze, arrivée à Bâle à 11h53, quatre heures et une minute plus tard. Et pas une de plus. C’est vrai que ce n’est pas bien grand, chez moi. Mais oh, comme c’est joli… aurait dit le Petit Prince.
Le lendemain, de Constance à Schaffhouse, j’ai vu le Rhin se prélasser, bucolique, sur la frontière, puis tout à coup, commesi on l’avait énervé, il plonge dans un bruit étourdissant. Sur le chemin qui conduit aux chutes, j’avais remarqué une plaque de bronze posée par la ville de Neuhausen, pour remercier Alusuisse de ses bienfaits. J’ai vu aussi le sigleSIGsur un bâtiment, derrière les chutes d’eau : Sig-Neuhausen. C’est là que se fabriquent des armes de guerre, dont les célèbres fusils d’assautSIG. Est-ce possible qu’on puisse, d’un regard, embrasser un symbole du tourisme helvétique et la plus grande contradiction d’un Etat neutre, la fabrique d’armes ? Je suis allé sur le site internet de Neuhausen, et j’ai pu vérifier que si, et depuis 140 ans ! Et cela personne ne me l’avait dit. Jamais. Là, j’avais la clé de voûte. La chute de mon discours se trouvait aux chutes du Rhin.
J’avais l’intro sur les fêtes qui marquent la vie en faisant oublier que tout va à la mort, même les nations. J’avais développé ensuite l’idée qu’il faut aimer son pays, quoi qu’il en coûte. J’ai poursuivi sur le fait que la Suisse est si ripolinée et critiquée et enviée et compliquée, que personne ne sait plus ce qu’il en est. J’ai glissé une petite pointe contre les têtes de turcs haut-valaisannes. J’ai dit les banquiers, les trains à l’heure, les lacs, les montagnes, le Grütli baigné d’une lueur irréelle. J’ai une allusion au tourisme, aux ventes d’armes, au chocolat, à l’économie de casino, à UBS.
Je retournais ravi à Schaffhouse : mission accomplie. C’est au moment précis où le bus me ramenait à la gare que je me suis aperçu que j’avais laissé mon portemonnaie aux chutes du Rhin. Mon portemonnaie de Suisse, avec les papiers suisses, les billets de trains CFF, les francs suisses, les cartes en plastique de bon Suisse, abonnement demi-tarif, carte Raiffeisen, carte Manor, Migros, Migrol, Denner, Coop, abonnement annuelà la Tzoumaz, aux bains d’Ovronnaz et de Saillon, carte permanente du comptoir de Martigny. Carte pour retirer de l’essence, pour retirer du lait, des livres, du fromage, carte d’identité, carte de vote, permis de conduire, permis de boire au-delà de la limite, permis de fumer au volant… Carte de donneur de sang, de donneur d’organes, de donneur de leçons, carte de professeur. Bref, j’avais tout perdu. J’étais nu comme au premier jour. Pas d’argent, pas de Suisses. J’étais nu, sans nom, sans argent, comme un requérant d’asile. J’ai hurlé comme un nouveau-né. J’étouffais … J’ai tout fait pour qu’on me remarque et une dame vint et me tira d’embarras. Elle était jolie comme une Egyptienne et douce comme une Italienne. Elle avait dans les yeux quelque chose de l’Espagne. Elle a enlevé l’aspirateur sur la banquette de sa voiture et l’a mis dans le coffre. Elle m’a conduit à un poste de police… Et là, un policier m’a dit de courir à la chute… Alors j’ai couru à travers les bois, je suis passé devant les bâtiments de SIG, devant la plaque en l’honneur d’Alusuisse, j’ai doublé soixante Japonais et autant d’Indiens. Je suis arrivé au petit snack où passent mille touristes à la minute, des rouges, des jaunes, des bleus et même des verts mentholés qui viennent d’une autre planète et qui explosent s’ils boivent du coca-cola. Là, sur le lieu du crime, il y avait une petite dame vietnamienne dans un costume d’Heidi. Elle m’a reconnu et elle était toute contente de m’annoncer que mon portemonnaie attendait à la caisse. Qu’elle l’avait trouvé par terre.
Alors je me suis dit c’est définitivement cela la Suisse : une histoire compliquée, des touristes et des banquiers, des montagnes et des lacs, des rivières qui se mettent parfois en colère, des sombres trafics et des chocolats délicieux, un comptoir à Martigny et des bains à Saillon.
La Suisse, c’est le pays où les trains partent à l’heure, où les serveuses vietnamiennes sourient, où les femmes de ménage équatoriennes vous invitent dans leur voiture et vous conduisent à la police. Alors qu’elles-mêmes sont sanspapiers. Un pays où on vous rend vos documents avec un sourire en suisse-allemand et des yeux bridés.
Voilà pourquoi, je l’aime ce pays de traditions et de contradictions. Et voilà pourquoi, j’ai l’envie de chanter avec vous, vive la Suisse, vive le jour de l’an, le premier avril, le premier mai, le premier joint, la première cuite.
– Le premier août ?
– Ah, bon.
Le même soir, à Martigny, Pascal Couchepin a prononcé son discours. Au sec.
XOCHITL BOREL
Xochitl Borel est née en 1987. Elle grandit au Nicaragua, fait le tour du monde en famille à l’âge de treize ans, puis continue à voyager aux quatre coins du globe, poussée par le vent et l’inspiration de l’instant. Musicienne, danseuse, passionnée, diplômée en sciences politiques, idéaliste et anciennement tenancière de L’Ange boiteux, un café culturel, Xochitl est également écrivaine. Son premier ouvrage, L’Alphabet des anges, publié à l’Aire en 2014, nous raconte avec finesse et poésie l’histoire d’Aneth, une petite fille borgne qui n’aurait pas dû naître, et qui, malgré une cécité galopante, apprend à voir le monde aux êtres qui l’entourent.
Pays de peau
Elle a enlevé doucement ses chaussures, de vieilles petites bottines en cuir avec un léger talon. Elle est sortie sur la pointe des pieds et à l’air libre, elle a respiré.
A l’intérieur, ils en parlent encore ; c’est du grand bonheur dont il est question, du plus grand même, ont-ils dit.
Quelqu’un a dit : Mon plus grand bonheur a été de garder les vaches dans ce pré de 1978. Jamais plus depuis, un champ n’a été aussi vert.
Un autre a dit : Mon plus grand bonheur a été cette femme qui a mis ses lèvres sur mes pieds. Jamais plus depuis, ceux-ci n’ont su la quitter.
Un autre a dit : Mon plus grand bonheur a été ce poignard lancinant qui a déchiré mes rêves de sang. Jamais plus depuis la réalité n’est revenue.
Elle a essayé de montrer de l’intérêt. Leur visage était honnête, et leur envie sincère. Elle s’est concentrée sur les regards, ces paysages et ces horizons de vie. Quand est venu son tour, elle a dit : « mon plus grand bonheur n’a pas d’heure précise » et s’est excusée. Certains ont trouvé sa réponse légère, peut-être trop vite esquissée. Somme toute, les gens réunis avaient surtout le souci de dire, bien avant celui d’écouter. Un seul parmi les conviés fut vraiment mécontent : quand il en vint à la traiter de sotte, elle ne répondit rien ; mais en sortant de la grande salle des fêtes, elle lui sourit et puis c’est tout.
Là-bas, dedans, ils le débattent et le soupèsent encore, le bonheur. Montre en main, heures en tête, ils le calculent. Quelle équation en tireront-ils ? Quelles lois universelles, quels théorèmes possibles ? Elle, elle n’a jamais su soupeser le poids de ces choses. Elle a aimé les mathématiques, justement parce qu’elles lui ont appris qu’on ne peut compter que sur ses dix doigts, et que le reste n’est qu’un dialogue avec l’infini où n’interfère plus la parole pour donner souffle au nombril. Depuis son enfance, elle est fascinée par les nombrils, tous les nombrils du monde, le sien mais surtout celui des autres, ce centre étrange et de quoi, une cicatrice première, un bout de peau depuis lequel tout part, tout vient, tout devient ; on peut y tourner sans fin sans en saisir ni le bout, ni l’entrée, ni l’extrémité, juste cette saveur de peau et de baisers, juste les frôlements, et l’envie folle d’y parvenir : au mystère.
Le nombril. Un pays de peau plus vaste que toute autre terre. Quand elle touche un nombril, elle a non seulement l’impression de caresser l’amour, mais surtout, elle sent comme l’autre lui est proche, malgré la distance, malgré la séparation des corps et des continents, et elle sent qu’elle ne peut être totalement une étrangère, qu’elle appartient à cela, à cette blessure de vie, la même pour tous. Son seul passeport : le nombril. La marque d’une humanité commune. Avec cet accord de principe, elle peut alors savourer le vertige, la profondeur des ventres, où s’esquisse l’origine, rejoindre l’infini. Et faire l’amour sans besoin d’en parler.
De fait, elle ne sait rien du bonheur. Rien. Que le vivre. Elle ne sait même pas s’en poser la question. Elle peut passer des heures à réfléchir à d’où vient le rire, sa lumière, les nuages. A tester le poids de la gravité. A comprendre où va l’écume une fois blanchie la roche d’un éclat. A ceux de la salle des fêtes, elle avait pensé leur parler de tout ceci, mais là-bas, ses mots s’étaient faits indociles, il lui avait été impossible de les affiner pour expliquer son point de vue. Tant pis si elle les a déçus, mais sur le moment, elle n’avait plus rien dans la tête si ce n’est ce cadran et l’heure qui s’étirait loin des étoiles.
Elle est dehors à présent, sous ses pieds nus, il y a la terre ferme, c’est de l’herbe mouillée de lune. Partout ailleurs, autour, au-dessus, à droite, à gauche d’elle, il y a tout le spectacle de la nuit qui s’en va. Celui de l’aube et du chant des mésanges. Il y a tous les thèmes des variations de la lumière dans la goutte de rosée. Dehors, il y a la joie et sa dissidence, il y a Le Chant du monde.
Dedans, quelqu’un a dit : «Mon plus grand bonheur, c’est quand je me suis baigné dans une mer épousée de soleil, jamais plus depuis une femme ne m’a effrayé. » Et il explique que le chant de la mer se compose de douze temps (vent ; mouvement de terre ; rire de l’être aimé à côté de soi ; bruissement du sable ; son propre souffle ; son propre cœur ; une musique oubliée qui revient; vagues ; ressac ; mouettes ; bateau du pêcheur ; baiser de l’éternité) ; elle l’écoute, elle le trouve beau dans sa tentative osée de déchiffrer le mystère.
Un autre a pris la parole, elle n’écoute plus déjà. Elle est tournée vers l’est à présent. Le soleil se lève, de quelle couleur sera son nombril ? Elle rit et murmure, « ma joie, principe premier de ma voix », mais est-ce elle qui a parlé et qui continue « joie, sens de la qualité. Les carrefours qui se croisent. Contrastes, pluriels, plus que duels. L’essentielle tendresse. Le caprice nécessaire. L’incomplète incompréhension. Le concret des vies humaines. La foule : rivière de chair, d’os, de rêves, de sang. Matière, toute la matière y compris l’immatérielle. La dérive des continents qui sépare et réunit les amants. Simplicité de sa main, de ma main. La Caresse. L’absolu qui s’absout même de sa soif d’absolu. Le compromis des nuits noires, le déséquilibre des pleines lunes. Etre présent. Y répondre. De la musique avant toute chose. »
La voix s’enroule autour des arbres, frappe les montagnes. En écho, elle entend : « Anarchie, mon amour. La vie, avant tout autre bonheur. »
Elle a failli retourner dans la salle pour leur faire plaisir. Elle ne voulait pas les froisser, et finalement, ils étaient sincères, même si elle n’arrivait pas à prendre au sérieux leur désir de compter les heures étoilées. Elle a fait un pas, un pas nu, pour revenir vers eux.
Indocile sang. Désobéissance. Transparence. Humilité, comme force évidente de l’homme.
Avouer ne pas savoir, à part cette blessure d’origine et l’inconnu qui va avec.
L’aveu de la vie.
Elle effleure son nombril.
Là-bas, un autre a dit :
Mon plus grand bonheur, c’est ce jour où j’ai reçu mon passeport pour l’Afrique.
Mon plus grand bonheur, c’est de ne jamais avoir fait de liste ni de contrat de mariage.
Mon plus grand bonheur, c’est le creux du vent que comble son souffle après l’amour.
Mon plus grand bonheur,
elle a murmuré,
C’est celui à vivre.
ALAIN CAMPIOTTI
Alain Campiotti est né en il y a une septantaine d’années, à la Vallée de Joux. Journaliste de formation, il a travaillé pour les principaux journaux romands et a notamment été rédacteur en chef du Nouveau Quotidien avant de participer à la création du journal Le Temps, en 1998. Voyageur au long cours, il a couvert l’actualité du monde entier de la Chine aux Etats-Unis. En 2013, il publie Fontaine blanche aux Editions de l’Aire, un livre à quatre mains, puisque Myriam Meuwly signe l’un des deux textes qui le composent, rédigé avant son décès. Chacun de son côté, ils ont raconté l’histoire du couple qu’ils formaient, entre fusion, fuite et destruction, sans savoir, sans pouvoir savoir que l’autre écrivait aussi. Son prochain ouvrage, La Rue longue, est attendu pour 2015.
Layla
Proust insistait. « Allons à Sarajevo ! » J’avais alors l’âme si près du pavé que j’ai fini par accepter. Mathieu, c’était son nom, Mathieu Proust. Un de ces freelances français, à la recherche d’un emploi stable, qui courent les zones de guerre pour forcer la porte des rédactions. Sorti de la ville assiégée avec un avion de l’ONU, il ne pouvait y retourner par les airs car la liaison avait été suspendue, et il espérait emmener avec lui de l’essence – autrement dit : de l’or là-bas.
Ma raison à moi, à part l’âme, c’était un besoin de clarté. La tuerie en Yougoslavie durait depuis cinq ans, et je vivais dans le malheur intime mon désaccord avec la doxa sur la guerre. Je n’arrivais pas à avaler la description dominante et manichéenne qui en était faite : le mal (les Serbes) persécutant le bien (les autres). La réalité me semblait un peu plus compliquée, et ce simplisme confortable servait surtout, à mes yeux, à dissimuler, devant ce déchirement sanglant, la responsabilité des Européens qui l’avaient toléré, et même aggravé par leurs propres divisions. Ce n’était pas facile à dire ou à écrire au milieu des passions à vif. Toute nuance était prise pour une insulte, lancée de loin, aux assiégés de Sarajevo.
Je parlais de mon trouble à Mathieu, au téléphone. Alors, quand il m’a dit qu’on pouvait, malgré le siège, pénétrer dans la ville par une petite route de terre descendant du Mont Igman jusqu’à l’aéroport tenu par les casques bleus, j’ai emprunté au journal la Ford à ventre bas, et nous sommes partis.
Proust savait qu’au-delà de Split il n’y aurait plus de station d’essence : nous avons rempli à une pompe de grandes bassines en plastique achetées au bazar. Après Mostar, la voiture sautait sur les nids de poule dans les tunnels en vidant la benzine dans le coffre. Avec cette puanteur dans le nez, je pensais : une bombe ambulante.
Mathieu a finalement jeté sa cigarette par la fenêtre, et pour la descente d’Igman il a pris le volant. La route zigzagante, m’avait-il informé, était dans le viseur de deux batteries antiaériennes serbes, et nous dévalions follement la pente dans un nuage de poussière en faisant gicler les cailloux dans tous les sens.
La nuit tombait quand nous sommes arrivés au centre de Sarajevo. Pas d’électricité. Il fallait tâtonner dans le noir. Nous avons siphonné de l’essence pour nourrir la Ford. Mathieu a pris les bassines et le reste, et je ne l’ai plus revu.
J’ai trouvé une chambre dans une villa derrière la Bibliothèque nationale incendiée. La propriétaire cachait avec des étoffes les blessures que des éclats d’obus avaient infligées à son salon. Son mari était dans l’armée bosniaque. Je dormais dans le lit du fils, étudiant en Allemagne.
Un vacarme épouvantable m’a réveillé le premier matin, avant le jour. Un duel d’artillerie. Les canons qui répliquaient aux tirs venant des collines étaient à côté de la maison. Les murs tremblaient. Ce fut mon seul bombardement. Des combats continuaient pour le contrôle de la colline de Debelo Brdo, sur le flanc sud de la ville, puis la prise en otage de dizaines de casques bleus français par les Serbes a ouvert une parenthèse, comme si la guerre retenait son souffle.