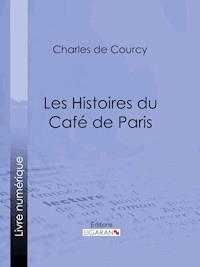
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Hier soir on dansait, place Vendôme, chez la princesse d'Ol-Neff, cette Russe à la face espagnole, qui semble avoir rapport des bords de la Néva un coeur gelé. Il y avait là une cohue d'uniformes, de dentelles et d'habits noirs. Vous connaissez l'étendue immense du salon de la princesse, que le critique Raoul désigne sous le nom de Champ-de-Mars – rouge et or."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091915
©Ligaran 2015
À
M. CHARLES HARTLEY
Mon bien cher et bien excellent ami,
Si quelque chose peut diminuer, à mes yeux, l’insuffisance du présent volume, c’est la joie que j’éprouve à vous le dédier. – Une goutte d’eau qui tombe ne laisse d’abord aucune trace sur le sable, mais si cette goutte d’eau se trouve multipliée par une averse, elle ne tarde pas à former une mare, – chose fort désagréable comme chacun sait. – La goutte d’eau devenue mare, c’est la feuille volante transformée en volume : pluie littéraire ou pluie céleste, nous sommes condamnés à être trempés en l’an de déluge 1860. – Les Histoires du Café de Paris n’avaient d’abord que soixante pages ; à la première nouvelle une autre vint qui s’y ajouta, puis insensiblement, jour par jour, elles sont arrivées au chiffre notoire de trois cents : j’en suis vraiment honteux.
Maintenant, pourquoi ai-je choisi comme titre les Histoires du Café de Paris ? – J’aurais, sans doute, cherché bien longtemps une réponse concluante à ce point d’interrogation, lorsque la Providence, – le hasard ne fait jamais de ces rencontres-là, – m’envoya un in-18 très observé, très français, très excellent, et d’autant plus excellent, – et d’autant plus français, – et d’autant plus observé, qu’il renferme ma réponse à sa première page, à son premier chapitre. – La voici : – « … Le lecteur moderne aime les surprises, m’avait-on dit ; or quelle plus belle surprise qu’un livre qui, en fin de compte, se trouve n’avoir aucun rapport avec son titre ? » – L’auteur qui a écrit ces lignes, c’est M. le marquis de Belloy ; l’in-18 d’où je les transcris s’intitule les Toqués : – un marquis qui n’écrit que pour les lettrés, – un titre qui s’adresse à tous. Donc, si le mien est et demeure les Histoires du Café de Paris, – prenez-vous-en, cher lecteur, au lecteur moderne. Mon intervention s’est bornée à choisir le Café de Paris, de préférence aux mille établissements du même genre, par la raison toute simple qu’il est, depuis de longues années déjà, rayé de la carte des restaurants parisiens, et qu’en désignant tel ou tel autre établissement en vogue aujourd’hui, j’aurais craint de passer pour faire de la réclame ou de la diffamation, – dans les deux cas un méchant métier.
Vous trouverez un peu de tout ici, hors du mérite toutefois : – de la prose et des vers, des nouvelles, des anecdotes courantes et je crois même un proverbe : vous voyez que j’ai grand besoin de votre indulgence. Dans le nouveau milieu où je vis, dans cette solitude verte que je me suis faite et que j’aime chaque jour davantage parce que je l’apprécie mieux, peut-être écrirai-je quelques pages plus dignes de vous et de la chère affection que vous me portez. Veuillez donc accepter celles-ci en attendant moins mal, – le volume en attendant le livre ; mais si, au milieu de toute cette prose, vous rencontrez une phrase, une ligne, un mot qui vous plaise, je ne croirai pas avoir fait fausse route : – les Histoires du Café de Paris méritaient d’être publiées. –
Un mot encore et j’ai fini : en inscrivant votre nom en tête de ces réimpressions, je ne me suis pas dissimulé le risque que je courais d’être accusé de céder à ces mobiles également puissants : le désir de vous donner un gage public de mon souvenir amical et l’ambition plus personnelle de compter au moins un lecteur. C’est à vous, cher ami, de choisir entre ces deux suppositions celle qui vous semblera plus conforme aux sentiments de votre
CHARLES DE COURCY.
Sèvres, – novembre 1860.
Hier soir on dansait, place Vendôme, chez la princesse d’Ol-Neff, cette Russe à la face espagnole, qui semble avoir rapporté des bords de la Néva un cœur gelé. Il y avait là une cohue d’uniformes, de dentelles et d’habits noirs. Vous connaissez l’étendue immense du salon de la princesse, que le critique Raoul désigne sous le nom de Champ-de-Mars – rouge et or. Le comte ***, ce jockey de tant de chevaux et de si peu d’esprit, parlait d’y faire courir, en sablant d’abord le parquet : – j’ignore s’il sera donné suite à cette drôlerie. Les bals de la place Vendôme sont très recherchés, et la danse s’y distingue par une absence complète de tous mouvements : – on marche au piano. Le samedi, jour de réception, vous trouverez devant les portes de l’hôtel russe une file de voitures armoriées : la place est pavée de bonnes livrées. Un ami de madame d’Ol-Neff, vieillard attaqué de statistique, a calculé qu’en moyenne on écrasait quatre badauds sur la place Vendôme les soirs où elle recevait : – elle reçoit vingt-six fois chaque hiver ; total, cent quatre badauds dont elle débarrasse, bon an mal an, le pavé de Paris. La marquise de Rh…, son ennemie intime, qui n’a pu jusqu’à présent en faire disparaître qu’un ou deux par soirée, ne lui pardonnera jamais ce massacre. On la dit en marché avec la ville pour la location de faux badauds, qui lui donneraient un revenu annuel de deux cents faux écrasés, – quatre-vingt-seize de plus que la princesse. – Nous verrons bien.
Les danses avaient cessé ; chacun ayant regagné sa place, un grand silence se fit. Les robes de soie, qui aujourd’hui ont toutes cinq volants, – comme les maisons ont cinq étages, – s’étaient posées sur des chaises basses. Les éventails, ces paravents à la main, s’agitaient discrètement pour cacher un sourire ou détourner un regard. On causait çà et là, à mi-voix, comme des personnes dont la danse a pris tout le souffle. Des messieurs à besicles, dont le col écarlate et entortillé dans une cravate blanche les faisait ressembler à des bouquets de pivoines entourés de papier blanc, discutaient entre eux la cote de la Bourse, le cours du jour, tandis que, plus loin, un groupe de ces jeunes gens qui marchent avec leur siècle sur des chevaux de louage, publiait tout haut les hauts faits du sport. Les femmes, séparées de ces vieillards et de ces enfants engouffrés dans les embrasures des fenêtres, chuchotaient entre elles de la grave question d’un ruban cerise et de la crinoline de demain. Elles faisaient là un charmant bruit, quelque chose comme le battement des ailes d’oiseaux prêts à s’envoler, quittant la branche fleurie. On respirait dans ce salon, à l’heure où les bougies, à demi consumées, commencent à cligner des yeux, où les fleurs des jardinières penchent sur leurs tiges mollement, où la pendule semble retenir sa respiration pour retarder l’instant des capuchons et des bottines fourrées, ce parfum de bonne compagnie dont le secret va chaque jour se perdant, et dont l’ivresse est si douce à qui le respire. Quelques mains, de ces mains qui portent des blasons roses, sortaient de leur prison de chevreau ; on rajustait, d’un doigt rieur, la chevelure défaite ; les importuns étaient partis et, par la porte entrouverte, la causerie familière venait d’entrer ; on s’installait dans son fauteuil comme pour une longue sieste, et chacun semblait s’abandonner plus entièrement à cette fête où régnaient toutes les grâces de l’intimité.
J’entrai dans une espèce de boudoir, où la maîtresse de maison avait élevé un autel d’acajou, tendu d’un drap de couleur verte, au dieu Whist, – cette divinité desservie par des prêtres chauves autant que décorés. La salle était vide ; des jetons gisaient au hasard, comme des morts sur un champ de bataille ; les jeux de cartes débraillés se reposaient de leurs fatigues de la soirée en cherchant des distractions : le roi de pique s’en allait, dos à dos, avec la dame de cœur, tandis que la dame de trèfle se traînait aux pieds du roi de carreau ; quant au valet de cœur, insouciant comme un page, il s’étalait insolemment et de tout son long sur la robe bariolée de la dame de pique. Les quatre bougies, prises d’un sommeil implacable, bâillaient aux quatre coins de la table, n’attendant pour rejoindre leur couche qu’un bonnet de nuit, – l’éteignoir. Cette table abandonnée m’attrista, et je pensai, malgré moi, à ces affamés jouant un morceau de pain contre un coup de pistolet dont parle Octave des Confessions d’un enfant du siècle. Mon souvenir tombait mal, les hôtes de la princesse d’Ol-Neff jouissant, tous ou à peu près tous, d’une quarantaine de mille livres de rente, ce qui est bien joli pour des affamés ; mais, que voulez-vous ? une table de jeu me peine presque autant qu’un corbillard : je pris mon chapeau que j’avais sous le bras, je le mis sur ma tête, et, l’ôtant aussitôt, je saluai gravement.
Le boudoir n’était pourtant pas désert comme je l’avais cru d’abord, grâce à la lumière vacillante des quatre bougies ; sur un coin de la table un monsieur, front penché, bâtissait avec un sérieux d’architecte une maison de cartes : je ne l’avais aperçu qu’au troisième étage.
– Vous vous élevez un hôtel ?
– Les loyers sont si chers !
– Je vous retiens l’entresol ?
– Il est à vous.
Quatre phrases, deux poignées de main. Mon futur propriétaire était ce charmant compositeur, Sylvain Valned, dont les refrains ont passé par toutes les bouches, et qui donne, la semaine prochaine, son premier opéra : il est plus solide, je vous jure, que ses constructions. Quelques jours auparavant j’avais été lui demander une place, cette place je l’avais reçue le matin même, c’est vous dire que je ne laissai pas échapper l’occasion qui se présentait pour moi de le remercier.
– C’est moi qui vous remercie, au contraire : des mains comme les vôtres ne se rencontrent pas au bout de tous les bras.
– En vérité, cher ami, il n’y a que vous au monde pour…
– Achevez ?
– Pour faire un compliment à quelqu’un, en lui disant qu’il a de grandes mains.
– C’est pour mieux m’applaudir ! répondit-il avec la voix du loup qui fit si peur au petit Chaperon Rouge.
– À la bonne heure ! – autrement personne ne vous croirait, à commencer par mon parfumeur : je gante sept et demi.
– Vengez-vous ! je gante huit… quand je me gante, ce qui n’arrive pas souvent, je vous prie de le croire.
– Le fait est que je ne vous ai jamais vu de gants.
– Et pourtant j’en ai toujours.
– Même à présent ? fis-je en indiquant sa main nue.
– Oui… mais au fond de ma poche.
En effet, il en tira trois paires : une blanche et deux noires, mais je vous laisse à deviner laquelle était la plus noire des trois.
Je m’inclinai.
– Vous venez du salon ? – fit Sylvain, après son exhibition.
– Oui, je ne vous y ai pas aperçu. Il y a longtemps que vous êtes ici ?
– Une vingtaine de polkas, à peine. – Vous aimez le monde ?
– Cela dépend du monde.
– Est-ce que vous en connaissez de différentes espèces ? – La bonne compagnie, un mot vide, un salon plein, où il y a d’un côté cinquante femmes avec des robes blanches et de l’autre cinquante hommes avec des habits noirs, c’est-à-dire cent personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se reverront jamais, et qui passent toute une soirée à se marcher sur les pieds comme si elles se connaissaient depuis l’enfance. Vous êtes marié – c’est une supposition, – vous possédez une jeune fille charmante, qui n’a des yeux que pour vous voir, des lèvres que pour vous sourire ; qui s’appuie radieuse sur votre bras, et devant la chambre de laquelle vous passez sur la pointe des pieds pour ne pas troubler son sommeil, qui rêve de vous. Elle ne sait rien de la vie, cette fleur éclose au bord de votre chemin, et que, voyageur d’un jour, vous venez de cueillir, et, penchée sur votre épaule, elle ouvre ses grands yeux rêveurs à vos récits d’autrefois, à vos projets de l’avenir, – cette île toujours verte pour ceux qui s’aiment. Son cœur, son gentil cœur qui bat, est un livre vierge que nul n’a ouvert encore, et que vous feuilletez, vous, d’un doigt craintif et recueilli. Le mot amour, écrit en lettres éternelles, c’est elle qui vous le montre et c’est vous qui l’épelez ! – Vous l’aimez avec tout ce que vous avez de jeune, de fort et d’enthousiaste ; comme Dieu, qui a fait l’ombre à côté du soleil, il y a dans votre affection pour elle une grande place réservée à l’amitié, – qui est l’ombre de l’amour. À certaines heures, à certaines poses, elle vous rappelle votre sœur. N’ont-elles pas le même âge et peut-être aussi sa robe ressemble-t-elle à une robe que vous connaissez ? – Alors vous l’embrassez, comme vous embrassiez votre sœur, sur les deux joues, – des baisers qui sonnent. D’autres fois, les jours où le ciel est couleur de spleen, vous sentez un long sanglot intérieur et votre âme qui déborde. À ces moments, ce qu’il vous faut, ce qu’il faut à votre cœur qui plie, ce ne sont ni des caresses, ni des protestations, ni des élans de sympathie, mais un doux serrement de main, une parole simple et cordiale, une émotion pleine et retenue. Vous songez alors à votre mère, qui doucement essuyait les larmes de vos premières douleurs, qui savait relever votre force agenouillée, qui donnait un nom aux tristesses sans nom que vous ressentiez, et qui, pour en effacer les rides, mettait un baiser sur votre front. Votre femme est là devant vous, le fauteuil sur lequel elle est assise fut occupé par celle que vous regrettez ; les paroles se pressent sur vos lèvres décolorées, elle y répond par les paroles d’autrefois, elle retient votre main que le découragement crispe, ainsi que l’absente la retenait ; elle a des sourires voilés pareils à d’autres sourires, et ce qu’elle vous dit alors, ses consolations aimantes réveillent en vous une voix éteinte. La chère ombre a pris un corps, le ciel qu’elle ne devait pas quitter, elle l’a quitté pour vous soutenir, et, rêve ou réalité, c’est bien votre mère que vous revoyez à cette heure douloureuse. Rajeuni, vous retrouvez vos lèvres d’enfant pour l’embrasser au front, avec lenteur. Oui, c’est bien votre sœur, votre mère et votre femme, la compagne pour laquelle vous avez toutes les tendresses, tous les dévouements et tous les respects de l’amour réel. Heureux, trois fois heureux celui qui l’a rencontrée au seuil de sa vie, et qui jeune a ouvert à cette jeunesse radieuse sa maison en fête ! Heureux, trois fois heureux celui-là ! Il a trouvé la femme philosophale ! – Entendez-vous cette ritournelle ? – C’est une valse. Un monsieur passe avec des gants blancs : – Valsez-vous, madame ? et madame quitte sa chaise, son éventail et son bouquet ; elle tourne ses bras vers cet inconnu tendu de noir comme une porte en deuil ; et le tourbillon les emporte ! – Le rêveur au cachet, courbé en deux sur le piano qu’il assassine, regarde tristement la pendule qui marche à minutes comptées, tandis que la foule, prise de vertige, danse extravagamment aux sons de cet orchestre de Barbarie ! – Il joue, le pauvre homme, et son front sue et ses doigts suent, et il pense à sa femme qui l’attend dans la chambre glaciale, et il voit son enfant, rouge de fièvre, qui colle à la tasse vide sa bouche en feu. – Les danseurs passent et passent sans cesse ! – Les belles dentelles, les splendides robes ! – Sa femme a vendu ce matin sa robe d’épousée ; – on dansait aussi ce jour-là dans la maison du pauvre homme ! – La douce atmosphère qui vous baigne ! et comme le corps se plonge en ce bain parfumé ! mais lui a froid maintenant, sa femme et son petit ne grelottent-ils pas ? sa femme et son enfant qui l’attendent. – Voici des laquais qui paraissent, surchargés de plateaux aux mille pâtisseries : lorsqu’il est parti, il n’y avait plus de pain à la maison, et, tandis que les verres de punch se vident, il croit entendre la voix de son enfant qui lui crie : J’ai soif ! et un long frisson le parcourt ! – Les danseurs passent et passent sans cesse ! – Voyez cette ombre qui s’avance rieuse ; ses cheveux pendent à demi défaits sur sa robe, et chaque soir ce métier recommence ; et chaque soir vous la jetez ainsi, demi-nue dans sa toilette de bal, au premier danseur qui s’incline devant elle. – Et le père qui a amené là sa fille, voyant qu’elle ronge ses poings gantés, seule sur sa banquette, tandis que les autres tourbillonnent, dit à un ami : Mais faites-donc danser ma fille ! – c’est-à-dire : Mais pressez-la donc tremblante contre votre habit fripé ; respirez l’haleine de ses seize ans en fleur ; parlez-lui, entre deux contredanses, du pays où les baisers fleurissent, et laissez-lui, en la quittant, haletante, énervée, quelques-uns de ces troubles inconnus dont elle rêvera ce soir, dans sa chambre virginale, et dont sa virginité pleurera demain ! – Voilà le monde, cher ami, voilà vos soirées. Prenez une maison qui a cinq étages, aux cinq étages on joue la même comédie ; la jeune fille y apprend à tromper sa mère, la mère à tromper son mari, c’est de rigueur ! – Que me parlez-vous de bonne compagnie ? – N’est-elle pas partout semblable ? – Pour ma part, si je préfère les bals du premier étage, c’est qu’il y a moins de marches à monter.
– Soit, je suis de votre avis : on trompe dans les deux camps ; l’immoralité figure dans toutes les réunions dansantes comme premier invité ; mais vous avouerez, à votre tour, que les formes étant pour beaucoup dans ces sortes de choses, il existe une grande différence entre la bonne société et la mauvaise ?
– Oui, il existe une différence, reprit Sylvain, après avoir renversé d’un coup de coude son hôtel de cartes, dont, fort heureusement pour moi, je n’occupais pas encore l’entresol ; et cette différence, la voici : dans la bonne société on fait du punch avec de l’eau-de-vie à cinq francs, et dans la mauvaise on le fait avec de l’eau-de-vie à quarante sous : c’est une question de rafraîchissement.
J’allais répliquer, mais il continua aussitôt :
– Croyez-moi ; on ne gagne rien à aller dans le monde, si ce n’est un rhume de cerveau en sortant, ou quelquefois une fluxion de poitrine. J’ai souvent entendu dire que pour un artiste, par exemple, il était indispensable de fréquenter la société ; ce sont les tailleurs, les bottiers et les parfumeurs qui ont fait courir ce bruit-là, parce que l’artiste-soirée use plus d’habits, plus de bottes et plus de gants que celui qui travaille devant sa table ou devant son chevalet. Beaucoup d’artistes croient, grâce aux fausses maximes mises en circulation par les fournisseurs que je viens de vous indiquer, que, pour arriver à la réputation, il suffit de parader dans un salon, de discuter art entre deux tasses de thé, de se faire plusieurs cercles dévoués où l’on ne jure que par votre nom, parfaitement inconnu des autres mortels, en un mot de montrer sa figure. Moi, je crois qu’il vaut mieux encore montrer ses œuvres ; car, quoi qu’on en dise, les gens du monde ne vous rendent jamais les heures qu’ils vous font perdre. – Il est un autre préjugé qui subsistera toujours, parce qu’il est ridicule ; j’entends par là la persuasion intime dans laquelle vivent et meurent la majorité des bourgeois, que tous les artistes ont pour maîtresses des femmes du monde. N’est-ce pas à pouffer de rire ? Cette femme qui monte furtivement, voile baissé, l’escalier boiteux du peintre ***, c’est la marquise ***. Cette voiture blasonnée, attelée de deux chevaux pur-sang qui brûlent le macadam, c’est l’équipage de la duchesse ***, qui se rend aux Délassements-Comiques, où l’on joue la première platitude, mêlée de couplets, de son amant, le littérateur ***. – Faites un roman, et dans ce roman racontez les amours d’une madame de *** quelconque, dont les quartiers de noblesse n’ont jamais existé que dans votre imagination ; et le lendemain un monsieur, rencontrant un autre monsieur, lui dira : – Avez-vous lu le roman de *** ? C’est son histoire avec madame de ***. – Il est bien entendu que vous ne pouvez plus battre monnaie qu’avec votre cœur. Vous avez beaucoup écrit, parce que vous avez beaucoup aimé. Que faire à cela ? que répondre ? Le pli est pris ; rien ne l’effacera. Tous ceux qui décriront l’intérieur d’un atelier de peintre, comme tous ceux qui l’ont décrit, ne manqueront pas de laisser traîner une femme du monde sur le canapé, entre la table à modèle et le chevalet, côté jardin. Et ainsi jusqu’au dernier artiste, jusqu’à la dernière femme du monde, jusqu’au dernier canapé ; après quoi l’on se rendra dans la vallée de Josaphat.
Un domestique circulait, plateau en main ; Sylvain l’appela, prit un verre de punch, et, l’approchant de ses lèvres, il s’écria en forme de conclusion :
– À Marion, qui n’est pas une femme du monde !
Puis il changea de chaise.
– Encore un grief, fit Sylvain ; le dernier, et celui-là m’est personnel. Vous savez si j’adore la musique ? Je possède tous les bustes connus de Beethoven, Mozart, Weber, Rossini, Meyerbeer, sur ma cheminée ; et leurs partitions dans ma tête. Eh bien, que j’aille encore deux années de suite dans le monde, et je ne pourrai plus voir une note en face ; je flanque par la fenêtre mes bustes et mon piano ; mais, pour me venger de ceux qui auront tué ma vocation, je les prierai de passer devant ma porte ce jour-là. Vous ne vous figurerez jamais notre supplice ! Le piano est bien tranquille dans un coin du salon, les bras croisés ; on cause chiffons, littérature, pralines et philosophie ; personne ne songe à l’art divin de M. Paul Henrion. Vous entrez : – « Ah ! monsieur Sylvain, jouez-nous donc quelque chose. » Quelque chose ! Comprenez-vous tout ce qu’il y a de féroce dans ces deux mots : Quelque chose ! Depuis l’âge de quinze ans – vous en avez trente ! – on vous a attelé à un piano, on a brisé vos doigts un à un, les gammes ont succédé aux gammes, le papier réglé au papier réglé ; lorsque, enfant, vous étiez à table sur une chaise trop basse, pour vous élever on mettait des livres sur cette chaise, et votre père avait soin de choisir les partitions qui devaient développer en vous le goût de la musique. Le jour où vous apercevez les rives, toujours si lointaines, du talent, vous ne regrettez plus votre jeunesse effeuillée au travail ; mais le regret vient un beau soir, quand la maîtresse de maison vous tire cette phrase à bout portant : – « Jouez-nous donc quelque chose ! » Il vient le regret cuisant ! Vous êtes sorti découragé, fatigué, brisé, et vous aspirez fortement l’air vivifiant ; vous montez un escalier ami pour entendre des banalités qui vous reposent, pour voir un visage qui vous plaît ; mais vous avez compté sans le piano : – « Jouez-nous donc quelque chose ! » Vous avez joué quelque chose toute la journée pour gagner votre pain et pour gagner votre gloire ; il faut que vous jouiez encore, et que Mozart ou Méhul payent votre tasse de thé et votre chaise ! Après le musicien, le poète, après le poète, le peintre auquel on demande des croquis ; mais il ne leur viendrait jamais à l’idée de prier un banquier de peser de l’or ou de l’argent au milieu du salon, ou d’esquisser un compte courant sur l’album de la maison. Et les dames qui ont pris, on n’a jamais su où, la mauvaise habitude de chanter leSaule ! On m’invite à les accompagner. Calamité numéro deux ! Après avoir joué quelque chose, il est bien juste qu’on chante quelque chose. Aussi, dès que je vois une dame quitter sa place et gagner, à pas lents, l’instrument de mon supplice, je cours vite vers la porte ; et…
Sylvain s’arrêta court.
– Entendez-vous ? me dit-il.
– Parfaitement. J’entends qu’on ouvre le piano. Du courage, Sylvain !
– Vous distinguez une voix, n’est-ce pas ?
– Je ne m’étais pas trompé !
Et tout radieux il m’entraîna dans le salon, en répétant : « Venez ! venez ! c’est elle qui va chanter ! » tandis que je m’étonnais de la contradiction qui existait entre ses paroles et sa conduite.
Je ne retrouvai pas le salon tel que je l’avais laissé : les embrasures des fenêtres étaient vides, de la foule il ne restait plus qu’une cinquantaine de personnes ; on s’était réuni en cercle, et la conversation, interrompue par elle, tirait ses dernières fusées.
Je me blottis dans un coin, à deux pas de Sylvain, qui paraissait plongé dans un rêve extatique. Le piano, vivement éclairé, brillait ainsi qu’un point lumineux ; son regard le fixait, immobile, s’abaissant à de courts intervalles, comme fatigué par une lumière trop vive. Je regardai à mon tour, et ce fut elle que j’aperçus dans tout son rayonnement.
Sa main dégantée appuyait sur le piano son corps à demi penché. Je cherchai vainement dans mes souvenirs une figure qui lui ressemblât. Elle était grande, d’un ensemble rêveur et aristocratique ; son teint avait des pâleurs exquises, que faisaient encore ressortir l’incarnat de ses lèvres royales et le noir vif de ses longs sourcils dont les arcs réguliers semblaient tracés par le pinceau. Ni fleurs ni plumes dans ses cheveux, qu’elle avait séparés en deux bandeaux puissants et tordus par derrière en un chignon bas. Une longue robe de velours noir l’enveloppait tout entière et projetait son ombre molle sur le col le plus blanc que l’amour ait plié. Des yeux limpides et profonds, où la pensée étincelait, des oreilles faites aux confidences, une main qui semblait de marbre et qui rappelait, dans sa perfection, les mains de mademoiselle Georges, signées Phidias, figurez-vous tout cela, évoquez cette ombre, habillez-la d’une robe de velours noir sans dentelles, sans diamants, et vous aurez devant vous cette ruisselante beauté qui chantait hier soir chez la princesse d’Ol-Neff.
Lorsqu’elle eut fini, un frémissement parcourut l’assemblée, un long bravo vint se briser à ses pieds comme une vague. Je regardai autour de moi ; Sylvain avait disparu. Il était déjà auprès d’elle, et à ses sourires je vis qu’il la complimentait. Cette femme m’avait profondément impressionné, et je pensai alors, malgré moi, à la Joconde de Léonard de Vinci : mais elle me parut plus passionnément belle.
On allait partir ; je la regardai fixement une dernière fois, et j’aperçus un mince ruban rose qui entourait son cou : ce ruban fané, à la couleur passée et devenue incertaine, ressemblait assez à une blessure.
Je courus rejoindre Sylvain.
– Comment se nomme cette femme ?
– Madame Durand.
Ce nom était plein de désillusions.
– N’est-ce pas qu’elle est belle ?
– Oui, elle est bien belle.
– Et quelle voix !
– Je ne l’ai pas entendue.
– Comment ?
– Je la regardais.
– Vous n’êtes pas musicien, je vous pardonne.
– Est-ce que vous la connaissez ?
– Oui.
– Beaucoup ?
– Beaucoup.
– Expliquez-moi alors un mystère.
– Quel est-il ?
– Il est rose, – c’est un ruban, à moitié déteint, qu’elle porte à son cou.
– Parfaitement.
– Est-ce une relique ou un souvenir ?
– Tous les deux.
– Est-ce qu’elle le met tous les jours, ce ruban ?
– Non.
– Ah !
– Elle le met tous les trois jours.
– Vous riez.
– Regardez-moi.
J’étais fort intrigué : il ne riait pas.
– Comment savez-vous cela ? lui dis-je.
– Mon cher ami, je connais très peu madame Durand, c’est-à-dire que je ne vais pas chez elle, et je la connais beaucoup, c’est-à-dire que je connais l’histoire de sa vie.
– Vous ?
– Moi. Je vous la conterai un de ces jours.
– Quel jour ?
– Vous êtes bien pressé.
Je ne répondis pas ; Sylvain réfléchit quelques instants.
– Avez-vous faim ?
– Quel rapport ?…
– Avez-vous faim ?
– Eh bien, oui, j’ai faim.
– Très faim ?
– Horriblement faim.
– Bravo ! Allons au Café de Paris, soupons, et, au dessert, je vous conterai…
– Quoi ?
– L’histoire de madame Durand.
Je poussai un cri de joie ; – dix minutes après, nous étions enfermés dans un cabinet, devant un perdreau capitonné de truffes.
Ayant vidé sa dixième coupe de champagne, Sylvain commença en ces termes :
À huit heures, il est trop tôt pour se lever, mais il est trop tard pour se rendormir ; aussi Lucien, convenablement étendu sur son lit, faisait-il les yeux doux à la rosace de son plafond. Comme après avoir visité une serre, on s’en va en mâchonnant la première fleur qui vous est tombée sous la main, Lucien, qui, la veille, avait entendu Zampa à l’Opéra-Comique, rêvait en mâchonnant un brin de mélodie arraché au hasard. Quand mon cœur a fait son choix avait toutes ses préférences ; mais c’est qu’en vérité cette romance, chantée à mi-lèvres, avait quelque chose de caressant à vous faire venir les baisers à la bouche. Il l’accompagnait, fort justement du reste, en frappant des deux pieds contre la partie basse de son lit de fer. Au dixième couplet, – c’est-à-dire après avoir chanté le même couplet dix fois, – il sauta lestement sur son tapis, passa ses chaussettes, mit ses pantoufles et s’achemina vers son pantalon : son cœur avait fait son choix. Il commença par ouvrir sa fenêtre toute grande ; les parfums du matin envahirent sa chambre en se précipitant, comme une bande d’écoliers à laquelle on ouvre la porte de la classe. L’air était doux et tout imprégné de senteurs, il en but une forte gorgée ; puis il se mit à contempler le ciel. – Avez-vous étudié la lumière que projette une bougie dans une pièce où l’on a beaucoup fumé ? – Le soleil était, ce matin-là, obscurci de la même façon, par de légers nuages grisâtres qui se tenaient immobiles devant lui, et à travers lesquels filtraient des éclaboussures d’or : on avait beaucoup fumé. – La maison dont il habitait le premier, – il faut dire qu’elle n’avait qu’un étage, – était précédée d’une cour, – préface mal pavée, – où se balançaient au vent deux lilas en fleurs sur lesquels l’orage de la veille avait pleuré à verse. Près de l’un d’eux chantait une nichée de moineaux francs, – ces oiseaux en blouse. – Les arbustes semblaient atteints de nostalgie, et, pris d’un bâillement convulsif, ils s’étiraient les branches, comme des gens qui s’éveillent. – Ils ont peut-être mal dormi, pensa Lucien ; et, détournant son regard, il le porta machinalement sur la maison qui s’acharnait à lui faire face. Chaque matin il espérait la voir renversée, et chaque matin il la retrouvait de bout, grave, impassible dans sa dignité badigeonnée. Je ne sais rien de plus triste que nos maisons modernes, de plus lugubrement idiot que cette maison unique, tirée à cent mille exemplaires par des photographes limousins. Celle que Lucien regardait avait les cinq étages obligés, recouverts de l’indispensable ton jaune sale, et terminés par l’éternelle terrasse sur laquelle on étend, – depuis les plombiers les plus reculés, – un tapis de zinc qui vous brûle les pieds aux jours de soleil, et qui, dès qu’il pleut, inonde votre appartement. S’y promener est impossible par le vertige qu’il y fait ; autant habiter la plate-forme de l’Arc de Triomphe. – Les volets étaient hermétiquement fermés, du haut en bas, comme pour dire aux passants : ici l’on dort. Lucien roula une cigarette, l’alluma et s’en fut, laissant après lui de longues traînées de nuages blancs, donner le bonjour à son pot à eau et à sa cuvette, – logés sur le derrière. Son cabinet de toilette, bâti sur une cour étroite et noire, était fort mal éclairé par un jour trouble que lui renvoyait le corps de logis situé dans le fond. Ce corps de logis avait pour principaux locataires des sergents de ville : du cabinet de Lucien, on avait vue sur des tricornes. – Tandis qu’il fait sa toilette, je vais vous esquisser son portrait.





























