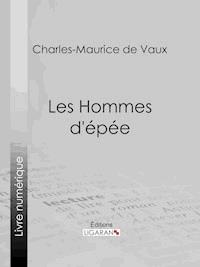
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Voici, sans contredit, une des figures les plus aimables et les plus sympathiques du monde de l'escrime. Ezpeleta est un des meilleurs élèves de Grisier, ce maître dans l'art de l'escrime. Aussi est-il le plus brillant, le plus élégant des tireurs parisiens ; c'est un tireur plein de fougue et de brio."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mon cher professeur L. Caïn
En vous dédiant ce livre, mon cher Maître, je tâche d’acquitter ma dette au talent, au souvenir et à l’amitié.
En portraicturant ici les Hommes d’épée, l’auteur n’a pas eu l’intention de les classer ; il fait un rapport et ne décore pas. Ce serait difficile de handicaper des tireurs comme ceux dont il parle. Esquisser la physionomie des meilleurs et des plus sympathiques d’entre eux, tel a été son but.
Les Hommes d’épée sont une galerie comme le Musée Grévin. Grévin a pris ses personnages un peu partout et lesa modelés en cire ; le baron de Vaux a pris les siens dans les salles d’escrime et les a dessinés à la plume. Un personnage manque à sa galerie, et ce personnage c’est lui-même.
Amoureux du fleuret et friand de la lame, le baron de Vaux connaît tous les maîtres et tous les tireurs de Paris ; il a ses grandes entrées dans toutes les salles, et suit les assauts avec une régularité, une persistance aussiopiniâtres que celles que met M. Francisque Sarcey à suivre les premières représentations.
Pas une première sans Sarcey, pas un assaut sans le baron de Vaux. Chacun prend son sacerdoce où il le trouve.
Jamais l’escrime n’a été en honneur autant qu’aujourd’hui. On ferraille dans les écoles, dans les lycées, partout. Chaque hôtel a sa salle d’armes comme il avait sa salle de bains.
L’escrime assouplit les membres et trempe les caractères. C’est la seule gymnastique qui présente ce double avantage ; l’esprit y gagne en vigueur comme le corps.
J’ai lu, dans le récit d’un voyageur, que les Arabes ont dix mots pour dire cheval, pas un pour dire honneur. En France, au contraire, honneur a de nombreux synonymes et des acceptions plus nombreuses encore.
Nous avons l’honneur militaire, l’honneur commercial, l’honneur du joueur, et vingt autres espèces d’honneur.
Un homme est appelé l’honneur de la magistrature, l’honneur du journalisme, l’honneur de sa famille. Une femme est qualifiée l’honneur de son sexe, l’honneur de son quartier, l’honneur de l’atelier.
On dit d’un homme qui ne paie pas ses billets qu’il ne fait pas honneur à sa signature. Son créancier le traite de filou ; l’homme se bat, on le déclare homme d’honneur, et on ne dira rien de celui qui a simplement payé son billet.
Le mot et la chose prêtent à tant de controverses qu’on a été obligé d’inventer le point d’honneur.
Le point d’honneur est le caractère de chaque situation et de chaque profession, une fierté relative.
Dites à un écrivain qu’il est mauvais colonel et à un colonel qu’il est un mauvais écrivain, vous ne ferez tressaillir ni l’un ni l’autre. Renverse l’appréciation, et vous serez à l’instant provoqué ou dévoré.
Le duel, si souvent discuté, blâmé, condamné, est utile à un point de vue indiscutable : c’est qu’il supplée la plupart du temps à l’insuffisance de la justice légale.
On a prétendu que le duel n’offre pas à l’offensé le moyen de réparer le tort qui lui a été fait. Matériellement, non ; moralement, oui. Quel que soit le blessé, l’offense est lavée par le seul fait du combat. Ainsi l’a voulu l’opinion.
C’est pour ne pas autoriser la loi du talion que la plupart des États traitent le duel avec modération.
Évidemment, dans le cas où l’homme a soif de vengeance, l’assassinat serait un moyen plus sûr ; mais, précisément, l’égalité du péril, la loyauté du combat, donnent au duel une couleur chevaleresque qui ne permet pas aux esprits les plus prévenus de le confondre avec une manœuvre criminelle.
Qu’on abuse un peu de l’épée par le temps qui court, qu’on aille sur le terrain pour des futilités, le fait est certain. C’est une manie de l’époque, mais qui, jusqu’à présent, n’a pas amené de grands désastres. Quand l’honneur est déclaré satisfait, il faut bien qu’il le soit.
Le jour où le législateur voudra poursuivre sérieusement le duel, il n’aura qu’à se reporter au règlement des maréchaux de France (1679) :
« Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison, et, à sa sortie, il devra demander pardon à celui qu’il aura offensé.
En cas de coups précédés d’un démenti, l’agresseur subira un an de prison ; si les coups n’ont pas été précédés d’un démenti, l’agresseur subira deux ans de prison. À sa sortie, il devra se soumettre à recevoir de la main de l’offensé des coups pareils à ceux qu’il aura donnés.
Quiconque sera convaincu d’avoir commis une injure à coups de bâton, canne ou arme de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage, subira quinze ans de prison.
Celui qui aura frappé par derrière et avec avantage, soit seul, soit en se faisant accompagner, sera puni de vingt ans de prison… »
Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures des maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d’Estrades, Montmorency-Luxembourg.
Au XVIIIesiècle, les philosophes s’attachèrent à déraciner le duel. Tout le monde connaît l’éloquente protestation de J.-J. Rousseau ; et, malgré Richelieu et les édits, malgré les maréchaux et les philosophes, le duel est encore le grand réconciliateur.
Que d’adversaires d’un jour sont devenus de véritables amis, et combien souvent nous voyons passer, bras dessus brasdessous, sur le boulevard, des hommes qui ont croisé le fer et ne s’en estiment que davantage !
Le baron de Vaux n’a pas voulu entrer dans toutes ces considérations. Il ne discute pas, il raconte. Il a pris son temps comme il l’a trouvé. Des artistes éminents ont jeté un coup de crayon, un trait, une physionomie, dans ces pages empreintes d’une modernité typique, si bien que les Hommes d’épée sont à la fois un livre et un album.
L’ami du docteur Véron, le célèbre Guillaume, qui en trente-cinq années ne manqua ni une répétition ni une représentation de l’Opéra, se piquait de connaître si bien le personnel du ballet qu’il proposa un jour le pari suivant. On réunirait toutes ces dames de la danse dans le grand salon des Frères Provençaux, suffisamment chauffé pour la circonstance. On leur envelopperait la figure – mais la figure seulement – de voiles assez épais pour cacher complètement leurs traits ; – et rien qu’à l’inspection de leur personne, des épaules jusqu’aux genoux, Guillaume se faisait fort de les nommer toutes l’une après l’autre. Le pari fut tenu et Guillaume le gagna.
Le baron de Vaux a proposé un pari tout aussi singulier. C’est à lui qu’on banderait les yeux ; après quoi, les vingt tireurs les plus connus dans les salles d’armes de Paris feraient assaut tour à tour en sa présence sans rien changer à leurs habitudes. Rien qu’au jeu de l’épée, au cliquetis du fer, à la rapidité des parades, le baron prétendait qu’il saurait nommer les jouteurs. – Le comte S… tint le pari et le perdit.
Il est tout naturel qu’un dilettante aussi passionné n’ait pas voulu laisser dans l’ombre ceux de ses contemporains qui ont plus ou moins pratiqué l’art de l’escrime. Le baron de Vaux a fait pour les Hommes d’épée ce que plusieurs critiques du lundi ont fait pour les artistes dramatiques. Il a voulu fixer ces physionomies parisiennes, si passagères et si fugaces. Et qui sait ? un romancier ou un auteur dramatique viendra peut-être, dans cinquante ans, choisir ses personnages dans cette galerie du XIXe siècle.
Ami lecteur, si, comme escrimeur, il vous arrive quelque jour de pénétrer dans la maison qui porte le numéro 91 de la rue de Rennes, au deuxième étage, un fort gaillard que vous reconnaîtrez facilement pour un prévôt d’armes, viendra vous ouvrir et vous introduira dans le cabinet du maître. Votre attention sera frappée : sur la cheminée, un vieux bois du XVIIe siècle, représentant saint Michel, le patron des escrimeurs ; à côté, un Don Quichotte l’épée à la main, étudie gravement, dans un livre, des bottes qui ne sont plus secrètes depuis longtemps ; et ne serait-ce pas à la présence du héros de Cervantès dans un cabinet qu’on pourrait attribuer l’horreur invincible que professe le maître de céans pour les coups d’épée dans l’eau ?
Dans les coins dorment des fleurets ; sur les murs, d’anciennes et rares gravures d’escrime et de duels ; le portrait en pied du maître, signé Carolus Duran ; à droite et à gauche, deux superbes bibliothèques renfermant tout ce qui a été écrit depuis plus de trois cents ans sur l’art des armes, collection peut-être unique ; au milieu, une table chargée de livres, d’une plume et d’un fleuret.
C’est là que le gentleman master, comme l’appellent les Anglais, donne ses consultations ; c’est là que sont combinés les plans de cet artiste qui pousse fièrement, trop fièrement peut-être, à la grandeur de son art et à l’indépendance de son enseignement.
Vigeant, à ce nom maîtres et amateurs dressent l’oreille ; déjà j’entends les discussions passionnées autour de celui à qui, convenons-en, l’art de l’escrime doit beaucoup.
Et en effet, par sa dignité et son savoir, son exécution et son enseignement, Vigeant n’a pas peu contribué à relever le prestige du maître d’armes et à mettre en relief son rôle dans l’éducation de la jeunesse et les nobles distractions de l’homme fait.
Je ne vous dépeindrai pas le physique du jeune maître, il est trop connu dans le monde de l’épée, et, quelque étrange que vous paraisse ici la chose, je n’essayerai pas davantage de vous décrire ce jeu qui, si finement, se transforme en raison des actions et du caractère adverses ; la tâche serait d’ailleurs difficile.
Il appartient par son père et par Bonnet, dont il fut le disciple favori, à l’école du célèbre Jean-Louis, et c’est à Bordeaux qu’il fit ses essais et ses préparations en vue de Paris, où il vint débuter en 1872.
Son talent lui assura vite renommée et position ; le maître gentleman devint à la mode, mais peu maniable.
Son humeur difficile fit trop remarquer l’éclat doré de son épée.
Comme autrefois le vaillant et boudeur Achille, Vigeant semble maintenant s’être retiré sous sa tente ; je croirais plutôt qu’il se recueille, méditant encore quelques-unes de ces surprises qui se traduisent en secousses fortes, il est vrai, mais toujours profitables à cet art qui réclame des stimulants.
Tout homme, dit un vieil adage, trouvera écrite quelque part sa destinée ; le Maître a trouvé : ense vigeant et c’est sa devise.
Celle écrite dans nos anciennes salles d’armes était, rappelons-le :
Salut aux armes, respect aux maîtres.
Tous les vrais amateurs connaissent la belle salle d’armes de la rue de Richelieu, qui, non sans raison, est un peu considérée comme la métropolitaine de l’escrime parisienne aujourd’hui.
Maîtres, amateurs et dilettanti du fleuret s’y donnent rendez-vous, certains qu’ils sont d’y voir souvent de forts et brillants assauts.
C’est là que trône Mimiague, le type parisien par excellence du maître d’armes greffé sur le meilleur caractère militaire qu’il soit possible de rencontrer. – Cinquante et quelques printemps n’ont pu vieillir ce digne représentant de la bonne école ; toujours gai, droit, taillé en athlète, et capable de rendre à n’importe quel anglais cinq biftecks sur dix à son déjeuner.
Mimiague, après des débuts assez pénibles et des luttes contre la destinée rebelle, est arrivé aujourd’hui, par son talent et l’autorité de sa situation, à se trouver à la tête des mouvements de son art, dont il est encore un des plus fermes champions.
C’est au sortir des mains du célèbre Jean-Louis qu’il vint à Paris, quitta le brillant uniforme de premier maître d’escrime des zouaves, et contraignit patiemment et laborieusement la fortune à lui sourire ; ce fut justice.
Maintenant, riche et posé, entouré de nombreux et forts élèves, dont il est autant l’ami que le maître, et à la tête desquels je dois citer MM. le comte de l’Angle-Beaumanoir, Guignard, de Villiers, Tony Girard, Sarlin de Villeneuve, capitaine Dérué, de Quelin, etc., etc., Mimiague est encore un travailleur infatigable et passe à bon droit pour l’un des premiers démonstrateurs connus.
« Si peu doué que soit un élève, dit-il quelquefois, j’arrive toujours à en tirer quelque chose. » N’allez pas croire à quelque gasconnade de sa part : ce qu’il dit, il l’a maintes fois prouvé.
Comme tireur, Mimiague appartient à l’école classique, et croit avec raison qu’il vaut mieux prêcher par l’exemple que par la parole. Aussi, dans les assauts qu’il a soutenus contre Pons, Robert aîné, etc., l’avons-nous toujours vu observer rigoureusement les principes d’une tenue où l’élégance et la correction ne laissaient pas plus à désirer que la rapidité et la précision des mouvements.
Absolument maître de lui-même, Mimiague est doué d’une agilité extrême et d’une souplesse de corps peu commune. Son doigté est d’une grande finesse ; il possède le sentiment de l’épée comme personne, et à son extrême légèreté de main il joint une vitesse de détente remarquable. Les coups de bouton qu’il donne sont nettement posés.
Il n’a pas de jeu proprement dit ; il est, selon les exigences, attaqueur, pareur ou riposteur ; ses attaques, parades, ripostes et contre-ripostes sont variées à l’infini. Il excelle surtout dans les attaques sur préparation et sur changement d’engagement. Ses ripostes sont celles du tac au tac ; il les alterne quelquefois avec les dégagements et les coupés-dégagés en pointe volante. Son jeu de contre-ripostes est toujours très habilement exécuté.
Mimiague est un des huit meilleurs plastrons démonstrateurs de Paris.
Maintenant, prenez rétrospectivement dans cette galerie les quelques portraits que j’ai esquissés de ses forts élèves, formez un tout de leurs qualités les plus saillantes, laissez de côté les défectuosités, s’il y en a, et vous aurez le Mimiague des plus beaux jours, l’épée à la main.
Je ne veux pas m’étendre davantage sur ce sympathique maître ; il aime assez peu, dit-on, qu’on s’occupe de lui : la moutarde lui monterait au nez, peut-être, et je serais alors terrifié à cette seule idée de me trouver un jour ou l’autre à portée de sa terrible… fourchette.
Caïn est aujourd’hui un des professeurs bien connus de la capitale, et s’était déjà acquis une réputation hors ligne dans l’armée, avant de prendre, en 1874, la direction de cette ancienne salle d’armes du passage de l’Opéra, qui, depuis plus d’un demi-siècle, a été souvent le refuge et la providence de nos jeunes friands de la lame.
Caïn a quarante ans environ et possède les qualités sérieuses qui caractérisent à la fois le tireur et le démonstrateur ; il s’est formé dans l’armée, d’où nous sont venus nos meilleurs maîtres, et là déjà il s’était montré le défenseur zélé des bonnes traditions de notre escrime.
La campagne d’Italie et la guerre de 70-71 le virent faire crânement son devoir ; peu après il quittait le service militaire pour prendre dans l’enseignement de l’escrime parisienne la place qu’il occupe aujourd’hui, c’est-à-dire une des premières places.
Son mérite, son ardeur et son caractère le firent bientôt entourer d’élèves dévoués, dont plusieurs comptent aujourd’hui parmi nos meilleurs tireurs, et sa salle fut aussi estimée pour sa tenue que pour le ton aimable et poli que le maître sut y conserver.
Là se retrouvent en effet plusieurs des anciens usages de nos antiques salles d’armes à peu près oubliés aujourd’hui ; ce qui vous change agréablement des allures communes et cavalières qu’affectent quelquefois bon nombre de nos jeunes élégants, qui vont, par mode et à heure fixe, enfumer leur salle d’armes et dormir sur ses banquettes.
Enfin, Caïn appartient à cette catégorie des artistes travailleurs qui, avant tout, réclament des résultats sérieux ; un progrès, un succès obtenu par ses élèves, lui donne à coup sûr plus de satisfaction qu’un bon assaut fourni par lui-même.
Amoureux passionné de son art, il a fait plus encore, et je n’hésite pas à donner la chose en exemple aux maîtres d’armes et à nos forts amateurs.
Caïn a voulu devenir un érudit, et il a puisé dans bon nombre de livres d’escrime anciens et modernes des connaissances aussi utiles que variées.
Le jeu de Caïn a beaucoup de vitesse et surtout beaucoup de finesse. Il est de tous les maîtres d’armes de Paris celui qui sait le mieux peut-être utiliser la science de l’escrime. Il affectionne cependant les coups droits et les dégagements sous les armes ; il pare très vite et très juste les contres de pied ferme. Ses ripostes du tac au tac sont aussi merveilleuses de rapidité que ses coupés-dégagés ; tout en lui est doué du reste de la même agilité, de la même flexibilité. Caïn est un tireur de tête par excellence : voyez-le dans un assaut, c’est presque toujours son jugement et sa tête qui le servent. Il ne prépare rien, il improvise, et malgré cela c’est encore lui qui enlève la galerie par son jeu à sensation.
Il a donc droit à la situation qu’il a pu se créer ; il a rendu à son art de véritables services.
Beaucoup d’entre nous les ont appréciés ; aussi puis-je affirmer avec conviction que la place de ce maître restera marquée dans la bonne escrime de notre époque.
Une agitation inaccoutumée régnait, ces temps derniers, dans la paisible académie d’armes de la rue des Pyramides.
Qui l’eût cru ? Pons, son éminent et zélé professeur, s’était déclaré octogénaire, et sagement réclamait un bras droit, un alter ego ; mais la chose n’était pas facile : où trouver un candidat libre qui réunirait le talent à toutes les qualités requises pour un pareil emploi ?
Dans cette élégante salle, en effet, sont inscrits bon nombre de forts amateurs, appartenant pour la plupart à l’aristocratie ; c’est là le rendez-vous des fines lames du faubourg Saint-Germain.
L’Académie d’armes (seule elle a osé conserver ce nom) nous reste comme un souvenir vivant des usages et traditions des anciennes académies d’armes de nos pères, chez qui, l’épée à la main, brillaient toujours la fierté, l’émulation et l’exquise politesse.
Tout à coup, on sut que le maître qui, dans l’escrime de l’armée, occupait la première place, avait accepté d’aider à la direction de ce sanctuaire du fleuret.
On applaudit, car il ne pouvait être fait de meilleur choix.
Rouleau, c’est bien de lui qu’il s’agit, a peut-être un peu dépassé la quarantaine, mais il a conservé les allures vives et le caractère enjoué du jeune homme.
Sa taille moyenne et bien prise supporte une tête fine, parfois railleuse, mais sympathique, éclairée de deux yeux souriants qui, sous le masque, mêlent parfois leurs éclairs aux reflets de sa lame hardie et puissante.
Tous nos dilettanti en armes connaissent ce talent si net et si fin, que les exigences militaires nous ont souvent dérobé, mais qui sûrement, maintenant, atteindra la renommée qu’il mérite, et prendra sa place parmi les premiers.
Rouleau, comme exécutant, s’est fait déjà connaître par les assauts qu’il a soutenus contre Vigeant et Mérignac.
Ses connaissances dans l’enseignement de son art ont fait loi dans l’armée et sont déjà appréciées et fort goûtées à Paris.
Le maître accuse en effet, à un degré éminent, tout ce qui caractérise le démonstrateur.
Peu possèdent comme lui cette faculté, entre autres, qui consiste, chez le professeur, à savoir parler dans le cours de ses leçons, non avec la voix, mais par les sensations de sa lame. Dès que l’élève a franchi les premiers obstacles, par elle le maître s’exprime et communique sa volonté ; il arrive dans l’action à pouvoir supprimer presque toute explication, ce qui, pour l’étude de l’à-propos et de la décision, économise à l’élève un temps considérable.
Tous les fervents de l’épée me comprendront ; ils savent que le vrai professeur ès armes se révèle souvent ainsi, et ce titre appartient certainement à Rouleau.
Son honorabilité, son parfait caractère, complètent cette personnalité, dont le rôle s’accentuera de plus en plus, secondé qu’il sera par de la fermeté et de l’initiative.
Plus que chez tout autre, ces dernières qualités sont nécessaires chez le maître d’armes ; tout artiste d’ailleurs est incomplet sans elle, et n’obtient guère qu’une renommée éphémère et inconstante.
Depuis quelque temps déjà je m’évertue à démêler les mobiles divers qui poussent certaines personnes à tirer si furieusement sur toutes les cordes, j’allais dire les ficelles, qui tendront à placer Mérignac sur des assises assez hautes pour défier toute atteinte, assez solides pour ne craindre aucun choc.
Certes, plus que tout autre j’applaudis aux nobles sentiments, malheureusement trop rares, d’admiration et de dévouement que doivent pratiquer les disciples pour leur maître, et je m’incline surtout si ces sentiments sont désintéressés.
Mais qu’est-ce donc que cette petite Église, où je distingue, à défaut de fervents, bon nombre de pontifes en quête de prosélytes et cherchant à s’arroger le droit exclusif de distribuer indulgences, bénédictions, réputations, etc. ?
Sa bannière est-elle bien celle de Mérignac ? J’en doute, et suis même très disposé à le séparer de ce qui n’est peut-être pas sa propre cause.
Dans tous les cas, je le préférerai sans tutelle, agissant en maître, avec des opinions personnelles et arrêtées ; l’art y gagnerait et le mérite professionnel aussi. Je n’insiste pas.
Mérignac est à coup sûr un des grands noms de l’escrime française, et personne n’hésite à reconnaître en lui un tireur de premier ordre et de grande allure.
Son père, qui laisse une sérieuse réputation de démonstrateur, a su très habilement tirer parti de ses puissantes qualités physiques.
Mérignac fils eut bientôt fait sa trouée dans la renommée parisienne ; dès l’âge de dix-huit ans on le vit figurer dans les assauts sous le nom du Tireur-Noir ; il grandit dans nos premières salles d’armes, et ces dernières années l’ont vu se poser en émule de Vigeant.
Leurs fulgurants assauts sont encore dans la mémoire de tous les escrimeurs.
Mérignac a aujourd’hui trente-six ans ; très brun, bien pris, la nature l’a certainement formé pour la carrière qu’il devait parcourir. Sa taille est moyenne, le corps mince, les jambes très fortes, des mains d’hercule, et avec cela, ce qui n’est pas à dédaigner pour un attaqueur, un pied qui chausse très bien de grandes sandales.
Si à ces avantages vous joignez une forte dose de sang-froid et de possession de lui-même en public, vous pourrez prévoir quel adversaire est ce maître, l’épée à la main.
Quelqu’un a dit avec raison que son attaque était le dernier mot de la puissance en armes.
Que puis-je lui souhaiter encore, si ce n’est de lui voir former des élèves à son image ?
C’est rue du Helder que Désiré et Georges Robert sont venus s’installer, lorsque ce dernier a quitté la rue Saint-Marc. Ces deux excellents professeurs, qui auraient été trop à l’étroit dans l’ancienne salle de Robert aîné, ont créé, sous la présidence du général des Essarts, un cercle d’escrime qui compte de bons et nombreux élèves. Leur salle est coquette et très confortablement installée.
Chaque année ont lieu des assauts qui sont fort suivis, par le soin qu’apportent ces deux maîtres à leur organisation, et aussi par le choix des tireurs qu’ils présentent au public d’élite qui assiste toujours à ces fêtes. Désiré Robert est un vrai maître, qui a été formé à l’école de son père, c’est-à-dire à celle de La Boëssière, et aux grandes traditions du XVIIIE siècle. Très petit de taille, il a le teint bistré du créole et les cheveux absolument crépus. C’est un homme jeune encore, âgé de trente-cinq ans environ, très intelligent et très sympathique.





























