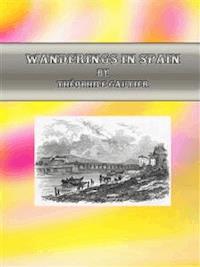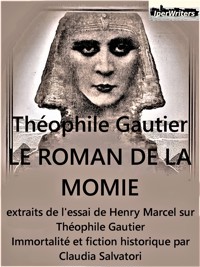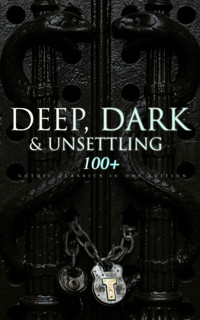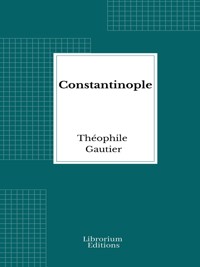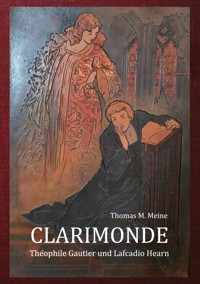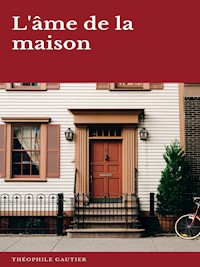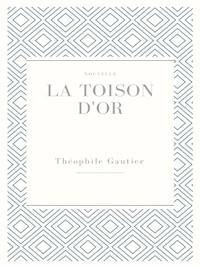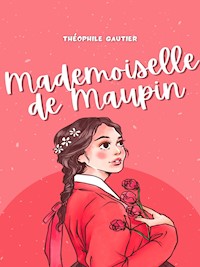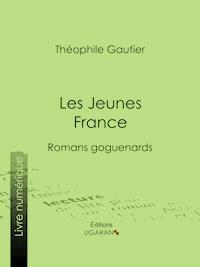
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les Jeunes France, écrit par Théophile Gautier, est un livre emblématique du mouvement romantique français du XIXe siècle. Publié en 1833, cet ouvrage nous plonge dans l'univers bohème et excentrique des jeunes artistes parisiens de l'époque.À travers une série de portraits, Gautier nous dépeint avec une plume vive et colorée les personnages hauts en couleur qui peuplent ce milieu artistique. Des poètes, des peintres, des musiciens, tous animés par une soif de liberté et de créativité, se réunissent dans les cafés et les salons pour échanger leurs idées et leurs passions.
Les Jeunes France est un véritable témoignage de l'effervescence artistique de l'époque, où l'individualisme et la recherche de l'originalité étaient érigés en valeurs suprêmes. Gautier nous fait découvrir les aspirations, les amours tumultueuses, les rêves et les désillusions de ces jeunes artistes, qui cherchent à se démarquer de la société conventionnelle et à vivre pleinement leur art.
Ce livre, à la fois critique et admiratif, nous offre une plongée captivante dans le Paris romantique du XIXe siècle. Les Jeunes France est un incontournable pour tous les amateurs de littérature romantique, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art et à la bohème artistique.
Extrait : "Qu'est-ce que la vertu ? moins que rien, un motA rayer de la langue. Il faudrait être sot
Comme un provincial débarqué par le coche
Pour y croire. Un filou, la main dans votre poche,
Concourra pour le prix Monthyon. Chaude encor
D'adultères baisers payés au poids de l'or,
Votre femme dira je suis honnête femme.
Mentez, pillez, tuez, soyez un homme infâme,
Ne croyez pas en Dieu, vous serez marguillier ;
Et quand vous serez mort un joyeux héritier …"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PIERROT.
Je te dis toujours la même chose, parce que c’est toujours la même chose ; et si ce n’était pas toujours la même, chose, je ne te dirais pas toujours la même chose.
Le Festin de Pierre.
Ceci en vérité, mon cher monsieur ou ma belle dame, n’est autre chose qu’une préface et une préface fort longue : je n’ai pas la moindre envie de vous le dissimuler ou de vous en demander pardon. Je ne sais si vous avez la fatuité de ne pas lire les préfaces ; mais j’aime à supposer le contraire, pour l’honneur de votre esprit et de votre jugement. Je prétends même que vous me remerciez de vous en avoir fait une ; elle vous dispense de deux ou trois contes plus ou moins fantastiques que vous eussiez eus sans cela, et vous conviendrez, si récalcitrant que vous soyez, que ce n’est pas une mince obligation que vous m’en devez avoir. J’espère que celle-ci tiendra la moitié du volume : j’aurais bien voulu qu’elle le remplît tout entier, mais mon éditeur m’a dit qu’on était encore dans l’habitude de mettre quelque chose après, pour avoir le prétexte de faire une table. C’est une mauvaise habitude ; on en reviendra. Qu’est-ce qui empêche de mettre la préface et la table côte à côte sans le remplissage obligé de roman ou de contes ? Il me semble que tout lecteur un peu imaginatif supposerait aisément le milieu à l’aide du commencement et de la fin ; sa fiction vaudrait probablement mieux que la réalité, et d’ailleurs il est plus agréable de faire un roman que de le lire.
Moi, pour mon compte, et je prétends vous convertir à mon système, je ne lis que les préfaces et les tables, les dictionnaires et les catalogues. C’est une précieuse économie de temps et de fatigue : tout est là, les mots et les idées. La préface, c’est le germe ; la table, c’est le fruit : je saute comme inutiles tous les feuillets intermédiaires. Qu’y verrais-je ? des phrases et des formes, que m’importe ! Aussi, depuis deux ans que j’ai fait cette précieuse découverte, je suis devenu d’une érudition effroyable : je ferais honte à Cluvérius, à Saumaise, à dom Calmet, à dom Sanchez, et à tous les dom bénédictins du monde ; je disserterais, comme Pic de la Mirandole, de omni re scibili et quibusdam aliis. Citez-moi quelque chose que je ne sache pas, je vous en défie ; et pour peu que vous usiez de ma méthode, vous arriverez au même résultat que moi.
Il en est des livres comme des femmes : les uns ont des préfaces, les autres n’en ont pas ; les unes se rendent tout de suite, les autres font une longue résistance ; mais tout finit toujours de même… par la fin. Cela est triste et banal ; cependant que diriez-vous d’une femme qui irait se jeter tout d’abord à votre tête ? Vous lui diriez comme le More de Venise à Desdemona :
…. à bas, prostituée.
Cette femme serait une catin sans vergogne : pourquoi voulez-vous donc qu’un livre soit plus effronté qu’une femme, et qu’il se livre à vous sans préliminaire ? Il est vrai que la fille que vous louez six francs n’y fait pas tant de façons, et vous avez acheté le livre vingt sous de plus que la fille. Il est à vous, vous pouvez en user et en abuser ; vous n’accorderez pas même à sa virginité le quart d’heure de grâce, vous le touchez, vous le maniez, vous le traînez de votre table à votre lit, vous rompez sa robe d’innocence, vous déchirez ses pages : pauvre livre !
La préface, c’est la pudeur du livre, c’est sa rougeur, ce sont les demi-aveux, les soupirs étouffés, les coquettes agaceries, c’est tout le charme ; c’est la jeune fille qui reste longtemps à dénouer sa ceinture et à délacer son corset avant d’entrer au lit où son amoureux l’attend.
Quel est le stupide, quel est l’homme assez peu voluptueux pour lui dire : Dépêche-toi !
D’autant que le corset et la chemise dissimulent souvent une épaule convexe et une gorge concave, d’autant que la préface cache souvent derrière elle un livre grêle et chétif.
Ô lecteurs du siècle ! ardélions inoccupés qui vivez en courant et prenez à peine le temps de mourir, plaignez-vous donc des préfaces qui contiennent un volume en quelques pages, et qui vous épargnent la peine de parcourir une longue enfilade de chapitres pour arriver à l’idée de l’auteur. La préface de l’auteur, c’est le post-scriptum d’une lettre de femme, sa pensée la plus chère : vous pouvez ne pas lire le reste.
Pourtant, n’allez pas inférer de ce que je viens de dire qu’il y ait une idée dans celle-ci, je serais désespéré de vous induire en erreur : je vous jure sur ce qu’il y a de plus sacré. Y a-t-il encore quelque chose de sacré ? Je vous jure sur mon âme, à laquelle je ne crois guère ; sur ma mère, à laquelle je crois un peu plus, qu’il n’y a réellement pas plus d’idée dans ma préface que dans un livre quelconque de M. Ballanche ; qu’il n’y a ni mythe, ni allégorie, que je n’y fonde pas de religion nouvelle comme M. G. Drouineau, que ce n’est pas une poétique ni quoi que ce soit qui tende à quelque chose, je n’y fais même pas l’apologie de mon ouvrage. Vous voyez bien que ma préface ne ressemble en rien à ses sœurs les autres préfaces.
Seulement je profite de l’occasion pour causer avec vous, je fais comme ces bavards impitoyables qui vous prennent par un bouton de votre habit, monsieur ; par le bout de votre gant blanc, madame, et vous acculent dans un coin du salon pour se dégorger de toutes les balivernes qu’ils ont amassées pendant un quart d’heure de silence. En honneur, ce n’est pas pour autre chose. Je n’ai pas grand-chose à faire ni vous non plus, je pense. Je m’en vais donc me raconter à vous de point en point, et vous faire moi-même ma biographie : il n’y aura pas plus de mensonges que dans tout autre… ni moins.
Avant de vous dire ma vie, vous me permettrez d’abord de vous toucher quelque chose des motifs qui m’ont porté à faire noires trois ou quatre cents pages blanches qui ne l’ont pas mérité.
Je suis un homme d’esprit, et j’ai pour amis des gens qui ont tous infiniment d’esprit, autant d’esprit que M. H. Delatouche et M. Loève-Veimars. Tous ces gens-là ont fait un livre ou même en ont fait deux ; il y en a un qui est coupable de trois. Moi, jusqu’à ce jour, je m’étais conservé vierge de toute abomination écrite ou imprimée, et chacun était libre de me croire autant de talent qu’il lui plaisait. Je jouissais dans un certain monde d’une assez honnête gloire inédite. J’étais célèbre depuis la cheminée jusqu’au paravent, je faisais un grand bruit dans quelques pieds carrés.
Alors quelques officieux sont venus qui m’ont dit : Il faut faire un livre. Je l’ai fait, mais sans prétention aucune, je vous prie de le croire, comme une chose qui ne mérite pas la peine qu’on s’en défende, comme on demande la croix d’honneur pour ne pas être ridicule, pour être comme tout le monde. Il est indécent aujourd’hui de ne pas avoir fait un livre, un livre de contes tout au moins : j’aimerais autant me présenter dans un salon sans culotte que sans livre. Il est juste de dire que j’avais déjà fait un volume de vers, mais cela ne compte pas ; c’est un volume de prose de moins, voilà tout. Ne me méprisez donc pas parce que j’ai fait des contes ; j’ai pris ce parti, parce que c’est ce qu’il y a de moins littéraire au monde : à ma place, vous eussiez agi de même pour avoir le repos. Maintenant que me voilà suffisamment compromis, et que j’ai perdu ma virginale réputation, j’espère que mes bons amis me laisseront tranquille.
Je vous le proteste ici, afin que vous le sachiez, je hais de tout mon cœur ce qui ressemble de près ou de loin à un livre : je ne conçois pas à quoi cela sert.
Les gros Plutarques in-folio, témoin celui de Chrysale, ont une utilité évidente ; ils servent à mettre en presse, à défaut de rabats puisqu’on n’en porte plus, les gravures chiffonnées et qui ont pris un mauvais pli ; on peut encore les employer à exhausser les petits enfants qui ne sont pas de taille à manger à table. Quant à nos in-octavos, je veux que le diable m’emporte si l’on peut en tirer parti, et si je conçois pourquoi on les fait.
Il a pourtant été un temps où je ne pensais pas ainsi. Je vénérais le livre comme un dieu, je croyais implicitement à tout ce qui était imprimé ; je croyais à tout, aux épitaphes des cimetières, aux éloges des gazettes, à la vertu des femmes. Ô temps d’innocence et de candeur !
Je m’amusais comme une portière à lire les Mystères d’Udolphe, le Château des Pyrénées, ou tout autre roman d’Anne Radcliffe ; j’avais du plaisir à avoir peur, et je pensais avec Grey que le paradis, c’était un roman devant un bon feu.
Que n’ai-je pas lu ! J’ai épuisé tous les cabinets du quartier. Que d’amants malheureux, que de femmes persécutées m’ont passé devant les yeux ! que de souterrains n’ai-je pas parcourus ! Aussi je suis devenu d’une si merveilleuse sagacité, que dès la première syllabe d’un roman je sais déjà la fin.
On aura beau dire, Notre-Dame de Paris ne vaut pas le Château des Pyrénées.
La belle dame élégante que vous avez maintenant, vous, jeune fashionable blasé, ne vaut pas la femme de chambre de votre mère qui vous a eu il y a dix ans, vous, écolier naïf et tremblant, pauvre chérubin plus timide que celui de Beaumarchais, qui n’osiez pas oser même avec la fille du jardinier.
Le seul plaisir qu’un livre me procure encore, c’est le frisson du couteau d’ivoire dans ses pages non coupées, c’est une virginité comme une autre, et cela est toujours agréable à prendre. Le bruit des feuilles tombant l’une sur l’autre invite immanquablement au sommeil, et le sommeil est après la mort la meilleure chose de la vie.
Je vous ai promis de vous conter mon histoire ; ce sera bientôt fait. J’ai été nourri par ma mère, et sevré à quinze mois ; puis j’ai eu un accessit de je ne sais quoi en rhétorique : voilà les évènements les plus marquants de ma vie. Je n’ai pas fait un seul voyage, je n’ai vu la mer que dans les marines de Vernet ; je ne connais d’autres montagnes que Montmartre. Je n’ai jamais vu se lever le soleil, je ne suis pas en état de distinguer le blé de l’avoine. Quoique né sur les frontières d’Espagne, je suis un Parisien complet, badaud, flâneur, s’étonnant de tout, et ne se croyant plus en Europe dès qu’il a passé la barrière. Les arbres des Tuileries et des boulevards sont mes forêts, la Seine mon Océan. Du reste, je vous avouerai franchement que je me soucie assez peu de tout cela ; je préfère le tableau à l’objet qu’il représente, et je serais bien capable de m’écrier, comme madame de Staël devant le lac de Genève : Ô le ruisseau de la rue Saint-Honoré !
Je ne comprends pas quel plaisir champêtre peut valoir celui de regarder les caricatures au vitrage de Martinet ou de Susse, et je ne trouve pas le soleil de beaucoup supérieur au gaz. Une fois, quelques-uns de mes amis sont venus me chercher, et m’ont emmené avec leurs maîtresses, je ne sais où, sur les limites du monde, comme j’imagine, car nous restâmes trois heures en voiture. On dîna sur l’herbe : ces dames et ces messieurs eurent l’air d’y prendre un grand plaisir ; quant à moi, je me souhaitais ailleurs. Des faucheux avec leurs pattes grêles arpentaient sans façon les assiettes, les mouches tombaient dans nos verres, les chenilles nous grimpaient aux jambes. J’avais un superbe pantalon de coutil blanc, je me relevai avec une indécente plaque verte au derrière. Je touchai par mégarde je ne sais quelles herbes, c’étaient des orties, il me vint des cloches ; je me manquai casser le cou en sautant un fossé ; j’eus le lendemain une belle et bonne courbature : cela s’appelle une partie de plaisir !
Je déteste la campagne : toujours des arbres, de la terre, du gazon. Qu’est-ce que cela me fait ? c’est très pittoresque, d’accord, mais c’est ennuyeux à crever.
Le murmure des ruisseaux, le ramage des oiseaux, et tout l’orchestre de l’églogue et de l’idylle, ne me font aucun plaisir ; je dirais volontiers comme Deburau au rossignol : Tais-toi, vilaine bête.
Ma vie a été la plus commune et la plus bourgeoise du monde, pas le plus petit évènement n’en coupe la monotonie ; c’est au point que je ne sais jamais l’année, le mois, le jour ou l’heure. En effet, eh ! qu’importe ? 1833 ne sera-t-il pas semblable à 1832 ? hier n’a-t-il pas été comme est aujourd’hui et comme sera demain ? Qu’il soit matin ou soir, n’est-ce pas la même chose ? Manger, boire, dormir, dormir, boire, manger, aller de son fauteuil à son lit, de son lit à son fauteuil, sans souvenir de la veille, sans projet pour demain ; vivre à l’heure, à la minute, à la seconde, cramponné au moment comme un vieillard qui n’a plus qu’un moment : voilà où j’en suis arrivé, et j’ai vingt ans. Pourtant j’ai un cœur et des passions, j’ai de l’imagination autant et plus qu’un autre, peut-être. Mais que voulez-vous ! je n’ai pas assez d’énergie pour secouer cela : comme tout vieux garçon, j’ai chez moi une servante-maîtresse qui me domine, et fait de moi ce qu’elle veut : c’est l’habitude.
L’habitude qui vous tient au cachot, dans une chambre ouverte, qui vous fait manger quand vous n’avez pas faim, qui vous éveille quand vous avez encore sommeil, qui tire comme avec un fil votre bras et votre jambe, qui fait mouvoir sous vous vos pieds malgré vous, qui vous traîne par les cheveux dans un endroit où vous vous ennuyez mortellement, qui vous remet entre les doigts le livre que vous savez par cœur.
Je n’ai jamais tué de sergent de ville, je n’ai jamais eu affaire aux gendarmes et aux gardes municipaux, je n’ai pas été à Sainte-Pélagie, je ne me suis jamais suicidé par désespoir d’amour ou toute autre raison, je n’ai signé aucune protestation, je n’ai eu ni duels ni maîtresses.
J’ai bien eu quelquefois un tiers ou un quart de femme, comme l’on a un tiers ou un quart de vaudeville ; mais cela ne compte pas, et ne vaut pas la peine d’être mentionné.
Je n’ai chez moi ni pipe, ni poignard, ni quoi que ce soit qui ait du caractère.
Je suis le personnage du monde le plus uni et le moins remarquable ; je n’ai rien d’artiste dans mon galbe, rien d’artiste dans ma mise ; il est impossible d’être plus bourgeois que je ne le suis. Vous m’avez vu cent fois, et ne me reconnaîtriez pas.
Mon mérite littéraire est très mince, et je suis trop paresseux pour le faire valoir. Je n’ai pas ajouté à mon prénom une désinence en us, je n’ai pas échangé mon nom de tailleur et de bottier contre un nom moyen-âge et sonore. Ni mes vers, ni ma prose, ni moi, n’avons un seul poil de barbe. Aussi beaucoup de gens ne veulent-ils pas croire que je suis réellement un génie, à me voir si bénin, si paterne, si peu insolent, si comme le premier venu, comme vous ou tout autre. Je ne tutoie et n’appelle par son nom de baptême aucun des illustres du jour ; je n’ai aucune pièce refusée ou tombée à aucun théâtre, je n’ai encore ruiné aucun libraire. Vous voyez que ma modestie est fondée, et que je n’ai pas de quoi faire le fier. Aucun journal, en parlant pour la première fois de moi, ne m’a désigné ainsi qu’il se pratique, le célèbre M. un tel. Je pourrais mourir demain, qu’excepté ma mère qui pleurerait, il ne resterait aucune trace de mon passage sur la terre. Mon épitaphe serait bientôt faite : Né-mort.
Je ne suis rien, je ne fais rien ; je ne vis pas, je végète ; je ne suis pas un homme, je suis une huître.
J’ai en horreur la locomotion, et j’ai bien souvent porté envie au crapaud qui reste des années entières sous le même pavé, les pattes collées à son ventre, ses grands yeux d’or immobiles, enfoncé dans je ne sais quelles rêveries de crapaud qui doivent bien avoir leur charme, et dont il devrait bien nous faire un livre.
Je partage l’avis des Orientaux : il faut être chien ou Français pour courir les rues quand on peut rester assis bien à son aise chez soi. N’était la circoncision, je me ferais Turc, je serais, certes, un excellent pacha. Par vingt-cinq degrés de chaleur, je suis capable de porter autant de caftans, de schalls et de fourrures qu’Ali, ou Rhegleb, ou tout autre. Les pachas aiment les tigres, moi j’aime les chats : les chats sont les tigres des pauvres diables, hormis les chats.
Je n’aime rien, je n’ai envie de rien ; je n’ai qu’un sentiment et qu’une idée, c’est que j’ai froid et que je m’ennuie.
Aussi je me chauffe à me géographier les jambes, je brûle mes pantoufles ; mes volets sont doubles, mes rideaux doubles, mes portes rembourrées. Ma chambre est un four, je cuis ; mais, malheureusement, il est plus difficile de se préserver de l’ennui que du froid.
Quoi faire ? rêver ? on ne peut toujours rêver : lire ? j’ai dit que je savais tout : quoi donc ?
Je n’ai jamais pu apprendre à jouer aux cartes ni aux dames, et encore moins aux échecs ; je n’ai pu m’élever à la hauteur du casse-tête chinois ; c’est pourquoi, n’étant bon à rien, je me suis mis à faire des vers. Je n’ai guère eu plus de plaisir à les aligner que vous à les lire… si vous les avez lus.
Je vous jure, en tout cas, que c’est un piètre divertissement, et que vous feriez bien d’en chercher un autre.
On m’a dit plusieurs fois qu’il faudrait faire quelque chose, penser à mon avenir. Le mot n’est-il pas ridicule dans notre bouche, à nous qui ne sommes pas sûrs d’une heure ? qu’il faudrait prendre un état, ne fût-ce que pour avoir un titre et une étiquette comme un bocal d’apothicaire. Que je ne pouvais pas n’être rien, que cela ne s’était jamais vu ; que ceux qui n’étaient rien en effet, cherchaient à se souffler eux-mêmes et à se faire quelque chose. À quoi j’ai répondu que cela serait rare et curieux de pouvoir et ne pas vouloir, et de fermer la porte au nez de la fortune qui viendrait y frapper d’elle-même.
D’ailleurs, il n’y a que trois états possibles dans une civilisation aussi avancée que la nôtre : voleur, journaliste ou mouchard : je n’ai ni les moyens physiques, ni les moyens intellectuels qu’exigent ces trois genres d’industrie. J’aurais assez aimé être voleur, c’est de la philosophie éclectique ; mais, on a trop de mal, comme disait feu Martainville. Je ne pense pas que j’eusse pu faire un mouchard remarquable, je suis trop distrait, j’ai la vue très basse et l’ouïe un peu dure. Ensuite, depuis que les honnêtes gens s’en mêlent, le métier ne va plus. Pour journaliste, j’aurais peut-être réussi, avec beaucoup de travail, à ne pas faire tache dans les Petites-Affiches, ou même dans la plus célèbre de nos revues. Mais je déclare formellement que je ne résisterais pas à plusieurs vaudevilles consécutifs, et que pour rien au monde je ne me battrais en duel, ayant naturellement peur des coups autant et plus que tout autre.
Dans cette perplexité grande, et pour céder à de fréquentes importunités, j’ai suivi une grande quantité de représentations de l’Auberge des Adrets, pour me choisir un état parmi ceux que se donnent chaque soir Frédérick et Serres : dans leur nomenclature variée, je n’ai rien trouvé qui me convînt. Nourrisseur de vers à soie, philhellène, fabricant de clyssoirs et de seringues à musique, professeur de philosophie, chef suprême de la religion saint-simonienne, répétiteur des chiens savants pour les langues mortes, tous ces états-là réclament des connaissances spéciales que je n’ai pas, et que je suis incapable d’acquérir. Ainsi, n’étant bon à rien, pas même à être Dieu, je fais des préfaces et des contes fantastiques ; cela n’est pas si bien que rien, mais c’est presque aussi bien, et c’est quasi-synonyme.
Je ne sais pas si cela vient de mon caractère qui tourne un peu à l’hypocondrie, ou de ma position dans le monde ; mais je n’ai jamais pu croire et m’intéresser sérieusement à quelque chose ; et je pourrais retourner à mon usage le vers de Térence :
Homo sum nihil a me humani alienum puto.
Par suite de ma concentration dans mon ego, cette idée m’est venue maintes fois que j’étais seul au milieu de la création que le ciel, les astres, la terre, les maisons, les forêts, n’étaient que des décorations, des coulisses barbouillées à la brosse, que le mystérieux machiniste disposait autour de moi pour m’empêcher de voir les murs poudreux et pleins de toiles d’araignées de ce théâtre qu’on appelle le monde.
Que les hommes qui se meuvent autour de moi ne sont là que comme les confidents des tragédies, pour dire Seigneur, et couper de quelques répliques mes interminables monologues.
Quant à mes opinions politiques, elles sont de la plus grande simplicité. Après de profondes réflexions sur le renversement des trônes, les changements de dynasties, je suis arrivé à ceci – o.
Qu’est-ce qu’une révolution ? des gens qui se tirent des coups de fusil dans une rue : cela casse beaucoup de carreaux ; il n’y a guère que les vitriers qui y trouvent du profit. Le vent emporte la fumée : ceux qui restent dessus mettent les autres dessous ; l’herbe vient là plus belle le printemps qui suit ; un héros fait pousser d’excellents petits pois.
On change aux bâtons des mairies les loques qu’on nomme drapeau. La guillotine, cette grande prostituée, prend au cou avec ses bras rouges ceux que le plomb a épargnés, le bourreau continue le soldat, s’il y a lieu, ou bien le premier drôle venu grimpe furtivement au trône, et s’asseoit dans la place vide. Et l’on n’en continue pas moins d’avoir la peste, de payer ses dettes, d’aller voir des opéras comiques sous celui-là comme sous l’autre. C’était bien la peine de remuer tant d’honnêtes pavés qui n’en pouvaient mais.
Quant à mon opinion sur l’art, je pense que c’est une jonglerie pure, et je suis parfaitement de l’avis d’Arnal : cela s’appelle des artistes. Ces baladins sont-ils fiers ! En fait d’artistes, je n’estime que les acrobates. Il faut véritablement dix fois plus d’art pour danser sur la corde lâche que pour faire cent poèmes épiques, et vingt charretées de tragédies en cinq actes et en vers.
Quant à ce qui est de la morale, rien ne m’a paru plus insignifiant que les vices de l’homme, si ce n’est la vertu de la femme.
Lecteur, vous me savez maintenant sur le bout du doigt. Voilà ce que je suis, ou plutôt ce que j’étais il y a trois mois, car je suis fort changé depuis quelque temps. Deux ou trois de mes camarades, voyant que je devenais tout à fait ours et maniaque, se sont emparés de moi et se sont mis à me former : ils ont fait de moi un jeune France accompli. J’ai un pseudonyme très long et une moustache fort courte ; j’ai une raie dans les cheveux à la Raphaël. Mon tailleur m’a fait un gilet… délirant. Je parle art pendant beaucoup de temps sans ravaler ma salive, et j’appelle bourgeois tous ceux qui ont un col de chemise. Le cigare ne me fait plus tousser ni pleurer, et je commence à fumer dans une pipe assez crânement et sans trop vomir. Avant-hier, je me suis grisé d’une manière tout à fait byronienne ; j’en ai encore mal à la tête : de plus, j’ai fait acquisition d’une mignonne petite dague en acier de Toscane, pas plus longue qu’un aiguillon de guêpe, avec quoi je trouerai tout doucettement votre peau blanchette, ma belle dame, dans les accès de jalousie italienne que j’aurai quand vous serez ma maîtresse, ce qui arrivera indubitablement bientôt. On m’a présenté dans plusieurs salons, par devant plusieurs coteries, depuis le bleu de ciel le plus clair jusqu’à l’indigo le plus foncé. Là, j’ai entendu infiniment de cinquièmes actes, et encore plus d’élégies sur le malheur d’être abandonné par son ou ses amants. J’en ai moi-même récité un nombre incalculable. Je me culotte, comme disent mes dignes amis, et il paraît que je deviens un homme à la mode. Mes deux cornacs prétendent même que j’ai eu plusieurs bonnes fortunes : soit, puisqu’on est convenu d’appeler cela ainsi.
Comme je suis naturellement olivâtre et fort pâle, les dames me trouvent d’un satanique et d’un désillusionné adorable ; les petites filles se disent entre elles que je dois avoir beaucoup souffert du cœur : du cœur peu, mais de l’estomac passablement.
Je suis décidé à exploiter cette bonne opinion qu’on a de moi. Je veux être le personnage cumulatif de toutes les variétés de don Juan, comme Bonaparte l’a été de tous les conquérants.
Les trois mille noms charmants seront dépassés de beaucoup. Le Don Juan de Molière n’est qu’un Céladon auprès de moi ; celui de Byron un misérable cokney : le Zaffye d’Eugène Sue est innocent comme une rosière. J’ai préparé, pour y inscrire mes triomphes, un livre blanc beaucoup plus gros que celui de Joconde et du prince Lombard ; j’ai fait emplette de quelques rames de papier à lettres azuré, de bâtons de cire rose et aventurine pour répondre aux billets doux qu’on m’écrira. Je n’ai pas oublié une échelle de soie : l’échelle de soie est de première importance, car je n’entrerai plus maintenant dans les maisons que par les fenêtres.
Personne ne me résistera : j’aurai mille scélératesses charmantes et inédites, mille roueries si machiavéliques, je serai si fatal et si vague, j’aurai l’air si ange déchu, si volcan, si échevelé, qu’il n’y aura pas moyen de ne pas se rendre. Votre femme elle-même, mon cher lecteur, votre maîtresse, si vous avez l’une ou l’autre, ou même les deux, ne pourront s’empêcher de dire en joignant les mains : Pauvre jeune homme !
Que je sois damné si, dans six mois, je ne suis pas le fat le plus intolérable qu’il y ait d’ici à bien loin.
Il ne me manque vraiment que d’être bâtard pour que je sois parfait. Au diable les vers, au diable la prose ! je suis un viveur maintenant, je ne suis plus l’hypocondre qui en fourgonnant son feu entre ses deux chats, faisait un tas de sottes rêvasseries à propos de tout et de rien. Avant qu’il soit longtemps, je prétends me faire un matelas de toutes les boucles blondes ou brunes dont mes beautés m’auront fait le sacrifice. Vous verrez, vous verrez ! d’un amour à l’autre, je vous écrirai pour me reposer de belles histoires adultérines, de beaux drames d’alcôve, auprès desquels Antony sera tout à fait enfantin et Florian. Pourtant je venais tout à l’heure d’envoyer les vers et la prose au diable ; ce que c’est que les mauvaises habitudes, on y revient toujours. Sur ce, monsieur, je vous salue avec tout le respect que l’on doit à un honnête lecteur. Madame, je vous baise les mains, et dépose mes hommages à vos pieds.
DIALOGUE BACCHIQUE
SUR PLUSIEURS QUESTION DE HAUTE MORALE.
LA FARCE DU MONDE, Moralité.
Il pouvait bien être deux heures du matin. La bougie, non mouchée, avait un pied de nez ; le feu était presque éteint.
Mon ami Théodore, accoudé sur sa table avec une désinvolture toute bacchique, fumait une pipe courte et noire noblement culottée, un digne brûle-gueule à faire envie à un caporal de la vieille garde.
De temps en temps il déposait sa pipe, et se donnait gravement à boire par-dessus l’épaule, ou à côté de la bouche, ou se versait d’une bouteille vide, ou laissait tomber son verre plein ; bref, notre ami Théodore était complètement ivre.
Et cela n’eût paru étonnant à personne, à voir la longue file
À moins qu’il n’en eût jeté le contenu par la fenêtre, ce qui est peu probable, il devait mathématiquement et logiquement être ivre-mort. Il y aurait eu de quoi griser un tambour-major et deux sonneurs, et notre ami Théodore était seul.
Je l’avoue en rougissant, il était seul, malgré le célèbre adage : Celui qui boit seul est indigne de vivre. Adage si religieusement suivi dans tout état un peu civilisé.
Il était seul, c’est-à-dire il le paraissait ; car un soupir profond, parti de dessous la table, vint révéler tout à coup un compagnon chaviré, et rendre plus facile à expliquer le nombre formidable de flacons vides ou brisés qui encombraient le guéridon et la table.
Théodore laissa tomber de haut, et avec un air d’ineffable pitié, un regard incertain et hébété sur la masse informe qui se remuait dans l’ombre, et aspira bruyamment une gorgée de fumée.
– Oh ! Théodore, ton chien de carreau est dur comme un cœur de femme ; tends-moi la main, que je me relève et que je boive : j’ai soif.
– Si tu veux, je vais te passer ton verre, répondit Théodore, sentant dans sa conscience qu’il était au-dessus de ses forces de relever son camarade. Peut-on se soûler comme celui ! – Fi, l’ivrogne ! ajouta-t-il par manière de réflexion.
– Âme dénaturée, reprit avec un sérieux comique la voix d’en bas, tu ne veux pas me relever ? Mettez donc après cela des lampions sur la tête aux gens, de peur que les voitures ne les écrasent quand ils tombent aux coins des bornes pour avoir oublié de tremper leur vin ce jour-là : on ne m’y reprendra plus. Ingrat !
Théodore, sensiblement ému et attendri par ce touchant souvenir, se décida à tenter la périlleuse opération de remettre son ami sur sa chaise ; mais le succès ne couronna pas cette pieuse entreprise, il fit le plongeon entre la table et le banc, et disparut.
Ce fut pendant quelques minutes des grognements sourds et étouffés ; car Théodore était précisément tombé sur l’estomac de son estimable camarade, et il lui pesait plus qu’un remords ; cependant, après des efforts inouïs, ils parvinrent à se mettre dans une position un peu moins incommode, et le calme se rétablit.
Après un silence assez long : – Hélas ! fit Roderick.
– Qu’as-tu, mon cher ami ? dit Théodore avec toute l’effusion caractéristique des ivrognes.
– Je suis bien malheureux !
– Est-ce que ta maîtresse t’a planté là ?
– Au contraire, mon ami, la pauvre femme n’est pas capable de cela ; c’est bien, pour mon malheur, la plus vertueuse créature qui soit.
– Voilà un singulier reproche.
– On voit bien que tu as le bonheur, toi, d’avoir pour maîtresse une catin.
– Singulier bonheur !
– Certainement, mais tu n’es pas à même de le comprendre ; tu n’as jamais eu que des filles ou des femmes entretenues, ou tout au plus des grisettes. Tu n’as jamais descendu jusqu’à l’honnête femme, tu ne sais pas ce qui en est. Par honnête femme, je n’entends pas, ce qu’on entend généralement par là, une femme qui a un mari, un cachemire, qui loge au premier, et ne se permet guère qu’un amant à la fois.
– Qu’est-ce donc alors ? dit l’autre en se soulevant sur le coude avec une stupéfaction profonde.
– Ce n’est pas même celle qui n’a pas d’amant du tout.
– Humph ! fit Théodore, comme un homme dont la conviction est tout à fait troublée.
– Ô mon ami ! j’en suis mortifié pour toi, tu es un âne, et tu ne seras probablement pas autre chose d’ici à bien longtemps.
À cet endroit de son apostrophe, Roderick fit un hoquet hasardeux, et s’interrompit un instant ; mais il reprit bientôt le fil de son discours avec une grâce toute particulière en imitant l’accent de Frédéric dans l’Auberge des Adrets. Tu n’entends rien, absolument à la triture des affaires, et tu ne possèdes pas le moindre rudiment de métaphysique ; ta philosophie est diablement en arrière, et je suis fâché de le dire, avec de belles dispositions, tu ne parviendras jamais à rien.
Théodore soupira.
– Qu’est-ce que la vertu, Théodore ?
– Que sais-je ?
– Ceci est du Montaigne, et c’est ce que tu as dit de plus raisonnable depuis que tu abuses de la langue que Dieu t’a donnée. Brutus définit la vertu un nom. En vérité, si ce n’est qu’un nom, jamais cinq lettres ne se sont donné rendez-vous dans deux misérables syllabes pour former un mot plus insignifiant. Du reste, s’il est permis à quelqu’un qui n’est pas vaudevilliste de faire un pitoyable calembour, la vertu n’est pas un nom, mais un non, indéfiniment prolongé.
Théodore, effaré, souffla par ses narines comme un hippopotame, et redoubla d’attention.
Roderick continua : – Oui, mon ami, la vertu est essentiellement négative. Être vertueux, qu’est-ce autre chose que dire non à tout ce qui est agréable dans cette vie, qu’une lutte absurde avec les penchants et les passions naturelles, que le triomphe de l’hypocrisie et du mensonge sur la vérité ? Quand les états reposaient sur des fictions, il y avait besoin de vertus fictives, sans quoi ils n’auraient pu vivre ; mais dans un siècle aussi positif, sous une monarchie constitutionnelle, entourée d’institutions républicaines, il est indécent et de mauvais ton d’être vertueux, il n’y a que les forçats qui le soient. Quant aux femmes honnêtes, la race en est perdue ; elles sont toutes au Père Lachaise ou ailleurs : les épitaphes en font foi.
– Mais il me semble que tu as dit tout à l’heure, Roderick, que ta maîtresse était vertueuse ?
– Benêt ! quand on dit que toutes les femmes sont des catins, il est toujours sous-entendu qu’on excepte sa mère et sa maîtresse : ainsi, ton observation n’a pas le sens commun.
– Pourtant, répliqua timidement Théodore, j’ai fait cet hiver la cour à une femme pendant quinze jours, et je ne l’ai pas eue.
– Si tu lui avais fait la cour seize jours au lieu de quinze, le résultat eût peut-être été tout différent. Tu t’es en allé au moment où elle t’allait céder par amour ou par ennui ; car l’ennui est au moins de moitié dans les conquêtes que nous faisons. D’ailleurs, bien que ton gilet soit d’une coupe irréprochable, et que tu fasses siffler ta cravache assez fashionablement, tu n’es encore qu’un médiocre Don Juan, et tu n’entends rien au fin des choses : tu n’es guère capable que de faire de la corruption de seconde main ; tu entres assez effrontément dans les âmes dont la serrure est forcée, mais tu ne sais pas forcer toi-même la serrure ; il faut un voleur plus adroit que toi pour ouvrir la porte et enlever le trésor. Que ce soit avec une clef ou un rossignol que l’on l’ouvre, peu importe ; mais, toi, tu n’es pas en état de trouver la clef véritable, ou d’en forger une fausse. Cette femme, dont tu me parlais, était peut-être dans ce cas. Sans doute, elle m’aurait cédé à moi ou à un autre. Ton exemple ne prouve rien ; tout est relatif. Je n’ai pas voulu dire qu’une femme était catin pour tout le monde, j’ai seulement voulu dire qu’elle n’était pas vertueuse pour tout le monde, ce qui est bien différent. Une femme qui serait vertueuse pour tous et à tous les instants, serait une monstruosité : ces monstruosités-là sont rares fort heureusement.
– Ma tante Gryselde, interrompit Théodore, était certainement une honnête femme.
– Mon digne ami, je ne sais pas à quoi ton père et ta mère pensaient en te faisant ; mais certainement ils pensaient à autre chose : ils ont manqué ta cervelle. Ta tante Gryselde, que tu cites, était bossue, rousse, borgne et brèche-dents, elle n’a pas dû être beaucoup sollicitée ; ce qui ne prouve pas qu’elle n’ait sollicité elle-même, car l’âne regimbe, et la chair est plus éloquente que l’esprit.
– Tu es donc matérialiste, ô Roderick ?
– Je le suis, tous les hommes d’esprit le sont ; c’est plus sûr. Tu devrais bien l’être aussi, car il est bien évident qu’il existe cent et quelques livres de chair qu’on nomme Théodore, et l’existence de son esprit est au moins problématique, à entendre la sotte conversation que nous menons ensemble.