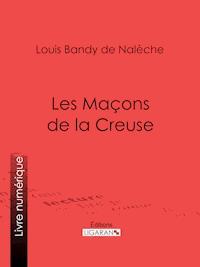
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'amour du changement, l'espoir d'un sort meilleur, ont déterminé les premières émigrations. Sous cette double influence, la terre entière a été explorée, des colonies ont été fondées, tous les habitants du globe sont devenus solidaires. De nos jours les émigrations ont un motif plus accablant, la nécessité de vivre. Les statistiques de la misère démontrent que les nations civilisées produisent plus d'hommes que l'agencement social ne leur permet d'en nourrir."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’amour du changement, l’espoir d’un sort meilleur, ont déterminé les premières émigrations. Sous cette double influence, la terre entière a été explorée, des colonies ont été fondées, tous les habitants du globe sont devenus solidaires.
De nos jours les émigrations ont un motif plus accablant, la nécessité de vivre. Les statistiques de la misère démontrent que les nations civilisées produisent plus d’hommes que l’agencement social ne leur permet d’en nourrir, et qu’elles doivent, sous peine de mourir, se défaire du trop-plein qui les étouffe.
On observe surtout ce phénomène en Allemagne, où l’émigration à l’étranger a passé dans les mœurs et n’excite plus la moindre récrimination. La division du sol ne pouvant excéder une certaine limite, les propriétaires se résignent d’avance à envoyer quelques-uns de leurs enfants chercher fortune ailleurs.
Les Allemands ont commencé par exploiter les pays qui les joignent, la France, l’Italie, la Russie principalement ; mais la population augmentant dans une proportion telle que les nations limitrophes s’encombraient elles-mêmes, ils se sont portés vers des contrées plus lointaines, et l’Afrique et l’Amérique sont actuellement leur double refuge.
Si l’homme est appelé à fertiliser la terre entière, si la patrie est là où l’on peut vivre, si enfin le respect de la famille est attaché au respect de la propriété, les Allemands ont adopté le plus vrai, le plus solide, le plus logique et en même temps le plus conservateur de tous les principes actuels d’organisation nationale.
Les émigrants Allemands partent sans esprit de retour. Pénétrés d’une sainte vénération pour le patrimoine de leurs ancêtres, ils l’abandonnent plutôt que de l’amoindrir en le divisant, et du même coup débarrassent leur pays natal.
Certaines contrées de l’Espagne, du Piémont, de la Savoie, de la Belgique, sont plus égoïstes dans leurs aspirations. Leurs émigrants ne se sacrifient point à la patrie : ils partent pour un temps, puis reviennent au bout de quinze ou vingt ans cultiver quelques immeubles et chercher dans une vieillesse aisée la récompense de leurs fatigues.
Leur retour ne produit que de minces avantages : car le père enrichi, étant appelé à partager sa fortune entre ses héritiers, chacun de ces héritiers est obligé de s’expatrier à son tour pour combler l’insuffisance de sa portion.
Il existe donc cette différence entre l’Allemagne et les autres pays, qu’en Allemagne l’aisance d’un enfant au moins est assurée et maintient à perpétuité une famille agricole sur le territoire, tandis qu’ailleurs la fortune, constamment individuelle et ne se déversant pas sur la génération subséquente, n’attache au sol aucune famille de travailleurs.
L’Irlande est le pays d’Europe qui fournit proportionnellement le plus d’émigrants, mais l’expatriation des Irlandais tient à des influences particulières. Ils n’ont pas comme les Allemands la certitude de laisser derrière eux des représentants de leurs noms, de leurs idées, de leurs affections ; ils n’ont pas, comme les Piémontais et les Espagnols, la perspective de rapporter plus tard le fruit de leurs travaux et de leurs épargnes.
Ils fuient, la haine dans le cœur, pour se délivrer d’un joug écrasant qui torture leurs consciences. Ne pouvant ni s’instruire à cause des lois compressives, ni se nourrir à cause du morcellement et de la cherté des fermes, ni améliorer leur sort par l’industrie à cause de l’interdiction du commerce des manufactures, les Irlandais cherchent un air libre pour pouvoir respirer à l’aise ; depuis dix ans, plus de 1 100 000 d’entre eux ont quitté l’île.
Au lieu de peser comme un remords sur la nation Anglaise, ce déplacement a rendu d’immenses services et diminué d’une manière considérable le nombre des pauvres à secourir. En 1849 on comptait 620 747 indigents ; en 1855 il n’en restait plus que 86 819.
La France contribue peu aux émigrations extranationales. Sauf les Béarnais, qui se dirigent vers des établissements fondés depuis longtemps à l’étranger, les Français n’aiment pas à se dépayser. Certains moments de fièvre entraînent bien des aventuriers du côté de la Californie, de la Nouvelle-Hollande, mais ils partent au hasard des divers points de l’empire, et ces mouvements accidentels ne présentent aucun caractère de périodicité ni de régularité.
En revanche la France reçoit des travailleurs étrangers qui n’ont pas le courage de se porter où les bras manquent, et qui aiment mieux profiter des libertés industrielles que laisse notre législation. Ces étrangers ont même fini par accaparer certaines branches d’industrie, de telle sorte que leur présence deviendra forcément une cause d’expulsion pour une quantité équivalente de nationaux.
À Paris, par exemple, la presque totalité des poêliers-fumistes, des commissionnaires, des brocanteurs, des colporteurs, beaucoup de domestiques, de porteurs d’eau viennent de la Savoie. La cordonnerie, la maçonnerie occupent un grand nombre d’Allemands ; l’horlogerie, un grand nombre de Suisses, etc.
Il serait brutal de les chasser par des mesures rigoureuses, mais il n’y aurait aucun inconvénient à les choisir seulement en seconde ligne et à donner toujours la préférence aux Français dans les cas de concurrence légitime.
Ces étrangers sont dispensés des services publics, mis en dehors des animosités politiques : de tels avantages suffisent ; les nations encombrées doivent combattre les invasions, dont elles ne profitent jamais, puisque le capital amassé est utilisé ailleurs.
La Russie et l’Espagne sont les deux nations où l’émigration intranationale s’opère sur la plus grande échelle. Les gens soumis à l’abrok, ou émigrants de la Russie centrale, se dirigent vers les villes, par bandes de quinze ou vingt, et sous la direction d’un chef qui prend d’avance l’engagement de les conduire, de les occuper, de veiller sur leur santé, leur moralité, et de partager avec eux les bénéfices des entreprises.
L’émigrant Russe part à dix-huit ans et revient à quarante, à moins que la mort de son père ne le rende chef de famille et ne le rappelle chez lui.
La Vieille-Castille, la Galice, les Asturies, les provinces Basques, envoient leurs paysans dans l’Andalousie, à Séville, à Madrid et jusqu’en Portugal ; et, pour que les champs ne restent point en friche, le retour est fixé aux époques des récoltes et des semences.
Pendant l’absence de leurs époux, les femmes sont chargées de l’aménagement des produits et des soins aux bestiaux. Cette coutume est sans inconvénients, puisqu’elle donne les bénéfices de l’industrie sans laisser péricliter les intérêts de l’agriculture ; aussi l’émigration dure autant que le permettent les forces de l’ouvrier.
En France l’émigration intranationale est fort variée : tantôt, comme dans la plupart des départements où se trouvent de grandes industries, les habitants des campagnes s’établissent dans les villes et profitent des jours de fête pour rapporter à la famille le gain de la semaine ; tantôt, comme dans l’Isère, le Cantal, l’Aveyron, les Alpes surtout, les ouvriers agricoles descendent des montagnes et font irruption sur les petits centres au commencement et jusqu’à la fin de l’hiver, demandant, non du travail, mais l’aumône pour eux, leurs femmes et leurs enfants.
À côté de ces émigrations à petites distances, qui ont pour mobile une occupation provisoire ou une passion de mendicité, il en existe d’autres plus lointaines, plus durables, véritables émigrations du travail, qui ont appelé la sollicitude des économistes, parce qu’elles sont plus spécialement dirigées vers les grandes villes.
M. Le Play a divisé les émigrants à Paris en deux classes : ceux à stations prolongées et ceux à stations périodiques. Les premiers viennent de l’Auvergne, du Rouergue, du Quercy, de l’Alsace. Ils séjournent comme les Savoyards, pendant plusieurs années, et rentrent dans leurs foyers avec un pécule qui leur assure une honnête aisance. Les autres séjournent à Paris pendant les neuf mois les moins froids de l’année, et retournent passer l’hiver dans leurs familles.
Je n’entrerai pas dans le détail de toutes les industries parisiennes exploitées par les émigrants intranationaux ; je me bornerai à l’étude d’une seule, la plus importante, du reste, à cause du grand nombre d’individus qu’elle occupe et qui sont partis du même point. Je veux parler de l’industrie du bâtiment, de la MAÇONNERIE.
Les maçons émigrent à stations périodiques ; ils viennent presque exclusivement de la Marche et du Limousin, c’est-à-dire des départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Leur nombre s’accroît chaque jour, au-delà même des bornes de l’activité industrielle.
Cette émigration change dès l’enfance l’agriculteur en ouvrier, laisse les champs incultes, et jette aveuglément sur certains points des masses d’hommes qui seront un embarras ou un danger aux jours de crise. Arrêter ce mouvement est impossible, l’organiser est essentiel ; mais auparavant il faut le connaître dans ses causes, dans ses résultats. Et peut-être l’organisation de l’émigration industrielle deviendra-t-elle une première solution du problème révolutionnaire : l’organisation du travail.
Né dans la Creuse, émigrant pour ainsi dire moi-même à stations périodiques, j’ai étudié le mal, cherché le remède. Puisse mon œuvre n’être point stérile pour mes compatriotes !
Dans la Marche, le Limousin et la haute Auvergne, l’émigration semble avoir existé de tout temps, ces provinces n’ayant jamais fourni de quoi nourrir leurs habitants.
D’abord les émigrations furent exclusivement guerrières. On partait par troupes et en armes des bords de la Creuse et de la Vienne, comme les barbares partirent plus tard du nord de l’Europe et de l’Asie, pour conquérir des plaines plus fertiles et se substituer aux propriétaires légitimes. L’histoire fait remonter le premier déplacement Marchois à l’an 600 environ avant l’ère chrétienne, sous la conduite du prince Bellovèse, qui envahit le Dauphiné, la Provence et protégea les Phocéens, émigrés d’un autre pays, avec lesquels il fonda Marseille.
Bellovèse ne revenant pas, on pensa dans la Gaule Celtique qu’il était mort ou enrichi, et de nouvelles hordes marchèrent sur ses traces pour le venger ou partager sa prospérité.
Tous les vingt ans à peu près des milliers de volontaires se dirigeaient vers le sud-est, et bientôt les Alpes furent franchies. Grand fut l’étonnement des Romains lorsqu’ils virent apparaître ces bandes indisciplinées, escortées de leurs chiens, vêtues de peaux de loups et armées d’instruments sans nom latin.
Déjà puissants, les Romains commirent l’imprudence de montrer leurs richesses ; alors toute la Gaule se dépeupla sans distinction et envahit l’Italie. Pour se débarrasser de pareils visiteurs, les Italiens songèrent à conquérir eux-mêmes les Gaules, et après d’épouvantables luttes ils y réussirent.
La guerre des Gaules est connue, les massacres qui la signalèrent pendant de longs siècles furent même assez nombreux dans la Marche et le Limousin pour rendre pendant longtemps les émigrations impossibles.
À l’invasion Romaine succéda l’invasion Gothique, puis l’invasion Franque et enfin, pendant un instant, l’invasion Arabe, arrêtée à Poitiers par Charles Martel.
Les envahisseurs, partout où ils passent, tuent généralement assez d’hommes pour équilibrer la population et la production ; c’est ce qui eut lieu pendant les premiers siècles de l’ère chrétienne, à un tel degré même que Charlemagne dut implanter dans la Marche de nouveaux habitants, afin que les terres ne demeurassent point sans maîtres.





























