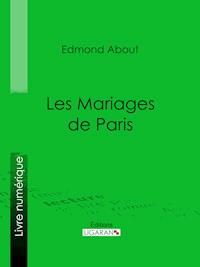
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lorsque j'étais candidat à l'école normale (c'était au mois d'octobre de l'an de grâce 1848), je me liai d'amitié avec d eux de mes concurrents, les frères Debay. Ils étaient Bretons, nés à Auray, et élèves au collège de Vannes. Quoiqu'ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien, et je n'avais vu deux jumeaux si mal assortis."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335096941
©Ligaran 2015
À MADAME L. HACHETTE.
MADAME,
J’ai vu, ces jours passés, un auteur bien en peine. Il avait écrit, au coin du feu, entre sa mère et sa sœur, une demi-douzaine de contes bleus qui pouvaient former un volume. Restait à faire la préface ; car un livre sans préface ressemble à un homme qui est sorti sans chapeau. L’auteur, modeste comme nous le sommes tous, voulait faire l’éloge de son œuvre. Il grillait de dire au public : « Mes contes sont honnêtes, sains et de bonne compagnie ; on n’y trouvera ni un mot grossier, ni une phrase trop court vêtue, ni une de ces tirades langoureuses qui propagent dans les familles la peste du sentiment ; les maris peuvent les prêter à leurs femmes et les mères à leurs filles. » Voilà ce que l’auteur aurait voulu dire : mais il est si malaisé de se louer soi-même, que la préface lui aurait coûté plus de temps que l’ouvrage. Savez-vous alors ce qu’il fit ? Il écrivit sur la première page le nom cher et respecté d’une femme du monde et d’une charmante mère de famille, sûr que ce nom le recommanderait mieux que tous les éloges, et que les lectrices les plus ombrageuses ouvriraient sans défiance un livre qui a l’honneur de vous être dédié.
EDM. ABOUT.
Lorsque j’étais candidat à l’école normale (c’était au mois d’octobre de l’an de grâce 1848), je me liai d’amitié avec deux de mes concurrents, les frères Debay. Ils étaient Bretons, nés à Auray, et élevés au collège de Vannes. Quoiqu’ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien, et je n’ai jamais vu deux jumeaux si mal assortis. Mathieu Debay était un petit homme de vingt-trois ans, passablement laid et rabougri. Il avait les bras trop longs, les épaules trop hautes et les jambes trop courtes : vous auriez dit un bossu qui a égaré sa bosse. Son frère Léonce était un type de beauté aristocratique : grand, bien pris, la taille fine, le profil grec, l’œil fier, la moustache superbe. Ses cheveux presque bleus frissonnaient sur sa tête comme la crinière d’un lion. Le pauvre Mathieu n’était pas roux, mais il l’avait échappé belle : sa barbe et ses cheveux offraient un échantillon de toutes les couleurs. Ce qui plaisait en lui, c’était une paire de petits yeux gris, pleins de finesse, de naïveté, de douceur, et de tout ce qu’il y a de meilleur au monde. La beauté, bannie de toute sa personne, s’était réfugiée dans ce coin-là. Lorsque les deux frères venaient aux examens, Léonce faisait siffler une petite canne à pomme d’argent qui excita bien des jalousies ; Mathieu traînait philosophiquement sous son bras un gros vieux parapluie rouge qui lui concilia la bienveillance des examinateurs. Cependant il fut refusé, comme son frère : le collège de Vannes ne leur avait point appris assez de grec. On regretta Mathieu à l’école : il avait la vocation, le désir de s’instruire, la rage d’enseigner ; il était né professeur. Quant à Léonce, nous pensions unanimement que ce serait grand dommage si un garçon si bien bâti se renfermait comme nous dans le cloître universitaire. Sa prise de robe nous aurait contristés comme une prise d’habit.
Les deux frères n’étaient pas sans ressources. Nous trouvions même qu’ils étaient riches, lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre : ils avaient l’oncle Yvon. L’oncle Yvon, ancien capitaine au cabotage, puis armateur pour la pêche aux sardines, possédait plusieurs bateaux, une multitude de filets, quelques biens au soleil et une jolie maison sur le port d’Auray, devant le Pavillon d’en bas. Comme il n’avait jamais trouvé le temps de se marier, il était resté garçon. C’était un homme de grand cœur, excellent pour le pauvre monde et surtout pour sa famille, qui en avait bon besoin. Les gens d’Auray le tenaient en haute estime ; il était du conseil municipal, et les petits garçons lui disaient, en ôtant leur casquette : « Bonjour, capitaine Yvon ! » Ce digne homme avait recueilli dans sa maison M. et Mme Debay, et il économisait deux cents francs par mois pour les enfants.
Grâce à cette munificence, Léonce et Mathieu purent se loger à l’hôtel Corneille, qui est l’hôtel des Princes du quartier latin. Leur chambre coûtait cinquante francs par mois ; c’était une belle chambre. On y voyait deux lits d’acajou avec des rideaux rouges, et deux fauteuils, et plusieurs chaises, et une armoire vitrée pour serrer les livres, et même (Dieu me pardonne !) un tapis. Ces messieurs mangeaient à l’hôtel ; la pension n’y est pas mauvaise à 75 fr. par mois. Le vivre et le couvert absorbaient les deux cents francs de l’oncle Yvon ; Mathieu pourvut aux autres dépenses. Son âge ne lui permettait pas de se présenter une seconde fois à l’école normale. Il dit à son frère :
« Je vais me préparer aux examens de la licence ès lettres. Une fois licencié, j’écrirai mes thèses pour le doctorat, et le docteur Debay obtiendra un jour ou l’autre une suppléance dans quelque faculté. Pour toi, tu feras ta médecine ou ton droit, tu es libre.
– Et de l’argent ? demanda Léonce.
– Je battrai monnaie. Je me suis présenté à Sainte-Barbe, et j’ai demandé des leçons. On m’a accepté pour répétiteur des élèves de troisième et de seconde : deux heures de travail tous les matins, et deux cents francs tous les mois. Il faudra me lever à cinq heures ; mais nous serons riches.
– Et puis, ajouta Léonce, tu appartiens à la famille des matineux, et c’est un plaisir pour toi que de réveiller le soleil. »
Léonce choisit le droit. Il parlait comme un oracle, et personne ne doutait qu’il ne fît un excellent avocat. Il suivait les cours, prenait des notes et les rédigeait avec soin ; après quoi il faisait toilette, courait Paris, se montrait aux quatre points cardinaux, et passait la soirée au théâtre. Mathieu, vêtu d’un paletot noisette que je vois encore, écoutait tous les professeurs de la Sorbonne, et travaillait le soir à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Tout le quartier Latin connaissait Léonce ; personne au monde ne soupçonnait l’existence de Mathieu.
J’allais les voir à presque toutes mes sorties, c’est-à-dire le jeudi et le dimanche. Ils me prêtaient des livres. Mathieu avait un culte pour Mme Sand ; Léonce était fanatique de Balzac. Le jeune professeur se délassait dans la compagnie de François le Champi, du bonhomme Patience ou des bessons de la Bessonière. Son âme simple et sérieuse cheminait en rêvant dans le sillon rougeâtre des charrues, dans les sentiers bordés de bruyères ou sous les grands châtaigniers qui ombragent la mare au Diable. L’esprit remuant de Léonce suivait des chemins tout différents. Curieux de sonder les mystères de la vie parisienne, avide de plaisir, de lumière et de bruit, il aspirait dans les romans de Balzac un air enivrant comme le parfum des serres chaudes. Il suivait d’un œil ébloui les fortunes étranges des Rubempré, des Rastignac, des Henri de Marsay. Il entrait dans leurs habits, il se glissait dans leur monde, il assistait à leurs duels, à leurs amours, à leurs entreprises, à leurs victoires ; il triomphait avec eux. Puis il venait se regarder dans la glace. « Étaient-ils mieux que moi ? Est-ce que je ne les vaux pas ? Qu’est-ce qui m’empêcherait de réussir comme eux ? J’ai leur beauté, leur esprit, une instruction qu’ils n’ont jamais eue, et, ce qui vaut mieux encore, le sentiment du devoir. J’ai appris dès le collège la distinction du bien et du mal. Je serai un de Marsay moins les vices, un Rubempré sans Vautrin, un Rastignac scrupuleux : quel avenir ! toutes les jouissances du plaisir et tout l’orgueil de la vertu ! » Quand les deux frères, l’œil fermé à demi, interrompaient leur lecture pour écouter quelques voix intérieures, on pouvait dire à coup sûr que Léonce entendait le tintement des millions de Nucingen ou de Gobseck, et Mathieu le bruit frétillant de ces clochettes rustiques qui annoncent le retour des troupeaux.
Nous sortions quelquefois ensemble. Léonce nous promenait sur le boulevard des Italiens et dans les beaux quartiers de Paris. Il choisissait des hôtels, il achetait des chevaux, il enrôlait des laquais. Lorsqu’il voyait une tête désagréable dans un joli coupé, il nous prenait à partie : « Tout marche de travers, disait-il, et l’univers est un sot pays. Est-ce que cette voiture ne nous irait pas cent fois mieux ? » Il disait nous par politesse. Sa passion pour les chevaux était si violente, que Mathieu lui prit un abonnement de vingt cachets au manège Leblanc. Mathieu, lorsque nous lui laissions le soin de nous conduire, s’acheminait vers les bois de Meudon et de Clamart. Il prétendait que la campagne est plus belle que la ville, même en hiver, et les corbeaux sur la neige flattaient plus agréablement sa vue que les bourgeois dans la crotte. Opinion paradoxale et contre laquelle j’ai toujours protesté. Léonce nous suivait en murmurant et en traînant le pied. Au plus profond des bois, il rêvait des associations mystérieuses comme celle des Treize, et il nous proposait de nous liguer ensemble pour la conquête de Paris.
De mon côté, je fis faire à mes amis quelques promenades curieuses. Il s’est fondé à l’école normale un petit bureau de bienfaisance. Une cotisation de quelques sous par semaine, le produit d’une loterie annuelle et les vieux habits de l’école, composent un modeste fonds où l’on prend tous les jours sans jamais l’épuiser. On distribue dans le quartier quelques cartons imprimés qui représentent du bois, du pain ou du bouillon, quelques vêtements, un peu de linge et beaucoup de bonnes paroles. La grande utilité de cette petite institution est de rappeler aux jeunes gens que la misère existe. Mathieu m’accompagnait plus souvent que Léonce dans les escaliers tortueux du 12e arrondissement. Léonce disait : « La misère est un problème dont je veux trouver la solution. Je prendrai mon courage à deux mains, je surmonterai tous mes dégoûts, je pénétrerai jusqu’au fond de ces maisons maudites où le soleil et le pain n’entrent pas tous les jours ; je toucherai du doigt cet ulcère qui ronge notre société, et qui l’a mise, tout dernièrement encore, à deux doigts du tombeau ; je saurai dans quelle proportion le vice et la fatalité travaillent à la dégradation de notre espèce. » Il disait d’excellentes choses, mais c’était Mathieu qui venait avec moi.
Il me suivit un jour, rue Traversine, chez un pauvre diable dont le nom ne me revient pas. Je me rappelle seulement qu’on l’avait surnommé le Petit-Gris, parce qu’il était petit et que ses cheveux étaient gris. Il avait une femme et point d’enfants, et il rempaillait des chaises. Nous lui fîmes notre première visite au mois de juillet 1849. Mathieu se sentit glacé jusqu’au fond des os en entrant dans la rue Traversine.
C’est une rue dont je ne veux pas dire de mal, car elle sera démolie avant six mois. Mais en attendant, elle ressemble un peu trop aux rues de Constantinople. Elle est située dans un quartier de Paris que les Parisiens ne connaissent guère ; elle touche à la rue de Versailles, à la rue du Paon, à la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ; elle est parallèle à la rue Saint-Victor. Peut-être est-elle pavée ou macadamisée, mais je ne réponds de rien : le sol est couvert de paille hachée, de débris de toute espèce, et de marmots bien vivants qui se roulent dans la boue. À droite et à gauche s’élèvent deux rangs de maisons hautes, nues, sales et percées de petites fenêtres sans rideaux. Des haillons assez pittoresques émaillent chaque façade, en attendant que le vent prenne la peine de les sécher. La rue de Rivoli est beaucoup mieux, mais le Petit-Gris n’avait pas trouvé à louer rue de Rivoli. Il nous raconta sa misère : il gagnait un franc par jour. Sa femme tressait des paillassons et gagnait de cinquante à soixante centimes. Leur logement était une chambre au quatrième ; leur parquet, une couche de terre battue ; leur fenêtre, une collection de papiers huilés. Je tirai de ma poche quelques bons de pain et de bouillon. Le Petit-Gris les reçut avec un sourire légèrement ironique.
« Monsieur, me dit-il, vous me pardonnerez si je me mêle de ce qui ne me regarde point, mais j’ai dans l’idée que ce n’est pas avec ces petits cartons-là qu’on guérira la misère. Autant mettre de la charpie sur une jambe de bois. Vous avez pris la peine de monter mes quatre étages avec monsieur votre ami, pour m’apporter six livres de pain et deux litres de bouillon. Nous en voilà pour deux jours. Mais reviendrez-vous après-demain ? C’est impossible : vous avez autre chose à faire. Dans deux jours je serai donc au même cran que si vous n’étiez pas venu. J’aurai même plus faim, car l’estomac est féroce le lendemain d’un bon dîner. Si j’étais riche comme vous autres, – ici Mathieu m’enfonça son coude dans le flanc, – je m’arrangerais de façon à tirer les gens d’affaire pour le reste de leurs jours.
– Et comment ? si la recette est bonne, nous en profiterons.
– Il y a deux manières : on leur achète un fonds de commerce, ou on leur procure une place du gouvernement.
– Tais-toi donc, lui dit sa femme, je t’ai toujours dit que tu te ferais du tort avec ton ambition.
– Où est le mal, si je suis capable ? J’avoue que j’ai toujours eu l’idée de demander une place. On m’offrirait dix francs pour m’établir marchand des quatre saisons ou pour acheter un fonds d’allumettes, je ne refuserais certainement pas, mais je regretterais toujours un peu la place que j’ai en vue.
– Et quelle place, s’il vous plaît ? demanda Mathieu.
– Balayeur de la ville de Paris. On gagne ses vingt sous par jour, et l’on est libre à dix heures du matin, au plus tard. Si vous pouviez m’obtenir cette place-là, mes bons messieurs, je doublerais mon gain, j’aurais de quoi vivre, vous seriez dispensés de monter ici avec des petits cartons dans vos poches, et c’est moi qui irais vous remercier chez vous. »
Nous ne connaissions personne à la préfecture, mais Léonce était lié avec le fils d’un commissaire de police : il usa de son influence pour obtenir la nomination du Petit-Gris. Lorsque nous lui fîmes une visite pour le féliciter, le premier meuble qui frappa nos yeux fut un balai gigantesque dont le manche était enrichi d’un cercle de fer. Le titulaire de ce balai nous remercia chaudement.
« Grâce à vous, nous dit-il, je suis au-dessus du besoin ; mes chefs m’apprécient déjà, et je ne désespère pas de faire enrôler ma femme dans ma brigade ; ce serait la richesse. Mais il y a sur notre palier deux dames qui auraient bien besoin de votre assistance ; malheureusement, elles n’ont pas les mains faites pour balayer.
– Allons les voir, dit Mathieu.
– Laissez-moi d’abord vous parler. Ce ne sont pas des personnes comme ma femme et moi : elles ont eu des malheurs. La dame est veuve. Son mari était bijoutier en gros, rue d’Orléans, au Marais. Il est parti l’année dernière pour la Californie avec une machine qu’il avait inventée, une machine à trouver l’or ; mais le bateau a fait naufrage en chemin, avec l’homme, la machine et le reste. Ces dames ont lu dans les journaux qu’on n’avait pas sauvé une allumette. Alors, elles ont vendu le peu qui leur restait, et elles sont allées demeurer rue d’Enfer ; et puis la dame a fait une maladie qui leur a mangé tout. Elles sont donc venues ici. Elles brodent du matin au soir jusqu’à la mort de leurs yeux, mais elles ne gagnent pas lourd. Ma femme les aide à faire leur ménage quand elle a le temps : on n’est pas riche, mais on fait l’aumône d’un coup de main à ceux qui sont trop malheureux. Je vous dis cela pour vous faire comprendre que ces dames ne demandent rien à personne, et qu’il faudra y mettre des formes pour leur faire accepter quelque chose. D’ailleurs, la demoiselle est jolie comme un cœur, et cela rend sauvage, comme vous comprenez. »
Mathieu devint tout rouge à l’idée qu’il aurait pu être indiscret.
« Nous chercherons un moyen, dit-il. Comment s’appelle cette dame ?
– Madame Bourgade.
– Merci. »
Deux jours après, Mathieu, qui n’avait jamais voulu de leçons particulières, entreprit de préparer un jeune homme au baccalauréat. Il s’y donna de si bon cœur, que son élève, qui avait été refusé quatre ou cinq fois, fut reçu le 18 août, au commencement des vacances. C’est alors seulement que les deux frères se mirent en route pour la Bretagne. Avant de partir, Mathieu me remit cinquante francs. « Je serai absent cinq semaines, me dit-il ; il faut que je revienne en octobre, pour la rentrée des classes et pour les examens de la licence. Tu iras à la poste tous les lundis, et tu prendras un mandat de dix francs, au nom de Mme Bourgade : tu connais l’adresse. Elle croit que c’est un débiteur de son mari qui s’acquitte en détail. Ne te montre pas dans la maison : il ne faut pas éveiller les soupçons de ces dames. Si l’une d’elles tombait malade, le Petit-Gris viendrait t’avertir, et tu m’écrirais. »
Je vous l’avais bien dit, qu’on ne lisait que de bons sentiments dans les petits yeux gris de Mathieu. Pourquoi n’ai-je pas conservé la lettre qu’il m’écrivit pendant les vacances ? Elle vous ferait plaisir. Il me dépeignait avec un enthousiasme naïf la campagne dorée par les ajoncs, les pierres druidiques de Carnac, les dunes de Quiberon, la pêche aux sardines dans le golfe, et la flottille de voiles rouges qui récolte les huîtres dans la rivière d’Auray. Tout cela lui semblait nouveau, après une longue année d’absence. Son frère s’ennuyait un peu en songeant à Paris. Pour lui, il n’avait trouvé que des plaisirs. Ses parents se portaient si bien ! L’oncle Yvon était si gros et si gras ! La maison était si belle, les lits si moelleux, la table si plantureuse ! – J’ai peut-être oublié de vous dire que Mathieu mangeait pour deux. – « Sais-tu la seule chose qui m’ait attristé ? m’écrivait-il en post-scriptum. Je te l’avouerai, quand tu devrais te moquer de moi. Il y a dans la maison de mon oncle deux grandes paresseuses de chambres, bien parquetées, bien aérées, bien meublées, et qui ne servent à personne. Je suis sûr que mon oncle les louerait pour rien à une honnête famille qui voudrait les prendre. Et l’on paye cent francs par an pour habiter la rue Traversine ! »
Mathieu revint au mois d’octobre, et enleva, haut la main, son diplôme de licencié ès lettres. Les notes des examinateurs lui furent si favorables qu’on lui offrit la chaire de quatrième au lycée de Chaumont. Mais il ne put se décider à quitter son frère et Paris. Il me donnait de temps en temps des nouvelles de la rue Traversine : Mme Bourgade était souffrante. Vous ne vous rendrez bien compte de l’intérêt qu’il portait à ses protégées invisibles que si je vous initie au grand secret de sa jeunesse : il n’avait encore aimé personne. Comme ses camarades ne lui avaient pas ménagé les plaisanteries sur sa laideur, il était modeste au point de se regarder comme un monstre. Si l’on avait essayé de lui dire qu’une femme pouvait l’aimer tel qu’il était, il aurait cru qu’on se moquait de lui. Il rêvait quelquefois qu’une fée le frappait de sa baguette, et qu’il devenait un autre homme. Cette transformation était la préface indispensable de tous ses romans d’amour. Dans la vie réelle, il passait auprès des femmes sans lever les yeux : il craignait que sa vue ne leur fût désagréable. Le jour où il devint le bienfaiteur inconnu d’une belle jeune fille, il sentit au fond du cœur un contentement humble et tendre. Il se comparaît au héros de la Belle et la Bête qui cache son visage et ne laisse voir que son âme, ou à ce Paria de la Chaumière Indienne qui dit : « Vous pouvez manger de ces fruits, je n’y ai pas touché. »
C’est un accident imprévu qui le mit en présence de Mlle Bourgade. Il était chez le Petit-Gris à demander des nouvelles, lorsque Aimée entra en criant au secours : sa mère était évanouie. Il courut avec les autres. Il amena le lendemain un interne de la Pitié. Mme Bourgade n’était malade que d’épuisement ; on la guérit. La femme du Petit-Gris fut installée chez elle en qualité d’infirmière. Elle allait chercher les médicaments et les aliments, et elle savait si bien marchander qu’elle les avait pour rien. Mme Bourgade but un excellent vin de Médoc qui lui coûtait soixante centimes la bouteille ; elle mangea du chocolat ferrugineux à deux francs le kilogramme. C’est Mathieu qui faisait ces miracles et qui ne s’en vantait pas. On ne voyait en lui qu’un voisin obligeant ; on le croyait logé rue Saint-Victor. La malade s’accoutuma doucement à la présence de ce jeune professeur, qui montrait les attentions délicates d’une jeune fille. Sa prudence maternelle ne se mit jamais en garde contre lui ; tout au plus si elle le regardait comme un homme. À la simplicité de sa mise, elle jugea qu’il était pauvre ; elle s’intéressait à lui comme il s’intéressait à elle. Un certain lundi du mois de décembre, elle le vit venir en paletot noisette, sans son manteau, par un froid très vif. Elle lui dit, après de longues circonlocutions, qu’elle venait de toucher une somme de dix francs, et elle offrit de lui en prêter la moitié. Mathieu ne sut s’il voulait rire ou pleurer : il avait engagé son manteau, le matin même, pour ces bienheureux dix francs. Voilà où ils en étaient au bout d’un mois de connaissance. Aimée s’abandonnait moins aux douceurs de l’intimité. Pour elle, Mathieu était un homme. En le comparant au Petit-Gris et aux habitants de la rue Traversine, elle le trouvait distingué. D’ailleurs, à l’âge de seize ans, elle n’avait guère eu le temps d’observer le genre humain. Elle ignorait non seulement la laideur de Mathieu, mais encore sa propre beauté : il n’y avait pas de miroir dans la maison.
Mme Bourgade raconta à Mathieu ce qu’il savait en partie, grâce aux indiscrétions du Petit-Gris. Son mari faisait médiocrement ses affaires et gagnait à peine de quoi vivre, lorsqu’il apprit la découverte des mines de la Californie. En homme de sens, il devina que les premiers explorateurs de cette terre fortunée poursuivraient les lingots d’or et les pépites enfouies dans le roc, sans prendre le temps d’exploiter les sables aurifères. Il se dit que la spéculation la plus sûre et la plus lucrative consisterait à laver la poussière des mines et le sable des ravins. Dans cette idée, il construisit une machine fort ingénieuse, qu’il appela, de son nom, le séparateur Bourgade. Pour en faire l’épreuve, il mélangea 30 grammes de poudre d’or avec 100 kilogrammes de terre et de sable. Le séparateur reproduisit tout l’or, à deux décigrammes près. Fort de cette expérience, M. Bourgade rassembla le peu qu’il possédait, laissa à sa famille de quoi vivre pendant six mois, et s’embarqua sur la Belle-Antoinette, de Bordeaux, à la grâce de Dieu. Deux mois plus tard, la Belle-Antoinette se perdait corps et biens, en sortant de la passe de Rio-de-Janeiro.
Mathieu s’avisa que, sans faire un voyage en Californie, on pourrait exploiter l’invention de feu Bourgade au profit de sa veuve et de sa fille. Il pria Mme Bourgade de lui confier les plans qu’elle avait conservés, et je fus chargé de les montrer à un élève de l’école centrale. La consultation ne fut pas longue. Le jeune ingénieur me dit après un examen d’une seconde : « Connu ! c’est le séparateur Bourgade. Il est dans le domaine public, et les Brésiliens en fabriquent dix mille par an à Rio-de-Janeiro. Tu connais l’inventeur ?
– Il est mort dans un naufrage.
– La machine aura surnagé ; cela se voit tous les jours. »
Je m’en revins piteusement à l’hôtel Corneille, pour rendre compte de mon ambassade. Je trouvai les deux frères en larmes. L’oncle Yvon était mort d’apoplexie en leur léguant tous ses biens.
J’ai conservé une copie du testament de l’oncle Yvon. La voici :
« Le 15 août 1849, jour de l’Assomption, j’ai, Mathieu-Jean-Léonce Yvon, sain de corps et d’esprit et muni des sacrements de l’Église, rédigé le présent testament et acte de mes dernières volontés.
Prévoyant les accidents auxquels la vie humaine est exposée, et désirant que, s’il m’arrive malheur, mes biens soient partagés sans contestation entre mes héritiers, j’ai divisé ma fortune en deux parts aussi égales que j’ai pu les faire, savoir :
1° Une somme de cinquante mille francs rapportant cinq pour cent, et placée par les soins de Me Aubryet, notaire à Paris ;
2° Ma maison sise à Auray, mes landes, terres arables et immeubles de toute sorte ; mes bateaux, filets, engins de pêche, armes, meubles, hardes, linge et autres objets mobiliers, le tout évalué, en conscience et justice, à cinquante mille francs.
Je donne et lègue la totalité de ces biens à mes neveux et filleuls, Mathieu et Léonce Debay, enjoignant à chacun d’eux de choisir, soit à l’amiable, soit par la voie du sort, une des deux parts ci-dessus désignées, sans recourir, sous aucun prétexte, à l’intervention des hommes de loi.
Dans le cas où je viendrais à mourir avant ma sœur Yvonne Yvon, femme Debay, et son mari mon excellent beau-frère, je confie à mes héritiers le soin de leur vieillesse, et je compte qu’ils ne les laisseront manquer de rien, suivant l’exemple que je leur ai toujours donné. »
Le partage ne fut pas long à faire, et l’on n’eut pas besoin de consulter le sort. Léonce choisit l’argent, et Mathieu prit le reste. Léonce disait : « Que voulez-vous que je fasse des bateaux du pauvre oncle ? J’aurais bonne grâce à draguer des huîtres ou à pêcher des sardines ! Il me faudrait vivre à Auray, et rien que d’y penser, je bâille. Vous apprendriez bientôt que je suis mort et que la nostalgie du boulevard m’a tué. Si, par bonheur ou par malheur, j’échappais à la destruction, toute cette petite fortune périrait bientôt entre mes mains. Est-ce que je sais louer une terre, affermer une pêcherie ou régler des comptes d’association avec une demi-douzaine de marins ? Je me laisserais voler jusqu’aux cendres de mon feu. Que Mathieu m’abandonne les cinquante mille francs, je les placerai sur une maison solide qui me rapportera vingt pour un. Voilà comme j’entends les affaires.
– À ton aise, répondit Mathieu. Je crois que tu n’aurais pas été forcé de vivre à Auray. Nos parents se portent bien, Dieu merci ! et ils suffisent peut-être à la besogne. Mais dis-moi donc quelle est la valeur miraculeuse sur laquelle tu comptes placer ton argent ?
– Je le placerai sur ma tête. Écoute-moi posément. De tous les chemins qui mènent un jeune homme à la fortune, le plus court n’est ni le commerce, ni l’industrie, ni l’art, ni la médecine, ni la plaidoirie, ni même la spéculation ; c’est… devine.
– Dame ! je ne vois plus que le vol sur les grands chemins, et il devient de jour en jour plus difficile ; car on n’arrête pas les locomotives.
– Tu oublies le mariage ! C’est le mariage qui a fait les meilleures maisons de l’Europe. Veux-tu que je te raconte l’histoire des comtes de Habsbourg ? Il y a sept cents ans, ils étaient un peu plus riches que moi, pas beaucoup. À force de se marier et d’épouser des héritières, ils ont fondé une des plus grandes monarchies du monde, l’empire d’Autriche. J’épouse une héritière.
– Laquelle ?
– Je n’en sais rien, mais je la trouverai.
– Avec tes cinquante mille francs ?
– Halte-là ! Tu comprends que si je me mettais en quête d’une femme avec mon petit portefeuille contenant cinquante billets de banque, tous les millions me riraient au nez ; tout au plus si je trouverais la fille d’un mercier ou l’héritière présomptive d’un fond de quincaillerie. Dans le monde où l’on tiendrait compte d’une si pauvre somme, on ne me saurait gré ni de ma tournure, ni de mon esprit, ni de mon éducation. Car enfin nous ne sommes pas ici pour faire de la modestie.
– À la bonne heure !
– Dans le monde où je veux me marier, on m’épousera pour moi, sans s’informer de ce que j’ai. Quand un habit est bien fait et bien porté, mon cher, aucune fille de condition ne s’informe de ce qu’il y a dans les poches. »
Là-dessus, Léonce expliqua à son frère qu’il emploierait les écus de l’oncle Yvon à s’ouvrir les portes du grand monde. Une longue expérience, acquise dans les romans, lui avait appris qu’avec rien on ne fait rien, mais qu’avec de la toilette, un joli cheval et de belles manières on trouve toujours à faire un mariage d’amour.
« Voici mon plan, dit-il : Je vais manger mon capital. Pendant un an, j’aurai cinquante mille francs de rente en effigie, et le diable sera bien malin si je ne me fais pas aimer d’une fille qui les possède en réalité.
– Mais, malheureux, tu te ruines !
– Non, je place mon argent à cent pour cinq. »
Mathieu ne prit pas la peine de discuter contre son frère. Au demeurant, les fonds placés ne devaient être disponibles qu’au mois de juin ; il n’y avait pas péril en la demeure.
Les héritiers de l’oncle Yvon ne changèrent rien à leur genre de vie : ils n’étaient pas plus riches qu’autrefois. Les bateaux et les filets faisaient marcher la maison d’Auray. Me Aubryet donnait deux cents francs par mois, ainsi que par le passé ; les répétitions de Sainte-Barbe et les visites à la rue Traversine allaient leur train. La vérité m’oblige à dire que Léonce était moins assidu aux cours de l’école de droit qu’aux leçons de Cellarius, et qu’on le voyait plus souvent chez Lozès que chez M. Ducauroy. Le Petit-Gris, toujours ambitieux, et, je le crains, un peu intrigant, obtint la nomination de sa femme, et intronisa un deuxième balai dans son appartement. Ce fut le seul évènement de l’hiver.
Au mois de mai, Mme Debay écrivit à ses fils qu’elle était fort en peine. Son mari avait beaucoup à faire et ne pouvait suffire à tout. Un homme de plus dans la maison n’eût pas été de trop. Mathieu craignit que son père ne se fatiguât outre mesure ; il le savait dur à la peine et courageux malgré son âge ; mais on n’est plus jeune à soixante ans, même en Bretagne.
« Si je m’écoutais, me dit-il un jour, j’irais passer six mois là-bas. Mon père se tue.
– Qu’est-ce qui te retient ?
– D’abord, mes répétitions.
– Passe-les à un de nos camarades. Je t’en indiquerai six qui en ont plus besoin que toi.
– Et Léonce qui fera des folies !
– Sois tranquille, s’il doit en faire, ce n’est pas ta présence qui le retiendra.
– Et puis…
– Et puis quoi ?
– Ces dames !
– Tu les as bien quittées aux vacances. Donne-les-moi encore à garder, j’aurai soin qu’elles ne manquent de rien.
– Mais elles me manqueront, à moi ! reprit-il en rougissant jusqu’aux yeux.
– Eh ! parle donc ! tu ne m’avais pas dit qu’il y avait de l’amour sous roche. »
Le pauvre garçon resta atterré. Il devina pour la première fois qu’il aimait Mlle Bourgade. Je l’aidai à faire son examen de conscience ; je lui arrachai un à un tous les petits secrets de son cœur, et il demeura atteint et convaincu d’amour passionné. De ma vie je n’ai vu un homme plus confus. On lui eût appris que son père avait fait banqueroute, je crois qu’il aurait montré moins de honte. Il fallut bien le rassurer un peu et le réconcilier avec lui-même. Mais quand je lui demandai s’il croyait être payé de retour, il eut un redoublement de confusion qui me fit peine. J’eus beau lui dire que l’amour était un mal contagieux, et que dix-neuf fois sur vingt les passions sincères étaient partagées, il croyait faire exception à toutes les règles. Il se plaçait modestement au dernier rang de l’échelle des êtres, et il voyait dans Mlle Bourgade des perfections au-dessus de l’humanité. Aucun chevalier du bon temps ne s’est fait plus humble et plus petit devant les beaux yeux de sa dame. J’essayai de le relever dans sa propre estime en lui révélant les trésors de bonté et de tendresse qui étaient en lui : à toutes mes raisons il répondait en me montrant sa figure, avec une petite grimace résignée qui m’attirait des larmes dans les yeux. En ce moment, si j’avais été femme, je l’aurais aimé.
« Voyons, lui dis-je, comment est-elle avec toi ?
– Elle n’est jamais avec moi. Je suis dans la chambre, elle aussi, et cependant nous ne sommes pas ensemble. Je lui parle, elle me répond, mais je ne puis pas dire que j’aie jamais causé avec elle. Elle ne m’évite pas, elle ne me cherche pas… Je crois cependant qu’elle m’évite, ou du moins que je lui suis désagréable. Quand on est bâti comme cela ! »
Il s’emportait contre sa pauvre personne avec une naïveté charmante. La froideur de Mlle Bourgade pour un être si excellent n’était pas naturelle. Elle ne s’expliquait que par un commencement d’amour ou par un calcul de coquetterie.
« Mlle Bourgade sait-elle que tu as hérité ?
– Non.
– Elle te croit pauvre comme elle ?
– Sans cela, il y a longtemps qu’on m’aurait mis à la porte.
– Si cependant… Ne rougis pas. Si, par impossible, elle t’aimait comme tu l’aimes, que ferais-tu ?
– Je… je lui dirais…
– Allons, pas de fausse honte ! Elle n’est pas là : tu l’épouserais ?
– Oh ! si je pouvais ! Mais je n’oserai jamais me marier. »
Ceci se passait un dimanche. Le jeudi suivant, quoique j’eusse bien promis d’éviter la rue Traversine, je fis une visite au Petit-Gris. J’avais mis mon plus bel habit d’uniforme, avec des palmes toutes neuves à la boutonnière. Un ami à toute épreuve m’avait prêté une paire de gants. Le Petit-Gris alla prévenir Mme Bourgade qu’un monsieur lui demandait la faveur de causer quelques instants avec elle seule. Elle vint comme elle était, et notre hôte sortit sous prétexte d’acheter du charbon.
Mme Bourgade était une grande et belle femme, maigre jusqu’aux os ; elle avait de longs yeux tristes, de beaux sourcils et des cheveux magnifiques, mais presque plus de dents, ce qui la vieillissait. Elle s’arrêta devant moi un peu interdite : la misère est timide.
« Madame, lui dis-je, je suis un ami de Mathieu Debay ; il aime Mlle votre fille, et il a l’honneur de vous demander sa main. »
Voilà comme nous étions diplomates à l’école normale.
« Asseyez-vous, monsieur, » me dit-elle doucement. Elle n’était pas surprise de ma démarche, elle s’y attendait ; elle savait que Mathieu aimait sa fille, et elle m’avoua avec une sorte de pudeur maternelle que depuis longtemps sa fille aimait Mathieu. J’en étais bien sûr ! Elle avait mûrement réfléchi sur la possibilité de ce mariage. D’un côté, elle était heureuse de confier l’avenir de sa fille à un honnête homme, avant de mourir. Elle se croyait dangereusement malade, et attribuait à des causes organiques un affaiblissement produit par les privations. Ce qui l’effrayait, c’était l’idée que Mathieu lui-même n’était pas très robuste, qu’il pouvait un jour prendre le lit, perdre ses leçons et rester sans ressources avec sa femme, peut-être avec ses enfants, car il fallait tout prévoir. J’aurais pu la rassurer d’un seul mot, mais je n’eus garde. J’étais trop heureux de voir un mariage se conclure avec cette sublime imprudence des pauvres qui disent : « Aimons-nous d’abord ; chaque jour amène son pain ! » Mme Bourgade ne discuta contre moi que pour la forme. Elle portait Mathieu dans son cœur. Elle avait pour lui l’amour de la belle-mère pour son gendre, cet amour à deux degrés, qui est la dernière passion de la femme. Mme de Sévigné n’a jamais aimé son mari comme M. de Grignan.
Mme Bourgade me conduisit chez elle et me présenta à sa fille. La belle Aimée était vêtue de cotonnade mauvais teint dont la couleur avait passé. Elle n’avait ni bonnet, ni col, ni manchettes : le blanchissage est si cher ! Je pus admirer une grosse natte de magnifiques cheveux blonds, un cou un peu maigre, mais d’une rare élégance, et des poignets qu’une grande dame eût payés cher. Sa figure était celle de sa mère, avec vingt années de moins. En les voyant l’une à côté de l’autre, je songeai involontairement à ces dessins d’architecture où l’on voit dans le même cadre un temple en ruine et sa restauration. La taille d’Aimée, avec une brassière au lieu de corset et un simple jupon sans crinoline, montrait une élégance de bon aloi. Le prix élevé des engins de la coquetterie fait que les pauvres sont moins souvent dupés que les riches. Ce qui m’étonna le plus dans la future Mme Debay, c’est la blancheur limpide de son teint. On aurait dit du lait, mais du lait transparent : je ne puis mieux comparer son visage qu’à une perle fine.
Elle fut bien franchement heureuse, la petite perle de la rue Traversine, lorsqu’elle apprit les nouvelles que j’apportais. Au beau milieu de sa joie tomba Mathieu, qui ne s’attendait pas à me trouver là. Il ne voulut croire qu’il était aimé que lorsqu’on le lui eut répété trois fois. Nous parlions tous ensemble, et les quatuors de Beethoven sont une pauvre musique au prix de celle que nous chantions. Puis, comme la porte était restée entrouverte, je me dérobai sans rien dire. Mathieu me savait un peu moqueur, et il n’aurait pas osé pleurer devant moi.
Il se maria le premier jeudi de juin, et j’eus soin de ne pas me faire consigner à l’école, car je tenais à lui servir de témoin. Je partageai cet honneur avec un jeune écrivain de nos amis qui débutait alors dans une revue jeune et hospitalière, l’Artiste. Les témoins d’Aimée furent deux amis de Mathieu, un peintre et un professeur : Mme Bourgade avait perdu de vue ses anciennes connaissances. La mairie du 11e arrondissement est en face de l’église Saint-Sulpice : on n’eut que la place à traverser. Toute la noce, y compris Léonce, était contenue dans deux grands fiacres qui nous menèrent dîner auprès de Meudon, chez le garde de Fleury. Notre salle à manger était un chalet entouré de lilas, et nous découvrîmes un petit oiseau qui avait fait son nid dans la mousse au-dessus de nos têtes. On but à la prospérité de cette famille ailée : nous sommes tous égaux devant le bonheur. Me croira qui voudra, mais Mathieu n’était plus laid. J’avais déjà remarqué que l’air des forêts avait le privilège de l’embellir. Il y a des figures qui ne plaisent que dans un salon ; vous en trouverez d’autres qui ne charment que dans les champs. Les poupées enfarinées qu’on admire à Paris seraient horribles à rencontrer au coin d’un bois : je frémis quand j’y pense. Mathieu était, au contraire, un Sylvain très présentable. Il nous annonça, au dessert, qu’il allait partir pour Auray, avec sa femme et sa belle-mère. L’excellente maman Debay ouvrait déjà les bras pour recevoir sa bru. Mathieu écrirait ses thèses à loisir ; il serait docteur et professeur quand les sardines le permettraient.
« Sans parler des enfants, ajouta une voix qui n’était pas la mienne.
– Ma foi ! reprit le marié, s’il nous vient des enfants, je leur apprendrai à lire au coin du feu, et puissé-je avoir dix élèves dans ma classe !
– Pour moi, dit Léonce, je vous ajourne tous à l’année prochaine. Vous assisterez au mariage de Léonce Debay avec Mlle X., une des plus riches héritières de Paris.
– Vive Mlle X. ! la glorieuse inconnue !
– En attendant que je la connaisse, reprit l’orateur, on vous contera que j’ai gaspillé ma fortune, éparpillé mes trésors et dispersé mon héritage à tous les vents de l’horizon. Souvenez-vous de ce que je vous promets : je jetterai l’or, mais comme un semeur jette la graine. Laissez dire, et attendez la récolte ! »
Pourquoi n’avouerais-je pas qu’on buvait du vin de Champagne ? Mathieu dit à son frère : « Tu feras ce que tu voudras. Je ne doute plus de rien, je crois tout possible, depuis qu’elle a pu m’épouser par amour ! »
Mais le dimanche suivant, à la gare du chemin de fer, Mathieu semblait moins rassuré sur l’avenir de son frère. « Tu vas jouer gros jeu, lui dit-il en lui serrant la main. Si Boileau n’était point passé de mode, comme les coiffures de son temps, je te dirais :
– Bah ! il ne s’agit pas de Boileau, mais de Balzac. Cette mer où je cours est féconde en héritières. Compte sur moi, frère : s’il en reste une au monde, elle sera pour nous.
– Enfin ! souviens-toi, quoi qu’il arrive, que ton lit est fait dans la maison d’Auray.
– Fais-y ajouter un oreiller. Nous irons vous voir dans notre carrosse ! » Le Petit-Gris toisa Léonce d’un coup d’œil approbateur, qui voulait dire : « Jeune homme, votre ambition me plaît. » Mais Léonce n’abaissa point ses regards sur le Petit-Gris. Il me prit par le bras, après le départ du train, et il me mena dîner chez Janodet ; il était gai et plein de belle espérance.
« Le sort en est jeté, me dit-il ; je brûle mes vaisseaux. J’ai retenu hier un délicieux entresol, rue de Provence. Les peintres y sont ; dans huit jours, j’y mettrai les tapissiers. C’est là, mon pauvre bon, que tu viendras, le dimanche, manger la côtelette de l’amitié.
– Quelle idée as-tu de commencer la campagne au milieu de l’été ? Il n’y a pas un chat à Paris.
– Laisse-moi faire ! Dès que mon nid sera installé, je partirai pour les eaux de Vichy. Les connaissances se font vite aux eaux : on se lie, on s’invite pour l’hiver prochain. J’ai pensé à tout, et mon siège est fait. Dire que dans quinze jours j’en aurai fini avec cet affreux quartier Latin !
– Où nous avons passé de si bons moments !
– Nous croyions nous amuser, parce que nous ne nous y connaissions pas. Est-ce que tu trouves ce poulet mangeable, toi ?
– Excellent, mon cher.
– Atroce ! À propos, j’ai une cuisinière : un garçon à marier dîne en ville, mais il déjeune chez lui. Reste à trouver un domestique. Tu n’as personne à m’indiquer ?
– Parbleu ! je suis fâché d’être à l’école pour dix-huit mois. Je me serais proposé moi-même, tant je trouve que tu feras un maître magnifique.
– Mon cher, tu n’es ni assez petit ni assez grand : il me faut un colosse ou un gnome. Reste où tu es. As-tu jamais réfléchi sur les livrées ? C’est une grave question.
– Dame ! j’ai lu Aristote, chapitre des chapeaux.
– Que penserais-tu d’une capote bleu de ciel avec des parements rouges ?
– Nous avons aussi l’uniforme des Suisses du pape, jaune, rouge et noir, avec une hallebarde. Qu’en dis-tu ?
– Tu m’ennuies. J’ai passé en revue toutes les couleurs ; le noir est comme il faut, avec une cocarde ; mais c’est trop sévère. Le marron n’est pas assez jeune, le gros bleu est discrédité par le commerce : tous les garçons de peine ont l’habit bleu et les boutons blancs. Je réfléchirai. Regarde-moi un peu mes nouvelles cartes de visite.
– LÉONCE DE BAŸ et une couronne de marquis ! Je te passe le marquisat, cela ne fait de tort à personne. Mais je crois que tu aurais mieux fait de respecter le nom de ton vieux père. Je ne suis pas rigoriste, mais il me fâche toujours un peu de voir un galant homme se déguiser en marquis, en dehors du carnaval. C’est une façon délicate de renier sa famille. Pour que tu sois marquis, il faut que ton père soit duc, ou mort : choisis.
– Pourquoi prendre les choses au tragique ? Mon excellent homme de père rirait de tout son cœur à voir son nom ainsi fagoté. Ne trouves-tu pas que ce tréma sur l’y est une invention admirable ? Voilà qui donne aux noms une couleur aristocratique ! Il ne me manque plus que des armoiries. Connais-tu le blason ?
– Mal.
– Tu en sais toujours assez pour me dessiner un écusson.
– François, du papier ! Tiens, voici les armes que je te donne. Tu portes écartelé d’or et de gueules. Ceci représente des lions de gueules sur champ d’or, et cela des merlettes d’or sur champ de gueules. Es-tu content ?
– Enchanté. Qu’est-ce qu’une merlette ?
– Un canard.
– De mieux en mieux. Maintenant, une devise un peu effrontée.
– BAŸ DE RIEN NE S’ÉBAŸT.
– Magnifique ! Dès ce moment, je te dois hommage comme à mon suzerain.
– Eh bien ! féal marquis, allumons un cigare et ramène-moi à l’école. »
Léonce passa l’été à Vichy et revint au mois d’octobre. Il ramena un grand domestique blond et un magnifique cheval noir. C’était l’héritage d’un Anglais mort du spleen entre deux verres d’eau. Il me fit annoncer son retour par le superbe Jack, dont la livrée gris de souris excita mon admiration. Jack portait sur ses boutons les armes des Baÿ, sans me payer de droits d’auteur.
Le plus beau de mes amis me reçut dans un appartement empreint d’une coquetterie mâle. On n’y voyait aucun de ces brimborions qui trahissent les attentions d’une femme : pas même une chaise de tapisserie ! Le meuble de la salle à manger était en chêne. Le salon, de satin ponceau, avait un air décent, riche et confortable. Le cabinet de travail était plein de dignité : vous auriez dit le sanctuaire d’un auteur qui écrit l’histoire des Croisades. Dans la chambre à coucher, on voyait une énorme tapisserie représentant la clémence d’Alexandre, une table de toilette en marbre blanc, un magnifique nécessaire étalé dans l’ordre le plus parfait, quatre fauteuils de moquette, et un lit à colonnes, lit monastique, large de trois pieds tout au plus.
La décoration ne donnait aucun démenti aux assurances de l’ameublement. Dans le salon, des paysages, une esquisse de Corot, quelques études signées Français, Villevieille, Varennes, Lambinet. Dans la salle à manger, un tableau de chasse par Mélin, quelques volailles par Couturier, une nature morte d’après Philippe Rousseau. Dans le cabinet, un trophée d’armes, de cannes et de cravaches, et quatre grands passe-partout remplis de gravures à l’eau-forte qui auraient pu figurer chez le farouche Hippolyte : des Paul Huet, des Bracquemond, de Méryon. Dans la chambre à coucher, cinq ou six portraits de famille achetés d’occasion chez les brocanteurs de la rue Jacob. Les meubles, les tableaux, les gravures et les livres de la bibliothèque, triés avec un soin scrupuleux, chantaient à l’unisson les louanges de Léonce. Les belles-mères pouvaient venir !
Mon premier soin en entrant fut de chercher les cigares, mais Léonce ne fumait plus. Il savait que le cigare, qui unit les hommes entre eux, n’a pas la vertu d’arranger les Mariages, et que le tabac offense également les femmes et les abeilles, créatures ailées. Il me raconta sa campagne d’été, et me montra triomphalement vingt-cinq ou trente cartes de visite qui représentaient autant d’invitations pour l’hiver.
« Lis tous ces noms, me dit-il, et tu verras si j’ai jeté ma poudre aux moineaux ! »
Je m’étonnai de ne voir que des noms de la Chaussée-d’Antin. « Pourquoi cette préférence ? Les héros de Balzac allaient au faubourg Saint-Germain.
– Ils avaient leurs raisons, dit Léonce ; moi j’ai les miennes pour n’y pas aller. À la Chaussée-d’Antin, mon nom et mon titre peuvent me servir ; ils me nuiraient peut-être au faubourg Saint-Germain. Annonce un marquis dans un salon de la rue Laffitte, cinquante personnes regarderont la porte. Rue de l’Université, personne ne lèvera les yeux. Les valets eux-mêmes y sont blasés sur les marquis. Et puis, tous ces nobles de vieille date se connaissent et s’entendent : ils sauraient bientôt que je ne suis pas des leurs. On ne demanderait pas à voir mes parchemins, mais on se dirait à l’oreille qu’on ne les a jamais vus. Mon marquisat serait éventé, et l’on m’enverrait chercher fortune ailleurs. Du reste, les grandes fortunes sont rares dans ce noble faubourg. Je me suis informé : il y en a cent ou cent cinquante, si vieilles que tout le monde en a entendu parler ; si claires, si évidentes, si bien établies au soleil, que tout le monde en a envie : de là, vingt prétendants autour d’une héritière. J’aurais beau jeu à faire le vingt et unième ! On ne m’y prendra pas. Regarde la Chaussée-d’Antin : quelle différence ! Dans le salon du moindre banquier ou du plus modeste agent de change, tu vois danser dans le même quadrille une douzaine de fortunes colossales ignorées du public, et qui ne se connaissent pas entre elles. Celle-ci date de vingt ans, celle-là d’hier. L’une sort d’une raffinerie d’Auteuil, l’autre d’une usine de Saint-Étienne, l’autre d’une manufacture de Mulhouse ; l’une arrive directement de Manchester, l’autre débarque à peine de Chandernagor. Les étrangers sont tous à la Chaussée-d’Antin ! Dans cette cohue toute retentissante du bruit de l’or, toute scintillante de diamants, on se rencontre, on se connaît, on s’aime, on s’épouse, en moins de temps qu’il n’en faut à une duchesse pour ouvrir sa tabatière. C’est là qu’on sait le prix du temps ; c’est là que les hommes sont vivants, remuants et pressés d’agir comme moi ; c’est là que je jetterai mon filet dans l’eau bruyante et tumultueuse ! »
Il me récita un passage du Lis dans la vallée, qui contenait les règles de sa conduite ; c’est la dernière lettre de Mme de Mortsauf au jeune Vandenesse. Nous relûmes ensuite les conseils d’Henri de Marsay à Paul de Manerville ; puis il demanda le déjeuner, puis il perdit deux heures à sa toilette, deux heures juste, à l’exemple de M. de Marsay.
Je le vis assez souvent, dans le cours de l’hiver, pour remarquer comme il pratiquait les leçons de son maître. S’il est vrai que le travail mérite récompense et que toute peine soit digne de loyer, il lui était dû d’épouser Modeste Mignon, Eugénie Grandet ou Mlle Taillefer. Il se montrait partout aux heures où l’on se montre. Il galopait au bois tous les soirs, aussi exactement que si sa course eût été payée. Il ne manqua aucune première représentation des théâtres de bonne compagnie ; il fut assidu aux Italiens comme s’il eût aimé la musique. Il ne refusa pas une invitation, ne perdit pas un bal, et n’oublia jamais une visite de digestion. En quoi je l’admirais. Sa toilette était exquise, sa chaussure, parfaite, son linge miraculeux. J’avais honte de sortir avec lui, même le dimanche, où nous portions des chemises empesées. Quant à lui, il sortait volontiers avec moi. Il avait loué pour six mois un coupé tout neuf où le carrossier avait peint provisoirement ses armoiries.
Dans le monde, il se recommanda dès l’abord par deux talents qui vont rarement ensemble : il était danseur et causeur. Il dansait le mieux du monde, au point de faire dire qu’il avait de l’esprit jusqu’au bout des pieds. Il avait des jarrets solides, ce qui ne gâte rien, et un bras à porter une valseuse de plomb. Toutes les filles qui dansaient avec lui étaient enchantées d’elles-mêmes, et de lui par conséquent. Les mères, de leur côté, veulent toujours du bien à l’homme qui fait briller leurs filles. Mais lorsque après une valse ou un quadrille il allait s’asseoir au milieu des femmes d’un certain âge, le penchant qu’on avait pour lui se changeait en enthousiasme. Il avait trop de bon goût pour lancer des compliments à la tête des gens, mais il faisait trouver des idées à ses voisines, et les plus sottes devenaient spirituelles au frottement de son esprit. Il se refusait sévèrement les douceurs de la médisance, ne remarquait aucun ridicule, ne relevait aucune sottise et plaisantait sur toutes choses sans jamais blesser personne ; ce qui n’est pas chose facile. Il n’avait aucune opinion sur les matières politiques, ne sachant pas dans quelle famille l’amour pouvait le faire entrer. Il s’observait, se surveillait et s’épiait perpétuellement sans en avoir l’air. Il se disait à lui-même vingt fois par soirée : Ma fille, tenez-vous droite !
Autant il était gracieux devant les femmes, autant il était froid dans ses rapports avec les hommes. Sa roideur frisait l’impertinence. C’était encore un moyen de faire sa cour à celles dont il attendait tout ; une façon détournée de leur dire : Je ne vis que pour vous seules. Le sexe faible est sensible aux hommages des forts, et c’est double plaisir de faire courber une tête orgueilleuse. Sa superbe était trop affectée pour passer inaperçue : elle lui attira des querelles. Il se battit trois fois et corrigea ses adversaires galamment, du bout de l’épée : le plus malade des trois fut quinze jours au lit. Le monde sut gré à Léonce de sa modération comme de sa bravoure, et l’on reconnut en lui un beau joueur qui prodiguait sa vie en ménageant celle des autres.
C’était, au reste, le seul jeu qu’il se permit. Quand la lettre de Mme de Mortsauf ne l’aurait pas prémuni contre les cartes, il s’en serait défendu de lui-même, dans l’intérêt de sa réputation et de ses finances. Il jetait l’argent à pleines mains, mais à bon escient. Il ne refusait ni un billet de concert, ni un billet de loterie ; nul citoyen des salons de Paris ne payait plus largement ses contributions. Il savait, à l’occasion, vider son porte-monnaie dans la bourse d’une quêteuse ou s’inscrire pour vingt louis sur le carnet d’une dame de charité. Il dépensait beaucoup pour la montre et fort peu pour le plaisir, comptant pour inutile tout déboursé fait sans témoins. C’est en cela surtout qu’il se distinguait de ses modèles, les Rubempré et les de Marsay, hommes de joie et grands viveurs. Il ne faisait pas de dettes, il n’avait pas de maîtresses ; il évitait tout ce qui pouvait l’arrêter dans sa course. Il voulait arriver sans retard et sans reproche : c’est la grâce que je vous souhaite.
Malgré de si louables efforts, il dépensa trois mois d’hiver et 35 000 francs d’argent, sans trouver ce qu’il cherchait. Peut-être manquait-il un peu de souplesse. Je l’aurais voulu plus moelleux. À l’étudier de près, on découvrait un bout d’oreille bretonne qui pouvait effaroucher le mariage. Il était trop agité, trop nerveux, trop tendu. C’était une machine supérieurement montée, mais on entendait le bruit des roues. Une femme de trente ans aurait pu lui donner le supplément de manières qui lui manquait ; et, si j’en crois la renommée, il avait des professeurs à choisir ; mais son plan était tracé, et il n’accepta les leçons de personne.
Quand je lui fis ma visite de nouvel an, il passa en revue les trois mois qui venaient de s’écouler. Il n’avait encore trouvé que des partis inaccessibles : une veuve légère et légèrement ruinée ; une princesse russe plus riche, mais suivie de trois enfants d’un premier lit ; et la fille d’un spéculateur taré.
« Je n’y puis rien comprendre, me dit-il avec une certaine amertume. J’ai des amis et point d’ennemis ; je connais tout Paris et je suis connu ; je vais partout, je plais partout ; je suis lancé, je suis même posé, et je n’arrive à rien ! Je marche droit à mon but, sans m’arrêter en route : on dirait que le but recule devant moi. Si je cherchais l’impossible, on s’expliquerait cela ; mais qu’est-ce que je demande ? Une femme de mon milieu, qui m’aime pour moi. Ce n’est pas chose surnaturelle ! Mathieu a trouvé dans son monde ce que je poursuis vainement dans le mien. Cependant je vaux bien Mathieu.
– Au physique, du moins. As-tu de leurs nouvelles ?
– Pas souvent : les heureux sont égoïstes. Le licencié améliore ses terres ; il met de la marne, il sème du sarrasin, il plante des arbres : des niaiseries ! Sa femme va aussi bien que le comporte son état. On espère l’avènement de Mathieu II pour le mois d’avril : il n’y a pas de temps perdu.
– Je ne te demande pas si l’on s’aime toujours.
– Comme dans l’arche de Noé. Papa et maman sont à genoux devant leur belle-fille. Mme Bourgade a bien pris : il paraît que c’est décidément une femme distinguée : tout ce monde s’occupe, s’amuse et s’adore : ils ont du bonheur !
– Tu n’as jamais eu la velléité d’aller les rejoindre avec le restant de tes écus ?
– Ma foi, non ! J’aime mieux mes ennuis que leurs plaisirs. Et puis, il n’est pas encore temps d’aller me cacher. »
En effet, huit jours après, il arriva tout radieux au parloir de l’école.
« Brr ! fit-il, on n’a pas chaud ici.
– Quinze degrés, mon cher, c’est le règlement.
– Le règlement n’est pas si frileux que moi, et j’ai bien fait de me laisser refuser, d’autant plus que je touche à mon but.
– Tu es sur la voie ?
– J’ai trouvé ! »
Léonce avait remarqué la gentillesse et l’élégance d’une toute petite femme, si frêle et si mignonne, que ses perfections devaient être admirées au microscope. Il avait valsé avec elle, et il avait failli la perdre plusieurs fois tant elle était légère et tant on la sentait peu dans la main ; il avait causé, et il était resté sous le charme : elle babillait d’une petite voix de fauvette assez mélodieuse pour faire croire à quelqu’une de ces métamorphoses qu’Ovide a racontées dans ses vers. Cet esprit féminin courait d’un sujet à l’autre avec une volubilité charmante. Ses idées semblaient onduler au caprice de l’air, comme les marabouts qui garnissaient le devant de sa robe. Léonce demanda le nom de cette jeune dame qui ressemblait si bien à un oiseau-mouche : il apprit qu’elle n’était ni femme ni veuve, malgré les apparences, et qu’elle s’appelait Mlle de Stock. Le monde lui donnait vingt-cinq ans et une grande fortune. Sur ces renseignements, Léonce se mit à l’aimer.
Chez les peuples civilisés, les naturalistes reconnaissent deux variétés d’amour honnête : l’un est une plante sauvage qui se sème spontanément dans les cœurs, qui se développe sans culture, qui jette ses racines jusqu’au plus profond de notre être, qui résiste au vent et à la pluie, à la grêle et à la gelée, qui repousse si on l’arrache, et qui emprunte à la nature une vigueur et une ténacité invincibles ; l’autre est une plante de jardin que nous cultivons nous-mêmes, soit pour ses fleurs, soit pour ses fruits : tantôt c’est une mère qui la sème dans l’âme de sa fille pour la préparer insensiblement à un brillant mariage ; tantôt on voit deux familles désireuses de s’unir par un lien étroit, sarcler et arroser dans le cœur de leurs enfants une petite passion potagère ; quelquefois un jeune ambitieux, comme Léonce, s’applique à développer en lui les germes d’un amour qui promet des fruits d’or. Cette variété, plus commune que la première, se cultive en plates-bandes dans les salons de Paris ; mais, comme toutes les plantes de jardin, elle est délicate, elle exige des soins, elle résiste rarement au froid et jamais à la misère.
Léonce se fit montrer le baron de Stock qui jouait à l’écarté et perdait des sommes avec l’indifférence d’un millionnaire. En ce moment, Mlle de Stock lui parut encore plus jolie. Le baron portait une assez belle brochette de décorations étrangères. Sa fille est adorable ! pensa Léonce. Il se fit présenter à la baronne, une noble poupée d’Allemagne, couverte de vieux diamants enfumés. Cette digne femme lui plut au premier coup d’œil. Peut-être l’eût-il trouvée un peu ridicule si elle n’avait pas eu une fille aussi spirituelle. Peut-être aussi aurait-il jugé que Mlle de Stock manquait un peu de distinction, s’il ne lui eût pas connu une mère aussi majestueuse.
Il dansa tout un soir avec la jolie Dorothée et murmura à son oreille des paroles de galanterie qui ressemblaient fort à des paroles d’amour. Elle répondit avec une coquetterie qui ne ressemblait pas à de la haine. La baronne, après s’être renseignée, invita Léonce à ses mercredis : il y fut assidu. M. de Stock habitait, rue de La Rochefoucauld, un petit hôtel entre cour et jardin, dont il était propriétaire. Léonce se connaissait en mobilier, depuis qu’il avait acheté des meubles. Sans être expert, il avait le sentiment de l’élégance. Il pouvait se tromper, comme tout le monde, car il faut être commissaire-priseur pour distinguer un bronze artistique d’un surmoulage à bon marché, pour deviner si un meuble est bourré de crin ou nourri économiquement d’étoupes, et pour reconnaître à première vue si un rideau est en lampas ou en damas laine et soie. Cependant, il n’était pas du bois dont on fait les dupes, et l’intérieur du baron le ravit. Les domestiques, en livrée amaranthe, avaient de bonnes têtes carrées et un accent allemand qui écorchait délicieusement l’oreille. On reconnaissait en eux de vieux serviteurs de la famille, peut-être des vassaux nés à l’ombre du château de Stock. Le train de maison représentait une dépense de soixante mille francs par an. Le jour où Léonce fut accueilli par le baron, fêté par la baronne et regardé tendrement par leur fille, il put dire sans présomption : J’ai trouvé !





























