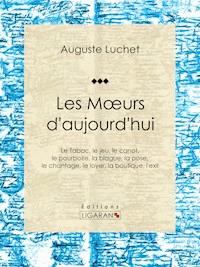
Extrait : "Commençons par le commencement. À tout seigneur tout honneur. Et d'abord, je demande à protester ici avec l'énergie convenable contre toute interprétation antifiscale et mal trésorière qu'il plairait à des esprits gauches de donner à ce qui va suivre. L'impôt du tabac me paraît un impôt très légitime en principe, ne portant sur rien que l'on puisse raisonnablement manger ou boire."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050172
©Ligaran 2015
Quiconque a l’honneur de travailler pour le public doit à son maître l’explication de son travail :
Car le public est notre maître.
L’écrivain doit en conséquence au lecteur la raison de ce qu’il lui donne à lire.
C’est le motif des préfaces. Et en voici une.
Mais, premièrement, lit-on encore aujourd’hui ? Et si on lit, qu’est-ce qu’on lit ? Je ne crois pas que ce soit les préfaces.
Les romans-feuilletons, assez volontiers : prose régimentaire, soumise à l’examen de capitaines compteurs de boutons et inspecteurs de guêtres ; collection farineuse et ménagère d’inventions surmoulées, renouvelées, retapées ; manière de clichés littéraires sans couleur ni cachet, où parfois apparaissent, rarœ nantes, des fantaisies pâles, incertaines et peureuses d’elles-mêmes, que des avoués et des marchands de chocolat ont préalablement contrôlées, corrigées et diminuées, dans leur légitime défiance des poètes.
Ou bien encore la reproduction avec figures d’ouvrages plus anciens, déjà lus et qui valaient mieux sans doute, mais qu’on se prend à relire comme si l’on se disait que n’y ayant aujourd’hui plus rien à exprimer, il n’y a non plus rien à savoir ; publications de forme infime, au reste, et malplaisantes à l’œil, faible honneur de la typographie, tentation du bon marché sur le désœuvrement. Allez aux foires, vous verrez acheter une foule de choses inutiles dans les boutiques à quatre sous : la librairie illustrée est la boutique à quatre sous des foires, et ses produits, en général, n’ont pas beaucoup meilleure mine sur une table que leurs rivaux les feuilletons recousus. Ils n’auront guère un meilleur sort non plus. Quand ils auront été suffisamment déchirés et salis par Monsieur, Madame, la bonne, les enfants, le chat et le chien, on en allumera le feu.
Nous n’entendons aucunement nier, au reste, les services que cette librairie a rendus, par intention ou par spéculation, en popularisant des ouvrages fort bons que leur haut prix rendait inaccessibles aux pauvres.
Voilà donc ce qu’on lit, quand on lit.
Les exceptions ne comptent pas.
Mais ce petit livre sans drame, sans histoire et sans fleurs, qui parle de mœurs et qui coûte trois francs, qui le lira ?
A-t-on seulement, depuis tant de choses passées, un souvenir encore de celui qui l’a écrit ?
Et puis à quoi bon parler mœurs ?
Est-ce que ce n’est pas comme si l’on parlait morale ?
Un livre de mœurs, cela sent la critique d’ailleurs ; et le temps n’est pas à la critique.
La critique implique, en effet, qu’il y a eu liberté dans la production du fait critiqué.
Or, comment critiquer le fait qui n’a pas été commis librement, dont la production tient à un ensemble providentiel ou fatal, comme y tiendrait, par exemple, l’arrivée en roulant d’un corps au bas d’une pente sans rampe, fossé, digue ni garde-fou ?
Où il y a force majeure, peut-il y avoir critique ?
Je cite au hasard. La censure dramatique a modifié une pièce de théâtre ; je ne sais pas ce qu’était cette pièce avant les modifications ; ai-je le droit de la critiquer ?
De même aussi la critique, pour valoir et servir, a besoin d’être libre.
Or est-on absolument libre de critiquer les mœurs d’un pays ?
Et quand on n’est pas absolument libre de parler, ne ferait-on pas mieux de se taire ?
Qu’est-ce qu’on entend par les mœurs ? J’ouvre le dictionnaire de Trévoux et je lis : – MŒURS.– Façon de vivre, ou d’agir, bonne ou mauvaise ; habitudes, naturelles ou acquises, pour le bien ou pour le mal, et suivant lesquelles les peuples, ou les particuliers, conduisent les actions de leur vie.
Les mauvaises mœurs sont contagieuses, dit Bossuet.
Or, les mœurs sont ce que la société veut ou souffre qu’elles soient.
Ce ne sont pas elles qui font la société, évidemment ; c’est la société qui les fait.
De même qu’un gouvernement est toujours plus ou moins l’image du pays qu’il gouverne. S’il était son contraire absolu, il ne durerait pas une minute. Si les mœurs n’étaient point conformes à la société, la société les rejetterait.
C’est donc un vieux sophisme que de prétendre séparer, selon le besoin, la société de ses mœurs et un état de sa politique. Cela n’est point juste, ni brave même, puisque c’est décliner une responsabilité à laquelle personne n’échappe.
Ainsi on ne critique pas une société, on la subit : de même, on ne critique pas des mœurs, on les constate.
On critique ce qui peut être changé par son auteur ou par autrui. Critiquer veut dire pour les uns donner un conseil, un avis, une réprimande, vous inviter à faire mieux que vous n’avez fait : c’est supposer que vous auriez pu mieux faire. Pour d’autres, critiquer c’est examiner, juger et condamner, comme s’il s’agissait d’un méfait à punir ou d’un méchant à supprimer.
L’une et l’autre façon d’entendre la critique peuvent être adoptées selon le cas, en matière d’art ou de littérature ; je n’en disconviens point. On nous l’a fait voir, quand on a voulu, et nous l’avons fait voir aussi.
Il y a encore la critique complaisante et panégyrique, qui n’en est pas une et dont nous ne parlons pas.
Ainsi réprimander ou condamner, voilà toute l’affaire.
Mais quand on est d’avis que ce qui existe a ses nécessités d’être, et ne saurait changer actuellement sans contrevenir, par exemple, aux lois du mouvement et de la logique, pourquoi le critiquer ?
Est-ce que critiquer, en pareil cas, ne voudrait pas dire attaquer ?
Et la société faisant elle-même ses mœurs, est-ce que critiquer les mœurs ne serait pas attaquer la société ?
Or la société ne permet pas qu’on l’attaque. Et c’est son droit.
Donc c’est entendu ; et nous n’avons point ici de critique à faire. Ce n’est pas notre droit, et ce n’est pas notre devoir.
Où manque le droit, toutes les législations le reconnaissent, le devoir manque aussi.
Citons à cet égard ce qu’il y a de plus haut dans l’humanité. Ce qui fait le devoir des enfants envers les parents, c’est le droit à la nourriture, à l’habit, à l’abri, à la protection, à l’éducation, à l’affection.
Où serait notre droit envers ce que nous blâmerions, et en conséquence où est notre devoir ?
Encore une fois nous n’avons qu’à constater.
Or chacun agit selon ses moyens et parle dans sa langue. La critique des savants a parfaitement le droit de trouver la langue pauvre et les moyens mal choisis : c’est affaire, cela, entre l’ouvrier et ceux qui verront l’œuvre. Seulement
La critique est aisée et l’art est difficile.
Ce que nous avons voulu constater dans ce livre, – et encore constater est bien ambitieux – c’est l’effet de certaines influences sur les coutumes et communes habitudes de la nation Française, en général, et des Parisiens en particulier.
Ainsi l’influence de la pipe, qui a causé la séparation des hommes d’avec les femmes ;
L’influence de la bière et des cartes, autrement dite vie d’estaminet, qui a causé la désertion du domicile ;
L’influence de ces trois habitudes réunies, qui a fait de l’homme une matière et tend tous les jours à supprimer le citoyen ;
L’influence du canot, qui a corrompu le langage, sali le costume, supprimé la politesse, et n’a fourni de bon qu’un peu d’exercice en plein air, tout aussitôt gâté par la première des habitudes ci-dessus ;
L’influence de la blague, qui a popularisé le mensonge en le rendant amusant ;
L’influence de la pose, qui porte tant des nôtres et des vôtres à vouloir passer pour ce qu’ils ne sont pas ;
L’influence du chantage, qui a fait entrer dans nos usages le vol et l’escroquerie ;
L’influence du pourboire, qui mène à nous changer tous en mendiants ou en laquais ;
Etc. etc.
C’est ainsi, par exemple, qu’un médecin physiologiste sachant, avec Bichat, que la mesure de la vie est la différence qui existe entre l’effort des puissances extérieures et celui de la résistance intérieure ; sachant, avec Broussais, que la médecine consiste tout entière dans l’étude de la double action des agents extérieurs sur nos organes et de nos organes les uns sur les autres, s’appliquera, s’il veut être utile, à chercher quels sont les mauvais agents, afin de nous apprendre à nous en préserver, et en quoi peut consister l’effort nuisible des puissances, afin d’y mesurer notre résistance. C’est ce qui fait la santé ; c’est ce qui fait la vie. Pipe, blague, pose, etc. sont de mauvais agents ; jeu, boutique, pourboire, chantage, sont des puissances funestes. Le dire ne saurait nuire ; le taire ne ferait de bien à personne, le bien mal venu ou mal acquis n’étant point du bien.
Voilà, nous le répétons, tout ce que nous avons voulu : signaler quelques mauvaises habitudes et tâcher d’y soustraire ceux qu’elles n’ont pas encore atteints.
Quant à ceux que ces habitudes possèdent, notre prétention n’est point de les y faire renoncer. Ce serait trop vouloir. Nous faisons ici de l’hygiène plutôt que de la médecine ; et si d’ailleurs nous allions dire à ces gens-là qu’ils sont malades, soyez convaincu, comme nous le sommes, qu’ils ne le croiraient pas. L’habitude émousse le sentiment, c’est une autre loi physiologique. « Le propre de l’habitude, dit encore Bichat, est de ramener toujours le plaisir ou la douleur non absolus à l’indifférence qui en est le terme moyen. »
L’indifférence, hélas !
Et c’est très vrai. Ainsi le fumeur a été malade à sa première pipe ; donc la pipe est une chose mauvaise. Il ne l’est plus : l’habitude a émoussé le sentiment. Mais il ne s’ensuit point que de mauvaise la chose soit devenue bonne. L’habitué des estaminets a ressenti du trouble et de la honte après sa première journée passée parmi les dominos et les cannettes : donc cette façon de vivre n’est point absolument honorable. Aujourd’hui plus rien en lui ne se soulève : est-ce à dire que l’opprobre se soit changé en gloire ?
Non ! mais l’indifférence est venue. L’appareil nerveux a digéré le poison et l’intelligence a digéré la honte ; de même que l’apprenti, dans nos villes, pleure sous les premiers coups du maître et ne sent rien aux derniers. Les coups sont toujours des coups cependant ; seulement la sensibilité est morte. La sensibilité qui est la fierté ! la sensibilité qui est l’héroïsme ! la sensibilité qui est la croyance ! la sensibilité qui est la bonté ! la sensibilité qui est l’amour !
Il est triste, pour un homme, de voir ses semblables assassiner tant de vertus.
Enfin, il n’en sera toujours que ce qu’il doit en être. – J’ai vécu, disait Duclos au XVIIIe siècle, je voudrais être utile à ceux qui ont à vivre. –
Et c’est tout.
Paris, 29 juillet 1854.
Commençons par le commencement. À tout seigneur tout honneur.
Et d’abord, je demande à protester ici avec l’énergie convenable contre toute interprétation antifiscale et mal trésorière qu’il plairait à des esprits gauches de donner à ce qui va suivre. L’impôt du tabac me paraît un impôt très légitime en principe, ne portant sur rien que l’on puisse raisonnablement manger ou boire. Quant à la façon même dont cet impôt est perçu en France, quant au mônôbôle, comme disait germaniquement à la tribune le ministre des finances Humann, je n’y sens rien non plus qui me répugne. J’avouerai, si l’on veut, et la honte n’en est pas pour moi, que parfois je voudrais voir le procédé s’étendre. Jadis, à ce qu’on assure, la fabrication libre de toutes choses était chez nous d’une loyauté majestueuse ; le monopole eût paru alors et dû paraître quelque chose d’exorbitant. Aujourd’hui, en présence de ce que nous sommes devenus, le monopole serait presque une garantie. Mais laissons là cette triste thèse : la concurrence illimitée devait faire ses petits, elle les a faits.
Ainsi donc, que l’État vende, avec honnêteté, huit francs le kilogramme au consommateur une denrée non indispensable qui lui coûte vingt-cinq ou trente sous, je n’ai rien à y reprendre. Au lieu de huit francs, bien plus, s’il la vendait cinquante francs, je regarderais seulement comme à plaindre quelques pauvres vieux nez d’invalide ou de curé ; et tout au plus. Ce qui nous touche dans cette question, par notre curieuse et maladroite fantaisie de chercher au fond des choses, c’est la condition peu honorable que menace de faire, non pas au trésor public, mais à l’esprit public en France, une consommation qui a représenté cent trente millions de francs l’année dernière, et qui, cette année, représentera davantage à coup sûr, l’industrie des pipes, son accessoire et son thermomètre, allant toujours en s’agrandissant.
Cent trente millions de francs ! sur lesquels l’État aura bénéficié de plus de cent millions, un seizième du budget ! C’est beau à l’œil, un chiffre de cette taille, long comme un chemin de fer de cinq cents kilomètres, surtout fait ainsi que le voilà, en dehors des nécessités premières, ne venant ni du pain, ni du vin, ni de la viande, ni du sel, ni de la fenêtre, ni de la porte. Le malheur, c’est qu’il vienne du tabac, comme en Chine le revenu anglais de l’opium, abrutissement consacré par le canon. Qui faut-il en blâmer ? L’excuse est la même pour l’État en France et pour l’Angleterre en Chine. Le Chinois, peuple fini, voulait fumer de l’opium ; le Français, peuple avancé, veut fumer du tabac, en attendant mieux. À leur aise tous deux ! La rivière est-elle responsable des gens qui se noient, ou le raisin des ivrognes ? La loi profite de l’abus, elle ne l’ordonne pas ; veut-elle le réprimer, quelquefois on la blâme, etc. Nous aurions là-dessus plus d’un sophisme à risquer ; mais il ne faut jamais pousser les choses imprudemment.
Quoi qu’il en soit, c’est une chose assez funèbre pourtant que du tabac puisse rapporter tant d’argent. La mauvaise herbe à Nicot, dont nous tirons la nicotine, qui tue à la dose d’une goutte ! Je dis nous, puisque tout culotteur un peu versé dans la partie, métamorphose, Bocarmé sans le savoir, le petit fourneau où brûle son tabac en alambic pour cette production équivoque ; et qui ne sait qu’en France, pays des sottises bien faites, le mérite du fumeur se mesure à la netteté du culot ! Le Turc lave sa pipe quand elle a servi ; le Hollandais la change ; l’Anglais la passe au feu ; le Français la culotte : grande nation ! Le tabac, dont Fautrel dit qu’un grenadier mourut pour avoir, par mégarde ou par doctrine, avalé le jus de sa pipe, et Helwig, que deux frères s’endormirent à jamais, l’un à sa dix-huitième pipe, l’autre à sa dix-septième : ils avaient parié bouteille, les deux braves, à qui en fumerait le plus ! Voyez Santeuil, un beau poète, l’Orphée de la liturgie catholique, aimant à boire en faisant ses hymnes comme buvaient les chantres qui les chantaient : à table, un soir, le prince de Condé, à moitié ivre, lui met un peu de tabac dans son vin ; Santeuil boit, et il meurt ! Je sais bien que fumer n’est pas avaler, pour qui sait s’y prendre ; mais lisez Ramazzini, traduit par Fourcroy, vous y trouverez l’histoire de la jeune fille qui périt en des convulsions horribles pour avoir couché, la nuit, dans une chambre où l’on avait râpé du tabac. Regardez les ouvriers qui travaillent la feuille, les employés sédentaires d’une manufacture, les voisins eux-mêmes, s’il vous plaît ! et dites si, malgré toutes les précautions de la science, la fabrication n’est point insalubre. Le poison n’agit pas également sur tous, parbleu ! Des doreurs résistent au mercure et des fondeurs de cuivre à l’arsenic ; en Normandie, les marchandes de poisson boivent du trois-six, et Mithridate eut, dit-on, digéré impunément tout Orfila. Dans l’homme, comme ailleurs dans la nature, on trouve des surfaces plus ou moins réfractaires. Ceux qui s’habituent vont : mais comment vont-ils ? Vivent-ils tout à fait ? Ce n’est pas seulement de manger et de boire que la vie humaine se compose : on a un estomac et un ventre, rien de plus vrai, mais on a un cerveau aussi !
Le cerveau ! forge de la pensée, foyer de toute volonté, de tout pouvoir, de tout savoir, empire où l’homme est toujours libre ! Qu’est-ce que les fumeurs achevés font du leur, je vous prie ? J’ai connu en exil un enfant de mon pays qui était spirituel, poète, ardent, inquiet, frémissant, flamboyant à tout propos d’enthousiasme et de tendresse ; un de ces êtres jeunes, frais, turbulents et bons qui vous rendent la patrie partout, dont vous faites à l’instant votre frère ou votre fils, pauvre proscrit pleurant que vous êtes ! Il promettait alors d’être, quand le temps voudrait, une force et une lumière pour sa génération. Il est revenu en France, et je ne sais à la suite de quoi il s’est mis à fumer furieusement. Ces natures-là ne peuvent faire à moitié ni le bien ni le mal. Tout ce qu’il avait de passion et de vigueur y a passé. Pays, famille, dedans, dehors, intérêt, ménage, amour, dignité, santé, la pipe a tout pris. Il est venu quelquefois me voir, par souvenir, ne se sachant pas si éteint ! Il s’asseyait là devant moi, sans mot dire, levant à demi autour de lui un regard atone, jadis le ciel de tant d’éclairs ; si nous étions seuls, il tirait de sa poche une pipe soigneusement vêtue à l’encontre de tout frottement suspect, et la déshabillant comme ferait de son petit une mère, il m’en montrait le culot avec cet orgueil froid et malade du chimiste que son œuvre a mis sur les dents. Je n’admirais pas, moi, je m’indignais ! Alors il rhabillait lentement sa bouffarde bien-aimée, la chargeait religieusement, l’allumait avec respect, et souriant du sourire triste d’un ami méconnu, il s’en retournait en silence comme il était venu. Était-ce donc là, ô mon pays, ce qu’il fallait absolument que devînt ta jeunesse ?
Pour qui a lu un peu d’histoire, il est clair qu’on ne trouve pas de si grandes choses tout de suite ; on n’y vient que petit à petit, et quelquefois même c’est en leur tournant le dos. Si le monopole eût existé d’abord, nous n’aurions pas eu les ordonnances de Louis XIII contre le tabac ; on n’aurait pas vu un sultan le défendre à ses Turcs, et un duc de Moscovie à ses Moscovites, moins sévères tous deux que ce shah de Perse, au nom perdu, qui coupait le nez aux priseurs, et surtout que le pape Urbain VIII, qui leur ôtait le paradis. De mauvais connaisseurs en fait de finances et d’hommes ! Ce ne sont pas les vertus qui rapportent le plus à un État, ce sont les vices. La pipe, d’ailleurs, est un goût, dit l’économiste, et nous sommes aujourd’hui un peuple assez savant pour être libres de nos goûts. La loi veut, tout au plus, imposer certains goûts, ce qu’elle fait ; mais elle n’entend point les suspendre. J’accepte si pleinement cette théorie en faits de goûts, que je voudrais qu’on surimposât encore celui-ci. C’est bien le moins de payer large et lourd pour un mal qu’on a tant de plaisir à se faire ! Qui nuit à lui-même nuit aux autres ; en s’enlevant volontairement une force, il appauvrit volontairement la masse ; et je ne trouverais point injuste que la société confisquât les biens du célibataire qui se suicide. Oui, quand je vois l’effrayante extension que prend chez nous celle consommation équivoque, je songe, malgré moi, à l’ordonnance du 30 mars 1635, dans laquelle l’administration parisienne reconnaissant comme hors de son droit de réglementer cette espèce d’empoisonnement privé, défendait au moins à toutes personnes vendant breuvages de fournir du tabac ni attirer aucun pour en user dans leurs maisons, à peine de la prison et du fouet, suivant arrêt de la Cour du 11 février 1634.
Je sais qu’il faut aujourd’hui plus que jamais mirer son idée à la chandelle, et mettre les points sur les i de son discours : que l’on n’aille point donc trouver dans ce souvenir historique une provocation de ma part à l’emprisonnement des limonadiers. Loin de moi, par Bacchus ! d’attribuer à des commerçants patentés, surveillés, surtaxés et estimables, la responsabilité des maux qui nous viennent de la pipe. L’administration de 1635 pensait dans l’affaire du tabac comme la Chambre des députés de 1839, je crois, dans l’affaire des jeux publics : elle croyait supprimer le goût en restreignant le moyen. Mais du moins, en sa naïveté, essayait-elle de mettre une salutaire entrave à ce qu’elle croyait un échec pour la santé publique, tandis que la nôtre se contente de mettre un impôt. C’est pourquoi, vraiment, sauf la pénalité pédagogique d’autrefois, nous ne blâmerions pas quelque chose ayant, par exemple, pour effet d’obliger les teneurs d’estaminet à rendre respirable l’air qui se fabrique chez eux. Fumons, parbleu ! ce que nous voudrons et tant que nous voudrons, mais entre nous et chez nous. La pipe a sa valeur à jeun ; c’est une médecine Leroy que l’on prend en vapeur. Les femmes ont bien le café au lait ! Le cigare accompagne et distrait le voyageur solitaire. Il y a des besognes infectes dans lesquelles la pipe passe pour une sauvegarde. À la fin d’une journée remplie de fatigue, semée d’incidents fâcheux, fumer est un narcotique qui détend, et qui fait oublier. Le prisonnier, grâce à sa pipe, endure mieux la prison, et le vaincu la défaite ; le travailleur, réduit à chômer, trompe en fumant et chasse l’importun désir de son dîner absent. Le tabac est le népenthès de ces tristesses profondes : il faudrait, en vérité, trop de sagesse et pas assez de cœur pour blâmer celui qui souffre de faire à sa souffrance une passagère enveloppe d’indifférence ou de rêverie. Malheur, si l’on veut, aux choses qui rendent nécessaires ces dangereuses suspensions du sentiment, et pitié aux victimes !
Mais qu’ont-ils donc, pour la plupart, à tant repousser, à tant oublier, à revêtir de tant de nuages, ceux qu’on voit à Paris peupler les grands estaminets ? Qu’est-ce que leur ont déjà fait la Nature et le Monde, à ces jeunes gens de nos écoles ? Ont-ils manqué tout le jour de travail, de pain et d’espérance, ces négociants, ces rentiers, ces fabricants, ces marchands, ces commis qui viennent en troupe, et invariablement, user là leurs soirées à culotter des pipes et vider des canettes ? Car le fumer appelle le boire ; le tabac aime la bière, et qui dit une pipe fumée dit au moins une choppe bue. Tous les fumeurs sont buveurs, lisez Giacomini : ils s’hyposthénisent par le tabac, ils se relèvent par les alcooliques ; or, qui ne sait combien renferment d’alcool les soi-disant bières de Strasbourg, de Munich, de Francfort, de Darmstadt, si mensongèrement faites et débitées à Paris ? Ces deux ivresses finissent par se confondre, à force d’allées et venues réciproques pour se guérir, et vous avez bientôt comme résultat de leur union un idiot qui reste là, le coude sur le marbre, sans couleur, sans geste et sans voix, jusqu’à ce que, onze heures ou minuit ayant sonné, instinctivement averti du devoir de se retirer, il demande à l’eau-de-vie de lui donner un peu de jambes. Le seul exercice intellectuel qu’il ait pu se permettre, c’est le jeu de cartes ; encore l’a-t-il délaissé bientôt ; il y faisait des fautes : son moral n’avait plus même la force de descendre aux profondeurs du bésigue. On en a vu cependant de plus intrépides ; deux, entre autres, qui sont restés à jouer, fumer et boire toute la journée du 23 février 1848, aux vitres d’un café de la rue Jean-Jacques Rousseau. Ils se sont arrêtés à l’heure de mettre la table ; ils ne savaient pas que Paris faisait une révolution !
Entrez tout frais de la rue, un soir d’hiver, dans quelqu’une de ces vastes maisons, palais du tabac, temples de la canette, galeries de la paresse, de l’insouciance, de l’hébétude et de l’anéantissement. Tout de suite, aux premiers pas que vous y faites, vous vous sentez saisi de façon singulière. Des innombrables pipes qui sont là, et des bouches qui, de leurs dents agacées en mordent le bout, s’élève une mer suspendue de fumée aux ondes tournoyantes, qui dévore l’air, rend la lumière malade, et refoule dans votre poitrine la respiration épouvantée. Vous marchez, étourdi d’abord, dans une atmosphère épaisse à couper au couteau, nuée brûlante, piquante, salée, qui vous prend par le nez, par les yeux, par la gorge. Une toux violente, voix des poumons qui se révoltent, vous avertit de fuir ; je ne sais quel vertige commençant vous ordonne de rester !… le vertige, et l’amour-propre aussi : on ne veut pas avoir l’air d’une petite maîtresse. Hélas ! les femmes elles-mêmes n’ont plus cet air charmant : elles font profession de supporter et presque d’aimer la pipe ; on va voir pourquoi tout à l’heure. D’ailleurs ne pouvez-vous point avoir affaire en ce lieu et y connaître les gens ? C’est là, en vérité, que tout le monde vient aujourd’hui : au sortir du bureau, la tabagie ; après la journée, la canette ! Nous cherchons bien loin pourquoi le public des théâtres diminue quand la population générale augmente : c’est qu’on ne fume pas dans les théâtres. L’héroïque M. Gaspari vient d’en rouvrir un qui n’a jamais été bien heureux, le théâtre Beaumarchais ; je crois que s’il y autorisait la pipe, avec du Strasbourg dans les entractes, il ferait de l’argent. Voyez les cafés-concerts : ce qu’on y prend est mauvais et coûte cher ; ce qu’on y entend est presque toujours le déshonneur de l’art, la prostitution de la voix ; mais on y fume. C’est si bon, et c’est si bête ! Et l’on est si heureux quand on est bête ! On ne reste plus les uns chez les autres maintenant ; adieu les après-dînées d’hommes et de femmes, heures frivoles et poudrées d’amour, où le cœur quelquefois se mettait à deux avec l’esprit ; où la parole se donnait la peine d’être recherchée et polie ; où l’on sentait, en causant, monter à soi de douces chaleurs ; où l’on parlait bienfaisance, belles actions, beaux-arts, tendresse, plaisir, bonheur, poésie, vertu même, par hasard ! Le café pris maintenant, et quasi sans dire bonsoir, vous voyez, l’été, les beaux fumeurs sortir et, comme des filles de joie, faire le boulevard, crachant à qui marche derrière eux des camouflets et des brandons. Vous ouvrez la bouche, passant, pour parler à votre mère, ou elle à vous : c’est l’âcre traînée d’un cigare qui s’y jette, et sa cendre qui vous éraille les yeux, même sous les arbres ! même parmi les fleurs ! Quel parfum vaut, pour eux, le parfum d’une pipe ? J’ai entendu dire qu’à Berlin, ville allemande, la police défendait de fumer dans les promenades. Un pays barbare que la Prusse ! L’hiver, ces messieurs ont l’estaminet ou le cercle, selon le monde dont ils sont. On y pense pesant ou méchant, quand on pense ; on y parle grossier, quand on parle ; les sentences ont goût d’écurie et les gaîtés de mauvaise maison : mais on y fume. De sorte que, pour retenir même son mari chez elle, il faut, en vérité, que la femme laisse fumer et fume aussi, elle, une femme !… à moins de prendre un autre parti, ce qu’elle fait quelquefois. À qui la faute ?
Car cela vous arrivera, à vous, après avoir fini de tousser parmi cette artillerie de fourneaux et de gosiers en combustion. La contagion est immédiate et indispensable : ou fumer ou sortir. Vous n’avez pu vous échapper, soumettez-vous. Vous souffririez davantage en ne fumant pas. Je suppose d’ailleurs qu’à votre âge vous n’en êtes plus à l’apprentissage, comme y vint si tard Napoléon le Grand. Curieux de savoir ce qu’y trouvait de bon sa garde, il essaya de fumer un jour, dans une belle pipe qui lui venait d’Orient, chibouque du Grand-Seigneur, propre et saine à coup sûr ; il reconnut que c’était une sale et horrible chose. Il eut des maux de tête, des vertiges, des nausées, des coliques, des vomissements, tout le cortège symptomatique de l’empoisonnement nicotinaire ; il y prit garde, quoi qu’on pût lui dire, et depuis ne vit jamais dans la pipe qu’une habitude bonne à désennuyer les fainéants. La réprobation venait de haut et fut un ordre : l’Empereur prisait, d’ailleurs, et nous prisâmes… de même que beaucoup fument aujourd’hui parce que l’empereur fume. Copier, c’est servir.





























