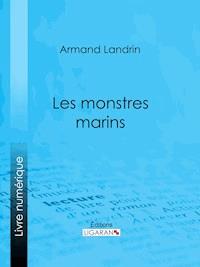
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "La monstruosité de grandeur est chose relative : Dame fourmi trouva le ciron trop petit Se croyant pour elle un colosse. Le rat est plus grand, comparé à la fourmi, que la baleine comparée à l'homme. On doit donc regarder comme d'une taille monstrueuse, non seulement les animaux qui nous semblent énormes, mais encore ceux dont les dimensions dépassent de beaucoup celles des autres de la même classe qu'eux."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À
MME A. LANDRIN
Bien affectueux hommage de son mari
ARMAND LANDRIN
Monstre est un des mots de la langue française les plus difficiles à définir, comme le fait remarquer Voltaire.
Quelques grammairiens disent qu’on doit appeler monstres les êtres contre nature ; ce qui paraît inexact, car, à proprement parler, il ne peut pas exister d’être contre nature.
Les animaux, les végétaux qu’on appelle difformes, ne sont pas opposés aux lois naturelles, que nous sommes d’ailleurs loin de bien connaître ; ils sont seulement en dehors de ce que nous avons l’habitude de voir.
En ce sens, les difformités ne sont pas toujours des anomalies : ce sont simplement des faits inhabituels.
Monstrum désigne, dit le dictionnaire ; tout ce qui est étrange, incroyable, extraordinaire bizarre, hideux, étonnant, excessif dans son genre, d’une férocité inouïe, fabuleuse.
Nous appellerons donc « MONSTRUEUX, tout animal prodigieux par rapport aux autres animaux de la même classe, à quelque titre que ce soit ; ANOMAL, tout animal prodigieux par rapport aux autres animaux de la même espèce. »
Par exemple, une baleine bien faite est un être monstrueux et non anomal, puisqu’elle est d’une grosseur prodigieuse comparée aux autres cétacés, mais qu’elle ne diffère en rien des autres baleines.
Compris de cette manière, le mot monstre ne fait pas naître l’idée d’une difformité, mais il désigne nécessairement ce qui nous étonne et frappe notre imagination, le plus souvent dans un sens opposé aux impressions que produisent sur nous l’harmonie des proportions et la beauté. C’est ainsi que l’ont entendu plus d’un de nos grands écrivains.
La Fontaine nous montre la mère hibou disant à l’aigle :
Et pourtant c’étaient :
C’est qu’en effet c’étaient de petits monstres seulement, et non des êtres anomaux ; laids aux yeux de l’aigle, ils étaient bien faits aux yeux de leur mère, à laquelle ils ressemblaient. S’ils eussent eu trois pattes, c’est-à-dire une patte de plus qu’elle, elle n’eût pu se faire la même illusion.
Montaigne a dit : « Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit dans l’immensité de son ouvrage l’infinité de formes qu’il y a comprises. »
Appuyé de ces autorités, nous nous lancerons hardiment dans la recherche des monstres, évoquant autour de nous les animaux de la Fable et ceux bien plus extraordinaires encore que l’étude de la nature nous révèle, cherchant à ramener la légende aux proportions de la vérité, errant dans un monde effrayant, peuplé de géants, d’êtres horribles, dégoûtants, frôlant des animaux dont les formes étranges choquent toutes nos idées, d’autres dont la voracité sans nom écœure et terrifie !
Que nos lecteurs se figurent qu’enveloppés dans une cloche à plongeur, ils descendent au fond des eaux ; qu’ils voient et touchent les mollusques, les krakens, les poissons, les serpents, les baleines, les requins, etc., dont nous allons leur parler, et peu de songes leur paraîtront plus invraisemblables que ce spectacle de la réalité !
La monstruosité de grandeur est chose relative.
Le rat est plus grand, comparé à la fourmi, que la baleine comparée à l’homme.
On doit donc regarder comme d’une taille monstrueuse, non seulement les animaux qui nous semblent énormes, mais encore ceux dont les dimensions dépassent de beaucoup celles des autres êtres de la même classe qu’eux. Tels sont les êtres dont l’étude fera l’objet de ce chapitre et en particulier les crustacés.
Le Muséum d’histoire naturelle a reçu la dépouille du plus grand crabe que l’on connaisse, écrivait récemment M. Georges Pouchet. Chacune de ses pinces mesure 1m,20 de long. Les pattes étendues, il a une envergure de plus de 2m,60. Il a été pêché au Japon, sur la côte orientale de Nippon, entre le 34e et le 35e degré de latitude nord, par M. de Siebold. Il appartient à l’espèce des araignées de mer, bêtes fort laides déjà quand elles n’ont que la grosseur de la tête d’un enfant, comme dans l’aquarium du boulevard Montmartre. On savait bien qu’elles étaient beaucoup plus grandes dans les mers de la Chine, mais on n’en connaissait aucune qui eût de telles proportions. C’est sans doute un individu très âgé, quelque vieux solitaire qui a vu des siècles passer, immobile à l’entrée de sa caverne et guettant le poisson au passage.
M. Blanchard, qui professe au Muséum l’histoire des animaux articulés, a présenté à l’Académie cet hôte nouveau de nos collections. Il y a joint quelques remarques intéressantes sur l’âge et la croissance de certaines espèces vivantes.
« L’araignée de mer du Japon n’est pas le seul crabe qui grandisse indéfiniment. On trouve sur les côtes des États-Unis un homard très voisin de celui de nos marchés. Depuis de longues années, deux individus de cette espèce sont exposés dans les galeries du Muséum, où ils attirent l’attention des visiteurs, même les moins gourmets, par leurs dimensions extraordinaires. La taille de ces deux vieux animaux avait fait croire autrefois que le homard d’Amérique était beaucoup plus grand que le nôtre. Il n’en est rien. Seulement, autrefois on ne pêchait guère sur la côte des États-Unis : les homards y grossissaient à l’aise. – Une certaine langouste habite les rivages de l’île Maurice et de l’île de la Réunion. Jadis toutes celles qu’on prenait étaient énormes ; aujourd’hui, elles sont petites ; les habitants des deux îles ne les laissent plus grandir. »
Les mollusques dont la coquille est d’un seul morceau, ou valve, les univalves, sont plus ou moins bizarrement modelés ou nuancés, plus ou moins gros, mais aucun ne mérite précisément l’épithète de monstrueux, ni par sa laideur, ni par ses dimensions, ni surtout par sa férocité.
Le plus gros est peut-être le casque de Madagascar (qui n’a guère plus de 0m,45 à 0m,50 de hauteur).
Les casques (fig. 1 et 2) sont employés dans le commerce. On détache leur lèvre épaisse, et une portion du dernier tour, formée de feuillets superposés de teintes alternativement blanc transparent (bleuâtre ou à peine rosé), et brun noirâtre. Ces plaques, aplanies autant que possible, se vendent sous le nom de capotes, aux graveurs, qui savent y ciseler un bas-relief, de telle sorte que toute la sculpture, exécutée dans une des couches, ait la couche sous-jacente pour fond. On obtient ainsi de ravissants effets.
Ces fragments de coquilles, ainsi sculptées, se débitent comme camées.
Un autre casque, le casque rouge, permet d’exécuter de semblables reliefs en rose sur fond acajou.
Le plus long des univalves est la cérithe géante, coquille fossile de 0m,7 de longueur. On en a trouvé un individu vivant près de l’Australie : c’est le seul exemplaire qu’on en connaisse. Il fait partie du musée de M. Delessert, à Paris. Toujours l’extrême pointe est usée ou cassée, sans doute par suite du frottement pendant la marche de l’animal.
Les mollusques dont la tête est indistincte sont tous renfermés dans deux coquilles : ce sont des bivalves.
Le plus connu de tous est l’huître, et comme on a parlé souvent d’huîtres géantes, c’est d’elles que nous, allons tout d’abord nous occuper.
Un marin qui visita Jesso (Japon), en 1643, rapporte, dans sa narration, que sur cette côte vivent en grande quantité des huîtres « qui ont, pour la plupart, une aune et demie de long et un demi quartier de large. »
Ces assertions, si elles se rapportent réellement à des huîtres, sont peu croyables, et les anciens naturalistes étaient bien plus exacts lorsque, dans l’histoire des animaux observés pendant la guerre d’Alexandre le Grand, ils rapportent qu’on trouve dans l’Inde des huîtres d’un pied de diamètre.
On a dit depuis, je ne sais dans quel journal, que sur les côtes d’Amérique abondaient des huîtres grandes comme des plats, et dont une seule suffisait pour assouvir l’appétit de plusieurs personnes. C’est là une fable digne de l’antiquité. Les huîtres qu’on recueille sur les côtes des États Delawares, New-Yorkais, etc., sont très grandes, mais restent néanmoins bien loin des dimensions qu’on a voulu leur attribuer.
L’huître perlière (qui n’est pas une huître, soit dit en passant, mais une aronde), est en vérité de belle grandeur, mais tous ceux qui ont goûté de ce mollusque s’accordent à le déclarer détestable ; de plus, l’animal étant très petit, et le pied seul pouvant se mâcher, la chair qu’on en retire est de peu de volume. Il est probable cependant que c’est de lui qu’ont voulu parler les observateurs qui ont avancé ces récits.
En résumé, les immenses mollusques comestibles de cette espèce, dont on parle si souvent, n’existent guère que dans l’imagination de ceux qui les ont décrits.
En résumé, les immenses mollusques comestibles de cette espèce, dont on parle si souvent, n’existent guère que dans l’imagination de ceux qui les ont décrits.
Les mollusques qui portent ce nom le doivent à la forme triangulaire, à la couleur brun enfumé de leur coquille, qui rappelle grossièrement un jambon.
Leur véritable nom vient du mot penninin ou penim, employé dans la Bible pour désigner ce mollusque ; mais la langue grecque n’ayant fait aucun emprunt aux langues sémitiques, il est bien plus probable qu’on les désigna ainsi à cause de leur byssus, que l’on peut comparer à l’aigrette ou plumet (πίννα), dont les soldats grecs ornaient leur casque.
La coquille des animaux de ce genre est toujours mince, d’une apparence cornée, fragile, glacée. Entre les valves sort une touffe de soies, un byssus (lana pinna), qui le rattache au sol.
Ce fait ne leur est pas particulier ; chacun sait que la moule se tient ancrée de la même manière, et nous allons voir qu’il en est ainsi pour d’autres mollusques.
Les pinnes sont surtout abondantes dans la mer Rouge, la Méditerranée, le Grand Océan.
L’espèce gigantesque qui motive la description de ces animaux habite les côtes de la Nouvelle-Zélande. On peut en voir, dans les galeries zoologiques du Muséum, de magnifiques exemplaires qui ont au moins 0m,40 de longueur et 0m,25 de large. Ses valves sont couvertes d’écailles hérissées et semi-tuberculeuses.
Nous parlions tout à l’heure du byssus du jambonneau : on conçoit que ces filaments flexibles, brillants, solides, longs, aient dû attirer de tout temps l’attention des pêcheurs. Les anciens eurent l’idée de le tisser, et cette fabrication s’est continuée jusqu’à nos jours. Les habitants du Tarente en font des bas ; les Napolitains et les Maltais l’utilisent aussi. À l’Exposition de l’an IX et à celle de 1855, on a beaucoup admiré les draps de pinne des orphelinats de Lecce. Rien ne les égale pour le moelleux et l’égalité des fils qui les composent. Leur couleur, d’un brun doré, est complètement inaltérable.
En 1862, M. Jules Cloquet offrit à la Société d’acclimatation des mitaines de cette fabrication ; mais jusqu’ici la récolte des pinnes est trop minime pour que ces tissus soient autre chose que des objets de simple curiosité.
On trouve assez souvent dans ces mollusques des perles roses. Leur valeur, quoique inférieure à celle des perles blanches, ne laisse pas d’être grande. Elles étaient bien connues des pêcheurs d’Acarnanie, et Strabon, Élien, Ptolémée, Théophraste, en font mention.
Pline raconte sur ce mollusque une assez jolie fable :
« La pinne, dit-il, naît dans les fonds limoneux, et jamais on ne la rencontre sans son compagnon, que les uns nomment pinnothère, et d’autres pinnophylax. C’est une petite squille, une sorte de crabe, et se nourrir est le but de leur association. Le coquillage, aveugle, s’ouvre, montrant son corps aux petits poissons qui jouent autour d’elle. Enhardis par l’impunité, ils remplissent la coquille. En ce moment, la pinnothère, qui est aux aguets, avertit la pinne par une légère morsure : celle-ci se referme, écrase tout ce qui se trouve pris entre ses valves, et partage sa proie avec son associée. »
En forme de commentaire à ce récit du naturaliste romain, ajoutons que la pinnothère est un petit crustacé rose vif, qui pénètre en effet dans les mollusques alors qu’ils sont entrouverts : il y trouve un double avantage, se mettant en sûreté contre les attaques de ses nombreux ennemis, auxquels sa faiblesse l’empêche de résister, et se nourrissant lui-même aux dépens de son hôte.
Nous voici arrivé au roi des coquillages, à la gigantesque tridacne, autrement dit au grand-bénitier.
Décrire la forme des tridacnes est difficile, et nous préférons renvoyer le lecteur à la figure ci-jointe. Comme on le voit, le dessinateur n’a montré qu’une seule valve. Elle est largement côtelée, et ces côtes forment de grandes dents sur le bord. Les dents d’une valve s’engrènent avec les échancrures de l’autre, de telle sorte que ce mollusque peut s’enfermer hermétiquement.
Comme le précédent mollusque, la tridacne produit un byssus à l’aide duquel elle se suspend au rocher, et on concevra aisément quelle doit être la force de ce byssus si l’on songe que le poids d’un de ces mollusques va parfois jusqu’à 600 livres ! Aussi ne peut-on le couper qu’à coups de hache, et encore faut-il s’y reprendre à plusieurs fois avant qu’il soit entièrement tranché.
L’animal du grand-bénitier ne pèse que 14 livres, mais le poids de chacune de ses valves est de 250 à 300 kilogrammes, et elles ont 1 mètre ou 1 mètre 1/2 de longueur. En Chine, on s’en sert comme abreuvoir pour les bestiaux, et de riches mandarins possèdent des baignoires faites d’une de ces coquilles.
Ce furent les Grecs les premiers qui lui donnèrent le nom de tridacne ; mais ce n’est qu’au quinzième siècle que ces magnifiques mollusques furent apportés en Europe. Le célèbre Dampier en trouva un grand nombre près des Célèbes ; il les appelle, dans ses Mémoires, « de grands pétoncles rouges, » et dit qu’une écaille vide pesait 258 livres. Le bénitier, en effet, rappelle quelque peu, par la disposition des cannelures profondes s’emboîtant sur le bord, l’aspect des pétoncles.
La république de Venise fit présent à François Ier d’une magnifique tridacne qui resta jusqu’à Louis XIV dans le trésor royal ; mais le curé Languet finit par l’obtenir de ce monarque, et fit des deux valves deux merveilleux bénitiers qui décorent encore l’église Saint-Sulpice.
D’autres églises, comme celle de Sainte-Eulalie, à Montpellier ; celle de Saint-Jacques, au Havre, etc., possèdent aussi pour bénitiers de beaux coquillages. Plusieurs exemplaires remarquables appartiennent au Muséum de Paris, mais les plus grands que l’on connaisse sont à Rome.
L’animal des tricdanes est vivement coloré, surtout celui de l’espèce dite safranée, qui est bleu sur les bords, violet au centre, rayé en travers d’un bleu pâle, semé de petits ronds jaunes, bruns, etc. Lorsque le voyageur, fouillant de son regard une mer peu profonde, aperçoit un assez grand nombre de ces animaux montrant au travers de l’ouverture bâillante de leurs valves ces brillantes couleurs, il lui semble voir un parterre de fleurs sous-marines à l’éclat velouté.
L’alcool dans lequel on plonge le grand-bénitier se teint en violet rouge très intense, et peut-être pourrait-on utiliser ces propriétés tinctoriales. À notre connaissance, on n’a encore tenté aucun essai dans cette voie.
Toutes les tridacnes habitent les mers chaudes, et l’espèce géante ne se rencontre que dans les mers qui séparent l’Inde de l’Australie, et dans la mer Rouge. Souvent elle vit à de grandes profondeurs, et on ne conçoit pas comment les plongeurs parviennent à s’en emparer.
Les Arabes et les Indiens, et surtout les habitants des Moluques, mangent la chair de ce coquillage, dont le goût rappelle de loin celui du homard. C’est néanmoins un aliment peu agréable, coriace et d’une difficile digestion.
« M. Lamiral, dit M. Moquin-Tandon, vit une perle de la grosseur d’un œuf de poule bantam, parfaitement sphérique et blanche comme du lait, provenant du grand-bénitier. »
Malheureusement pour les pêcheurs arabes, de telles trouvailles sont bien rares.
On prétend que lorsqu’un plongeur maladroit vient à engager sa jambe ou son bras entre les valves d’une tridacne entrouverte, celle-ci se ferme brusquement et le tient prisonnier au fond de l’eau jusqu’à ce qu’il meure asphyxié. Le fait est-il vrai, nous l’ignorons ; il est certain que le mollusque est bien de force à retenir un homme malgré ses efforts pour lui échapper. Un naturaliste, M. Vaillant, voulant savoir quelle était sa puissance, attacha une de ses valves à une poutre, puis accrocha à l’autre valve des seaux d’eau jusqu’à ce qu’il l’eut forcé à s’ouvrir. Il put ainsi constater qu’une tridacne, de 0m,21 seulement de longueur, soulève 4 914 grammes ; une de 0m 25, 7 220 grammes ; et qu’une autre, qui pèse 250 kilogrammes, ne cède qu’à un poids de 900 kilogrammes ! Or quel est l’homme capable de faire remuer seulement un poids de 1 800 livres ? Pour forcer un grand-bénitier à bâiller malgré lui, il faudrait atteler trois chevaux à l’une de ses valves.
Le kraken est un mollusque céphalopode.
Parmi les céphalopodes est un genre qui a reçu le nom de poulpe (altération du mot latin polypus) ; on appelle généralement ainsi par extension tous les céphalopodes, c’est-à-dire les poulpes proprement dits (pieuvre ou chatrouille), les sèches, les calmars, etc. C’est pourquoi on dit poulpe géant en parlant du kraken, bien qu’il soit maintenant reconnu que cet animal est un calmar gigantesque.
On appelle vulgairement les céphalopodes des encornets.
On sait quelle est leur forme. Un sac allongé, ayant la forme d’un œuf, d’un cylindre ou d’un verre à pied, et duquel sort une grosse tête arrondie qui porte latéralement des yeux énormes et aplatis ; sur la tête, au sommet, une sorte de bec de corne brune et dure, de la forme d’un bec de perroquet, et autour de ce bec une couronne de huit ou dix bras vigoureux entés sur la tête : tel est le poulpe.
À la face intérieure, chacun de ses bras est garni d’une double rangée parallèle de ventouses. Ces ventouses se composent d’une sorte de petite tasse dont le fond est mobile. Le poulpe veut-il se coller à un objet, il applique une ou plusieurs de ces ventouses, le fond étant au niveau des bords ; puis il retire ce fond et forme une petite cavité sans air, produisant ainsi un vide qui retient l’objet hermétiquement collé. On comprend quelle est la puissance de ce lien, lorsque plusieurs centaines de ventouses agissent concurremment.
S’ils veulent manger, ils saisissent et flagellent avec leurs bras un animal quelconque, un poisson, un crabe, un mollusque, et l’attirent jusqu’à leur bec, qui leur sert à le déchirer ; car, il faut bien le remarquer, les bras ou tentacules, armés de leurs ventouses, sont des instruments de préhension et non de succion. Certains êtres, la sangsue, par exemple, ont au fond de leur ventouse une dentition propre à déchirer la peau tuméfiée qu’ils ont saisie, mais les céphalopodes n’ont rien de semblable.
La manière de nager de ces mollusques est curieuse. Les branchies ont besoin, pour fonctionner et pourvoir à la respiration, qu’une grande quantité d’eau leur apporte quelques globules d’air. Cette eau pénètre dans l’intérieur du manteau, lequel abrite les branchies ; puis le manteau se contracte, l’eau est chassée au travers d’un tube situé entre les yeux ; une nouvelle dilatation a lieu, l’eau-rentre, puis ressort, et ainsi de suite.
Chaque fois que le manteau se contracte, l’eau chassée par le tube forme un jet qui, frappant la masse inerte environnante, donne un élan en sens contraire au céphalopode. C’est une application naturelle d’un jouet physique bien connu, le tourniquet hydraulique. À chaque pulsation, l’animal avance, et c’est ainsi qu’il chemine rapidement.
On a, croyons-nous, essayé autrefois d’appliquer ce système propulseur à la navigation. On a fait des navires dans lesquels l’eau circulait au travers de larges conduites. Arrivé dans un réservoir, le liquide était repris par une pompe qui le lançait avec vigueur derrière le bâtiment.
L’expérience avait réussi en ce sens que le vaisseau avançait ; mais, pour lancer l’eau avec assez de violence, il fallait une machine à vapeur d’une grande puissance, et dont l’entretien coûtait tellement cher, qu’on a dû renoncer, dans la pratique, à cette invention… renouvelée des poulpes. Peut-être y reviendra-t-on plus tard !
Les céphalopodes de nos côtes sont tous de petite taille, mais il paraît que la haute mer en nourrit qui sont de grandes dimensions. C’est à ce géant des mollusques que les traditions scandinaves ont donné le nom de kraken.
De tous les animaux légendaires il n’en est peut-être pas un qui ait rencontré, chez les naturalistes, depuis Aldrovande, Banks, Johnson, Lacépède, jusque dans ces dernières années, une plus complète incrédulité ; et cependant il est aujourd’hui démontré qu’en dépouillant l’histoire du kraken des exagérations dont elle est remplie, comme le sont, d’ailleurs, tous les récits populaires, on arrive à un monstre très réel et de dimensions des plus respectables.
Après avoir trop longtemps exalté Aristote, on est arrivé aujourd’hui à n’en parler qu’avec indifférence. Il n’est cependant que bien peu de savants modernes qu’on puisse lui comparer pour la science, la précision et l’esprit d’observation. Il est incroyable de voir combien de faits on nous présente comme nouvellement découverts, qui sont déjà signalés dans les ouvrages du philosophe grec, et le plus souvent presque entièrement dépourvus de l’exagération dont on accuse à juste titre si souvent les anciens.
Aristote a donc connu l’histoire des céphalopodes, et même leur anatomie, à un degré vraiment étonnant ; il parle d’un grand calmar (τεῡθος), de la Méditerranée, long de 5 coudées (3m,10). Nous verrons plus tard que ces données n’ont rien d’invraisemblable.
À Cartéia, prétend Trebius, un poulpe sortait chaque soir de la mer pour venir dévorer des salaisons. Ses continuels larcins irritèrent les gardiens, qui, pour y mettre un terme, entourèrent leurs sécheries de palissades élevées. Ce fut en vain : s’aidant d’un arbre, le poulpe les franchissait. Il ne put être découvert que grâce à la sagacité des chiens, qui l’éventèrent une nuit, tandis qu’il regagnait son élément naturel. La nouveauté du spectacle, la laideur du monstre couvert de saumure, sa grandeur extraordinaire, l’odeur horrible qu’il répandait, pénétrèrent d’effroi les pêcheurs accourus. Il combattait bravement les chiens, tantôt les fouettant de ses tentacules, tantôt les assommant des coups de deux de ses bras, plus grands que les autres. Enfin, on le tua, après une longue lutte, à coups de tridents. Pline, citant Trebius, admet difficilement, disons-le à sa louange, cette histoire, qu’il traite de prodige.
On apporta la tête et les bras de ce poulpe à Lucullus. On sait, en effet, que les Romains mangeaient volontiers ces animaux, comme le font encore nos pêcheurs normands. La tête avait la grandeur d’un baril de quinze amphores, et un bec proportionné. Les bras étaient longs de 30 pieds ; à peine un homme pouvait-il les embrasser. Ce qui fut conservé du corps pesait 700 livres.
Fulgosus répète ce récit, à quelques variantes près.
Une histoire presque semblable se trouve dans Élien.
Un poulpe, dont il compare les dimensions à celle des plus grands cétacés, fut tué à coups de hache, dit-il, par des marchands espagnols dont il dévastait les magasins.
On voit qu’Élien est encore plus exagéré que Trebius.
Pline semble plus raisonnable, parce qu’il ne garantit l’existence que des sèches de 2 coudées et des calmars de 5, et se méfie de Trebius ; mais, dans un autre endroit, il cite, sous le nom d’arbas, un poulpe dont les pieds seraient si longs qu’ils l’empêcheraient de passer du Grand Océan, sa demeure habituelle, dans la Méditerranée, et détroit de Gibraltar n’ayant pas assez de profondeur, et c’est ainsi qu’il retombe dans sa crédulité habituelle.
Lorsqu’on compare les traditions et les légendes des divers peuples, on est frappé de la diversité de leur caractère dans les pays froids et dans les pays chauds. Chez les uns comme chez les autres, les monstres et les miracles sont des êtres et des faits réels, mal observés, ou défigurés ; mais l’imagination altère leurs récits d’une manière différente. Sombre, effrayante, froide, la fable scandinave emprunte son caractère grandiose à la terreur ; riante, riche, gracieuse, la fable grecque atteint le même but en nous faisant rêver. Le Nord se fait craindre, le Midi se fait aimer.
On trouve des preuves frappantes de cette opposition dans l’étude des deux animaux les plus populaires entre tous les habitants de l’onde.
Nous voulons parler du kraken et du dauphin.
Les Scandinaves voient un poulpe de grandes dimensions ; aussitôt ils s’emparent de ce fait, se complaisent à l’entourer de toutes les exagérations propres à enlaidir l’animal, à faire de lui un être terrible, effrayant, puis se prennent à croire eux-mêmes à leurs rêveries, et s’abandonnent à l’âcre volupté qu’enfante la terreur dans les esprits sombres. Pour eux, la forme du poulpe n’est que peu défigurée (ils la peignent presque telle qu’elle est), mais ils le rendent terrible en décuplant ses dimensions. Ils finissent par le chercher partout, et chaque fois que la sonde leur révèle un bas-fond inconnu, ils croient avoir touché le kraken ou poisson-montagne.
Les Grecs remarquent que les dauphins suivent leurs galères et semblent jouer entre eux. Il n’en faut pas plus pour qu’ils voient dans ce cétacé un ami de l’homme ; c’est dans ce sens que sculpteurs, poètes, naturalistes, le transforment à l’envi. Non seulement il devient méconnaissable au physique, mais on lui prête mille aventures fantastiques dans lesquelles il joue le rôle de sauveur des naufragés : ne fallait-il pas qu’il fût fidèle à son rôle amical ? Grecs et Romains connaissent le poulpe géant, mais ils ne veulent pas s’appesantir sur un si vilain objet. Son image répugne à leur âme souriante ; ils la repoussent. Jamais leurs poésies n’y font allusion, et quoi que dise M. de Salverte, rien ne prouve que Virgile ait voulu faire allusion au monstre, sous le nom de Scylla, puisque ce nom propre n’est accompagné d’aucun commentaire qui aide à l’interpréter.
Le kraken norvégien est grand comme une île. Plus d’une fois, des navigateurs, croyant prendre terre, sont descendus sur son dos. C’est ce qui arriva, entre autres, à Éric Falkendorff, évêque de Nidros, et à saint Brandaine. Le premier écrivit au pape Léon, en 1520, une longue lettre à ce sujet. Le saint regrettait, un dimanche qu’il était en voyage sur un navire norvégien, de ne pouvoir célébrer sur la terre ferme le sacrifice de la messe avec toute la solennité désirable. Aussitôt surgit des flots, non loin de là, une île nouvelle. On aborde, et le saint officie sur un autel dressé immédiatement. Mais à peine avait-il quitté cette île, à peine était-il remonté sur son vaisseau, qu’elle s’ébranla et s’abîma dans la mer. Cette île était un kraken !
Olaüs Wormius aussi, en 1643, soutient que son apparition sur l’eau ressemble plus à celle d’une terre qu’à celle d’un animal : Similiorem insulæ quam bestiæ. Il croit qu’il n’existe que très peu de krakens, qu’ils sont immortels, et que les méduses ne sont autre chose que le frai et les œufs de ces animaux.
D’autres auteurs de la même époque, tels que Olaüs Magnus, Pautius, Bartholin, Deber, etc., répètent à peu près ce qu’en avait dit Wormius et admettent aussi l’immortalité du monstre, ce qui n’empêche pas qu’en 1680, on trouva enfin le cadavre d’un kraken dans le golfe d’Uewangen, paroisse d’Astabough. Il s’était pris le bras dans les innombrables rochers qui obstruent ces parages, et n’avait pu se dégager. Lorsque la putéfraction s’empara de ce corps immense qui remplissait à peu près tout le chenal, l’infection fut telle, que longtemps on craignit qu’elle n’engendrât une peste. Il n’en fut rien, heureusement ; l’animal s’en alla lambeau par lambeau, dépecé par les vagues. Cet évènement fut régulièrement constaté, et rapport fut fait à qui de droit par D. Früs, assesseur consistorial de Bodœn en Nortlande.
Un cas analogue s’est présenté depuis. On sait combien les poulpes abondent sur les côtes de Terre-Neuve ; c’est à ce point que, chaque année, les pêcheurs de morue en prennent, à la ligne, douze millions de toutes tailles pour leur servir d’appât. Eh bien, à la fin du dix-huitième siècle, un de ces mollusques, mais véritablement monstrueux, vint mourir sur les récifs, au-delà de Pinc-Light entre le 48e et le 50e degré de latitude. Cette fois encore on crut que l’odeur provoquerait des maladies épidémiques, et on ne fut rassuré que quand les courants eurent délivré le pays de ce fléau.
Nous disions que l’imagination frappée des pêcheurs prenait souvent des îles véritables pour l’effroyable céphalopode. Il semble que, dans le récit suivant, des récifs, ne se découvrant que lors des marées exceptionnelles, aient produit cette illusion.
Le géographe Buræus, d’après un de nos jeunes savants, M. Amédée Pichot, avait placé sur sa carte une île du nom de Gummer’s-Ore, en vue de Stockholm. Le baron Charles de Grippenheim l’avait vainement cherchée de tous côtés, lorsque un jour, tournant la tête par hasard, il distingua comme trois pointes de terre qui s’étaient tout à coup élevées sur la surface des flots : « Voilà sans doute le Gummer’s-Ore de Buræus ? demanda-t-il au pilote qui gouvernait sa chaloupe. – Je ne sais, répondit celui-ci, mais soyez certain que ce que nous voyons pronostique une tempête ou une grande abondance de poisson. Gummer’s-Ore n’est qu’un amas de récifs à fleur d’eau où se tient volontiers le soe-trolden (fléau de mer, nom populaire du kraken dans ces parages), ou plutôt c’est le soe-trolden lui-même. »
De tous les auteurs qui se sont occupés de l’histoire naturelle boréale, Pontoppidan (1752) et Auguste de Bergen sont ceux qui ont recueilli avec le plus de soin et de précision les traditions qui concernent cet animal.
Les gens du Nord, dit Pontoppidan, affirment tous, et sans la moindre contradiction dans leurs récits, que lorsqu’ils poussent au large à plusieurs milles, particulièrement pendant les jours les plus chauds de l’été, la mer semble tout à coup diminuer sous leurs barques ; s’ils jettent la sonde, au lieu de trouver 80 ou 100 brasses de profondeur, il arrive souvent qu’ils en mesurent à peine 50 : c’est un kraken qui s’interpose entre le bas-fond et la sonde. Accoutumés à ce phénomène, les pêcheurs disposent leurs lignes, certains que là abonde le poisson, surtout la morue et la lingue, et les retirent richement chargées.
Si la profondeur de l’eau va toujours diminuant, si ce bas-fond accidentel et mobile remonte, les pêcheurs n’ont pas de temps à perdre ; c’est le kraken qui se réveille, qui se meut, qui vient respirer l’air et étendre ses larges bras au soleil.
Les pêcheurs font force de rames, et quand, à une distance raisonnable, ils peuvent enfin se reposer en sécurité, ils voient en effet le monstre qui couvre un espace d’un mille et demi de la partie supérieure de son dos. Les poissons, surpris par son ascension, sautillent un moment dans les creux humides formés par les protubérances inégales de son enveloppe extérieure ; puis de cette masse flottante sortent des espèces de pointes ou de cornes luisantes qui se déploient et se dressent semblables à des mâts armés de leurs vergues ; ce sont les bras du kraken, et telle est leur vigueur, que s’ils saisissaient les cordages d’un vaisseau de ligne, ils le feraient infailliblement sombrer.
Après être demeuré quelques instants sur les flots, le kraken redescend avec la même lenteur, et le danger n’est guère moindre pour le navire qui serait à sa portée, car, en s’affaissant, il déplace un tel volume d’eau, qu’il occasionne des tourbillons et des courants aussi terribles que ceux de la fameuse rivière Male.
L’Histoire naturelle d’Éric Pontoppidan est très curieuse à consulter à cause de la grande quantité de documents que le savant évêque a recueillis ; mais elle manque de méthode ; les faits positifs, sont mêlés avec les fables ; il n’y a pas de critique. Pontoppidan avait trop de capacité pour croire au kraken qu’il dépeint, et lui-même note son incrédulité, mais il ne cherche nullement à dégager la vérité sous tout ce fatras.
Il n’en est point de même d’Auguste de Bergen, qui, comparant avec soin tous les récits scandinaves, en conclut qu’il doit exister un poulpe énorme (quoique bien loin d’atteindre les proportions d’une île), pourvu de bras ; qu’il doit être odorant ; que lorsqu’il s’élève, ses bras sont dirigés vers le fond ; qu’il laisse rarement entrevoir ses tentacules ; qu’il monte et descend en ligne droite ; enfin, qu’il ne se montre que l’été et par les temps calmes. On verra que les découvertes modernes ont entièrement corroboré les conclusions de ce naturaliste.
Linné, après avoir admis l’existence du poulpe géant dans sa Faune suédoise et dans les six premières éditions de son Système de la nature, s’y refuse dans les suivantes ; on ignore pourquoi.
Cependant les marins avaient toujours foi dans les légendes sur le kraken ou encornet géant, et sur les côtes de France, un proverbe très répandu disait : L’encornet est le plus petit et le plus grand animal de la mer.
Dans plusieurs chapelles étaient suspendus des ex-voto retraçant les dangers courus par les équipages de divers navires dans des combats avec ces horribles animaux. L’un d’eux, qui existe encore à Notre-Dame de la Garde, de Marseille, rappelle une lutte qui eut lieu sur les côtes de la Caroline du Sud. Un autre qu’on peut voir dans la chapelle Saint-Thomas, à Saint-Malo, fut placé là par les matelots d’un navire négrier, attaqué par un poulpe au moment où il levait l’ancre pour s’éloigner d’Angola.
Du reste le voyageur Grandpré dit qu’il a souvent entendu parler, par les indigènes de ces côtes africaines, du terrible céphalopode ; ils en ont une grande peur, mais soutiennent qu’il se tient constamment dans la haute mer.
En 1783, un baleinier assura au docteur Swédiaur, qui raconte cette observation dans le Journal de Physique, qu’il avait trouvé dans la gueule d’une baleine un tentacule de 27 pieds de long.
Denys Montfort ayant lu cette note, eut l’idée d’interroger les baleiniers que Calonne avait fait venir d’Amérique pour tenter de relever la grande pêche en France, et qui étaient établis à Dunkerque. Deux d’entre eux lui dirent qu’ils avaient également examiné des bras de krakens. L’un, Benjohnson, en avait trouvé aussi, une fois, un de 35 pieds dans la : bouche d’une baleine, de laquelle il sortait ; l’autre, Reynolds, en avait pêché un de 45 pieds, qui flottait, et dont la couleur était rouge ardoisé.
Ce fut en cette occasion, vers 1786, que Denys Montfort entendit faire un récit qu’il accepta de la meilleure foi du monde, malgré les traces nombreuses de hâblerie qu’a laissé passer le narrateur. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ce curieux passage, ne fût-ce qu’à titre de document historique. Denys Montfort l’accompagne d’une gravure qui montre un poulpe fantastique enlaçant un navire ; peut-être est-ce l’ex-voto de Saint-Malo.
Le capitaine Jean-Magnus Dens, homme respectable et véridique, après avoir fait quelques voyages à la Chine pour la compagnie de Gothembourg, était enfin venu se reposer de ses expéditions maritimes à Dunkerque, où il demeurait, et où il est mort depuis peu d’années, dans un âge très avancé. Il m’a raconté que, dans un de ses voyages, étant par les 15 degrés de latitude sud, à une certaine distance de la côte d’Afrique, par le travers de l’île Sainte-Hélène et du cap Nigra, il y fut pris d’un calme qui dura quelques jours, et il se décida à en profiter pour nettoyer son bâtiment et le faire approprier et gratter en dehors. En conséquence, on descendit, le long du bord, quelques planches suspendues, sur lesquelles les matelots se placèrent pour gratter et nettoyer le vaisseau. Ces marins se livraient à leurs travaux, lorsque subitement un de ces encornets nommés en danois ancher-troll s’éleva du fond de la mer, et jeta un de ses bras autour du corps de deux matelots, qu’il arracha tout d’un coup avec leur échafaudage, et les plongea dans la mer ; il lança ensuite un second de ses bras sur un autre homme de l’équipage, qui se proposait de monter aux mâts, et qui était déjà sur les premiers échelons des haubans. Mais comme le poulpe avait saisi en même temps les fortes cordes des haubans, et qu’il était entortillé dans leurs enfléchures, il ne put en arracher cette troisième victime, qui se mit à pousser des hurlements pitoyables. Tout l’équipage courut à son secours ; quelques-uns, sautant sur les harpons et les fouanes, les lancèrent dans le corps de l’animal, qu’ils pénétrèrent profondément, pendant que les autres, avec leurs couteaux et des herminettes ou petites haches, coupèrent le bras qui tenait lié le malheureux matelot, qu’il a fallu retenir de crainte qu’il ne tombât à l’eau, car il avait entièrement perdu connaissance.
Ainsi mutilé et frappé dans le corps de cinq harpons, dont quelques-uns, faits en lance et roulant sur une charnière, se développaient quand ils étaient lancés de façon à prendre une position horizontale et à s’accrocher ainsi par deux pointes et par un épanouissement dans le corps de l’animal qui en était atteint, ce terrible poulpe, suivi de deux hommes, chercha à regagner le fond de la mer par la puissance seule de son énorme poids. Le capitaine Dens, ne désespérant pas encore de ravoir ses hommes, fit filer les lignes qui étaient attachées aux harpons ; il en tenait une lui-même, et lâchait de la corde à mesure qu’il sentait du tiraillement ; mais quand il fut presque arrivé au bout des lignes, il ordonna de les retirer à bord, manœuvre qui réussit pendant un instant, le poulpe se laissant remonter : ils avaient déjà embarqué ainsi une cinquantaine de brasses, lorsque cet animal lui ôta toute espérance en pesant de nouveau sur les lignes qu’il força de filer encore une fois. Ils prirent cependant la précaution de les amarrer et de les attacher fortement à leur bout.





























