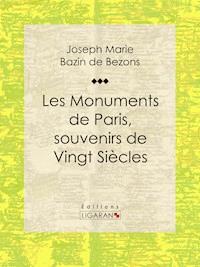
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"""Les monuments de Paris, souvenirs de vingt siècles"" est un ouvrage incontournable pour tous les amoureux de la Ville Lumière. Écrit par Joseph Marie Hippolyte Théodore Bazin de Bezons, ce livre nous plonge au cœur de l'histoire de Paris à travers ses monuments emblématiques.
Au fil des pages, Bazin de Bezons nous guide à travers les rues pavées de la capitale, nous dévoilant les secrets et les anecdotes qui entourent chaque monument. De la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris à l'imposante Tour Eiffel, en passant par le romantique Pont des Arts et le mystérieux cimetière du Père-Lachaise, l'auteur nous invite à redécouvrir ces lieux chargés d'histoire.
Mais ce livre ne se contente pas de nous présenter les monuments les plus célèbres de Paris. Bazin de Bezons nous emmène également à la découverte de trésors moins connus, tels que la fontaine Saint-Michel, le Palais-Royal ou encore la place des Vosges. Chaque monument est décrit avec précision, nous permettant ainsi de mieux comprendre son architecture, son évolution au fil des siècles et son importance dans l'histoire de la ville.
En plus de ses descriptions détaillées, l'auteur nous offre également de magnifiques illustrations qui viennent sublimer chaque monument. Ces dessins, réalisés avec finesse et talent, nous transportent instantanément dans l'atmosphère unique de Paris.
""Les monuments de Paris, souvenirs de vingt siècles"" est bien plus qu'un simple guide touristique. C'est un véritable voyage à travers le temps, une plongée dans l'âme de la capitale française. Que vous soyez un habitant de longue date ou un visiteur occasionnel, ce livre saura vous émerveiller et vous faire redécouvrir Paris sous un nouvel angle. Alors laissez-vous guider par Bazin de Bezons et partez à la découverte des trésors cachés de la Ville Lumière.
Extrait : ""Transportons-nous par la pensée, 52 ans avant Jésus-Christ, dans le Paris gaulois alors tout entier contenu dans l'île de la Cité. La ville était fortifiée ; César lui donne le nom d'oppidum dans ses Commentaires. L'enceinte, que l'eau venait battre, était faite à la manière indigène, de terrassements maintenus par des troncs d'arbres et des clayonnages ; les maisons, sortes de huttes aux toits coniques, se pressaient à l'intérieur des retranchements..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335012323
©Ligaran 2015
PROVISEUR DU LYCÉE LAKANAL
Monsieur et cher Proviseur,
Dans une de ces causeries qu’un heureux voisinage a rendues plus fréquentes, vous m’avez avoué que vous prépariez un livre sur l’histoire de Paris et de ses monuments depuis vingt siècles ; et à cette marque de confiance, vous en avez ajouté une autre : vous m’avez demandé de présenter moi-même votre œuvre au public. J’ai d’abord essayé de vous opposer une exception d’incompétence : – encore qu’habitant Paris depuis tantôt un demi-siècle, je suis resté provincial dans l’âme et, par conséquent, peu autorisé à donner mon avis sur un ouvrage spécialement consacré aux traditions et aux édifices parisiens. – Mais vous m’avez prouvé que, précisément parce que provincial, je devais être plus frappé que les indigènes par la physionomie de la grande ville, par les phases de ses évolutions architecturales et par la diversité des monuments qui en constituent l’originale beauté. Bref, vous avez été si persuasif en ce plaidoyer pro domo, qu’entraîné par votre éloquence, je vous ai donné ma parole : me voici mis en demeure de la tenir, et je le fais avec grand plaisir après avoir lu les bonnes feuilles de votre livre.
Cette lecture m’a vivement intéressé et m’a appris une quantité de choses que j’ignorais. J’ai été émerveillé de constater, à propos d’un sujet si touffu et si complexe, avec quelle science de sélection, avec quelle souplesse d’esprit et quelle solide érudition, vous réussissez à donner à vos lecteurs une très claire vision de chaque époque historique et de chacune des œuvres architecturales qui en ont caractérisé les commencements, l’apogée et le déclin. Guidé par vous, j’ai assisté à la naissance de la petite Lutèce dans son île limoneuse, resserrée entre deux bras de la Seine et entourée de forêts profondes. Vous me l’avez montrée, pauvre et obscur oppidum aux huttes de terre et de bois, se développant peu à peu, après la conquête romaine, jusqu’à se transformer en une cité peuplée de temples, de villas, de thermes et de théâtres, ainsi que l’attestent les ruines du palais de Julien et les arènes de la rue Monge. Puis vous m’avez raconté l’écroulement de cette civilisation gallo-romaine, au choc des invasions des Huns et des Francs, et comment la Lutèce de César est devenue le Paris des Mérovingiens. – Voici que, sur les débris des temples païens, des églises chrétiennes s’élèvent : Saint-Germain des Prés au temps de Childebert ; l’abbaye de Saint-Denis, sous le roi Dagobert. Avec Charlemagne et ses successeurs, la ville perd, il est vrai, de son importance ; les Normands l’assiègent et l’incendient ; mais elle renaît bien vite et prospère sous la dynastie capétienne. Les deux rives de la Seine se bâtissent, la population s’accroît, Notre-Dame sort de terre ; de tous côtés s’élancent de sveltes flèches d’églises et de massives tours de palais. Au temps de Philippe-Auguste, la capitale étouffe dans sa clôture de pierre et la brise. « Une ville comme Paris, ainsi que le remarque Victor Hugo, est dans une crue perpétuelle. Il n’y a que ces villes-là qui deviennent capitales ; ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d’un pays ; toutes les pentes naturelles d’un peuple ; des puits de civilisation pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse, goutte à goutte, siècle à siècle. » – La nouvelle enceinte de Philippe-Auguste, devenue trop étroite, est démolie, à son tour ; et ainsi, de Charles VI à Napoléon III, Paris fait sept ou huit fois craquer sa ceinture pour se donner de l’air et se répandre à travers champs. Chacun de ces bris de clôture est caractérisé par une nouvelle floraison d’édifices civils, religieux, militaires, et par une transformation plus ou moins radicale des idées, des mœurs et des habitudes parisiennes. – Comme vous l’avez fort bien dit, ces monuments successifs et ces évolutions morales « marquent d’une série de jalons la route de l’Histoire, et, à les suivre, on arrive de siècle en siècle, ainsi que d’étape en étape, depuis les origines gallo-romaines jusqu’à nos jours. »
À mesure que la civilisation accélère sa marche et que les besoins matériels et intellectuels des sociétés se multiplient, ces étapes s’accourcissent, et les métamorphoses qui se produisent dans l’intervalle deviennent plus notables et plus fréquentes. Les gens de ma génération ont été témoins, il y a un demi-siècle, d’une de ces transformations de la capitale. Elle a été considérable. Ceux de mes contemporains qui se seraient absentés de Paris pendant cinquante ans, auraient déjà grand-peine à le reconnaître. Peut-être même quelques-uns d’entre eux accueilleraient-ils avec un soupir mélancolique les nombreux changements qui ont altéré la physionomie, les paysages, les façons d’être et les habitudes de la grande ville. Certes Paris, dans ses lignes principales, est toujours beau. Le promeneur qui, au sortir des Champs-Élysées, traverse la place de la Concorde par un radieux après-midi d’été et se dirige vers les quais de la rive gauche, éprouve toujours un sursaut d’admiration devant le spectacle unique qui s’offre à ses yeux émerveillés. – Le soleil, déjà plus bas, éclaire obliquement la Seine mordorée et les robustes peupliers de Virginie penchés sur le cours de l’eau. Le pavillon de Flore et le Louvre, dont les vitres s’empourprent, la perspective des ponts et, là-bas, dans une buée d’or, la flèche de la sainte Chapelle s’élançant, élégante et mince, au-dessus des maisons teintées de rose ; tout ce magnifique et spacieux décor conserve une noblesse et un charme qui prennent l’esprit et le cœur. – Pourtant, quand je me reporte aux lointaines années où, jeune et ingénu provincial, je venais passer mon baccalauréat en Sorbonne et suivre les cours de la Faculté de Droit, je ne puis m’empêcher de donner un regret au Paris de 1852.
Peut-être ce regret rétrospectif est-il tout simplement un effet du vieil âge, et peut-être, en m’y abandonnant, ne fais-je qu’obéir à cette impulsion chagrine qui prédispose les vieilles gens à être des louangeurs du temps passé. Ce temps passé, en effet, c’était le temps de notre jeunesse, la saison de nos émotions printanières. Nous nous complaisons à en évoquer le souvenir, et le souvenir est toujours un embellisseur. Néanmoins, préventions à part, et tout en convenant que la capitale d’aujourd’hui a gagné en confortable et en bien-être, que les rues sont plus larges, mieux aérées, et que les lois hygiéniques y sont mieux observées, je dois en conscience ajouter que, vers la moitié du dix-neuvième siècle, Paris était moins banal, plus gai, plus pittoresque, et qu’on s’y sentait mieux chez soi.
À cette époque, le réseau des voies ferrées était loin d’être achevé. Le chemin de fer de l’Est n’allait pas encore jusqu’à Nancy ; celui d’Orléans s’arrêtait à Poitiers ; les lignes de Bretagne et du Midi n’existaient pas. Les diligences et les malles-postes roulaient encore sur nos grandes routes et amenaient de quotidiennes fournées de voyageurs qui, pour la plupart, prenaient leur gîte dans les nombreux hôtels foisonnant entre la rue Richelieu et la rue Montmartre. Au centre de ces populeuses hôtelleries, le Palais-Royal – aujourd’hui un désert – était le rendez-vous des étrangers et des provinciaux. Sous les galeries intérieures, une foule bariolée circulait joyeusement, au long des magasins tout reluisants d’orfèvrerie et de bijoux. Les cafés en renom et les grands restaurants occupaient une bonne partie des maisons en façade sur le jardin : – Véfour, les Frères provençaux, la Rotonde, le Café d’Orléans, Véry, le Café de Foy… À côté de ces établissements de luxe, les restaurants à prix fixe et à bon marché ouvraient aux petites bourses leurs vastes salles situées au premier étage. Après six heures, on n’y trouvait plus de place. Des orchestres militaires jouaient chaque jour, dans la belle saison, autour du grand bassin, et les consommateurs dînaient en musique, tandis qu’au-dehors les badauds s’attroupaient autour des parterres,
Pour entendre un de ces concerts, riches de cuivre, Dont les soldats parfois inondent nos jardinsEt qui, dans ces soirs d’or où l’on se sent revivre,Versent quelque héroïsme au cœur des citadins
Partout, alors, on déjeunait à dix heures et on dinait entre cinq et six. Quand les restaurants se vidaient, les cafés s’emplissaient. Le soir venu, le Palais-Royal s’illuminait. Dans la galerie d’Orléans, une foule houleuse s’amassait, lisant les journaux aux lumières des boutiques, feuilletant les nouveautés aux étalages des libraires en vogue : – Dentu, Barba, Ladvocat, les frères Garnier. – Les théâtres non plus ne chômaient pas. Dès six heures, des queues serpentaient aux abords de la Comédie française et du Palais-Royal. Les amateurs de spectacles, qui n’y trouvaient pas de place, refluaient par la rue Vivienne, très animée, où les grands magasins de modes et de soieries ne fermaient guère avant dix heures, et s’arrêtaient au Vaudeville pour y voir MmeDoche et Fechter, ou bien poussaient jusqu’aux boulevards. Là aussi, l’animation et les distractions ne manquaient pas. Depuis la rue de la Chaussée-d’Antin jusqu’au boulevard du Temple, les théâtres, grands et petits, se succédaient à la file : – l’Opéra, l’Opéra-Comique, les Variétés, le Gymnase,la Porte Saint-Martin, la Gaîté, l’Ambigu, le Théâtre-Lyrique, les Délassements, les Funambules, etc. La plupart se touchaient presque. Si, par hasard, on ne pouvait se caser dans une salle déjà pleine, on avait la ressource de s’adresser au théâtre voisin ; de sorte qu’on ne risquait pas de s’être dérangé pour rien et de perdre sa soirée. Cette sécurité, garantie aux plaisirs de la veillée, maintenait sur toute la ligne des boulevards un mouvement et une gaieté qu’on ne retrouve qu’imparfaitement, aujourd’hui que les magasins éteignent leur éclairage dès sept heures et que les principaux passages : – Choiseul, Opéra, Jouffroy, Panoramas, – prennent, sitôt la nuit venue, l’aspect de mornes couloirs obscurs et déserts.
Les larges voies actuelles n’avaient pas encore été percées à travers les quartiers du centre. Les rues ombreuses, bordées d’antiques logis datant de la Renaissance et du dix-septième siècle, conservaient cette originalité et cette diversité architecturale qu’on ne retrouve plus guère que dans certaines rues du Marais. On y pouvait circuler sans être ahuri et menacé par l’assourdissante sonnerie des tramways, la trompe des automobiles, la corne des bicyclettes. Les moyens de locomotion, à la vérité, étaient modestes et assez restreints. Les omnibus sans impériale, concédés à de petites compagnies et portant des noms amusants : – Batignollaises, Béarnaises, Dames blanches, Hirondelles, etc., convoyaient paisiblement les voyageurs d’une barrière de Paris à l’autre. Pour les gens pressés, il y avait les voitures de place : les citadines à un cheval, où l’on pouvait tenir trois ; les mylords ; les cabriolets, qui ne coûtaient que quinze sous et où l’on se juchait à côté du cocher. Tout cela manquait de confort ; les véhicules mis à la disposition du public étaient peu nombreux ; mais les piétons abondaient, et cette active circulation des passants donnait aux rues je ne sais quoi de plus réveillant et de plus jovial.
Sur la rive gauche,et notamment dans le quartier des Écoles, que de transformations en cinquante ans ! Combien la physionomie des rues et la façon de vivre ont changé ! En 1852, le vieux Pays latin existait encore et la vie y était plus intime, plus concentrée, plus simple qu’à l’époque actuelle. Le boulevard Saint-Michel n’était pas percé ; le Luxembourg s’étendait, en largeur, de la grille de la rue de Fleurus à la rue Monsieur-le-Prince et occupait tout l’espace limité par les deux grandes rues de l’Est et de l’Ouest, qui se rejoignaient à l’Observatoire. Les étudiants peuplaient les antiques rues Saint-Jacques, La Harpe, des Mathurins-Sorbonne et des Grès. Ils s’y sentaient mieux chez eux, s’y tenaient davantage et passaient plus rarement les ponts. Les jeunes gens débarqués de la même province se groupaient en de petits clans où l’on menait une existence doucement casanière. Pour plus d’économie, on allait travailler à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et dans certains cabinets de lecture très achalandés alors et tous disparus depuis : – passage du Commerce ; au coin de la place de l’Odéon, chez une petite bossue nommée Julia Morel ; chez la mère Foucault, rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel. – On déjeunait sommairement pour douze sous dans les crémeries du voisinage, et l’on dînait pour un franc en de très modestes restaurants, dont la clientèle très sobre ne s’abreuvait que d’eau pure. Le soir, on se réunissait dans la chambre d’un compatriote et on y prenait le thé entre amis. De loin en loin, surtout au commencement du mois, on se permettait une débauche au café du Luxembourg, situé au coin de la rue Monsieur-le-Prince et de l’ancienne place Saint-Michel, ou bien une soirée à l’Odéon, qui restait ouvert toute l’année, comme d’ailleurs tous les théâtres parisiens. L’hiver, on suivait assidûment le cours de Saint-Marc Girardin dans le vieil amphithéâtre de la Sorbonne. Celle-ci, non encore restaurée, conservait sa vaste cour intérieure au niveau inégal, aux pavés sertis d’herbe, qu’encadraient de noires façades à mine rébarbative et où, l’on pénétrait par deux porches profonds aux voussures sculptées.
Dès que le printemps poussait sa première pointe, notre grande distraction était de flâner longuement dans le jardin du Luxembourg, que le second Empire n’avait pas mutilé et qui étendait sous un large espace du ciel, depuis la grille de la rue de Vaugirard jusqu’à celle de l’Observatoire, ses royales terrasses, ses massifs de lilas et d’aubépines, ses parterres semés de fleurs et peuplés de blanches statues que les ramiers frôlaient de leur vol mélodieux, ses bassins qui reflétaient les nuages, ses pelouses, ses quinconces et les ombrages de sa charmante Pépinière…
Oh ! la Pépinière !… C’était la promenade préférée, le coin d’intimité choisi entre tous. Située en contrebas, sur l’emplacement de l’ancien clos des Chartreux, elle enchevêtrait ses capricieuses allées sous le feuillage léger des cytises, sous l’épaisse ramure des catalpas et des magnolias. Il y avait de tout dans ce jardin enchanté : des résédas, des chèvrefeuilles et des jasmins qui embaumaient ; des vergers de cerisiers, de pêchers, de poiriers et de pommiers, qui se couvraient en mai de floraisons roses et blanches, et pliaient dès le mois d’août sous les fruits mûrissants ; il y avait même, au long des talus bien exposés, des champs de vignes, dont les pampres verdoyants et les grappes en fleur nous rappelaient, à nous autres provinciaux, les vignobles du pays natal…
Cette aimable Pépinière, avec son jardin botanique, ses collections d’arbres fruitiers, son rond-point ombreux où se dressait la statue de Velléda, entre pour une bonne part dans mes regrets du temps jadis, et tous les étudiants de cette époque en gardent pieusement la douce mémoire. Vers 1866, sous je ne sais quel prétexte d’embellissement, mais en réalité pour effectuer une opération financière fructueuse, on l’a bouleversée, et ses parterres ont fait place à des maisons de rapport. Ce coin de la rive gauche, qui avait une si originale physionomie, est devenu banal et sans caractère, comme la plupart des nouveaux quartiers et des squares de création récente. Il est vrai qu’en revanche on nous a dotés de la fontaine placée à l’entrée du boulevard Saint-Michel, où un archange, posé comme un acrobate, terrasse un démon de convention ; il est vrai également qu’on a rebâti à neuf l’École de médecine et l’ancienne Sorbonne ; mais vous avouerez que ces réédifications, si elles répondent à des exigences pratiques, ne donnent qu’une médiocre impression de beauté.
Pour parler franchement, les monuments de la seconde moitié du dix-neuvième siècle n’ont rien de génial et ne marqueront pas d’une façon bien glorieuse dans l’histoire architecturale de la France. Le siècle dernier, qui a si étonnamment progressé dans le domaine de la science, sera surtout fameux par son mouvement industriel et par la mise en application des découvertes des savants. Il devra son renom à ses ingénieurs plutôt qu’à ses architectes. Ses plus notables monuments seront les Halles centrales, les gares des chemins de fer et la galerie des Machines. Mais le noble et bel art de l’architecture n’y brillera ni par la grandeur simple ni par l’harmonieuse conception du décor. Les principaux édifices parisiens de la période contemporaine se distinguent uniquement par des imitations, quelquefois heureuses, des divers styles des époques antérieures. Les plus laborieux efforts des architectes n’ont abouti, en fait de nouveauté, qu’à ces fantasques inventions du modern-style, près desquelles le style rococo, tant raillé, paraît un modèle de logique et de grâce.
C’est pourquoi, Monsieur et cher Proviseur, je pense, comme vous, que les constructions de la dernière moitié du dix-neuvième siècle trahissent, « par leur diversité même, les incertitudes de l’heure présente et les hésitations de la société sur l’orientation qu’elle doit prendre ». Comme vous, après avoir lu votre livre si intéressant et si richement documenté, je souhaite que le vingtième siècle, plus sage et mieux inspiré que son devancier, « profite de l’expérience acquise et donne naissance à un art qui méritera de porter son nom ».
André Theuriet
Juillet 1904.
Paris a le singulier bonheur de posséder des monuments qui marquent comme d’une série de jalons la route de l’Histoire, et à les suivre, on arrive de siècle en siècle, ainsi que d’étape en étape, depuis les origines gallo-romaines jusqu’à nos jours.
Quelle est la pensée qui a présidé à la construction de ces édifices ? Quelle a été la physionomie de leurs hôtes les plus célèbres ? Quels souvenirs historiques importants rappellent-ils ? Tels sont les points essentiels que l’on s’efforcera de mettre en lumière : tableaux vivants, avec le monument, tantôt en bonne place, tantôt à l’arrière-plan ; mélanges d’art et d’histoire dans la ville du monde où l’un a eu sa plus belle éclosion, et l’autre sa vitalité la plus intense.
Ce livre est écrit pour le Parisien justement fier de ses origines, pour le Français qui voit dans Paris l’âme et le cœur de la France, pour l’étranger curieux de connaître notre civilisation là où elle a brillé de son éclat à la fois le plus radieux et le plus national.
Nous venions de terminer notre ouvrage Une Vieille Cité deFrance, Reims, lorsque M. Ernest Lavisse, à qui nous l’avions présenté, voulut bien nous suggérer l’idée de tenter quelque chose d’analogue sur Paris : « La méthode est originale, nous dit-il, il n’existe rien de semblable sur la capitale ; faites ce qui nous manque. » Et, avec sa grande netteté de vue, qui, des sommets où sa science le place, lui permet de voir l’ensemble et de discerner les détails, il nous traça, à grandes lignes, le plan de l’œuvre, et excita chez nous l’enthousiasme qu’il excelle à faire naître chez tous ceux à qui s’adresse sa parole persuasive à force de chaleur et de clarté. Nous nous mîmes au travail ; il dura plusieurs années. Notre soin fut avant tout d’être bref, dans un sujet où les détails abondaient. Que de pages noircies n’avons-nous pas déchirées avec une impitoyable rigueur ! Du moins espérons-nous être arrivé à notre but de prendre le moins de temps qu’il est possible à ceux qui nous feront l’honneur de nous lire.
Dans la préparation laborieuse du livre, nous avons rencontré le concours dévoué d’un ami, M. Albert Engelhard, à qui nous adressons ici nos publics remerciements. Nous faisons de même pour M. Nelson Dias, l’artiste distingué dont l’habile crayon a commenté notre texte avec intelligence et poésie.
M. Max Delagrave, parisien de race, a soigné cette édition avec le respect que l’on a pour un document de famille.
Merci également à M. H. Enlart, conservateur du Musée de sculpture comparée du Trocadéro, à M. P. Vitry, attaché au Musée du Louvre, et à tant d’autres à qui notre livre est redevable de ce qu’il renferme de meilleur.
Les origines gauloises de Lutèce. – Camulogène et Labiénus autour de l’île de la Cité. – Les Parisiens se soumettent ; leur romanisation prouvée par les autels gallo-romains du chœur de Notre-Dame. – La statue de Germanicus. – L’amphithéâtre. – Le palais des Thermes, résidence de Julien, César des Gaules. – La statue de l’empereur.
Transportons-nous par la pensée, 52 ans avant Jésus-Christ, dans le Paris gaulois alors tout entier contenu dans l’île de la Cité. La ville était fortifiée ; César lui donne le nom d’oppidum dans ses Commentaires. L’enceinte, que l’eau venait battre, était faite à la manière indigène, de terrassements maintenus par des troncs d’arbres et des clayonnages ; les maisons, sortes de huttes aux toits coniques, se pressaient à l’intérieur des retranchements ; elles avaient dû servir souvent à abriter les habitants des campagnes en lutte avec leurs voisins ou en danger d’être attaqués par les bandes pillardes venues de l’Orient. La tribu gauloise des Parisii avait un territoire environ trois fois plus étendu que le département actuel de la Seine. Elle comptait au nombre des peuplades les plus influentes de la Gaule.
Après cinq années de luttes sanglantes et de négociations habiles, César, croyant la Gaule vaincue, s’était rendu en Italie pour tirer profit de sa conquête au point de vue de ses idées politiques. Tout à coup, il apprend que le pays entier se soulève et que ses légions sont en danger. Il accourt et cherche à engager un combat corps à corps avec le chef arverne Vercingétorix. Celui-ci, conscient de la supériorité d’organisation militaire et de la discipline des troupes romaines, savait que la bravoure gauloise l’emporterait difficilement sur les légions incomparablement mieux armées et évoluant avec ensemble et sûreté. Il voulait, avant de les aborder de front, les affaiblir en les désorganisant. En outre, plus la campagne se prolongeait, plus s’augmentaient les forces des Gaulois, à mesure que les tribus hésitantes prenaient courage et entraient dans la confédération ; c’était donc manœuvrer habilement pour les Gaulois que de reculer en ruinant le pays derrière eux.
Cette tactique, inaugurée par Vercingétorix, fut suivie par son lieutenant Camulogène dans sa campagne autour de Lutèce. Bien que d’un âge avancé, le chef des Parisiens était plein de vigueur et d’énergie ; sa confiance dans le succès de son plan était encore augmentée par la promesse que lui avaient faite les gens de Beauvais de venir à son secours. César détacha contre lui l’important effectif de quatre légions, sous les ordres de son lieutenant Labiénus, avec mission d’agir promptement.
Lutèce était la base d’opération de Camulogène. La contrée environnante, arrosée par plusieurs rivières, couverte de forêts, avec des collines favorables à la défense, lui paraissait offrir les conditions les plus avantageuses pour arrêter l’élan et empêcher le déploiement méthodique des légions. Il s’installa sur la rive gauche de la Seine, en s’appuyant sur la hauteur qui fut depuis la montagne Sainte-Geneviève et en laissant entre l’ennemi et lui les marais formés par la Bièvre. De son côté, Labiénus, parti de Sens, à vingt-cinq lieues de Paris, s’avançait avec précaution le long de la rive gauche, moins accidentée et moins propre à des embuscades ; il évitait en outre ainsi d’être pris à revers par les gens de Beauvais. Arrivé devant les Parisiens solidement retranchés, il essaya de tourner les marais ; mais si forte était la position de Camulogène, si mouvant était le sol où disparaissaient troncs d’arbres et fascines, que le général romain comprit bientôt l’impossibilité de surmonter de pareilles difficultés, et le lendemain, dans la nuit, sans hésitation, il leva clandestinement son camp, remonta la Seine, gagna la rive droite et se présenta devant Melun. Sa marche avait été tellement rapide que les habitants surpris se défendirent à peine ; ils avaient bien coupé leur pont, mais Labiénus, s’emparant de cinquante barques amarrées au rivage, établit un pont de bateaux et réussit à faire passer son armée. Aussitôt il reprend sa marche en avant, sans abandonner d’ailleurs la flottille qui lui avait été si utile.
De Melun à Paris, la distance est courte. Cependant Camulogène, informé par ses éclaireurs, ne se laissa pas surprendre, et, craignant que les ennemis ne missent à profit les bateaux dont ils disposaient, peu confiant aussi dans les faibles remparts qui défendaient Lutèce de ce côté, il ordonna, fidèle en cela à la tactique de Vercingétorix, aux Parisiens de brûler leur ville.
En présence d’un pareil ordre, quelque temps auparavant, les gens de Bourges avaient hésité et, à force de supplications, obtenu du généralissime l’autorisation de se défendre : ils succombèrent, et le résultat de la campagne fut, par leur manque d’énergie, sérieusement compromis.
Avec un patriotisme qui est tout à leur gloire, les Parisiens obéirent sans délai et, la torche à la main, mirent le feu aux armatures de bois de leurs remparts et à leurs huttes de clayonnage. Lutèce était réduite en cendres, mais elle ne devait pas être prise par Labiénus.
Paris incendié, Camulogène put demeurer sur sa position en opérant un mouvement de conversion qui le plaçait face à l’ennemi. Son armée, échelonnée sur les pentes de Sainte-Geneviève, avait les deux bras de la Seine entre elle et les Romains ; il comptait profiter d’une marche en avant de ces derniers, pour les culbuter au passage du fleuve, avant qu’ils eussent pu reprendre leur redoutable ordre de bataille. Il attendait aussi l’arrivée de ses alliés de Beauvais pour combiner avec eux une attaque décisive.
Labiénus avait son camp en face de la cité, dans l’espace compris entre l’hôtel de ville actuel et la place Saint-Jacques ; il s’aperçut bientôt du danger qu’offrait sa position et résolut de la quitter. Mais franchir de vive force les deux bras de la Seine sous les coups de l’armée gauloise, il n’y fallait pas songer. Il recourut alors à un stratagème pour diviser l’ennemi et, si possible, l’écraser par paquets. Ayant mandé dans sa tente les chefs des cohortes légionnaires, il leur donna ses instructions, qui devaient être exécutées le soir même, à la première veille, soit à neuf heures. Cinq cohortes, remontant la rive droite, accompagnées d’une flottille, détourneraient l’attention de l’ennemi. En même temps, une troupe d’élite, descendant la Seine pendant quatre milles, environ jusqu’à la hauteur du pont actuel de Grenelle, s’efforcerait d’assurer le passage aux légions venues à leur suite d’une marche plus lente. Les moins bons soldats devaient rester à la garde du camp.
Comme il était dit, il fut fait. Les Romains étaient, du reste, favorisés par une nuit sombre et un violent orage.
Averti que l’ennemi se mettait en mouvement et se préparait à passer la Seine sur trois points différents, Camulogène perdit de son sang-froid. Il eut le tort de sectionner son armée, dont une partie fut envoyée en amont et une seconde demeura en face de Lutèce, dans sa position primitive. Lui-même, à la tête de la troisième section, descendit le fleuve jusqu’à l’endroit que ses éclaireurs lui avaient désigné comme point de passage des Romains. Il ignorait que de ce côté seulement allait se produire la grande attaque et que, fatalement, il serait écrasé par des forces supérieures. Si prompte avait été la marche de Labiénus, que trois légions entières avaient traversé la Seine et s’étaient rangées en bataille avant l’arrivée du chef gaulois, qui, surpris, ne recula pas cependant. Ses guerriers se battirent avec leur valeur habituelle et balancèrent un moment la victoire. L’heureuse initiative des cohortes de l’aile gauche qui vinrent prendre les Gaulois à revers, décida de l’issue de la bataille. Camulogène et ses soldats, enserrés dans un cercle de fer, ne pouvaient résister à l’attaque savante, aux lourds javelots de l’ennemi ; leurs longues épées se faussaient dans le combat. Mais, de même qu’ils n’avaient pas hésité à brûler leur ville, les Parisiens ne reculèrent pas devant la mort. Se dépouillant de leur sagum, ce qui signifiait qu’ils voulaient résister à outrance, ils s’élancèrent nus contre leurs adversaires, et, ne pouvant vaincre, moururent avec intrépidité.
Paris avait reçu le baptême du sang.
Maître du champ de bataille, Labiénus ne poursuivit pas son avantage, trop heureux de ce demi-triomphe. Il rappela à lui les soldats qui, sur son ordre, avaient remonté la rive droite du fleuve et ceux qui avaient été laissés à la garde du camp, puis se dirigea vers Sens pour rejoindre César, fort occupé au siège d’Alésia, tombeau de l’indépendance gauloise.
L’armée de Beauvais arriva trop tard, le lendemain seulement, au secours de Camulogène. Si les confédérés eussent pu opérer leur jonction avec les Parisiens, c’en était fait de Labiénus, et probablement aussi de César.
Le nom de Camulogène n’en brille pas moins d’un vif éclat à côté et au-dessous de celui de Vercingétorix, à l’aurore de notre histoire.
Après avoir défendu héroïquement leur indépendance sans reculer devant aucun sacrifice, après avoir perdu des millions d’hommes, brûlé leurs villes pour affamer l’ennemi, les Gaulois qui avaient, avec Vercingétorix, déposé leurs armes aux pieds de César, tinrent désormais leur promesse d’être fidèles à l’empire. Ils acceptèrent sans arrière-pensée les bienfaits de la paix romaine. Nous en trouvons la preuve à Paris même, en interprétant les figurations et inscriptions des autels gallo-romains découverts en 1710, lors des fouilles pratiquées sous le chœur de Notre-Dame, et conservés aujourd’hui au musée Carnavalet. Si incomplets et si frustes qu’ils soient, ces documents lapidaires témoignent des progrès accomplis par l’idée romaine dès les premiers siècles de l’ère chrétienne dans le territoire des Parisii.
On y voit, à côte de Cérumnos représenté accroupi avec des cornes de cerf qui lui sortent du front, nombre de divinités empruntées au Panthéon romain, et une étude minutieuse de leurs attributs montre nettement la fusion des croyances des deux peuples vivant côte à côte et se pénétrant réciproquement.
Il y a plus : les données de l’archéologie sont confirmées par celles de l’épigraphie. Voici l’inscription qui se lit sur l’une des faces de l’un de ces blocs quadrangulaires :
SOUS TIBÈRE-CÉSAR-AUGUSTE À JUPITER TRÈS PUISSANT, TRÈS GRAND, SUPRÊME LES BATELIERS PARISIENS ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT AUX FRAIS DE LA CITÉ
Texte très explicite, on le voit, d’abord sur la nature du dieu auquel l’autel – car c’est un autel – a été dédié : il s’agit de la divinité romaine par excellence, Jupiter très bon ; ensuite sur la date de la consécration : le règne de Tibère, qui vécut de 14 à 37 après Jésus-Christ. L’année exacte n’est pas précisée, comme elle eût pu l’être par la mention du consulat et de la puissance tribunicienne, détails que n’eussent pas omis des gens plus au courant que nos Parisiens des habitudes romaines. Par quelles mains fut dressé cet autel ? La dédicace nous l’apprend encore : par les nautæ Parisiaci, ces bateliers parisiens qui formaient, aux premiers siècles de notre ère, une puissante corporation. Le trafic par eau était, en effet, très important à une époque où le réseau des voies de communication était infiniment moins compliqué et moins commode que de nos jours, et où les chaussées impériales étaient presque exclusivement réservées à la poste et aux services publics. Les nautæ avaient à Paris même trois ports. Il n’est donc pas étonnant que, sous Tibère, ils aient pris l’initiative d’élever à frais communs, publice, un monument à la grande divinité du Capitole, honorée dans toutes les parties de l’empire.
Il est un autre monument encore qui mérite de retenir un instant notre attention.
En 1871, des fouilles pratiquées sur l’emplacement de l’ancien Hôtel-Dieu firent mettre à nu des pierres sculptées qui appartenaient évidemment à un grand piédestal de statue équestre. Les sujets représentés sont, suivant l’interprétation de M. Mowat, d’un côté le désarmement de Mars, et de l’autre la figure de Janus quadrifrons, symbole de la paix romaine. Quel était le bienfaiteur de la Gaule à qui avait été élevée la statue dont nous possédons une partie du piédestal ? C’était, d’après le même savant, Germaniens, le vainqueur d’Arminius et des hordes germaines, si populaire que l’empereur inquiet l’enleva à ses légions et le fit périr en Orient. De la statue rien n’existe plus ; mais, quoique mutilé, le piédestal est d’un réel intérêt, si, comme nous le supposons, il exprime le sentiment de la reconnaissance publique envers Rome et envers un général dont l’épée victorieuse arrêta la marche envahissante des barbares.
Ces productions artistiques, qui datent du premier siècle de l’ère chrétienne, sont un signe évident de la rapidité de la romanisation à Lutèce.
Ainsi s’explique la construction de nombreux monuments dont les vestiges ont apparu, à diverses reprises, au cours de travaux d’appropriation, tant dans l’île même de la Cité que sur les deux rives : à droite du fleuve jusqu’à Saint-Eustache, et même plus loin, jusque sur le flanc de la colline Montmartre, et, sur la rive gauche, le long des pentes du mont Leucoticius, la montagne Sainte-Geneviève. Ainsi s’expliquent la fondation de l’énorme massif de l’Amphithéâtre et celle des Thermes.
Lorsque fut percée, entre la place Maubert et le quartier Mouffetard, la rue Monge, une de ces larges saignées qui ont apporté l’air et la lumière dans l’inextricable treillis des rues du vieux Paris, de grands travaux de nivellement furent opérés, et la terre enlevée sur une assez grande épaisseur.
La Compagnie des omnibus ayant acquis, le long de la voie nouvelle, un vaste emplacement pour y établir ses remises et ses écuries, la pioche des terrassiers mit au jour des murs en appareil romain. Leur disposition, leurs divisions transversales et certains détails caractéristiques montrèrent que l’on se trouvait en présence d’un amphithéâtre gallo-romain. La Société des Amis des Arènes de Lutèce, aussitôt formée, fit tous ses efforts pour assurer la conservation des ruines. Elle n’aboutit pas cependant. L’impérieuse préoccupation des besoins immédiats l’emporta sur l’intérêt historique, et, faute de fonds suffisants pour le rachat du terrain, les sociétaires eurent la tristesse de voir la Compagnie des omnibus procéder à des travaux qui ici dérasèrent les antiques murailles, là comblèrent les vides. Le dépôt des voitures s’établit sur la partie septentrionale de l’amphithéâtre de Lutèce.
Tout n’était heureusement pas perdu. La compagnie ne possédait que la moitié environ de l’emplacement sur lequel se trouvaient les Arènes, et, sous la pression de l’opinion publique, qui supportait avec impatience la disparition de ce premier feuillet de ses annales parisiennes, le conseil municipal acheta les immeubles sous lesquels étaient cachés les vestiges inexplorés que le compas des architectes avait désignés avec sûreté, grâce à la forme toujours la même de ces sortes de monuments. Les déblaiements, sagement conduits, firent reparaître les parties de l’édifice qui n’avaient pas été démolies pour être utilisées sur d’autres points, comme, par exemple, ces grosses pierres taillées, dont quelques-unes avec inscriptions, trouvées dans la Cité, anciens gradins transportés à cet endroit pour servir à des constructions nouvelles.
Aujourd’hui, à gauche d’une petite rue amorcée sur le côté oriental de la rue Monge, dans un square gazonné dont les avenues sont commandées par les formes de l’hémicycle, se voit ce qui reste encore debout de l’amphithéâtre où luttaient des gladiateurs, où eurent peut-être lieu des combats d’hommes contre des bêtes féroces, spectacles sanglants auxquels répugnent nos mœurs adoucies, mais que nos pères affectionnaient et dont le goût s’est prolongé assez avant, jusque sous le règne de Chilpéric.
L’amphithéâtre de Lutèce n’a pas d’histoire. Il n’en est pas de même des Thermes, auxquels demeure à jamais attaché le nom de l’empereur Julien.
À l’angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain, on voit, enclos par une haute grille de fer, un jardin d’aspect pittoresque, où sont groupés, dans un désordre voulu, des fragments architecturaux, vierges enlevées au portail d’une église, arcades de cloître, gargouilles en forme de monstres grimaçants, fûts de colonne et chapiteaux.
Ces restes du Moyen Âge ne sont pas ce qu’il y a de plus ancien à cet endroit : l’œil est encore arrêté par la majesté de ruines recouvertes de lierre, murailles noires et épaisses, voûtes béantes, les unes descendant dans les profondeurs de la terre, les autres s’élevant à une imposante hauteur, enchevêtrement de passages couverts dont le plan, après tant de remaniements, serait difficile à établir si les archéologues ne venaient à notre aide.
Ce sont là les vestiges d’un ancien palais impérial ; les salles qui subsistent faisaient partie des Thermes, complément indispensable de toute grande habitation romaine. Le percement du boulevard Saint-Michel a fait recouvrir les aqueducs amenant les eaux d’Arcueil, et l’aménagement du Musée a effacé presque complètement les traces des hypocaustes et des piscines.
Si l’emplacement du palais jadis habité par Julien, César des Gaules, est ainsi déterminé, il ne subsiste malheureusement plus rien des substructions mises à jour par l’établissement de la rue Soufflot, dans lesquelles on reconnut, à n’en pas douter, d’anciennes casernes, les castrastativa, qui, d’après le récit d’Ammien Marcellin, n’étaient séparées du palais que par le Champ de Mars. Ce souvenir permet cependant de reconstituer par la pensée et de faire revivre, dans son véritable décor, la scène pittoresque du couronnement de Julien par les légions.
Julien était un personnage d’allures mystérieuses ; il a été jugé très diversement : il a eu de violents détracteurs et d’ardents apologistes. Était-ce un indifférent en matières religieuses ou un sceptique ? Il semble plutôt qu’il ait été dévot à sa façon. Reconnaissant l’action exercée par la Providence non seulement sur les destinées générales de l’humanité, mais sur chaque homme en particulier, imbu des doctrines qu’il avait puisées dans les livres des écoles, de celle d’Alexandrie notamment, et dans les assemblées des mystères, il rêvait d’une régénération de l’ancienne religion épurée et le retour aux mœurs antiques de l’empire.
Ce n’était pas un simple théoricien, c’était un pratiquant, comme on dit aujourd’hui ; il accomplissait les rites et les libations. Mais était-il de bonne foi, ou jouait-il simplement un rôle ? On peut se le demander, car il y avait dans sa conduite des façons de faire si théâtrales, une préoccupation si évidente de se concilier l’opinion publique, que de légitimes soupçons s’élèvent chez les moins prévenus. Nous n’en voulons d’autre preuve que la comédie jouée par lui à Paris, dans le Palais des Thermes, devant les soldats qui occupaient les castra stativa de la rue Monge. Il est curieux de voir dans le récit d’Ammien Marcellin comment Julien affecte de se montrer détaché des idées de grandeur, et il est facile de se rendre compte que sa résistance calculée n’avait d’autre but que d’exciter le zèle de ses partisans.
Dans son amitié pour Julien et dans sa bonne foi naïve, le narrateur latin n’aperçoit pas l’habile mise en scène du merveilleux acteur, qui, exploitant le mécontentement des troupes exilées en Orient, les comble de prévenances et de compliments, et leur vante la bienveillance de l’empereur, dans la pensée évidente de provoquer des dénégations violentes. C’est malgré lui qu’il accepte le diadème, dit-il, et à peine l’a-t-il ceint, qu’il se cache dans son palais et fait répandre le bruit de sa mort. Une explosion d’affection, si forte qu’on peut croire à une révolte, se produit chez les soldats ; il en profite pour réunir les troupes, et, dans un discours éloquent, il place sa vie sous la protection de ceux qui viennent de le proclamer empereur. Ces différents épisodes sont évidemment le résultat d’une tactique adroite, et on est ainsi amené à mettre en doute la sincérité d’un homme qui ne régla pas toujours sa vie conformément à ses principes et qui, d’apparence simple et austère, maniait la flatterie avec un talent consommé.
Sous l’antique voûte du Palais des Thermes, qui servent aujourd’hui de musée, se dresse une statue en marbre blanc, celle d’un homme barbu, vêtu de la toge, une main ramenée sur la poitrine, l’autre tenant un rouleau de papyrus, à la manière des philosophes. La comparaison avec d’autres portraits de caractère absolument authentique, rend incontestable l’attribution qu’ont faite de cette statue des iconographes expérimentés : c’est celle de l’empereur Julien. Mais, comme s’il était dit que le mystère devait en tout demeurer attaché à la personnalité de cet homme, on ignore et on ignorera probablement toujours l’origine de cette statue, qui fut trouvée à Paris, chez un marbrier, où elle était demeurée pendant de longues années sans attirer l’attention. L’on ne sait si elle a été exhumée du sol de l’antique Lutèce, ou si elle est venue de Rome ou de la Grèce avec des statues analogues que la Renaissance introduisit en France en assez grand nombre. On a eu raison de l’enlever du musée du Louvre, où elle était confondue dans la multitude des statues antiques, et elle est bien à sa place dans ce palais dont elle rappelle l’hôte impérial.
Origine historique. – Saint Germain, évêque de Paris, et Brunehaut, reine d’Austrasie. – Destruction de l’abbaye par les Normands. – Les trois époques de la reconstruction. – L’abbaye, ses bâtiments, sa vie intellectuelle et morale. – Les abbés commendataires.
Avec son étrange clocher aux épais contreforts, avec ses tours carrées, aujourd’hui coupées au ras de la toiture, et qui enserraient l’abside dans de solides étais, avec ses formes massives, l’église Saint-Germain des Prés a un air de vénérable antiquité.
À l’intérieur, les peintures et les ors ne parviennent pas à lui communiquer un air de jeunesse ; piliers et chapiteaux ont un aspect archaïque sous leur parure moderne, et si les larges ouvertures pratiquées sur un des côtés de la haute nef donnent entrée à une lumière trop crue, les parties latérales demeurent plongées dans la religieuse obscurité des édifices de l’époque romane.
C’est, cependant, plus loin encore dans le passé qu’il faut chercher ses origines, dans ces temps mérovingiens dont un de nos grands historiens a dépeint l’âpre et sauvage caractère. L’église, appartenant à une riche abbaye, ne se dressait pas, comme aujourd’hui, en quartier habité, mais en pleine campagne, au milieu des prairies dont elle a pris le nom.
Bien qu’il ne reste plus rien des constructions primitives, est-ce une raison suffisante pour nous priver de porter nos regards sur cette époque dont elle évoque, malgré tout, le souvenir ? Si les pierres d’alors ont disparu, du moins n’est-il pas impossible de faire revivre l’image du grand évêque dont elle a conservé le nom : saint Germain, contemporain de Childebert, celui-là même qui, sous le règne suivant, fit entendre à Sigebert et à Brunehaut une si courageuse et si austère leçon.
C’est un spectacle bien curieux que celui de cette société mérovingienne, mélange d’éléments non encore fusionnés, de Gallo-Romains à l’esprit affiné par une civilisation avancée, et de Francs violents et barbares, de mœurs grossières. Le christianisme exerçait bien quelque influence sur les esprits ; mais, au fond, les instincts ataviques demeuraient non transformés. Les princes francs, en s’installant en Gaule, y apportèrent, avec leur sauvagerie et leur rudesse, les vices germains : la ruse et la duplicité. Ils vivaient dans leurs palais, au milieu de guerriers farouches qui leur formaient une sorte de clientèle, dans une omnipotence peu favorable à l’austérité des mœurs, et ils offraient aux semences du christianisme un terrain mal préparé. Éblouis par la solennité du culte, pleins de respect pour les évêques, dont l’autorité était d’ailleurs réelle, remplis de crainte à l’idée du châtiment immédiat dont Dieu et les saints punissaient les impies, ils avaient une religion toute superficielle. Au lieu de considérer la foi comme un puissant moyen de perfectionnement moral, comme un appel impérieux vers l’idéal, ils se laissaient aller aux caprices de leurs instincts et croyaient en être quittes envers le Créateur par quelque fondation d’église ou des dotations de monastères. C’est précisément ce qui arriva pour Childebert.
Il s’était rendu en Espagne, avec son frère Clotaire, à la tête d’une armée nombreuse pour venger sa sœur malmenée par son époux, le roi des Visigoths. Pampelune tomba aux mains des princes francs, mais Saragosse résista avec énergie. Un jour, l’armée assiégeante aperçut, formant une imposante procession sur les boulevards de la ville, les habitants et le clergé qui portaient avec vénération, dans un déploiement magnifique, les trésors vénérés des églises : vases d’or provenant, disait-on, du temple de Salomon, calices et ciboires ornés de pierreries, feuilles d’or massif servant d’enveloppes aux livres liturgiques, et, objet bien plus précieux encore, l’étole du glorieux saint Vincent, célèbre par tant de miracles.
Le roi franc fut-il réellement impressionné par cette théorie sacrée, espéra-t-il posséder dans l’étole de saint Vincent un talisman qu’il ferait servir à sa puissance ? Ce n’est pas impossible. Toujours est-il que la paix fut conclue entre lui et les habitants de Saragosse, à la condition que la miraculeuse étole et les vases saints lui seraient remis.
C’est pour abriter ces trésors que Childebert fit construire, dans des terrains situés à l’ouest des jardins de son palais des Thermes, l’église qui, d’abord consacrée à saint Vincent, fut plus tard dédiée à saint Germain. Il n’épargna rien pour la rendre digne du dépôt qui lui était confié. Des sculptures, analogues à celles que l’on voit encore aujourd’hui dans la crypte de Jouarre, ornaient les lourds chapiteaux ; le plafond était lambrissé comme celui des basiliques romaines ; la toiture, faite de plaques de bronze, resplendissait au soleil ; les murailles étaient décorées de mosaïques à la mode byzantine.
Tel était le temple qui, sous le vocable de saint Vincent, occupa la place où se dresse l’église actuelle de Saint-Germain des Prés. D’où est venu ce changement de nom ? On a vingt exemples analogues d’un saint aux reliques vénérées se substituant à un autre dans la dévotion populaire.
Saint Germain était évêque de Paris. C’était non seulement un pieux prélat, mais un homme d’une haute intelligence. Son autorité, qui prenait naissance dans la pureté de sa vie, était augmentée encore par l’élévation de son caractère.
Si grande était son indépendance qu’il put, à maintes reprises, s’interposer au nom de Dieu et de la justice entre les rois francs, toujours en luttes fratricides. Il eut le courage d’excommunier Haribert, qui, sans attendre la mort de sa première femme, avait donné le titre de reine et d’épouse à une fille nommée Méroflède, et qui ensuite, portant ses vues sur la sœur de sa première femme, une religieuse, lui avait solennellement passé au doigt l’anneau conjugal. Le prince était ainsi coupable de bigamie et de sacrilège. L’évêque Germain le frappa des foudres canoniques, sans effet d’ailleurs, car le roi garda près de lui ses deux épouses.
Mais l’acte de courage le plus extraordinaire et le plus méritoire du saint prélat, fut son intervention à la fois ferme et habile auprès de Brunehaut, l’épouse de Sigebert. Nous avons la bonne fortune de posséder le texte même de la lettre qu’il écrivit à cette femme hautaine parvenue au comble de la puissance.
« Répéterai-je les bruits, écrivait-il à Brunehaut, qui courent dans le public ? Ils me consternent, et je voudrais les dérober à la connaissance de votre piété. On dit que c’est par vos conseils et votre instigation que le très glorieux roi Sigebert s’acharne si obstinément à la ruine de ce pays. Si je rapporte de semblables propos, ce n’est pas que j’y ajoute foi, c’est afin de vous supplier de ne fournir aucun prétexte à de si graves imputations. Quoique déjà, depuis longtemps, ce pays soit loin d’être heureux, nous ne désespérons pas encore de la miséricorde divine, qui peut arrêter le bras de la vengeance, pourvu que ceux qui gouvernent ne se laissent pas dominer par des pensées de meurtre, par la cupidité, source de tout mal, et par la colère qui fait perdre le sens… »
La vindicative reine d’Austrasie ne se laissa pas toucher par les conseils du pieux prélat, et l’on sait les malheurs qui l’accablèrent après l’assassinat de Sigebert, sa captivité à Rouen, son mariage avec le jeune Mérovée, ses vains efforts pour exercer en Austrasie, malgré les leudes, le pouvoir au nom de ses enfants, les hontes de sa vieillesse, ses crimes, et enfin la vengeance posthume de Frédégonde, dont le fils la fit attacher nue à la queue d’un cheval sauvage.
Il n’était pas sans intérêt, pensons-nous, de remettre en mémoire, à propos de l’église Saint-Germain des Prés, ces souvenirs d’une époque voisine de sa fondation, et de rappeler, à côté du nom de son saint patron, ceux de Childebert, de Sigebert et de Brunehaut.
Les dotations que Childebert avait faites à l’abbaye de Saint-Germain des Prés étaient considérables. Les terrains concédés aux religieux comprenaient, outre le territoire actuel d’Issy, un chemin de dix-huit pieds de large sur chacune des rives de la Seine, depuis le petit pont jusqu’à Sèvres, avec le droit exclusif de pêche. Établie en dehors des murs de Paris, la communauté possédait quatre cent mille hectares de terre. Mais des temps allaient venir où à cette immense prospérité succéderait une extrême détresse.
Un jour, on apprit qu’une flotte de cent vingt navires remontait la Seine. Elle portait des Normands venus de Scandinavie, hommes barbares et farouches, avides de sang et de pillage, et qui répandaient sur leur passage la dévastation et la terreur. Rouen fut incendié, la population égorgée. Enorgueillis par leurs succès, les pirates marchèrent sur Saint-Denis. Les habitants de Paris fuirent épouvantés dans les marais situés entre la Seine et la Bièvre et dans les forêts voisines. La ville et l’abbaye furent mises à sac, et, pour obtenir la retraite de ces hordes, les descendants dégénérés de Charlemagne, ignorant les résolutions viriles et la vigoureuse énergie, durent payer un tribut. Aussi, comme il fallait s’y attendre, les Normands revinrent à plusieurs reprises, exigeant des villes repeuplées de nouveaux sacrifices. Paris fut rançonné plusieurs fois. À la fin, cependant, il se rencontra un homme de cœur et de volonté, lui fit fortifier la ville, Gozlin, ancien abbé de Saint-Germain des Prés, puis évêque de Paris, et dont on a, par reconnaissance, donné le nom à une des rues de la capitale. Impuissants à s’emparer de la ville, les Normands se vengèrent sur l’abbaye, qu’ils prirent d’assaut et saccagèrent. Ce fut, d’ailleurs, leur dernier succès ; bientôt après ils se retirèrent. Paris et ses environs étaient à jamais délivrés de ces bandes pillardes, et, dès lors, l’abbaye de Saint-Germain allait retrouver des jours prospères.
Dans l’église actuelle, à peu près rien ne subsiste des Constructions mérovingiennes ; à peine quelques colonnes du triforium, empruntées elles-mêmes à des temples païens, et quelques fûts de marbre précieux, tels que n’en taillait pas le Moyen Âge.
Elle porte dans son architecture, sans parler des remaniements de ces dernières années, les traces de trois époques bien distinctes : le début du onzième siècle, la fin du douzième et le dix-septième siècle.
Les formes massives de la première période se voient tant dans la nef centrale que dans les bas-côtés qui l’accompagnent : lourds piliers accotés de quatre colonnes et surmontés de chapiteaux épais, ornés d’entrelacs, de personnages de tailles courtes, d’animaux fantastiques. Encore faut-il faire un choix dans cette série de chapiteaux, dont beaucoup ont été refaits sur d’anciens modèles, il est vrai, mais par un ciseau qui n’a pu communiquer à la pierre la marque de cette époque reculée.
Le chœur, l’abside et le portail, abstraction faite, bien entendu, de l’ajout qu’il a reçu ultérieurement, appartiennent à la seconde période. On connaît même la date exacte de la consécration de l’église. En 1163, le pape Alexandre III bénit le chœur de Saint-Germain et posa la première pierre de Notre-Dame. Ces embellissements avaient été accomplis par l’abbé Hugues III, désireux de mettre le monument à la mode du jour. Or, Saint-Denis et Sens venaient d’inaugurer le style ogival ; à leur exemple, on mêla dans la nouvelle partie de Saint-Germain des Prés l’arc brisé au plein cintre. Les sculptures, si intéressantes dans leur variété, ont ici une netteté et une perfection ignorée de l’âge précédent ; la fantaisie de l’artiste s’est donné carrière avec liberté et souplesse. On trouve bien encore des êtres fantastiques, mais la nature est déjà observée de plus près, les personnages ont moins de lourdeur ; les crochets élégants se dessinent et se projettent hardiment en avant.
À l’exemple de leurs prédécesseurs du douzième siècle, les abbés du dix-septième siècle apportèrent, sous Louis XIII et sous Louis XIV, d’importants changements à l’église de leur monastère. Ils appliquèrent sur le portail ogival de l’entrée un insignifiant fronton triangulaire, ils ouvrirent une porte sur le flanc méridional de l’édifice et allongèrent les bras du transept. Puis, l’église surélevée perdit son plafond lambrissé ; des voûtes le remplacèrent, qui eurent pour points d’appui des pilastres d’ordre composite, comme on les aimait alors. Plusieurs fenêtres furent agrandies, et d’autres furent percées. Il en résulta la détérioration du triforium ogival, dont la disposition primitive se reconnaît encore dans la partie du chœur qui n’a pas de fenêtres.
Saint-Germain a en outre reçu, au cours du présent siècle, au-dessus des pleins des grandes arcades de la nef et du chœur, la magnifique décoration picturale d’Hippolyte Flandrin. Les colonnes elles-mêmes ont été peintes, et les chapiteaux brillent sous l’or qui les recouvre.





























