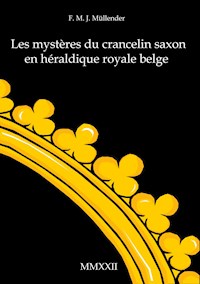
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Le crancelin, cet élément mystérieux initialement présent dans les armoiries de nos premiers Rois et soudainement réapparu en 2019, après un siècle de bannissement. Quelle est exactement cette pièce, dite végétale, brisure, métallique, divine ? Des anciens Grecs et valeureux Germains, en passant par le peuple élu et les ours totémiques, débroussaillant les légendes héraldiques, on en arrive aux états européens, en Afrique et Amérique. Une démystification prouvée sur base d'un dépouillement rigoureux de l'abondante littérature allemande sur le sujet. Illustrations du dessinateur héraldique Sivane Saray (Bruxelles)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des difficultés … exposent celui qui veut interpréter des
documents figurés.
Il faut se garder de prendre ‘à la lettre’ toutes les
représentations graphiques.
J. Pycke, La critique historique1
Table des matières
Vorwort
Préambule
Introduction
La Saxe en Belgique
Un premier aperçu
Crancelin, qui es-tu ?
Bernard de Saxe et son ascendance
Descendance et imagerie
Une démystification
L’essaimage du crancelin
Le destin des crancelins non-saxons
Des cousins éloignés
Une concluson
Notes
Vorwort
Das „Sachsenwappen“ mit den Balken und dem Rautenkranz ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur Historikern, die sich mit dem 1918 untergegangenen Königreich und den Herzogtümern beschäftigen, ein vertrauter Begriff.
Im öffentlichen Raume begegnet der Rautenkranz auf Bundesebene als Bestandteil der visuellen Identität zweier Länder, dem Freistaate Sachsen und dem Lande Sachsen-Anhalt, wo es im Amtsverkehr beispielsweise bei der Polizei oder der Feuerwehr vorkommt.
Im Königreiche Belgien läßt es sich nur äußerst selten antreffen. So erscheint es nirgendwo in staatlicher, provinzieller oder kommunaler Heraldik. Mit einer Ausnahme, welche die Regel bestätigt, besteht es weder im Adels- noch im bürgerlichen Stande. Ausgerechnet beim herausragendsten Vertreter des Adeltums, dem Königshause, war es seit dem ersten Weltkriege außer Gebrauch gefallen. Daher ist es nur zu verständlich, daß weder in der breiten Bevölkerung noch unter den hiesigen Wappenkundlern Kenntnisse des Rautenkranzes vorherrschen.
Als ein deutschsprachiges Bindeglied zu unseren belgischen Mitbürgern war es unser Bestreben, die ergiebigen Schriftquellen und Zeugnisse aus der fremden Sprache zugänglich zu machen. Wir hoffen, zum besseren Verständnis des heraldischen Denkmals, das dank des königlichen Erlasses von 2019 seinen angestammten Platz im Wappen des Königshaueses zurückgefunden hat, beizutragen.
Préambule
En république fédérale d’Allemagne, le „blason de Saxe“ aux fasces et au crancelin n’est nullement connu que par les historiens qui traitent du royaume disparu en 1918 et des principautés.
Au niveau fédéral, le crancelin se rencontre dans l’espace public comme faisant partie de l’identité visuelle de deux länder, la Saxe et la Saxe-Anhalt, où il apparaît par exemple dans la communication officielle de la police et des services de secours.
Au royaume de Belgique, il ne s’aperçoit que très rarement. On ne le discerne nulle part en héraldique d’État, provinciale ou communale. A une exception près qui confirme la règle, il n’existe ni dans l’état noble ni bourgeois. Précisément auprès du plus haut représentant de la noblesse, la maison royale, il était tombé en désuétude depuis la Grande guerre. De ce fait, il est tout à fait compréhensible que le grand public et les héraldistes nationaux n’ont généralement pas connaissance du crancelin.
En tant que chaînon germanophone avec nos concitoyens belges, notre objectif a été de rendre accessibles les riches sources et témoignages rédigés en langue étrangère. Nous espérons pouvoir contribuer à une meilleure compréhension de ce monument héraldique qui, grâce à un arrêté royal de 2019, a retrouvé sa place séculaire dans les armoiries de la famille royale.
IntroductionI
Dans leurs armoiries personnelles, nos premiers rois – LL. MM. Léopold Ier, Léopold II et Albert Ier – portèrent également un écu de Saxe : burellé (sic !) d’or et de sable de dix pièces, au crancelin ou couronne de rue de sinople, brochant en bande sur le tout.2 Remarquons les obiits royaux dans l’église de la « paroisse royale » de Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles. Cet usage prit fin durant la Grande guerre, en même temps que l’abandon, de facto mais non de jure, des titres saxonsII à cause de l’agression de la Belgique neutre par l’empire allemand, dont la Saxe fit partie fédérée.3 Jusques alors, non seulement nos rois, mais également les princes et princesses – de Louis-Philippe à Marie-José – furent ducs et princes saxons.4
Parallèlement, le Royaume-Uni déchut en 1919 le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, le prince héritier de Hanovre et son fils le duc de Brunswick, ainsi que le comte de Taaffe – pourtant issu d’une famille irlandaise – de leurs titres britanniques pour avoir porté les armes contre lui. La Maison royale elle-même opta pour un changement patronymique.5
C’est à d’autant plus forte raison que l’arrêté royal du 12 juillet 2019 déterminant les armoiries de la Maison royale et de ses membres6 doit être considéré comme remarquable puisqu’il réintroduit officiellement l’écusson de Saxe dans la pratique héraldique royale belge : burelé d’or et de sable de dix pièces, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout. Après exactement un siècle d’ignorance, cette absence réparée risque pourtant d’étonner plus d’un de nos contemporains, n’ayant jamais connu ces armoiries anciennes. Il paraît ainsi utile d’apporter quelques éclaircissements à ce sujet.
Dans le présent papier, nous étudierons les origines des armoiries saxonnes que nous replacerons dans leur contexte historique et géographique avant leur importation en notre royaume, en 1831. Nous tenterons de faire la part des légendes héraldiques et présenterons des armes parentes en Belgique, en Europe et bien au-delà. En effet, il nous importe de placer l’étude de cette figure héraldique dans un cadre dépassant le contexte strictement saxon.
Nous dédions ces quelques lignes à la mémoire de feu Roger Harmignies AIH (1922-2017), précurseur en héraldique royale belge, qui nous fit l’honneur d’assister, avec son épouse, à la présentation de notre livre « De scutis ænigmatis sanctis Felicis », en 2007.
I La présente publication constitue l’édition intégrale de cette étude, dont un extrait fut publié dans « Le Parchemin », n° 456, OGHB, Bruxelles, 2021
II Duc en Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, ainsi que landgrave de Thuringe, duc de Clèves, margrave de Misnie, duc de Juliers, Berg, Westphalie etc., ces derniers titres jamais portés en Belgique
La Saxe en Belgique
Étant donné le mariageIII7 de S. A. Léopold, prince de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duc en Saxe, avec S. A. R. Charlotte-Auguste, princesse de Galles, ce premier, étant devenu veuf, écartela en 1818 ses armes pleines puis simplifiées (de Saxe uniquement) avec celles du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (version de 1816 modifiée),8IV puisque son épouse fut appelée à accéder au trône. Par la même occasion, Léopold fut titré d’altesse royale.
Précisons que la même année 1818, l’écu de Saxe fut également introduit en héraldique britannique par le double mariage du futur roi Guillaume IV (1765-1837) avec Adélaïde, née princesse de Saxe-Meiningen (1792-1849), ainsi que de son frère Édouard Auguste (1767-1820) avec Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1786-1861, sœur de Léopold).9 Mais ce fut surtout le prince consort Albert, né prince de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duc en Saxe (1819-1861, neveu de Léopold), qui popularisa les armes saxonnes en Grande-Bretagne.10
Élu roi des Belges et entre-temps (1826) nommé Saxe-Cobourg-Gotha,11 Léopold Ier chargea, dans un premier stade, ses armoiries britanniques d’un écu de Belgique en abîme.1213 Ce fut donc par sa prestation de serment, le 21 juillet 1831, sur les marches de Saint-Jacques sur Coudenberg, que les armes de Saxe au crancelin firent leur entrée dans la Dynastie belge.
Durant les premières années de son règne, l’héraldique personnelle du Roi ne fut point sa préoccupation principale, ce qui se comprend au vu des importants défis sur les plans intérieur et extérieur que le jeune état dut relever.
Armoiries du roi Léopold Ier
Lorsqu’il s’agit, en 1858, de déterminer un pavillon royal, l’ordre fut inversé et le lion belge porta dorénavant sur l’épaule un écusson écartelé aux armes du Royaume-Uni et de Saxe, comme l’exhibe son obiit à Saint-Jacques sur Coudenberg.14 Ce procédé se fut toutefois déjà insinué quelques années plus tôt de façon officieuse.15
Par analogie, S. A. R. Philippe, son fils puîné auquel il concéda le titre personnel de comte de Flandre en 1840, porta d’abord de Flandre à l’écu écartelé de Grande-Bretagne et de Saxe avant d’adopter de Belgique audit écusson et au lambel de gueules.16
Quinze ans après le décès de son père, Léopold II réglementa les armoiries du Roi et celles des princes et princesses de la Maison royale, dont le comte de Flandre. En 1880, en effet, il abandonna les armes britanniques concédées à feu son père – ad personam, il est vrai17 – et ne conserva que les armes-souche de Saxe sur l’épaule du lion, comme il se voit encore à Saint-Jacques sur Coudenberg.18
Si l’arrêté royal de 1910 du roi Albert maintint les dispositions de son auguste oncle en vigueur, en 1921 toutefois, il ne fut plus question de l’écu de Saxe, devenue ennemie, dans le pavillon personnel des membres de la famille royale.19
Compte tenu de la longue présence des armes saxonnes dans l’héraldique royale belge, il paraît justifié d’y s’intéresser de plus près. Ces armes se blasonnent comme suit : fascé de sable et d’or, au crancelin brochant de sinople, posé en bande. Mais ces armoiries, si simples en apparence, constituent le point de départ de bien de questions !
III La création de duc de Kendal – auld grey town du comté de Cumbria – pour le prince Léopold, annoncée par un quotidien local, ne fut jamais suivie d’effets et resta donc lettre morte.
IV Écartelé d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande et d’Angleterre, à l’écu de Hanovre (sans écusson de la couronne de Charlemagne et non timbré) en abîme, et au lambel d’argent à cinq pendants, celui du centre chargé d’une rose de gueules, brochant sur le tout
Un premier aperçu
Pour débuter par les couleurs utilisées, le sable et l’or, elles sont restées stables tout au long de l’existence de ces armoiries, depuis ses origines jusqu’à nos jours, car elles sont toujours bien vivantes dans les espaces privé et public. Un émail et un métal incarnent pratiquement le minimum dans la constitution d’armoiries, garantie d’une bonne héraldique. Ces couleurs sont d’un bel effet signalétique, à tel point que l’on retrouve justement ce fascé sur les feux de circulation routière en région flamande et, en bande, sur du ruban de signalisation et de balisage. Du règne animal nous viennent les guêpes, frelons, serpents et salamandres tachetées qui nous avertissent de leur dangerosité par un bandé de jaune et noir – noli me tangere !
Les choses sont moins claires pour le fascé, comme cela est souvent le cas pour cette partition. À titre d’exemple, on peut citer les armoiries du Luxembourg. Le nombre de pièces varie selon les représentations historiques, allant jusqu’au burelé.20 Aussi, l’ordre des couleurs était-il fluctuant, avec un sable-or traditionnel et or-sable pour la province prussienne. 21 Il doit en être retenu qu’à l’origine, il devait s’agir d’un simple fascé sans précision, avant que cela ne soit fixé de façon définitive des siècles plus tard.22
Il semblerait également que, d’une façon générale, les toutes premières armoiries n’eussent consisté que de partitions, rebattements et pièces honorables, avant d’être peuplées de meubles et figures. D’après le P. Claude-François Menestrier S. J. (1631-1705),





























