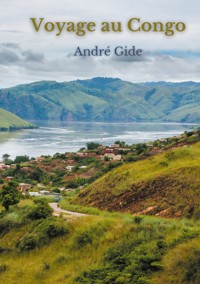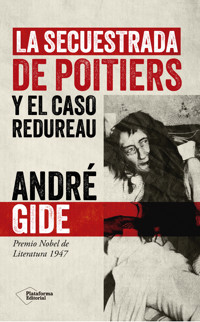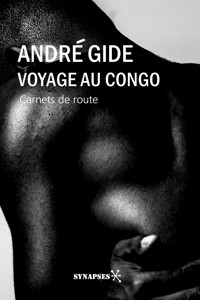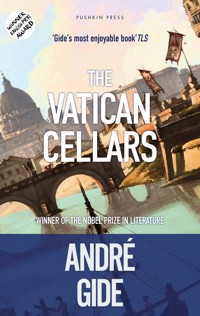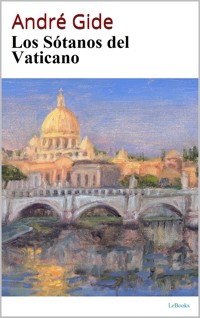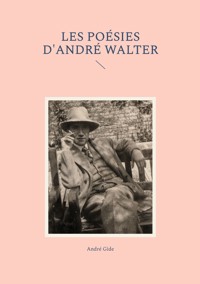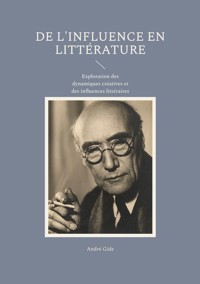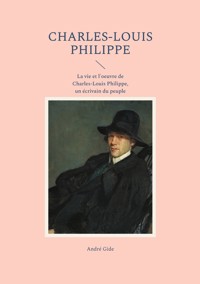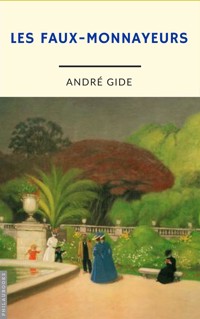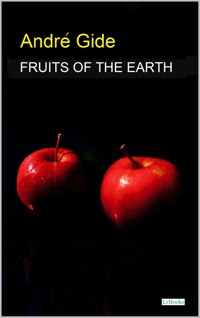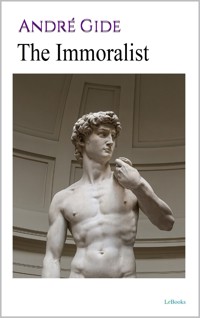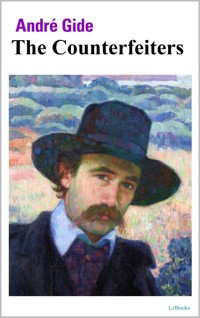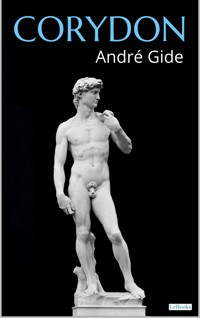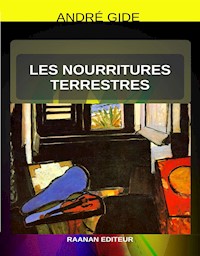
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Nourritures terrestres, parfois appelé plus simplement Les Nourritures, est une œuvre littéraire d'André Gide (1897), sur le désir et l'éveil des sens. Présentation | Citations Avant-propos Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, — puis à tout le reste plus qu'à toi. Livre premier Tandis que d'autres publient ou travaillent, j'ai passé trois années de voyage à oublier au contraire tout ce que j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile ; elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d'une éducation. Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie ; mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose — passionnément. Que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée...|Wikipedia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SOMMAIRE
LIVRE I
LIVRE II
LIVRE III
LIVRE IV
LIVRE V LA FERME
LIVRE VI LYNCÉUS
LIVRE VII
LIVRE VIII
HYMNE EN GUISE DE CONCLUSION
ENVOI
Notes
ANDRÉ GIDE
LES NOURRITURES TERRESTRES
PARIS
Mercure de France, 1897
Raanan Éditeur
Livre 1014 | édition 1
LIVRE I
Mon paresseux bonheur, qui longtemps sommeilla, S’éveille…
HAFIZ.
1
Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout.
Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle.
Dès que notre regard s’arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu.
⁂
Tandis que d’autres publient ou travaillent, j’ai passé ces trois années de voyage à oublier au contraire tout ce que j’avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile ; elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d’une éducation.
Tu ne sauras jamais les efforts qu’il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie ; mais maintenant qu’elle nous intéresse, ce sera comme toute chose — passionnément.
— Je châtiais allègrement ma chair, éprouvant plus de volupté dans le châtiment que dans la faute — tant je me grisais d’orgueil à ne pas pécher simplement.
— Supprimer en soi l’idée de mérite ; il y a là un grand achoppement pour l’esprit.
… L’incertitude de nos voies nous tourmenta toutes nos vies. Que te dirais-je ? Tout choix est effrayant, quand on y songe ; effrayante une liberté que ne guide plus un devoir. — C’est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu, où chacun fait sa découverte et, remarque-le bien, ne la fait que pour soi… de sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore… Des bocages ombreux nous attirent ; des mirages de sources pas encore taries… mais plutôt les sources seront où les feront couler nos désirs ; car le pays n’existe qu’à mesure que le forme notre approche et le paysage à l’entour peu à peu, devant notre marche se dispose… et nous ne voyons pas au bout de l’horizon — et même près de nous ce n’est qu’une successive et modifiable apparence.
Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave ? Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons hélas, en attendant de le trouver, où nous devons adresser nos prières, nous tourner pour nos perpétuelles prières… Puis on se dit enfin qu’il est partout, n’importe où, l’Introuvable, et on s’agenouille au hasard.
— Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main.
— Où que tu ailles tu ne peux rencontrer que Dieu ; Dieu, disait Ménalque : c’est ce qui est devant nous.
Nathanaël, tu regarderas tout en passant, et tu ne t’arrêteras nulle part. Dis-toi bien que Dieu seul n’est pas provisoire.
Nathanaël — que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée.
Tout ce que tu gardes en toi de connaissances distinctes, restera distinct de toi jusques à la consommation des siècles. Pourquoi y attaches-tu tant de prix ?
Il y a profit aux désirs, et profit au rassasiement des désirs — parce qu’ils en sont augmentés. Car, je te le dis en vérité, Nathanaël, chaque désir m’a plus enrichi que la possession toujours fausse de l’objet même de mon désir.
⁂
Non point la sympathie, Nathanaël, — l’amour.
Pour bien des choses délicieuses, Nathanaël, je me suis usé d’amour. Leur splendeur venait de ceci que j’ardais sans cesse pour elles. Je ne pouvais pas me lasser. Toute ferveur m’était une usure d’amour, — une usure délicieuse.
Hérétique entre les hérétiques, toujours m’attirèrent les opinions écartées, les extrêmes écarts des pensées, les divergences. Chaque esprit ne m’intéressait que par ce qui le faisait différer des autres. — J’en arrivai à bannir de moi la sympathie, n’y voyant plus que la reconnaissance d’une émotion commune. — Non point la sympathie, Nathanaël, — l’amour.
Il faut agir sans juger si l’action est bonne ou mauvaise. Aimer sans s’inquiéter si c’est le bien ou le mal.
Nathanaël je t’enseignerai la ferveur.
Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité. Je ne souhaite pas d’autre repos que celui du sommeil de la mort. J’ai peur que tout désir, toute puissance que je n’aurai pas satisfaits durant ma vie, pour leur survie ne me tourmentent. J’espère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi, — satisfait, — mourir complètement désespéré.
Non point la sympathie, Nathanaël, l’amour. Tu comprends n’est-ce pas, que ce n’est pas la même chose. C’est par peur d’une perte d’amour que parfois j’ai su sympathiser avec des tristesses, des ennuis, des douleurs que si non je n’aurais qu’à peine endurés. — Laisse à chacun le soin de sa vie.
…… (Je ne peux écrire aujourd’hui parce qu’une roue tourne en la grange. Hier je l’ai vue ; elle battait du colza.
La balle s’envolait ; le grain roulait à terre.
La poussière faisait suffoquer.
Une femme tournait la meule. Deux beaux garçons, pieds nus, récoltaient le grain.
Je pleure parce que je n’ai rien de plus à dire.
Je sais qu’on ne commence pas à écrire quand on n’a rien de plus à dire que ça. Mais j’ai pourtant écrit encore d’autres choses sur le même sujet.)
⁂
Nathanaël, j’aimerais te donner une joie que ne t’aurait donnée encore aucun autre. Je ne sais comment te la donner, et pourtant, cette joie, je la possède. — Je voudrais m’adresser à toi plus intimement que ne l’a fait encore aucun autre. Je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres — cherchant dans chacun plus qu’il ne t’avait encore révélé ; où tu attends encore ; où ta ferveur va devenir tristesse, de ne pas se sentir soutenue. Je n’écris que pour toi ; je ne t’écris que pour ces heures. Je voudrais écrire tel livre d’où toute pensée, toute émotion personnelle te semblât absente, où tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur. Je voudrais m’approcher de toi, et que tu m’aimes.
La mélancolie n’est que de la ferveur retombée.
Tout être est capable de nudité ; toute émotion, de plénitude.
Mes émotions se sont ouvertes comme une religion. Peux-tu comprendre cela : toute sensation est d’une présence infinie.
Nathanaël je t’enseignerai la ferveur. — Nos actes s’attachent à nous comme sa lueur au phosphore. Ils nous consument, il est vrai, mais ils nous font notre splendeur.
Et si notre âme a valu quelque chose, c’est qu’elle a brûlé plus ardemment que quelques autres.
Je vous ai vus, grands champs baignés de la blancheur de l’aube ; lacs bleus, je me suis baigné dans vos flots — et que chaque caresse de l’air riant m’ait fait sourire, voilà ce que je ne me lasserai pas de te redire — Nathanaël ; je t’enseignerai la ferveur.
Si j’avais su des choses plus belles, c’est celles-là que je t’aurais dites — celles-là, celles-là, certes et non pas d’autres.
Tu ne m’as pas enseigné la sagesse, — Ménalque. — Pas la sagesse, mais l’amour.
⁂
J’eus pour Ménalque plus que de l’amitié, Nathanaël, et à peine moins que de l’amour… Je l’aimais aussi comme un frère.
Ménalque est dangereux ; crains-le ; il se fait réprouver par les sages, mais ne se fait pas craindre des enfants. Il leur apprend à n’aimer plus seulement leur famille, et, lentement, à la quitter ; il rend leur cœur malade d’un désir d’aigres fruits sauvages et soucieux d’étrange amour. — Ah ! Ménalque — avec toi j’aurais voulu courir encor sur d’autres routes — mais tu haïssais la faiblesse et prétendis m’apprendre à te quitter.
Nathanaël, il y a d’étranges possibilités dans chaque homme. Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n’y projetait déjà une histoire. Mais hélas un unique passé propose un unique avenir — le projette déjà devant nous, comme un pont infini sur l’espace.
On n’est sûr de ne jamais faire que ce que l’on est incapable de comprendre. Comprendre, c’est se sentir capable de faire.
ASSUMER LE PLUS POSSIBLE D’HUMANITÉ, voilà la bonne formule.
Formes diverses de la vie — ah ! que vous me parûtes belles. (Ce que je te dis là, c’est ce que me disait Ménalque.)
J’espère bien avoir connu toutes les passions et tous les vices ; — au moins les ai-je favorisés. Tout mon être s’est précipité vers toutes les croyances — et j’étais si fou certains soirs que je croyais presque à mon âme, tant je la sentais près de s’échapper de mon corps, — me disait encore Ménalque.
Et notre vie aura été devant nous comme ce verre plein d’eau glacée, ce verre humide que tiennent les mains d’un fiévreux, qui veut boire, et qui boit tout d’un trait, sachant bien qu’il devrait attendre, mais ne pouvant pas repousser ce verre délicieux à ses lèvres, tant est fraîche cette eau, tant l’altère la cuisson de la fièvre.
2
Ah ! comme j’ai donc respiré l’air froid de la nuit — ah ! croisées ! et, tant les pâles rayons coulaient de la lune, à cause des brouillards, comme des sources — on semblait boire. — Ah ! croisées ! que de fois mon front s’est venu rafraîchir à vos vitres, et que de fois mes désirs, lorsque je courais de mon lit trop brûlant vers le balcon, à voir l’immense ciel tranquille, se sont évaporés comme des brumes.
Fièvres des jours passés, vous étiez à ma chair une mortelle usure — mais comme l’âme s’épuise quand rien ne la distrait de Dieu ! —
La fixité de mon adoration était effrayante ; je m’y décontenançais tout entier.
Tu chercherais encore longtemps, me dit Ménalque, le bonheur impossible des âmes…
— Les premiers temps de douteuse extase passés — mais avant d’avoir rencontré Ménalque — ce fut une période inquiète d’attente et comme une traversée de marais. Je sombrais en des accablements de sommeil dont dormir ne me guérissait pas. Je me couchais après les repas ; je dormais, je me réveillais plus las encore, l’esprit engourdi comme pour une métamorphose.
Obscures opérations de l’être, — travail latent, genèses d’inconnu, parturitions laborieuses — somnolences, attentes ; — commue les chrysalides et les nymphes, je dormais ; je laissais se former en moi le nouvel être, que je serais, qui ne me ressemblait déjà plus. Toute lumière me parvenait comme au travers de couches d’eaux verdies, à travers feuilles et ramures ; perceptions confuses, indolentes, analogues à celles des ivresses et des grands étourdissements. — Ah ! que vienne enfin, suppliais-je, la crise aiguë, la maladie, la douleur vive ! — Et mon cerveau se comparait aux ciels d’orage, de nuages pesants encombrés, où l’on respire à peine, où tout attend l’éclair pour déchirer ces outres fuligineuses, pleines d’humeur et cachant le ciel.
Combien durerez-vous, attentes ? et finies, nous restera-t-il de quoi vivre ? — Attentes ! attentes de quoi ? criais-je. — Que pouvait-il venir qui ne naîtrait pas de nous-mêmes ? Et que se pouvait-il de nous que nous ne connussions déjà ?
La naissance d’Abel, mes fiançailles, la mort d’Éric — le bouleversement de ma vie, loin de finir cette apathie, semblèrent m’y replonger davantage, tant il semblait que cette torpeur vînt de la complexité même de mes pensées, et de mes volontés indécises…… J’eusse voulu dormir, infiniment, dans l’humidité de la terre et comme une végétation. — Parfois je me disais que la volupté viendrait à bout de ma peine, et je cherchais dans l’épuisement de la chair une libération de l’esprit. — Puis de nouveau je dormais de longues heures, ainsi que les petits enfants que l’on couche au milieu du jour, assoupis de chaleur, dans la maison vivante.
Puis je me réveillais de très loin, en sueur, le cœur battant, la tête somnolente. La lumière qui s’infiltrait d’en bas, entre les fentes des volets clos, et renvoyait au plafond blanc les reflets verts de la pelouse, cette clarté du soir m’était la seule chose délicieuse, pareille à la clarté qui paraît douce et charmante, venue entre les feuilles et les eaux, et qui tremble, au seuil des grottes après qu’on a longtemps senti vous envelopper leurs ténèbres.
Les bruits de la maison arrivaient vaguement… je renaissais lentement à la vie. Je me lavais avec de l’eau tiède et j’allais plein d’ennui vers la plaine, jusqu’au banc du jardin où j’attendais venir le soir sans rien taire. Pour parler, pour écouter, pour écrire, j’étais perpétuellement fatigué. Je lisais :
« …… Il voit devant lui Les routes désertes. Les oiseaux de la mer qui se baignent, Étendant leurs ailes…… il faut que j’habite ici…… …… On me contraint à demeurer Sous les feuillages de la forêt ; Sous le chêne, dans cette caverne souterraine : Froide est cette maison de terre ; J’en suis tout lassé.
Obscurs sont les vallons Et hautes les collines Triste enceinte de rameaux Couverte de ronces, — Séjour sans joie. »|1|
Le sentiment d’une plénitude de vie, possible, mais non encore obtenue se laissait parfois percevoir, puis revenait après, puis de plus en plus obsédante. Ah ! qu’une baie de jour s’ouvre enfin, criais-je — qu’elle éclate au milieu de ces perpétuelles représailles !
Il semblait que tout mon être eût comme un immense besoin de se retremper dans le neuf. J’attendais une seconde puberté… Ah ! refaire à mes yeux une vision neuve, — les laver de la salissure des livres, les rendre plus pareils à l’azur qu’ils regardent — aujourd’hui complètement clarifié par les récentes pluies……
Je tombai malade ; je voyageai, je rencontrai Ménalque, et ma convalescence délicieuse me fut comme une palingénésie. Je renaquis avec un être neuf, sous un ciel neuf et au milieu de choses complètement renouvelées.
3
Nathanaël je te parlerai des attentes.
J’ai vu la plaine après l’été, attendre ; attendre un peu de pluie. La poussière des routes était devenue trop légère et chaque souffle la soulevait. Ce n’était même plus un désir ; c’était une appréhension. La terre se gerçait de sécheresse comme pour plus d’accueil de l’eau. Les parfums des fleurs de la lande devenaient presque intolérables. Sous le soleil tout se pâmait. Nous allions chaque après-midi nous reposer sous la terrasse, abrités un peu de l’extraordinaire éclat du jour. C’était le temps où les arbres à cônes chargés de pollen agitent aisément leurs branches pour répandre au loin leur fécondation. Le ciel s’était chargé d’orage et toute la nature attendait. L’instant était d’une solennité trop oppressante, car tous les oiseaux s’étaient tus. Il monta de la terre un souffle si brûlant que l’on crut défaillir, et le pollen des conifères sortit comme une fumée d’or des branches. — Puis il plut.
J’ai vu le ciel frémir de l’attente de l’aube. Une à une les étoiles se fanaient. Les prés étaient inondés de rosée ; l’air n’avait que des caresses glaciales. Il sembla quelque temps que l’indistincte vie voulût s’attarder au sommeil, et ma tête encore lassée s’emplissait de torpeur. Je montai jusqu’à la lisière du bois ; je m’assis ; chaque bête reprit son travail et sa joie dans la certitude que le jour va venir, et le mystère de la vie recommença de s’ébruiter par chaque échancrure des feuilles. — Puis le jour vint.
J’ai vu d’autres aurores encore. — J’ai vu l’attente de la nuit.
Nathanaël, que chaque attente, en toi, ne soit même pas un désir — mais simplement une disposition à l’accueil. — Attends tout ce qui vient à toi — mais ne désire que ce qui vient à toi. — Ne désire que ce que tu as… Comprends qu’à chaque instant du jour tu peux posséder Dieu dans sa totalité. — Que ton désir soit de l’amour, et que ta possession soit amoureuse… car qu’est ce qu’un désir qui n’est pas efficace ?
Eh ! quoi, Nathanaël, tu possèdes Dieu et tu ne t’en étais pas aperçu ! — Posséder Dieu c’est le voir ; mais on ne le regarde pas. Au détour d’aucun sentier, Balaam, n’as-tu vu Dieu, devant qui s’arrêtait ton âne ? — parce que toi tu te l’imaginais autrement. — Mais, Nathanaël, il n’y a que Dieu que l’on ne puisse pas attendre. — Attendre Dieu, Nathanaël, c’est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà. — Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l’instant.
J’ai porté tout mon bien en moi, comme les femmes de l’Orient pâle sur elles leur complète fortune. À chaque petit instant de ma vie, j’ai pu sentir en moi la totalité de mon bien. Il était fait, non par l’addition de beaucoup de choses particulières, mais par leur unique adoration. J’ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir.
Regarde le soir comme si le jour y devait mourir ;
Et le matin comme si toute chose y naissait.
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle.
Le sage est celui qui s’étonne de tout.
Toute ta fatigue de tête vient, ô Nathanaël, de la diversité de tes biens. Tu ne sais même pas lequel entre tous tu préfères et tu ne comprends pas que l’unique bien c’est la vie. Le plus petit instant de vie est plus fort que la mort, et la nie. La mort n’est que la permission d’une autre vie — pour que tout soit sans cesse renouvelé — afin qu’aucune forme de vie ne détienne cela plus de temps qu’il ne lui en faut pour se dire. Heureux l’instant où ta parole retentit. Tout le reste du temps écoute — mais quand tu parles, n’écoute plus.
Il faut, Nathanaël, que tu brûles en toi tous les livres.
RONDE
POUR ADORER CE QUE J’AI BRÛLÉ
―――――
Il y a des livres qu’on lit, assis sur des petites planchettes :
Devant un pupitre d’écolier. Il y a des livres qu’on lit en marche (Et c’est aussi à cause de leur format) ; Tels sont pour les forêts, tels pour d’autres campagnes,Et nobiscum rusticantur, dit Cicéron. Il y en a que je lus en diligence ;D’autres couché au fond des greniers à foin. Il y en a pour faire croire qu’on a une âme ; D’autres pour la désespérer. Il y en a où l’on prouve l’existence de Dieu ; D’autres où l’on ne peut pas y arriver.Il y en a que l’on ne saurait admettre Que dans les bibliothèques privées ; Il y en a qui ont reçu les éloges De beaucoup de critiques autorisés. Il y en a où il n’est question que d’apiculture Et que certains trouvent un peu spéciaux ; D’autres où il est tellement question de la nature Qu’après ce n’est plus la peine de se promener. Il y en a que méprisent les sages hommes Mais qui excitent les petits enfants. Il y en a qu’on appelle les anthologies Et où l’on a mis tout ce qu’on a dit de mieux sur n’importe quoi. Il y en a qui voudraient vous faire aimer la vie ; D’autres après lesquels l’auteur s’est suicidé.
Il y en a qui sèment la haine Et qui récoltent ce qu’ils ont semé. Il y en a qui lorsqu’on les lit semblent luire Chargés d’extase, délicieux d’humilité. Il y en a que l’on chérit comme des frères Plus purs et qui ont vécu mieux que nous. Il y en a dans d’extraordinaires écritures Et qu’on ne comprend pas, même quand on les a beaucoup étudiées.
Nathanaël ! quand aurons-nous brûlé tous les livres !
Il y en a qui ne valent pas quatre sous ; D’autres qui valent des prix considérables. Il y en a qui parlent de rois et de reines ; Et d’autres de très pauvres gens. Il y en a dont les paroles sont plus douces Que le bruit des feuilles à midi. C’est un livre que mangea Jean à Patmos, Comme un rat, — mais moi j’aime mieux les framboises — Ça lui a rempli d’amertume les entrailles Et après il a eu beaucoup de visions.
Nathanaël ! quand aurons-nous brûlé tous les livres !!
Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux ; je veux que mes pieds nus le sentent. Toute connaissance que n’a pas précédé une sensation m’est inutile.
Je n’ai jamais rien vu de doucement beau dans ce monde, sans désirer aussitôt que toute ma tendresse le touche. Amoureuse beauté de la terre, l’effloraison de ta surface est merveilleuse ! — Ô paysage où mon désir s’est enfoncé ! Pays ouvert où ma recherche se promène ; — allée de papyrus qui se referme sur de l’eau ; roseaux courbés sur la rivière ; ouvertures des clairières ; apparition de la plaine dans l’embrasure des branchages, de la promesse illimitée. Je me suis promené dans les couloirs de roches ou de plantes. J’ai vu se dérouler des printemps. — volubilité des phénomènes.
Dès ce jour, chaque instant de ma vie prit pour moi la saveur de nouveauté d’un don absolument ineffable. Ainsi je vécus dans une presque perpétuelle stupéfaction passionnée. J’arrivais très vite à l’ivresse et me plus à marcher dans une sorte d’étourdissement.
*
Certes, tout ce que j’ai rencontré de rire sur les lèvres, j’ai voulu l’embrasser ; de sang sur les joues, de larmes dans les yeux, j’ai voulu le boire ; mordre à la pulpe de tous les fruits que vers moi penchèrent des branches. À chaque auberge me saluait une faim ; devant chaque source m’attendait une soif — une soif, devant chacune, particulière ; — et j’aurais voulu d’autres mots pour marquer mes autres désirs
de marche où s’ouvrait une route ;
de repos où l’ombre invitait ;
de nage au bord des eaux profondes ;
d’amour ou de sommeil au bord de chaque lit.
J’ai porté hardiment ma main sur chaque chose et me suis cru des droits sur chaque objet de mes désirs. — (Et d’ailleurs, ce que nous souhaitons, Nathanaël, ce n’est point tant la possession que l’amour.) Devant moi, ah ! que toute chose s’irise ; que toute beauté se revête, se diapre de mon amour.
LIVRE II
NOURRITURES !
Je m’attends à vous, nourritures !
Ma faim ne se posera pas à mi-route ;
Elle ne se taira que satisfaite ;
Des morales n’en sauraient venir à bout
Et de privations je n’ai jamais pu nourrir que mon âme.
Satisfactions ! je vous cherche.
Vous êtes belles comme les aurores d’été.
Sources plus délicates au soir, délicieuses à midi ; eaux du petit matin glacées ; souffles au bord des flots ; golfes encombrés de mâtures ; tiédeur des rives cadencées. Ô ! s’il est encore des routes vers la plaine ; les touffeurs de midi ; les breuvages des champs, et pour la nuit le creux des meules…… s’il est des routes vers l’orient, des sillages sur les mers aimées ; des jardins à Mossoul ; des danses à Touggourt ; des chants de pâtre en Helvétie ; — s’il est des routes vers le Nord ; des foires à Nijni ; des traîneaux soulevant la neige ; des lacs gelés…… Certes, Nathanaël, ne s’ennuieront pas nos désirs……
Des bateaux sont venus dans nos ports apporter les fruits nus de plages irrêvées… allons ! allons ! déchargez-les de leur faix un peu vite, que nous puissions enfin y goûter……
Nourritures ! je m’attends à vous, nourritures !
Satisfactions, je vous cherche.
Vous êtes belles comme les rires de l’été.
Je sais que je n’ai pas un désir
Qui n’ait déjà sa réponse apprêtée,
Chacune de mes faims attend sa récompense.
Nourritures ! je m’attends à vous, nourritures !
Par tout l’espace je vous cherche, satisfactions de tous mes désirs.
*
Ce que j’ai connu de plus beau sur la terre
ah ! Nathanaël ! c’est ma faim.
Elle a toujours été fidèle
à tout ce qui toujours l’attendait.
Est-ce de vin que se grise le rossignol ?
L’aigle, de lait ? — ou non point de genièvre les grives ?
— L’aigle se grise de son vol. Le rossignol s’enivre des nuits d’été. La plaine tremble de chaleur. Nathanaël, que toute émotion sache te devenir une ivresse. Si ce que tu manges ne te grise pas, c’est que tu n’avais pas assez faim.
Chaque action parfaite s’accompagne de volupté. À cela tu connais que tu devais la faire. — Je n’aime point ceux qui se font un mérite d’avoir péniblement œuvré. Car si c’était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. La joie que l’on y trouve est signe de l’appropriation du travail et la sincérité de mon plaisir, Nathanaël, m’est le plus important des guides.
Je sais ce que mon corps peut désirer de volupté chaque jour et ce que ma tête en supporte. Et puis commencera mon sommeil. Terre et ciel ne me valent plus rien au delà.
⁂
Il y a des maladies extravagantes Qui consistent à vouloir ce que l’on n’a pas.
— Nous aussi, dirent-ils, nous aussi. Nous aurons connu le lamentable ennui de notre âme…… — De la caverne d’Adullam, tu soupirais, David, après l’eau des citernes. Tu disais : Ô ! qui m’apportera l’eau fraîche qui jaillit du pied des murs de Bethléem. Enfant, je m’y désaltérais ; mais maintenant elle est captive, cette eau que ma fièvre désire……
Ne désire jamais, Nathanaël, regoûter les eaux du passé.
Nathanaël, ne cherche pas, dans l’avenir, à retrouver jamais le passé. Saisis de chaque instant sa nouveauté irressemblable et ne prépare pas tes joies — ou sache qu’en son lieu préparé te surprendra une joie autre.
Que n’as-tu donc compris que tout bonheur est de rencontre et se présente à toi dans chaque instant comme un mendiant sur ta route. Malheur à toi si tu dis que ton bonheur est mort parce que tu n’avais pas rêvé pareil à cela ton bonheur — et que tu ne l’admets que conforme à tes vœux.
Le rêve de demain est une joie — mais la joie de demain en est une autre — et rien heureusement ne ressemble au rêve qu’on s’en était fait, car c’est différemment que vaut chaque chose.
Je n’aime pas que vous me disiez : viens, je t’ai préparé telle joie ; je n’aime plus que les joies de rencontre, et celles que ma voix fait jaillir du rocher ; — elles couleront ainsi pour nous, neuves et fortes, comme les vins nouveaux abondent du pressoir.
Je n’aime pas que ma joie soit parée, ni que la Sulamite ait passé par des salles ; pour l’embrasser je n’ai pas essuyé de ma bouche les taches que les grappes avaient laissées ; après les baisers, j’ai bu du vin doux sans avoir rafraîchi ma bouche — et j’ai mangé du miel de ruche avec sa cire.
Nathanaël, n’apprête aucune de tes joies.
⁂
Où tu ne peux pas dire tant mieux, dis : tant pis. Nathanaël, il y a là de grandes promesses de bonheur.
Il y en a qui regardent les instants de bonheur comme donnés par Dieu — et les autres comme donnés par Qui d’autre ?…
Nathanaël, ne distingue pas Dieu de ton bonheur.
— Je ne peux pas plus être reconnaissant à « Dieu » de m’avoir créé que je ne pourrais lui en vouloir de ne pas être, — si je n’étais pas.
Nathanaël, il ne faut parler de Dieu que naturellement.
Je veux bien que l’existence une fois admise, celle de la terre et de l’homme et de moi paraisse naturelle, mais ce qui confond mon intelligence, c’est la stupeur de m’en apercevoir…
Certes j’ai chanté moi aussi des cantiques et j’ai écrit la
RONDEDES BELLES PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU
Nathanaël, je t’enseignerai que les plus beaux mouvements poétiques sont ceux sur les mille et une preuves de l’existence de Dieu. Tu comprends n’est-ce pas qu’il ne s’agit pas ici de les redire, ni surtout de les redire simplement ; — et puis il y en a qui ne prouvent que l’existence — et ce qu’il nous faut c’est aussi sa permanéité.
Je sais bien, ah ! oui, qu’il y a l’argument de Saint-Anselme.
Et l’apologue des parfaites îles Fortunées. —
Mais hélas ! hélas, Nathanaël, tout le monde ne peut pas y habiter.
Je sais qu’il y a l’assentiment du plus grand nombre. —
Mais tu crois, toi, au petit nombre des élus.
Il y a bien la preuve par deux et deux font quatre. —
Mais, Nathanaël, tout le monde ne sait pas bien calculer.
Il y a la preuve du premier moteur,
À cause de celui qui était encore avant celui-là ;
Nathanaël, c’est fâcheux que nous n’ayons pas été là. —
On aurait vu créer l’homme et la femme ;
Eux s’étonner de n’être pas nés petits enfants ;
Les cèdres de l’Elbrouz fatigués d’être nés déjà séculaires.
Et sur des monts déjà ravinés par les eaux.
— Nathanaël ! avoir été là pour l’aurore ! — par quelle paresse n’étions-nous pas déjà levés ? — Est-ce que toi tu ne demandais pas à vivre ? — ah ! moi je le demandais certainement… Mais dans ce temps, l’esprit de Dieu s’éveillait à peine, après avoir dormi hors du temps, sur les eaux. — Si j’eusse été là, Nathanaël, je lui eusse demandé de faire tout un peu plus vaste — et ne me réponds pas, toi, qu’alors rien ne s’en serait aperçu|2|.
… Il y a la preuve par les causes finales
Mais tous ne trouvent pas que la fin justifie les moyens.
Il y en a qui prouvent Dieu par l’amour que l’on sent pour lui. — Voilà pourquoi, Nathanaël, pour moi j’ai nommé Dieu tout ce que j’aime, et que j’ai voulu tout aimer. — Ne crains pas que je t’énumère…… d’ailleurs je ne commencerais pas par loi ; j’ai préféré bien des choses aux hommes et ce ne sont pas eux que j’ai surtout aimés sur la terre… Car ne t’y méprends pas, Nathanaël, ce que j’ai de plus fort en moi, ce n’est certes pas la bonté, — ni je crois non plus de meilleur — et ce n’est pas non plus la bonté que j’estime surtout chez les hommes. Nathanaël, préfère-leur ton Dieu… Moi aussi j’ai su louer Dieu, j’ai chanté pour Lui des cantiques, — et je crois même ce faisant l’avoir parfois un peu surfait.
―――――
« Cela t’amuse-t-il tant, me dit-il, d’édifier ainsi des systèmes ? »
— « Rien ne m’amuse plus, répondis-je, et je m’y contente l’esprit.
Je ne goûte pas une joie que je ne l’y veuille attachée. »
— « Cela l’augmente-t-il ? »
— « Non, dis-je, cela me la légitime. »
Certes, il m’a plu souvent qu’une doctrine et même qu’un système complet de pensées ordonnées justifiât à moi-même mes actes ; mais parfois je ne l’ai pu considérer que comme l’abri de ma sensualité.
⁂
Toute chose vient en son temps, Nathanaël, et chacune naît de son besoin, et n’est pour ainsi dire qu’un besoin extériorisé.
J’avais besoin d’un poumon, m’a dit l’arbre ; alors ma sève est devenue feuille, afin d’y pouvoir respirer. Puis quand j’eus respiré, ma feuille est tombée, et je n’en suis pas mort… Mon fruit contient toute ma pensée sur la vie.
Nathanaël, ne crains pas que j’abuse de cette forme d’apologue, car je ne l’approuve pas beaucoup. Je ne veux t’enseigner d’autre sagesse que la vie. Car c’est un grand souci que de penser. Je me suis fatigué quand j’étais jeune à suivre au loin les suites de mes actes et je n’étais sûr de ne plus pécher qu’à force de ne plus agir.
Puis j’écrivis : Je ne dus le salut de ma chair qu’à l’irrémédiable empoisonnement de mon âme — puis je ne compris plus du tout ce que j’avais voulu dire par là.
Nathanaël — je ne crois plus au péché.
Mais tu comprendras que ce n’est qu’avec beaucoup de joie qu’un peu de droit à la pensée s’achète. — L’homme qui se dit heureux et qui pense, celui-là sera appelé vraiment fort.
⁂
Nathanaël, le malheur de chacun vient de ce que c’est toujours chacun qui regarde et qu’il s’importe toujours plus que les choses. Ce n’est pas pour nous, c’est pour elle que chaque chose est importante. Que ton œil soit la chose regardée.
… Nathanaël ! je ne peux plus commencer un seul vers, sans que ton nom délicieux y revienne…
Nathanaël, je voudrais te faire naître à la vie…
Nathanaël — est-ce que tu comprends assez le pathétique de mes paroles ? — Je voudrais m’approcher de toi plus encore…
Et, comme, pour le ressusciter, Élisée, sur le fils de la Sulamite — « la bouche sur sa bouche, et les yeux sur ses yeux — et les mains sur ses mains s’étendit » — mon grand cœur rayonnant contre ton âme encore ténébreuse, m’étendre sur toi tout entier, ma bouche sur ta bouche, et mon front sur ton front, tes mains froides dans mes mains brûlantes, et mon cœur palpitant… « Et la chair de l’enfant se réchauffa », est-il écrit… Afin que dans la volupté tu t’éveilles — puis me laisses — pour une vie palpitante et déréglée. — Nathanaël, voici toute la chaleur de mon âme… emporte-la. Nathanaël, je veux t’apprendre la ferveur.
Nathanaël — car ne demeure pas auprès de ce qui te ressemble ; — ne demeure jamais, Nathanaël. — Dès qu’un environ a pris ta ressemblance, ou que toi tu t’es fait semblable à l’environ — il n’est plus pour toi profitable. Il faut le quitter. Rien n’est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé…… Ne prends de chaque chose que leur éducation ; et que la volupté qui te vient d’elles te les épuise.
Nathanaël, je te parlerai des instants… As-tu compris de quelle force est leur présence ?… Une pas assez constante pensée de la mort n’a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie… Et ne comprends-tu pas que chaque instant ne prendrait pas cet éclat admirable, sinon détaché pour ainsi dire sur le fond très obscur de la mort ?
— Je ne chercherais plus à rien faire, s’il m’était dit, s’il m’était prouvé, que j’ai pour cela tout le temps ; — je me reposerais d’abord d’avoir voulu commencer quelque chose, ayant le temps de faire aussi toutes les autres. Ce que je ferais ne serait jamais que n’importe quoi… s’il m’était prouvé que, au moins, cette forme de vie ne devait finir — et que je ne m’en reposerai pas, l’ayant finie, dans un sommeil un peu plus profond, un peu plus oublieux que celui que j’attends chaque nuit…
*
Et je pris ainsi l’habitude de séparer chaque instant de ma vie, pour une totalité de joie, isolée — pour y concentrer subitement toute une particularité de bonheur… tellement, que je ne me reconnaissais plus dès le plus voisin souvenir.
*
Il y a un grand plaisir, Nathanaël, à déjà tout simplement affirmer :
Le fruit du palmier s’appelle datte — et c’est un mets délicieux.
Le vin du palmier s’appelle lagmy ; c’en est la sève fermentée ; les Arabes s’en grisent et je ne l’aime pas beaucoup. C’est une coupe de lagmy que m’offrit ce berger de chèvres dans les beaux jardins de Ouardi.
· · · · · · ·
— J’ai trouvé ce matin, dans une allée des Sources, m’y promenant, un champignon étrange.
C’était, enveloppé d’une gaine blanche, comme un fruit de magnolia rouge-orange, avec de réguliers dessins gris de cendre qu’on comprenait formés de poussière sporagineuse, issue de l’intérieur. Je l’ouvris ; il était plein d’une matière boueuse, au centre formant gelée claire ; il en sortait une nauséabonde odeur.
Autour de lui, d’autres plus ouverts n’étaient plus que comme ces fongosités aplaties qu’on voit sur le tronc des vieux arbres.
— (J’écrivais cela avant de partir pour Tunis — et je te le copie ici pour te montrer quelle importance prenait pour moi chaque chose aussitôt que je la regardais. )
Honfleur, (dans la rue.)
Et par moments il me semblait que les autres, autour de moi, ne s’agitaient que pour augmenter en moi le sentiment de ma vie personnelle.
Hier j’étais ici — aujourd’hui je suis là Mon Dieu ! que me font tous ceux là Qui disent, qui disent, qui disent : Hier j’étais ici, aujourd’hui je suis là…
Je sais des jours où me répéter que deux et deux faisaient encore quatre suffisait à m’emplir d’une certaine béatitude — et la seule vue de mon poing sur la table…
et d’autres jours où cela m’était complètement égal.
LIVRE III
Villa Borghèse.
Dans cette vasque…… (pénombre)…… chaque goutte, chaque rayon, chaque être, s’y mourait avec volupté.
Volupté ! Ce mot je voudrais le redire sans cesse ; je le voudrais synonyme de bien-être et même qu’il suffit de dire être, simplement.
Ah ! que Dieu n’ait pas créé le monde en vue simplement de cela, c’est ce qu’on ne pourrait comprendre qu’en se disant…… : etc.
*
… C’est un lieu de fraîcheurs exquises, où le charme de dormir est si grand qu’il semblait jusqu’alors inconnu,
… Et là, des nourritures délicieuses attendaient que nous en eussions faim.
Adriatique, (3 h. du matin).
Le chant de ces marins dans les cordages m’importune……
Ô ! si tu savais, si tu savais, terre excessivement vieille et si jeune, le goût amer et doux, le goût délicieux qu’a la vie si brève de l’homme……
Si tu savais, éternelle idée de l’apparence, ce que la proche attente de la mort donne de valeur à l’instant !
Ô ! printemps, les plantes qui ne vivent qu’un an, ont leurs fragiles fleurs plus pressées ; — l’homme n’a qu’un printemps dans la vie et le souvenir d’une joie n’est pas une nouvelle approche du bonheur.
Colline de Fiesole.
Belle Florence, ville d’étude grave, de luxe et de fleurs ; surtout sérieuse ; grain de myrte et couronne de « svelte laurier ».
Colline de Vincigliata. Là j’ai vu pour la première fois les nuages, dans l’azur, se dissoudre ; je m’en étonnai beaucoup ne pensant pas qu’ils pussent ainsi se résorber dans le ciel — croyant qu’ils duraient jusqu’à la pluie et ne pouvaient que se grossir. Mais non : j’en observais tous les flocons un à un disparaître ; — il ne restait plus que de l’azur. C’était une mort merveilleuse ; un évanouissement en plein ciel.
Rome, Monte Pincio.
Ce qui fit ma joie ce jour là, c’est quelque chose comme l’amour — et ce n’est pas l’amour — ou du moins pas celui dont parlent et que cherchent les hommes. — Et ce n’est pas non plus le sentiment de la beauté. Il ne venait pas d’une femme ; il ne venait pas non plus de ma pensée. Écrirai-je, et me comprendras-tu si je dis que ce n’était là que la simple exaltation de la LUMIÈRE ?
J’étais assis dans ce jardin ; je ne voyais pas le soleil ; mais l’air brillait de lumière diffuse — comme si l’azur du ciel devenait liquide et pleuvait. Oui vraiment, il y avait des ondes, des remous de lumière ; sur la mousse des étincelles comme des gouttes ; oui vraiment, dans cette grande allée on eût dit qu’il coulait de la lumière, et des écumes dorées restaient au bout des branches de ce ruissellement de rayons.
.......
Naples, petite boutique du coiffeur devant la mer et le soleil. Quais de chaleur ; stores qu’on soulève pour entrer. On s’abandonne ; est-ce que cela va durer longtemps ; quiétude ; gouttes de sueur aux tempes ; frisson de la mousse de savon sur les joues. Et lui qui raffine après qu’il a rasé, rase encore avec un rasoir plus habile et s’aidant à présent d’une petite éponge imbibée d’eau tiède, qui mollit la peau, relève la lèvre… Puis avec une douce eau parfumée il lave la brûlure laissée ; puis avec un onguent, calme encore… et pour ne pas bouger encore, je me fais couper les cheveux.
Amalfi, (dans la nuit).
Il y a des attentes nocturnes d’on ne sait encor quel amour.
Petite chambre au-dessus de la mer ; m’a réveillé la trop grande clarté de la lune, de la lune au-dessus de la mer.
Quand je m’approchai de la fenêtre, je croyais que c’était l’aube et que j’allais voir se lever le soleil… Mais non… (chose déjà pleine et parfaitement accomplie) — la lune — douce, douce, douce comme pour l’abord d’Hélène au second Faust ; mer déserte ; village mort. Un chien hurle dans la nuit… loques pendant à des fenêtres.
Pas de place pour l’homme. Ne plus comprendre comment tout cela va se réveiller. Désolation excessive du chien. Le jour n’aura plus lieu. Impossibilité de dormir. Est-ce que tu feras… : (ceci ou cela) : sortiras-tu dans le jardin désert ? — descendras-tu vers la plage, t’y laver ? — iras-tu cueillir des oranges, qui semblent grises sous la lune… ? d’une caresse consoleras-tu le chien ? — (Tant de fois j’ai senti la nature réclamer de moi un geste, et je n’ai pas su lequel lui donner)… Attendre le sommeil qui ne va pas venir…
.......
Un enfant est entré dans ce jardin, s’accrochant à la branche qui frôlait l’escalier ; l’escalier menait à des terrasses ; longeant ce jardin ; l’on n’y paraissait pas pouvoir entrer.
Ô ! petite figure que j’ai caressée sous les feuilles — jamais assez d’ombre n’aura pu ternir ton éclat — et l’ombre des boucles sur ton front paraît toujours encor plus sombre.
Je descendrai dans ce jardin, me pendant aux lianes et aux branches — et sangloterai de tendresse sous ces bosquets plus pleins de chants qu’une volière — jusqu’à l’approche du soir, jusqu’à l’annonce de la nuit qui dorera, puis approfondira l’eau mystérieuse des fontaines.
… Et les corps délicats épousés sous les branches. … J’ai touché d’un doigt délicat sa peau nacrée… Je voyais ses pieds délicats Qui posaient sans bruit sur le sable…
―――――
Syracuse.
Barque à fond plat ; ciel bas, qui parfois baissait jusqu’à nous en pluie tiède ; — odeur de vase des plantes d’eau, froissement des tiges.
La profondeur de l’eau dissimule l’abondant jaillissement de cette source bleue. Aucun bruit ; c’est, dans cette campagne solitaire, dans cette naturelle vasque creusée, comme une éclosion
d’eau entre les papyrus.
Tunis.
Dans tout l’azur, rien que ce qu’il fallait de blanc pour une voile, — de vert pour son ombre dans l’eau.
La nuit — Bagues qui luisent dans l’ombre — Clartés de la lune où l’on erre. Pensées différentes de celles du jour.
Néfaste clarté de la lune au désert. — Les démons rôdeurs des cimetières ; — pieds nus sur les dalles bleues.
Malte.
Extraordinaire ivresse des crépuscules d’été sur les places, quand il fait encore très clair, et que pourtant on n’a plus d’ombres. — Exaltation très spéciale.
Nathanaël, je te dirai tous les jardins que j’ai vus :
À Florence on vendait des roses : certains jours la ville entière embaumait. Je me promenais chaque soir aux Cascine et le dimanche aux jardins Boboli sans fleurs.
À Séville, il y a, près de la Giralda, une ancienne cour de mosquée ; des orangers y poussent par places régulières ; le reste de la cour est dallé ; les jours de grand soleil, on n’y a qu’une petite ombre restreinte ; c’est une cour carrée, entourée de murs ; elle est d’une grande beauté ; je ne sais pas t’expliquer pourquoi.
Hors de la ville, dans un énorme jardin clos de grilles, croissent beaucoup d’arbres des pays chauds ; je n’y suis pas entré, mais, à travers les grilles, j’ai regardé ; j’ai vu courir des pintades et j’ai pensé qu’il y avait là beaucoup d’animaux apprivoisés.
Que te dirai-je de l’Alcazar ? jardin semblant de merveille persane ; je crois, en t’en parlant, que je le préfère à tous. J’y pense en relisant Hafiz :
« Apportez-moi du vin — Que je tache ma robe ! — Car je chancelle d’amour — Et l’on m’appelle sage… »
Des jeux d’eaux sont préparés dans les allées ; les allées sont dallées de marbre, bordées de myrtes et de cyprès. Des deux côtés sont des bassins de marbre, où les courtisanes du roi se lavaient. On n’y voit d’autres fleurs que des roses, des narcisses et des fleurs de laurier. Au fond du jardin, il y a un arbre gigantesque, où l’on se figure un bulbul épinglé. Près du palais, d’autres bassins de très mauvais goût rappellent ceux des cours de la Présidence à Munich, où il y a des statues faites tout en coquilles.
C’est dans les jardins royaux de Munich que j’allais, un printemps, goûter les glaces à l’herbe de mai, près d’une obstinée musique militaire. Un public inélégant, mais mélomane. — Le soir s’enchantait de pathétiques rossignols. Leur chant m’alanguissait, comme d’une poésie allemande. — Il est une certaine intensité de délices que l’homme peut à peine dépasser — et non sans larmes. Les délices mêmes de ces jardins me faisaient presque douloureusement songer que j’aurais aussi bien pu être ailleurs. — C’est pendant cet été que j’appris à jouir plus particulièrement des températures. Les paupières sont admirablement aptes à cela. Je me souviens d’une nuit en wagon que je passai devant la fenêtre ouverte, uniquement à goûter l’attouchement du souffle plus frais ; je fermais les yeux, non pour dormir, mais pour cela. La chaleur avait été durant tout le jour étouffante et, ce soir, l’air encore très tiède pourtant parut frais et comme liquide à mes paupières enflammées.
À Grenade, les terrasses du Généraliffe, plantées de lauriers roses, n’étaient pas fleuries lorsque je les vis ; — ni le Campo Santo de Pise ; ni le petit cloître de Saint-Marc, que j’aurais souhaité plein de roses… Mais à Rome, le Monte Pincio, je l’ai vu dans la plus belle saison ; durant les après-midi accablantes, on y venait chercher de la fraîcheur. Demeurant auprès, je m’y promenais chaque jour. J’étais malade et ne pouvais penser à rien ; la nature me pénétrait ; aidé par un trouble des nerfs, je ne sentais parfois plus à mon corps de limites ; il se continuait plus loin ; ou parfois, voluptueusement, devenait poreux comme un sucre ; je fondais. — Du banc de pierre où j’étais assis, l’on cessait de voir Rome qui m’exténuait ; on dominait les jardins Borghèse, dont le contrebas mettait au niveau de mes pas les cimes un peu lointaines des plus hauts pins… ô terrasses ! terrasses, d’où l’espace s’est élancé. Le vent sur les ramures dominées… ô ! navigation aérienne…
J’aurais voulu, la nuit, rôder dans les jardins Farnèse ; mais on n’y laisse pas pénétrer…
Admirables végétations sur ces ruines dissimulées.
À Naples, il y a des jardins bas qui suivent la mer comme un quai et laissent entrer le soleil.
À Nîmes, la Fontaine, pleine d’eaux claires canalisées.
À Montpellier, le jardin botanique. Je me souviens qu’avec Ambroise, un soir, comme aux jardins d’Académus, nous nous assîmes sur une tombe ancienne, qui y est tout entourée de cyprès ; et nous causions lentement en mâchant des pétales de roses.
Nous avons, une nuit, vu du Pérou, la mer lointaine et que la lune argentait ; auprès de nous s’ébruitaient les cascades du château d’eau de la ville ; des cignes noirs frangés de blanc nageaient sur le bassin calmé.
À Malte, dans les jardins du résident je vins lire ; il y avait à Citta Vecchia un bois très petit de citronniers ; on l’appelait « il Boschetto » ; nous nous y plûmes ; et nous mordîmes des citrons mûrs, dont la saveur première est d’une acidité intolérable, mais qui laisse après dans la bouche un arôme rafraîchissant. Nous en avons mordu aussi dans les cruelles Latomies de Syracuse.
Dans le parc de La Haye circulent des daims point trop sauvages.
Du jardin d’Avranches on voit le Mont-Saint-Michel, et les sables lointains, au soir, semblent une matière embrasée. — Il y a de très petites villes qui ont des jardins charmants ; on oublie la ville ; on oublie son nom ; on souhaite revoir le jardin, mais on ne sait plus y revenir.
Je rêve aux jardins de Mossoul ; on m’a dit qu’ils sont pleins de roses. Ceux de Kashpur, Omar les a chantés, et Hafiz les jardins de Shiraz ; nous ne verrons pas les jardins de Nashpur.
Mais à Biskra je connais les jardins de Ouardi. Des enfants y gardent les chèvres.
À Tunis, il n’y a pas d’autre jardin que le cimetière. À Alger, au jardin d’essai (des palmiers de toute espèce) j’ai mangé des fruits que je n’avais avant jamais vus. — Et de Blidah ! Nathanaël, que dirai-je ?
Ah ! douce est l’herbe du Sahel ; — et tes fleurs d’orangers ! et tes ombres ! suaves les odeurs de tes jardins… Blidah ! Blidah ! petite rose ! — au début de l’hiver, je t’avais méconnue. Ton bois sacré n’avait de feuilles que celles qu’un printemps ne renouvelle pas ; et tes glycines et tes lianes semblaient des sarments pour la flamme. La neige descendue de tes montagnes t’approchait ; je ne pouvais me réchauffer dans ma chambre, et moins dans tes jardins pluvieux. Je lisais la Doctrine de la Science de Fichte et me sentais redevenir religieux. J’étais doux ; je disais qu’il faut se résigner à sa tristesse et je tâchais de faire de tout cela de la vertu. — Maintenant j’ai secoué là-dessus la poussière de mes sandales ; qui sait où le vent l’a portée ? — poussière du désert où j’ai rôdé comme un prophète ; — pierre trop aride effritée ; — à mes pieds elle fut brûlante (car le soleil l’avait énormément chauffée). — Dans l’herbe du Sahel, à présent, que mes pieds se reposent ! Que toutes nos paroles soient d’amour !
Blidah ! Blidah ! fleur du Sahel ! petite rose ! Je t’ai vue tiède et parfumée, pleine de feuilles et de roses. La neige de l’hiver avait fui. Dans ton jardin sacré luisait mystiquement ta mosquée blanche et la liane ployait sous les fleurs. Un olivier disparaissait sous les guirlandes qu’une glycine lui faisait. L’air suave apportait le parfum qui s’élevait des fleurs d’oranges et même les mandariniers grêles embaumaient. Du plus haut de leurs hautes branches les eucalyptus délivrés laissaient tomber leur vieille écorce ; elle pendait, protection usée, comme un habit que le soleil fait inutile, comme ma vieille morale qui ne valait que pour l’hiver.
Blidah.
Les tiges énormes du fenouil, (l’éclat de leur floraison d’or verdi, sous la lumière d’or ou sous les feuilles azurées des eucalyptus immobiles) — ce matin de premier été, sur la route que nous suivons dans le Sahel, elles étaient d’une splendeur incomparable.
… Et les eucalyptus étonnés ou tranquilles.
— Participation de chaque chose à la nature ; impossibilité d’en sortir. Lois physiques enveloppantes. Wagon s’élançant dans la nuit ; au matin il se couvre de rosée.
À bord.
… Que de nuits, ah ! vitre ronde de ma cabine, hublot fermé, — que de nuits j’ai regardé vers toi de ma couchette en me disant : Voici, quand cet œil blanchira, ce sera l’aube ; alors je me lèverai et je secouerai mon malaise ; et l’aube lavera la mer ; et nous aborderons à la terre inconnue. — L’aube est venue sans que la mer en soit calmée, la terre était encore lointaine et sur la face mobile des eaux chancelait toute ma pensée.
Le malaise des flots dont toute la chair se souvient. — Accrocherai-je une pensée à cette hune vacillante ? pensai-je. Lames, ne verrai-je que l’eau s’éparpiller au vent du soir ? — Je sème mon amour sur la vague ; ma pensée sur la stérile plaine des flots. — Mon amour plonge dans les flots, qui se suivent et se ressemblent. Ils passent et l’œil ne les reconnaît plus. — Mer informe et toujours agitée ; loin des hommes, tes flots se taisent ; rien ne s’oppose à leur fluidité ; mais nul ne peut entendre leur silence ; sur la plus frêle chaloupe, déjà se heurtent-ils, et leur bruit nous fait croire que la tempête en est bruyante. Les grandes vagues avancent et se succèdent sans aucun bruit. Elles se suivent, et chacune soulève à son tour la même goutte d’eau, sans presque la déplacer. Seule leur forme se promène ; l’eau se prête, et les quitte, et ne les accompagne jamais. Toute forme ne prend que pour bien peu d’instants le même être ; à travers chacun, elle continue, puis le laisse. Mon âme ! ne t’attache à aucune pensée. Jette chaque pensée au vent du large qui te l’enlève ; tu ne la porteras jamais toi-même jusqu’aux cieux.
Mobilité des flots, c’est vous qui fîtes ma si chancelante pensée ! tu ne bâtiras rien sur la vague. Elle s’échappe sous chaque poids.
Le doux port viendra-t-il, après ces décourageantes dérives, ces errements de ci, de là ? — où mon âme enfin reposée, sur une solide jetée, près du phare tournant — regardera la mer.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
LIVRE IV
1
Dans un jardin — sur la colline de Florence,
(celle qui fait face à Fiesole) — où nous
étions ce soir assemblés :
Mais vous ne savez pas — vous ne pouvez savoir, Angaire, Ydier, Tityre, dit Ménalque (et je te le redis à présent en mon nom, Nathanaël) la passion qui brûla ma jeunesse. J’enrageais de la fuite des heures. La nécessité de l’option me fut toujours intolérable ; choisir m’apparaissait non tant élire, que repousser ce que je n’élisais pas. Je comprenais épouvantablement l’étroitesse des heures, et que le temps n’a qu’une dimension ; c’était une ligne que j’eusse souhaitée spacieuse, et mes désirs en y courant empiétaient nécessairement l’un sur l’autre. — Je ne faisais jamais que ceci ou que cela. Si je faisais ceci, cela m’en devenait aussitôt regrettable, et je restais souvent sans plus rien oser faire, éperdument et comme les bras toujours ouverts, de peur, si je les refermais pour la prise, de n’avoir saisi qu’une chose. L’erreur de ma vie fut dès lors de ne continuer longtemps aucune étude, pour n’avoir su prendre mon parti de renoncer à beaucoup d’autres. — N’importe quoi s’achetait trop cher à ce prix-là, et les raisonnements ne pouvaient venir à bout de ma détresse. Entrer dans un marché de délices, en ne disposant (grâce à Qui ?) que d’une somme trop minime ; en disposer ! choisir, c’était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste — et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n’importe quelle unité.
De là me vint d’ailleurs un peu de cette aversion pour n’importe quelle possession sur la terre — la peur de n’aussitôt plus posséder que cela.
Marchandises ! provisions ! tas de trouvailles ! que ne vous donnez-vous sans retraite ? Et je sais que les biens de la terre s’épuisent (encore qu’ils soient inépuisablement remplaçables) — et que la coupe que j’ai vidée reste vide pour toi, mon frère, (bien que la source soit voisine). Mais vous ! vous, immatérielles idées, formes de vie non détenues, — sciences, et science de Dieu — coupes de vérité, coupes intarissables — pourquoi marchander votre ruissellement à nos lèvres ? quand toute notre soif ne pourrait vous tarir et que votre eau déborderait toujours nouvelle pour chaque autre lèvre tendue. — J’ai compris maintenant que toutes les gouttes de cette grande source divine s’équivalent, que la moindre suffit à notre ivresse et nous révèle la plénitude et la totalité de Dieu. — Mais alors que n’eût point souhaité ma folie ? — J’enviais toute forme de vie ; tout ce que je voyais faire par quelque autre, j’eusse aimé le faire moi-même ; non l’avoir fait, le faire — entendez-moi — car je ne craignais que très peu la fatigue, la souffrance, et les croyais instruites de la vie. Je fus jaloux de Parménide trois semaines parce qu’il apprenait le turc ; deux mois plus tard de Théodose qui découvrait l’astronomie. Ainsi ne traçai-je de moi que la plus vague et la plus incertaine figure, à force de ne la vouloir point limiter.
Raconte-nous ta vie, Ménalque, dit Alcide, —
et Ménalque reprit : ……
… « À dix-huit ans|3|, quand j’eus fini mes premières études, l’esprit las de travail, le cœur inoccupé, languissant de l’être, le corps exaspéré par la contrainte, je partis sur les routes, sans but, usant ma fièvre vagabonde. Je connus tout ce que vous savez : le printemps, l’odeur de la terre, la floraison des herbes dans les champs, les brumes du matin sur la rivière, et la vapeur du soir sur les prairies. Je traversai des villes, et ne voulus m’arrêter nulle part. Heureux, pensais-je, qui ne s’attache à rien sur la terre et promène une éternelle ferveur à travers les constantes mobilités. — Je haïssais les foyers, les familles, tous lieux où l’homme pense trouver un repos — et les affections continues, et les fidélités amoureuses, et les attachements aux idées — tout ce qui compromet la justice ; je disais que chaque nouveauté doit nous trouver toujours tout entiers disponibles.
Des livres m’avaient montré chaque liberté provisoire et qu’elle n’est jamais que de choisir son esclavage, ou du moins sa dévotion, comme la graine des chardons vole et rôde, cherchant le sol fécond où fixer des racines, — et qu’elle ne fleurit qu’immobile. Mais ayant appris dans les classes que les raisonnements ne mènent pas les hommes et qu’à chacun s’en peut opposer un adverse qu’il ne s’agit que de trouver, je m’occupais à le chercher, parfois, dans le milieu des longues routes…
Je vivais dans la perpétuelle attente, délicieuse, de n’importe quel avenir. Je m’appris, comme des questions devant les attendantes réponses, à ce que la soif d’en jouir, née devant chaque volupté, en précédât d’aussitôt la jouissance. Mon bonheur venait de ce que chaque source me révélait une soif, et que, dans le désert sans eau, où la soif est inapaisable, j’y préférais encore la ferveur de ma fièvre sous l’exaltation du soleil. Il y avait, au soir, des oasis délicieuses, plus fraîches encore d’avoir été souhaitées tout le jour. — J’ai, sur l’étendue sablonneuse, au soleil, accablée, comme un immense sommeil étendu — mais tant la chaleur était grande, et dans la vibration même de l’air, — j’ai senti la palpitation encore de la vie qui ne pouvait pas s’endormir, à l’horizon trembler de défaillance, à mes pieds se gonfler d’amour. —
Chaque jour, d’heure en heure, je ne cherchais plus rien qu’une pénétration toujours plus simple de la nature. Je possédais le don précieux de n’être pas trop entravé par moi-même. Le souvenir du passé n’avait de force sur moi que ce qu’il en fallait pour donner à ma vie l’unité : c’était comme le fil mystérieux qui reliait Jason à son amour passée mais ne l’empêchait pas de marcher à travers les plus nouveaux paysages. Encore ce fil dût-il être rompu… Palingénésies merveilleuses ! Je savourais souvent, dans mes courses du matin, le sentiment d’un nouvel être, la tendresse de ma perception. — « Don du poète, m’écriais-je, tu es le don de perpétuelle rencontre » — et j’accueillais de toutes parts. Mon âme était l’auberge ouverte aux carrefours ; ce qui voulait entrer, entrait. Je me suis fait ductile, à l’amiable, disponible par tous mes sens, attentif, écouteur jusqu’à n’avoir plus une pensée personnelle, capteur de toute émotion en passage, et de réaction si minime que je ne reconnaissais plus rien pour mal à force de ne protester devant rien. Au reste, je remarquai bientôt de combien peu de haine du laid s’étayait mon amour du beau.