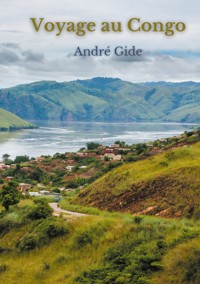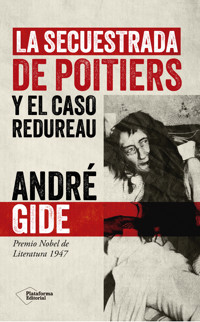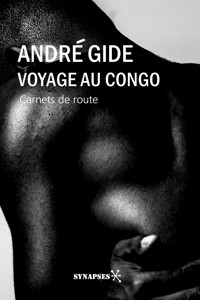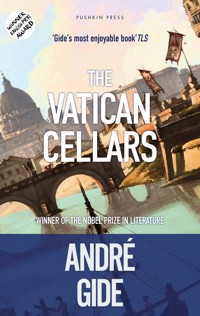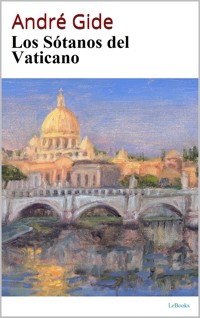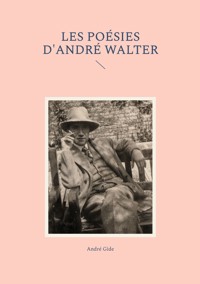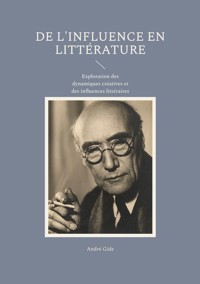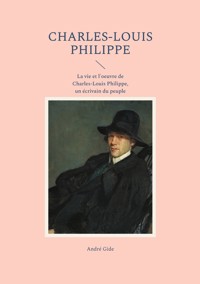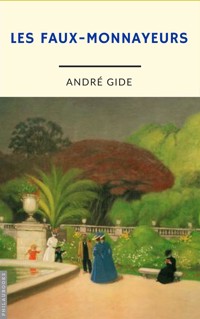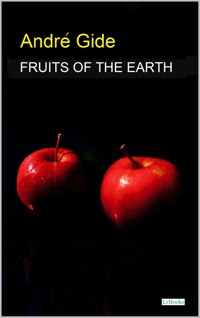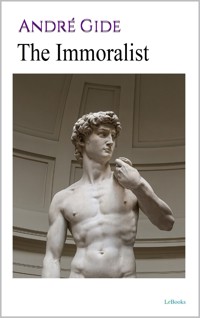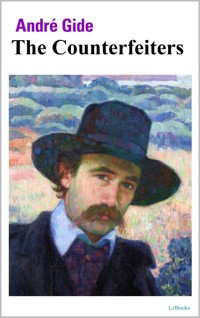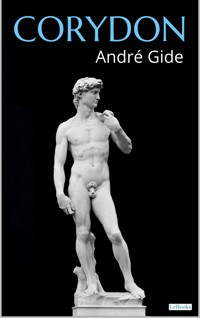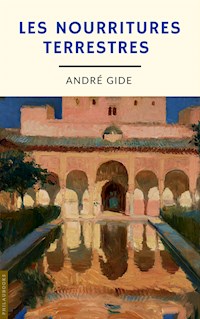
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Texte révisé suivi de repères chronologiques.
" 1) Les Nourritures terrestres sont le livre, sinon d’un malade, du moins d’un convalescent, d’un guéri — de quelqu’un qui a été malade. Il y a, dans son lyrisme même, l’excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu’il a failli perdre ;
" 2) J’écrivais ce livre à un moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermé ; où il me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu. »
André Gide.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LES NOURRITURES TERRESTRES
ANDRÉ GIDE
PHILAUBOOKS
TABLE DES MATIÈRES
Préface
Avant-propos
Livre I
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Livre II
Chapitre 1
Livre III
Chapitre 1
Livre IV
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Livre V
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Livre VI
Chapitre 1
Livre VII
Chapitre 1
Livre VIII
Chapitre 1
HYMNE
ENVOI
Repères chronologiques
Couverture
Copyright © 2022 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0238-3
Réalisé avec Vellum
A mon ami Maurice Quillot
Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre.
LE KORAN, II, 23.
PRÉFACE
DE L'ÉDITION DE 1927
Ce manuel d’évasion, de délivrance, il est d’usage qu’on m’y enferme. Je profite de la réimpression que voici pour présenter à de nouveaux lecteurs quelques réflexions, qui permettront de réduire son importance, en le situant et en le motivant d’une manière plus précise.
1o Les Nourritures terrestres sont le livre, sinon d’un malade, du moins d’un convalescent, d’un guéri — de quelqu’un qui a été malade. Il y a, dans son lyrisme même, l’excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu’il a failli perdre ;
2 oJ’écrivais ce livre à un moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermé ; où il me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu.
À quel point ce livre heurtait le goût du jour, c’est ce que laissa voir son insuccès total. Aucun critique n’en parla. En dix ans, il s’en vendit tout juste cinq cents exemplaires ;
3 oJ’écrivais ce livre au moment où, par le mariage, je venais de fixer ma vie ; où j’aliénais volontairement une liberté que mon livre, œuvre d’art, revendiquait aussitôt d’autant plus. Et j’étais en l’écrivant, il va sans dire, parfaitement sincère ; mais sincère également dans le démenti de mon cœur ;
4 oJ’ajoute que je prétendais ne pas m’arrêter à ce livre L’état flottant et disponible que je peignais, j’en fixais les traits comme un romancier fixe ceux d’un héros qui lui ressemble, mais qu’il invente ; et même il me parait aujourd’hui que ces traits, je ne les fixais pas sans les détacher de moi, pour ainsi dire, ou, si l’on préfère, sans me détacher d’eux ;
5 oL’on me juge d’ordinaire d’après ce livre de jeunesse, comme si l’éthique des Nourritures avait été celle même de toute ma vie, comme si moi tout le premier, je n’avais point suivi le conseil que je donne à mon jeune lecteur : « Jette mon livre et quitte-moi » Oui j’ai tout aussitôt quitté celui que j’étais quand j’écrivais Les Nourritures ; au point que si j’examine ma vie, le trait dominant que j’y remarque, bien loin d’être l’inconstance, c’est au contraire la fidélité. Cette fidélité profonde du cœur et de la pensée, je la crois infiniment rare. Ceux qui devant que de mourir, peuvent voir accompli ce qu’ils s’étaient proposé d’accomplir, je demande qu’on me les nomme, et je prends ma place auprès d’eux ;
6 oUn mot encore : Certains ne savent voir dans ce livre, ou ne consentent à y voir, qu’une glorification du désir et des instincts. Il me semble que c’est une vue un peu courte. Pour moi, lorsque je le rouvre, c’est plus encore une apologie du dénuement, que j’y vois. C’est là ce que j’en ai retenu, quittant le reste, et c’est à quoi précisément je demeure encore fidèle. Et c’est à cela que j’ai dû, comme je le raconterai par la suite, de rallier plus tard la doctrine de l’Évangile, pour trouver dans l’oubli de soi la réalisation de soi la plus parfaite, la plus haute exigence, et la plus illimitée permission de bonheur.
« Que mon livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même, — puis à tout le reste plus qu’à toi » Voici ce que déjà tu pouvais lire dans l’avant-propos et dans les dernières phrases des Nourritures. Pourquoi me forcer à le répéter ?
A.G.
AVANT-PROPOS
Ne te méprends pas, Nathanaël, au titre brutal qu’il m’a plu de donner à ce livre ; j’eusse pu l’appeler Ménalque, mais Ménalque n’a jamais, non plus que toi-même, existé. Le seul nom d’homme est le mien propre, dont ce livre eût pu se couvrir ; mais alors comment eussé-je osé le signer ?
Je m’y suis mis sans apprêts, sans pudeur ; et si parfois j’y parle de pays que je n’ai point vus, de parfums que je n’ai point sentis, d’actions que je n’ai point commises — ou de toi, mon Nathanaël, que je n’ai pas encore rencontré —, ce n’est point par hypocrisie, et ces choses ne sont pas plus des mensonges que ce nom, Nathanaël qui me liras, que je te donne, ignorant le tien à venir.
Et quand tu m’auras lu, jette ce livre — et sors. Je voudrais qu’il t’eût donné le désir de sortir — sortir de n’importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N’emporte pas mon livre avec toi.
Si j’étais Ménalque, pour te conduire j’aurais pris ta main droite, mais ta main gauche l’eût ignoré, et cette main serrée, au plus tôt je l’eusse lâchée, dès qu’on eût été loin des villes, et que je t’eusse dit : oublie-moi.
Que mon livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même, — puis à tout le reste plus qu’à toi.
LIVRE1
Mon paresseux bonheur qui longtemps sommeilla
S'éveille..
HAFIZ.
CHAPITRE1
Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout.
Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle.
Dès que notre regard s’arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu.
* * *
Tandis que d’autres publient ou travaillent, j’ai passé trois années de voyage à oublier au contraire tout ce que j’avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile ; elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d’une éducation.
Tu ne sauras jamais les efforts qu’il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie ; mais maintenant qu’elle nous intéresse, ce sera comme toute chose — passionnément.
Je châtiais allégrement ma chair, éprouvant plus de volupté dans le châtiment que dans la faute — tant je me grisais d’orgueil à ne pas pécher simplement.
Supprimer en soi l’idée de mérite ; il y a là un grand achoppement pour l’esprit.
… L’incertitude de nos voies nous tourmenta toute la vie. Que te dirais-je ? Tout choix est effrayant, quand on y songe : effrayante une liberté qui ne guide plus un devoir. C’est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu, où chacun fait sa découverte et, remarque-le bien ne la fait que pour soi ; de sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore… Des bocages ombreux nous attirent ; des mirages de sources pas encore taries… Mais plutôt les sources seront où les feront couler nos désirs ; car le pays n’existe qu’à mesure que le forme notre approche, et le paysage à l’entour, peu à peu, devant notre marche se dispose ; et nous ne voyons pas au bout de l’horizon ; et même près de nous ce n’est qu’une successive et modifiable apparence.
Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave ? Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons, hélas ! en attendant de Le trouver, où nous devons adresser nos prières. Puis on se dit enfin qu’il est partout, n’importe où, l’Introuvable, et on s’agenouille au hasard.
Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main.
Où que tu ailles, tu ne peux rencontrer que Dieu. — Dieu, disait Ménalque : c’est ce qui est devant nous.
Nathanaël, tu regarderas tout en passant, et tu ne t’arrêteras nulle part. Dis-toi bien que Dieu seul n’est pas provisoire.
Que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée.
Tout ce que tu gardes en toi de connaissances, distinctes restera distinct de toi jusques à la consommation des siècles. Pourquoi y attaches-tu tant de prix ?
Il y a profit aux désirs, et profit au rassasiement des désirs — parce qu’ils en sont augmentés. Car, je te le dis en vérité, Nathanaël, chaque désir m’a plus enrichi que la possession toujours fausse de l’objet même de mon désir.
* * *
Pour bien des choses délicieuses, Nathanaël, je me suis usé d’amour. Leur splendeur venait de ceci que j’ardais sans cesse pour elles. Je ne pouvais pas me lasser. Toute ferveur m’était une usure d’amour, une usure délicieuse.
Hérétique entre les hérétiques, toujours m’attirèrent les opinions écartées, les extrêmes détours des pensées, les divergences. Chaque esprit ne m’intéressait que par ce qui le faisait différer des autres. J’en arrivai à bannir de moi la sympathie, n’y voyant plus que la reconnaissance d’une émotion commune.
Non point la sympathie, Nathanaël, — l’amour.
Agir sans juger si l’action est bonne ou mauvaise. Aimer sans s’inquiéter si c’est le bien ou le mal.
Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur.
Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité. Je ne souhaite pas d’autre repos que celui du sommeil de la mort. J’ai peur que tout désir, toute énergie que je n’aurais pas satisfaits durant ma vie, pour leur survie ne me tourmentent. J’espère, après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi, satisfait, mourir complètement désespéré.
Non point la sympathie, Nathanaël, l’amour. Tu comprends, n’est-ce pas, que ce n’est pas la même chose. C’est par peur d’une perte d’amour que parfois j’ai pu sympathiser avec des tristesses, des ennuis, des douleurs que sinon, je n’aurais qu’à peine endurés. Laisse à chacun le soin de sa vie.
(Je ne peux écrire aujourd’hui parce qu’une roue tourne en la grange. Hier je l’ai vue ; elle battait du colza. La balle s’envolait ; le grain roulait à terre La poussière faisait suffoquer. Une femme tournait la meule. Deux beaux garçons, pieds nus, récoltaient le grain.
Je pleure parce que je n’ai rien de plus à dire.
Je sais qu’on ne commence pas à écrire quand on n’a rien de plus à dire que ça. Mais j’ai pourtant écrit et j’écrirai encore d’autres choses sur le même sujet.)
* * *
Nathanaël, j’aimerais te donner une joie que ne t’aurait donnée encore aucun autre. Je ne sais comment te la donner et pourtant, cette joie, je la possède. Je voudrais m’adresser à toi plus intimement que ne l’a fait encore aucun autre. Je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres cherchant dans chacun d’eux plus qu’il ne t’avait encore révélé ; où tu attends encore ; où ta ferveur va devenir tristesse, de ne pas se sentir soutenue. Je n’écris que pour toi ; je ne t’écris que pour ces heures. Je voudrais écrire tel livre d’où toute pensée, toute émotion personnelle te semblât absente, où tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur. Je voudrais m’approcher de toi et que tu m’aimes.
La mélancolie n’est que de la ferveur retombée.
Tout être est capable de nudité, toute émotion, de plénitude.
Mes émotions se sont ouvertes comme une religion. Peux-tu comprendre cela : toute sensation est d’une présence infinie.
Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur.
Nos actes s’attachent à nous comme sa lueur au phosphore. Ils nous consument, il est vrai, mais ils nous font notre splendeur.
Et si notre âme a valu quelque chose, c’est qu’elle a brûlé plus ardemment que quelques autres.
Je vous ai vus, grands champs baignés de la blancheur de l’aube ; lacs bleus, je me suis baigné dans vos flots — et que chaque caresse de l’air riant m’ait fait sourire, voilà ce que je ne me lasserai pas de te redire, Nathanaël. Je t’enseignerai la ferveur.
Si j’avais su des choses plus belles, c’est celles-là que je t’aurais dites — celles-là, certes, et non pas d’autres.
Tu ne m’as pas enseigné la sagesse, Ménalque. Pas la sagesse, mais l’amour.
* * *
J’eus pour Ménalque plus que de l’amitié, Nathanaël, et à peine moins que de l’amour. Je l’aimais aussi comme un frère.
Ménalque est dangereux ; crains-le ; il se fait réprouver par les sages, mais ne se fait pas craindre par les enfants. Il leur apprend à n’aimer plus seulement leur famille et, lentement, à la quitter ; il rend leur cœur malade d’un désir d’aigres fruits sauvages et soucieux d’étrange amour. Ah ! Ménalque, avec toi j’aurais voulu courir encore sur d’autres routes. Mais tu haïssais la faiblesse et prétendais m’apprendre à te quitter.
Il y a d’étranges possibilités dans chaque homme. Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n’y projetait déjà une histoire. Mais, hélas ! un unique passé propose un unique avenir — le projette devant nous, comme un point infini sur l’espace.
On n’est sûr de ne jamais faire que ce que l’on est incapable de comprendre. Comprendre, c’est se sentir capable de faire, ASSUMER LE PLUS POSSIBLE D’HUMANITÉ, voilà la bonne formule.
Formes diverses de la vie ; toutes vous me parûtes belles. (Ce que je te dis là, c’est ce que me disait Ménalque.)
J’espère bien avoir connu toutes les passions et tous les vices ; au moins les ai-je favorisés. Tout mon être s’est précipité vers toutes les croyances ; et j’étais si fou certains soirs que je croyais presque à mon âme, tant je la sentais près de s’échapper de mon corps, — me disait encore Ménalque.
Et notre vie aura été devant nous comme ce verre plein d’eau glacée, ce verre humide que tiennent les mains d’un fiévreux, qui veut boire, et qui boit tout d’un trait sachant bien qu’il devrait attendre, mais ne pouvant pas repousser ce verre délicieux à ses lèvres, tant est fraîche cette eau, tant l’altère la cuisson de la fièvre.
CHAPITRE2
Ah ! comme j’ai donc respiré l’air froid de la nuit, ah ! croisées ! et, tant les pâles rayons coulaient de la lune, à cause des brouillards, comme des sources — on semblait boire.
Ah ! croisées ! que de fois mon front s’est venu rafraîchir à vos vitres, et que de fois mes désirs, lorsque je courais de mon lit trop brûlant vers le balcon, à voir l’immense ciel tranquille, se sont évaporés comme des brumes.
Fièvres des jours passés, vous étiez à ma chair une mortelle usure ; mais comme l’âme s’épuise quand rien ne la distrait de Dieu !
La fixité de mon adoration était effrayante ; je m’y décontenançais tout entier.
Tu chercherais encore longtemps, me dit Ménalque, le bonheur impossible des âmes.