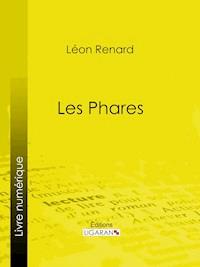
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les phares, si secourables à la marine moderne, n'ont point complétement manqué à la marine ancienne. Malheureusement, en s'écroulant du même coup que l'empire romain, les phares de l'antiquité n'ont pas laissé autant de ruines ; leurs contemporains ne nous ont légué sur ces édifices que de nombreuses dissertations ; trop de livres et pas assez de pierres."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À
M. ÉDOUARD THIERRY
HOMME DE LETTRES
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE DE DANEBROG
Ce livre est respectueusement et cordialement dédié.
L.R.
Les phares, si secourables à la marine moderne, n’ont point complètement manqué à la marine ancienne. Malheureusement, en s’écroulant du même coup que l’empire romain, les phares de l’antiquité n’ont pas laissé autant de ruines ; leurs contemporains ne nous ont légué sur ces édifices que de nombreuses dissertations ; trop de livres et pas assez de pierres. Quelques débris auraient suffi peut-être pour vérifier l’exactitude de ce que nous disent les auteurs, et l’on n’en serait pas réduit, comme nous le sommes, au doute et à l’incertitude en raison de l’abondance même des renseignements écrits.
Les Grecs attribuent les premiers phares à Hercule. Les plus anciens que l’on connaisse sont les tours bâties par les Libyens et par les Cuthites, qui habitaient les provinces de la Basse-Égypte. Elles servaient de point d’observation pendant le jour et de phares pendant la nuit. C’étaient aussi des temples, qui recevaient le nom d’une divinité. Les marins les avaient en grande vénération ; ils les enrichissaient de leurs ex-voto. On suppose qu’elles renfermaient des cartes de la côte et de la navigation du Nil. D’abord dessinées sur les murs, ces cartes le furent ensuite sur le papyrus. Les prêtres de ces temples-collèges y enseignaient le pilotage, l’hydrographie et l’art de diriger la marche d’un navire d’après les constellations. Protée d’Égypte que l’on dit avoir été visité par Ménélas à son retour de la guerre de Troie, ne serait qu’un de ces collèges religieux et nautiques. À son sommet brûlait un feu continuellement entretenu. La méthode qui présidait à l’éclairage était naturellement très grossière. Les Libyens plaçaient leurs feux dans une machine en fer ou en bronze, composée de trois ou quatre branches représentant chacune un dauphin ou quelque autre animal marin, et reliées par des feuillages. Dans l’espèce de corbeille que formait cet enchevêtrement on disposait le combustible. Cet instrument était fixé à l’extrémité d’une forte perche, dirigée vers la mer.
Les Libyens, dit le baron de Zach, dans sa Correspondance astronomique, appelaient ces tours tar ou tor, qui signifie hauteur et aussi tour. Is veut dire feu, de là on a composé Tor-Is, tour de feu. Les Grecs en ont fait τύῤις, les Latins, turris. Les constructions de ce genre qu’on élevait dans les villes, occupaient toujours l’endroit le plus proéminent, et se nommaient Bosrah, nom sous lequel on désigna plus tard la citadelle de Carthage.
Lorsque ces fanaux étaient situés hors des villes, sur des éminences et de forme ronde, on les appelait Tith. Tithon si célèbre par sa longévité, paraît n’avoir été qu’un de ces édifices dédiés au Soleil, et Thétis, cette ancienne déesse de la mer, qu’une tour à feu près de l’Océan, appelée Thit-Is (feu sur l’éminence). Le massacre des Cyclopes, tués à coups de flèches par Apollon, se rapporterait encore assez bien à la manière dont les fanaux des tours cyclopéennes, placées sur les côtes orientales de Sicile, étaient éteints par les rayons du soleil levant.
Le premier phare fonctionnant d’une façon régulière paraît être celui que Leschès, auteur de la Petite Iliade, qui vivait dans la neuvième olympiade, plaçait au promontoire de Sygée, près duquel il y avait une rade. La Table Iliaque représente cette tour.
Quoique figurant en tête de la liste, ce phare n’a pas eu la gloire de laisser son nom aux monuments dont il a été le prédécesseur, pas plus que Colomb n’a eu celle de laisser le sien à l’Amérique. Cet honneur était réservé à la tour élevée sur l’île de Pharos, à Alexandrie. Ce dernier a également servi de modèle aux plus célèbres tours à feu élevées depuis. Suétone le dit expressément de celui d’Ostie bâti par Claude, et qui paraît avoir été le plus remarquable de ceux qui ont éclairé les côtes latines. L’Italie en eut pourtant de forts beaux, tels que ceux de Ravenne et de Pouzzole, dont parle Pline, et celui de Messine, qui a donné son nom au détroit qui sépare la Sicile de l’Italie, et où se rencontrent les rochers fameux de Charybde et de Scylla ; le phare de l’île de Caprée, enfin, qu’un tremblement de terre fit tomber peu de jours avant la mort de Tibère.
Denis de Byzance parle à son tour d’un phare célèbre situé à l’embouchure du fleuve Chrysorrhoas qui se jetait dans le Bosphore de Thrace. « Au sommet de la colline, dit-il, au bas de laquelle coule le Chrysorrhoas, on voit la tour Timée, d’une hauteur extraordinaire, d’où l’on découvre une grande plage de mer, et que l’on a bâtie pour la sûreté de ceux qui naviguaient, en allumant des feux à son sommet pour les guider ; ce qui était d’autant plus nécessaire que l’un et l’autre bord de cette mer est sans ports, et que les ancres ne sauraient prendre son fond. Mais les Barbares de la côte allumaient d’autres feux aux endroits les plus élevés des bords de la mer, pour tromper les mariniers et profiter de leur naufrage. À présent, ajoute cet auteur, la tour est à demi-ruinée, et l’on n’y met plus de fanal. »
Quelle était la forme des phares latins ? On ne peut émettre que des doutes à ce sujet, bien qu’Hérodien dise que les catafalques des empereurs étaient semblables aux phares. Il faut remarquer que ces catafalques étaient carrés, et que les tours à feu ne l’étaient pas toujours un médaillon tiré du cabinet du maréchal d’Estrées, et reproduit par Montfaucon, nous représente un port romain avec un phare à quatre étages qui est rond.
Une autre médaille, trouvée en Bithynie, à Apamée, et dont Baudelot de Dairval était possesseur à l’époque où Montfaucon écrivait, donne également une forme ronde au phare qu’elle représente. Le phare de Boulogne, enfin, était octogonal, ainsi qu’on le verra dans notre chapitre sur ce monument, l’un des plus célèbres de l’antiquité.
D’après Strabon, Pline, Lucien, Eusèbe, Suidas, Jules César, etc., ce serait à Ptolémée Philadelphe que reviendrait l’honneur de la construction du phare d’Alexandrie, ce monument colossal et si magnifique que les anciens l’avaient mis au rang des merveilles du monde. Mais si nous en croyons Ammien Marcelin et Tzetzès, c’est à Cléopâtre qu’il faut attribuer cette gloire que d’autres historiens donnent à Alexandre.
Les modernes ne sont pas mieux renseignés. Tout ce qu’ils peuvent affirmer, c’est que l’architecte se nommait Sostrate. Dans son Antiquité expliquée (à sa manière), dom Bernard de Montfaucon cherche à démontrer comment, sachant le nom de l’architecte on a des doutes sur celui du fondateur que, pour sa part, il croit être Ptolémée. « Cette ignorance vient, dit-il, de la fourberie de Sostrate. Il voulait immortaliser son nom ; ce qui n’aurait pas été blâmable, s’il n’eût en même temps voulu supprimer celui de Ptolémée qui faisait la dépense. Pour cet effet il s’avisa d’un stratagème qui lui réussit : il grava profondément sur la tour cette inscription : Sostrate Cnidien, fils de Dexiphane, aux dieux sauveurs de ceux qui sont sur mer. Et se doutant bien que le roi Ptolémée ne serait pas content d’une telle inscription, il la couvrit d’un enduit fort léger, qu’il savait ne pouvoir résister longtemps aux injures de l’air, et y mit le nom de Ptolémée. L’enduit et le nom du roi tombèrent dans quelques années, et l’on n’y vit plus que l’inscription qui en donnait toute la gloire à Sostrate. »
Le bon bénédictin ajoute une foi entière à cette anecdote, et il discute les opinions contraires. « Pline, ajoute-t-il, a prétendu que Ptolémée par modestie et par grandeur d’âme, voulut que Sostrate mit son nom sur la tour, sans qu’il y fût fait aucune mention de lui. Mais ce fait n’est nullement croyable : cela aurait passé dans ces temps-là, et passerait même encore aujourd’hui, pour une grandeur d’âme mal entendue. On n’a jamais vu de prince qui ait refusé de mettre son nom sur des ouvrages magnifiques faits pour l’utilité publique, et qui en ait voulu donner toute la gloire aux architectes. » Pour arranger le différend, Champollion-Figeac fait construire ce phare par Ptolémée-Soter. Comme dit Edrisi avec solennité : « Dieu seul connaît la vérité du fait. »
Le nom de phare, donné pour la première fois à une tour à feu, n’a pas fourni une moins vaste carrière aux discussions des érudits. Quoiqu’il soit bien évident que la tour d’Alexandrie ait reçu de l’îlot sur lequel elle s’élevait, le nom qu’elle a gardé et transmis aux monuments copiés sur elle, Isidore prétend qu’il vient de φώς, qui veut dire lumière, et d’όρᾀν qui signifie voir. Le Liceti donne une autre étymologie qui ne vaut pas mieux ; ce qui mécontente fort l’honnête Montfaucon. « Que des gens qui ne lisaient pas les auteurs grecs, dit-il, se soient ainsi exercés inutilement à tirer ces étymologies, cela est encore moins surprenant que de voir Isaac Vossius, qui lisait Homère, chercher dans la langue grecque l’origine de pharos. De φαίνειν ; luire, dit-il, vient φανερός ; de φανερός, φάρος… L’île s’appelait Φάρός sept ou huit cents ans avant qu’il n’y eût ni tour ni fanal. Cela fait voir que ces étymologistes de profession tirent quelquefois des étymologies sans consulter la raison. »
Ce mot ne s’en tint pas à ce premier succès. On le retrouve appliqué ailleurs et servant à qualifier d’autres objets que ceux dont nous nous occupons. « On vit, dit Grégoire de Tours, un phare de feu qui sortit de l’église de Saint-Hilaire, et qui vint fondre sur le roi Clovis. » Le même historien se sert encore de ce mot pour exprimer un incendie : « Ils mirent, dit-il, le feu à l’église de Saint-Hilaire, firent un grand phare, et pendant que l’église brûlait, ils pillèrent le monastère. » On retrouve souvent dans l’œuvre du grand historien le même mot employé avec le même sens ; ce qui laisserait supposer que du temps de Grégoire un incendiaire pouvait être désigné comme un faiseur de phares. Plus tard encore on appelle phare certaines machines où l’on mettait plusieurs lampes ou plusieurs cierges, et qui approchaient de nos lustres. On trouve dans Anastase le Bibliothécaire que le pape Sylvestre fit faire « un phare d’or pur, » et que le pape Adrien Ier, en fit un « en forme de croix, » où l’on mit jusqu’à cent soixante-dix chandelles ou cierges. À son tour, Léon d’Ostie, dans sa Chronique du Mont-Cassin, dit de l’abbé Didier : « Il fit faire un phare ou une grande couronne d’argent du poids de cent livres, d’où s’élevaient douze petites tourelles et d’où pendaient trente-six lampes. »
Ajoutons avant de fermer notre parenthèse que les poètes, qui aiment les licences, ont pris le mot phare dans un sens encore plus métaphorique, en l’employant pour désigner tout ce qui éclaire en instruisant, et même les gens dont l’esprit peut éclairer les autres.
a dit Ronsard à Charles IX.
Revenons à l’édifice égyptien.
L’île sur laquelle s’élevait sa tour superbe, était distante de la terre ferme de sept stades ou d’un bon quart de lieue, quoique ait prétendu Homère, qui fait dire à Ménélas, dans l’Odyssée, qu’elle est éloignée de l’Égypte d’une journée entière. Plus tard elle fut jointe à la terre par une chaussée et un pont.
D’après les descriptions qui nous ont été laissées, le phare était à plusieurs étages voûtés, à peu près comme la tour de Babylone, qui avait huit étages, ou, dit Hérodote, huit tours l’une sur l’autre. Pline assure que les frais de sa construction montèrent à huit cents talents.
Jusqu’à quelle époque subsista ce monument grandiose ? Il est certain qu’il existait encore au douzième siècle, puisque Edrisi l’a vu. « Ce phare, dit-il, n’a pas son pareil au monde sous le rapport de la structure et sous celui de la solidité ; car, indépendamment de ce qu’il est fait en excellentes pierres de l’espèce dite kedan, les assises de ces pierres sont scellées les unes contre les autres avec du plomb fondu et les jointures tellement adhérentes, que le tout est indissoluble, bien que les flots de la mer, du côté du nord, frappent continuellement cet édifice. Du sol à la galerie (ou étage) du milieu, on compte exactement 70 brasses ; et de cette galerie au sommet du phare, 26. On monte à ce sommet par un escalier construit dans l’intérieur, et large comme le sont ordinairement ceux qu’on pratique dans les tours. Cet escalier se termine vers le milieu du monument, et là l’édifice devient, par ses quatre côtés, plus étroit. Dans l’intérieur, et sous l’escalier, on a construit des habitations. À partir de la galerie, le phare s’élève jusqu’au sommet, en se rétrécissant de plus en plus jusqu’au point de pouvoir être embrassé de tous les côtés par un homme. De cette même galerie on monte de nouveau, pour atteindre le sommet, par un escalier de dimensions plus étroites que celles de l’escalier inférieur ; cet escalier est percé, dans toutes ses parties, de fenêtres destinées à procurer du jour aux personnes qui montent, et afin qu’elles puissent placer convenablement leurs pieds en montant. »
Cet édifice, ajoute Edrisi, est singulièrement remarquable, tant à cause de sa hauteur qu’à cause de sa solidité ; il est très utile en ce qu’on y allume nuit et jour du feu pour servir de signal aux navigateurs durant leurs voyages ; ils connaissent ce feu et se dirigent en conséquence, car il est visible d’une journée maritime (100 milles) de distance. Durant la nuit il apparaît comme une étoile ; durant le jour on en distingue la fumée.
Edrisi dit que de loin la lumière du phare avait si bien l’air d’une étoile élevée sur l’horizon que les marins s’y méprenant, tournaient leur proue d’un autre côté, et allaient se jeter sur les sables de la Marmarique.
C’est Montfaucon qui nous apprend cette particularité qui s’est reproduite de nos jours. Plus d’un des feux qui brillent en ce moment sur les différents écueils du globe ont deux lumières, l’une au sommet du phare, l’autre plus bas, pour que les navigateurs ne prennent pas la plus forte pour un astre.
À propos du phare d’Alexandrie, Montfaucon ajoute : « Les Arabes et les voyageurs en ont rapporté bien des choses fort sujettes à caution. Ils disent que Sostrate fonda cette prodigieuse masse sur quatre grands cancres de verre, ce qui paraît si fabuleux qu’on ne voudrait pas même se donner la peine de le réfuter. Cependant Isaac Vossius assure qu’il a entre les mains un ancien auteur manuscrit des Merveilles du monde, qui raconte la même chose. Mais cet auteur semble ne rapporter cela que sur un bruit public ; et Vossius se donne inutilement la torture pour rendre croyable un fait qui a si peu de vraisemblance. S’il y avait eu quelque chose d’approchant de cela, on a peine à croire que de tant d’anciens auteurs qui ont parlé de la tour de Pharos, pas un n’en eût rien dit. »
« On doit encore ajouter moins de foi, poursuit Montfaucon, à ce que rapporte, sur la foi des Arabes, Martin Crusius dans ses Turco-Græciæ libri VIII ; qu’Alexandre le Grand fit mettre au haut de la tour un miroir fait avec tant d’art, qu’on y découvrait de 500 parasanges, c’est-à-dire de plus de cent lieues, les flottes des ennemis qui venaient contre Alexandrie ou contre l’Égypte ; et qu’après la mort d’Alexandre ce miroir fut cassé par un Grec nommé Sodore, qui prit un temps où les soldats de la forteresse étaient endormis. Cela supposerait que le phare était déjà bâti du temps d’Alexandre le Grand, ce qui est certainement faux. C’est assez le génie des Orientaux, d’inventer des choses si déraisonnablement merveilleuses », dit en terminant le bon bénédictin.
La tour célèbre qui, sous le nom de Tour d’Ordre ou plutôt d’Orde se partagea pendant si longtemps avec la tour de Douvres l’éclairage de la Manche, et dont les ruines imposantes se dressaient, il y a encore deux siècles, aux portes de Boulogne, remontait à Caligula. Si nous en croyons les assertions un peu confuses des historiens, le trop fameux empereur revenait des bords du Rhin et songeait à envahir la Bretagne, lorsque le hasard lui ayant procuré la soumission volontaire d’un jeune prince breton, il prit occasion de cette fortune heureuse et imprévue pour se faire décerner les honneurs triomphaux. C’est pour en laisser un souvenir plus durable que les pompes du Capitole, qu’il éleva sur les falaises de Gesoriacum, devenu la Boulogne romaine, un monument destiné à perpétuer sa gloire.
Comment l’édifice glorieux s’est-il transformé en monument utile ? comment la tour triomphale est-elle devenue un phare ? c’est ce qu’on ne sait guère. Il est certain toutefois qu’en l’an 191 de notre ère, une lumière brillait à son sommet ainsi que le démontre un médaillon en bronze, sur lequel Commode porte le titre de Britannicus, en souvenir des victoires d’un de ses lieutenants sur les Bretons, et qui représente ce phare et le départ d’une flotte romaine.
Placée sur le lieu même où s’effectuait le plus souvent le passage de la Gaule en Bretagne, la tour de Boulogne fut soigneusement entretenue tant que dura la domination romaine. Au neuvième siècle, en 811, on la voit réparée, et bien à titre de phare cette fois, par Charlemagne, qui s’occupait alors d’une expédition contre les pirates normands. Plus tard, et jusqu’au dix-septième siècle, la tradition nous la montre servant au même usage ; de là, selon une étymologie qui a fait fortune, mais dont M. Egger signale toute la fausseté, le nom de turris ardents, devenu par corruption Tour d’Ordre. Il paraît qu’elle servit encore de forteresse. Sa position et sa grande masse, comme on le verra plus loin, ne la rendaient que trop propre à cette destination.
Au seizième siècle, pendant la courte et désastreuse occupation de Boulogne par les Anglais, de 1544 à 1559, on trouve la Tour d’Ordre entourée de deux remparts, l’un en brique, l’autre en terre et muni de pièces d’artillerie. Ce point en effet était parfaitement choisi pour l’attaque et pour la défense de Boulogne, car il domine, et il dominait surtout alors, toute la ville et les deux rives de la Liane. Cependant ce ne furent pas les foudres qu’on amassait sur son front qui firent périr la Tour d’Ordre, tout ce dont elle souffrit à ces époques peu éprises d’archéologie, ce fut de la destruction de sa lanterne, plusieurs fois réparée. Sa ruine est due tout entière à l’incurie des mayeurs et échevins de Boulogne. Ébranlés d’abord par le flot même qui, dans les hautes marées, bat violemment la falaise, puis par le travail souterrain des sources, enfin par l’imprudente exploitation des carrières qu’elle renferme, le fort et la tour s’écroulèrent en deux fois selon les uns, en trois fois selon les autres, de 1640 à 1644 ou 1645, avec le massif même de la falaise sur lequel ils reposaient. « Dans l’intervalle d’une chute à l’autre, dit M. Egger, on ne fit rien pour sauver au moins ce qui restait d’un si précieux monument qui pourtant servait encore aux signaux de nuit pour l’entrée du port, et quand il eût péri dans l’éboulement profond du terrain, la municipalité boulonnaise se crut dégagée des redevances que, pour cette partie de son territoire, elle payait, en vertu d’un droit ancien, au seigneur de Baincthun. Le sol n’existait plus, le tenancier croyait être libre de toute obligation envers le propriétaire.
Celui-ci plaida et obtint gain de cause, par arrêt du Parlement, en date du 1er juillet 1656. MM. de Boulogne, vu qu’ils avaient eux-mêmes causé la perte dont ils arguaient pour nier la dette, furent condamnés à payer, comme devant, deux mille harengs sorets et blancs, portés à Arras, Amiens et autres villes de pareilles distances, au choix du seigneur, ou à remettre les lieux en leur ancien état (ce qui rappelle un peu l’aventure de Mummius à Corinthe) et à abandonner au seigneur de Baincthun, baron d’Ordre, “le droit de demande qui se prend pour tous les pêcheurs entrant au Havre. ” Tout porte à croire qu’en expiation de sa faute, Boulogne paya les deux mille harengs jusqu’à la Révolution française. »
Il reste peu de chose aujourd’hui de ce monument plus glorieux par les services qu’il rendit à l’humanité que par son origine qui ne rappelle qu’une extravagance de Caligula, et M. Egger nous met en garde contre les dessins qui en ont été donnés. Celui qui lui paraît mériter le plus de confiance est celui qu’exécuta Claude Châtillon, ingénieur du roi Henri IV, et que nous reproduisons.
Les descriptions que l’on a faites de la tour sont également très insuffisantes. Néanmoins elles renferment des renseignements certains et précieux sur la situation, les dimensions et la forme de l’édifice, ainsi que sur les matériaux employés à sa construction. Ceux-ci étaient simplement des pierres grises, des pierres jaunes et des briques rouges disposées de façon à composer un monument aussi solide qu’élégant et agréable à voir. La tour était située à la longueur d’un jet d’arbalète du bord de la falaise ; elle était octogone, avait 192 pieds de circuit et environ 64 pieds de diamètre ; ainsi que chez la plupart des phares romains, chacun de ses douze étages faisait retrait d’un pied et demi sur l’étage inférieur, ce qui lui donnait la forme d’une pyramide. On assure que sa hauteur égalait à peu près sa circonférence, soit en nombre rond, 200 pieds, « ce qui semble à vrai dire, une bien grande hauteur pour un phare, déjà situé sur une falaise haute d’environ 100 pieds au-dessus de la mer, » remarque M. Egger. Quoi qu’il en soit, chaque étage avait sur le midi une ouverture en façon de porte. On y voyait encore, au commencement du dix-septième siècle, trois chambres voûtées, l’une sur l’autre, avec un escalier intérieur pour relier ces trois étages, destinés sans doute à l’habitation des gardiens.
Quant à la place où brillait le feu, on ne peut faire à ce sujet que des conjectures. Comme les chroniqueurs du neuvième siècle disent que le sommet fut réparé en vue d’y allumer des feux, il y a lieu de croire qu’avant cette réparation ces feux brillaient dans une chambre du dernier des étages.
M. Egger suppose qu’en opérant quelques fouilles on pourrait retrouver des débris importants. D’après les motifs qu’il donne de penser ainsi, on ne peut que se ranger complètement à son avis, et faire des vœux pour que la municipalité actuelle répare dans la mesure de ses moyens l’incurie de ses ancêtres, MM. le mayeurs et échevins. En ce qui la concerne la Commission des phares n’a rien négligé pour que le feu romain fût dignement remplacé. Elle a établi à Boulogne, en 1835, un feu fixe rouge et deux feux fixes, le premier qui s’étend à 4 milles et les deux autres éclairant à 9 milles, ce qui est suffisant pour une partie de côte déjà illuminée, au cap Gris-Nez, par une lumière qui va jusqu’à 22 milles, et à la pointe d’Alpreck, par un feu de 12 milles.
Passer sous silence la tour de Douvres, après avoir parlé de celle de Boulogne, serait une injustice flagrante ; ces deux tours sont sœurs, en ce sens que ce furent des mains romaines qui les construisirent, et que leurs destinées furent pareilles, de ce côté-ci et de ce côté-là de la Manche. Il y a toutefois cette différence entre la tour de Boulogne et celle de Douvres, qu’en dépit du brouillard qui enveloppe l’histoire de la première, il n’est pas impossible de le percer çà et là, tandis que pour la seconde ce brouillard est devenu la nuit la plus obscure. Écoutons plutôt Montfaucon : « Voulant m’éclaircir à ce sujet, dit-il, j’ai écrit à quelques amis d’Angleterre, qui ont intéressé Mgr l’archevêque de Cantorbéry à faire faire quelques recherches, tant sur le lieu même, que dans les auteurs anglais qui en ont écrit en leur langue. On m’a envoyé quelques extraits et quelques mémoires, dont la plupart regardent le château de Douvres, et peu parlent du phare. Quelques-uns croient que le phare bâti par les Romains n’était pas cette vieille tour qui subsiste encore aujourd’hui au milieu du château de Douvres, mais un grand monceau de masures, de pierres et de chaux, qu’on voit auprès de Douvres, que les gens du pays appellent, je ne sais pourquoi, la Goutte du Diable. D’autres croient que le phare était cette même tour du château, dont on m’a envoyé la description suivante, avec le dessin de ses dimensions :
“Voici le plan et la face extérieure des quatre côtés d’une vieille tour située sur une éminence vers le milieu du château de Douvres. Sa hauteur est de 72 pieds. Elle est longue de 36 pieds, du nord au sud, et large de 33, de l’est à l’ouest. Les trous ronds faits à dessein sur les trois côtés, et les fenêtres en arcades qu’on voit sur tous les quatre, font juger qu’elle avait été faite pour découvrir de loin. On voit de là toutes les côtes de France et une vaste étendue de mer tout autour. Selon toutes les apparences, cette tour servait de fanal pour guider la nuit ceux qui passaient des Gaules dans la Grande-Bretagne. ” L’auteur de la description ajoute que, dans la suite des temps, les chrétiens en firent une église, et qu’avec quelques bâtiments qu’ils y ajoutèrent, ils lui donnèrent la forme d’une croix. Ce n’est pas tout. Montfaucon ajoute :
“Environ deux ans après (1724) que j’eus reçu ce dernier mémoire, Mgr l’archevêque de Cantorbéry m’envoya, en estampe, le plan, le profil et la coupe de l’ancien phare de Douvres, qui n’était pas cette tour dont je viens de parler, mais un phare octogone comme celui de Boulogne et à peu près de la même forme. Ce n’est pas que la tour carrée n’ait aussi servi de phare ; la manière dont elle est percée de fenêtres semble en être une preuve ; mais ce n’a été que depuis que l’ancienne tour octogone tomba en ruine, ou peut-être que la tour carrée se trouva mieux située pour découvrir au loin… La face extérieure de la tour allait toujours en diminuant depuis le bas jusqu’en haut, mais la diminution se prenait uniquement sur l’épaisseur du mur ; en sorte qu’il se trouvait extraordinairement épais en bas et beaucoup moins en haut, ce qui faisait une structure fort solide…” Ce que dit là Montfaucon est plein de sens ; mais comme le bon bénédictin était assez crédule, malgré l’excellent sentiment critique qui perce dans ses écrits, il est bon, croyons-nous, d’attendre que des travaux plus sérieux soient venus confirmer son opinion avant de l’adopter complètement. »
« Les hommes reçoivent indifféremment les uns des autres, sans examen, ce qu’ils entendent dire sur les évènements passés, même sur ceux de leur propre pays… Tant, pour la plupart, dans leur indolence à rechercher la vérité, ils aiment à adopter sans examen tout ce qui se présente à eux. » Ainsi s’exprime Thucydide ; et quoique son observation date de deux mille ans, elle n’a point perdu de sa justesse.
Le spirituel dessin que nous publions en est une preuve nouvelle. C’est une représentation du Colosse de Rhodes, d’après l’idée généralement admise que cette célèbre statue d’Apollon était placée à l’entrée du port de Rhodes, auquel elle servait de phare, et qu’elle était d’une si énorme grandeur que les navires passaient à pleines voiles entre ses jambes.
Et d’abord le Colosse de Rhodes n’a jamais servi de phare, ou du moins aucun auteur ancien ne lui donne cet emploi. Le premier écrivain qui en ait fait un fanal est Urbain Chevreau, assez médiocre compilateur du dix-septième siècle, qui ne dit point, et pour cause, où il a puisé ce renseignement. En second lieu, l’attitude traditionnelle du colosse rhodien est également une pure imagination des temps modernes.
Cette seconde erreur est plus ancienne que la première, elle date du seizième siècle, et c’est à Blaise de Vigenère, traducteur de Philostrate, bon gentilhomme du Boulonnais, mais écrivain dépourvu de critique, qu’on doit d’avoir transformé le chef-d’œuvre de Charès, l’élève de Lysippe, en une bizarrerie impossible.
Où Vigenère a-t-il trouvé cela ? Il ne le dit pas ; il conserve, sur ce point, de Chevreau le silence prudent. On a voulu répondre pour lui, et l’on a cherché. Déjà, dans un très bon mémoire, inséré parmi ceux de l’Académie des inscriptions, le comte de Caylus avait démontré : 1° que l’Apollon de Rhodes n’avait pas été construit à la bouche du port ; 2° que les vaisseaux n’avaient jamais passé entre ses jambes écartées. Cette assertion ne suffisant pas, on est allé plus loin ; on est allé à Strabon, qui ne souffle mot de ce que dit Vigenère. L’illustre géographe cite un fragment d’une épigramme en vers ïambiques, où se trouvent mentionnés le nom de l’auteur, Charès, de Lindos (ville de l’île de Rhodes) ainsi que les dimensions de son œuvre, 70 coudées. Strabon ajoute que le colosse gît à terre, renversé par un tremblement de terre et brisé aux genoux. « Les Rhodiens, dit-il, ne l’ont pas relevé, empêchés qu’ils en ont été par un oracle. » Et c’est là tout.





























