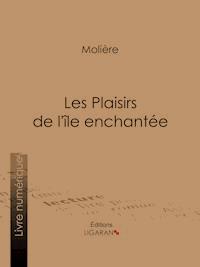
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le Roi voulant donner aux Reines et à toute sa cour le plaisir de quelques fêtes peu communes, dans un lieu orné de tous les agréments qui peuvent faire admirer une maison de campagne, choisit Versailles, à quatre lieues de Paris. C'est un château que l'on peut nommer un palais enchanté, tant les ajustements de l'art ont bien secondé les soins que la nature a pris pour le rendre parfait."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Plaisirs de l’Île enchantée, parmi lesquels figure, ce qui surtout ici nous intéresse, la pièce de Molière intitulée la Princesse d’Élide, sont restés une des fêtes les plus célèbres de Versailles. Cette suite de divertissements, appelée ainsi du nom donné aux premiers et principaux, que reliait l’un à l’autre la fiction d’une sorte de grande féerie en trois journées, dura du 7 mai 1664 au 13 inclusivement. Une autre œuvre en perpétuera le souvenir, plus encore que la Princesse d’Élide : l’histoire littéraire ne laissera jamais oublier que, le 12 mai, avant-dernier jour de cette semaine, Molière fit représenter, pour la première fois, devant ces invités de Louis XIV, trois actes du Tartuffe.
Nous avons de toute la fête de l’Île enchantée plusieurs relations : d’abord la relation officielle dans la Gazette, puis celle qui, depuis les premières éditions de la Princesse d’Élide, et, à leur exemple, dans la nôtre, sert de cadre aux cinq actes de cette comédie, et à laquelle Molière a pu avoir quelque part, notamment pour le passage relatif à la représentation des trois premiers actes du Tartuffe ; puis encore le spirituel récit de Marigny, que nous publions en appendice. Voltaire, dans son Siècle de Louis XIV, n’a pas dédaigné de consacrer à ces brillantes journées plusieurs pages. Enfin, récemment, M. Édouard Thierry a repris le même sujet dans un opuscule intitulé : la Troupe de Molière et les Plaisirs de l’Île enchantée ; et ce titre indique que l’auteur s’est plus occupé de la comédie de Molière que des autres divertissements auxquels elle était mêlée. Ces diverses relations suffisent, pour satisfaire la curiosité des amateurs des fêtes galantes ; nous n’avons à parler ici que de la Princesse d’Élide.
L’intention secrète de ces fêtes s’adressait, dit-on, à Mlle de la Vallière, depuis quatre mois relevée de ses premières couches ; mais, en apparence au moins, elles étaient destinées à la Reine mère et à la jeune Reine, Anne d’Autriche et Marie-Thérèse, toutes deux Espagnoles. Ce fut peut-être cette considération, de la patrie des deux reines, qui détermina Molière à choisir son sujet dans une des meilleures comédies du théâtre espagnol, el Desden con el desden, « Dédain contre dédain, » d’Augustin Moreto. Molière n’a fait que transporter dans l’antiquité et en Élide le sujet que Moreto a placé à Barcelone. Du reste, la donnée est toute semblable : Carlos cherche à vaincre l’insensibilité de Diana en affectant une insensibilité absolue à l’égard de l’amour : le succès de la ruse est le même dans Moreto et dans Molière. Seulement, chez l’auteur espagnol, l’intrigue est plus compliquée, les développements sont plus abondants, les caractères plus marqués. Pressé par le temps, Molière abrège et simplifie. Il n’a pu mettre en vers que le premier acte, une partie de la première scène du second ; le reste de la comédie est en prose, et encore la plupart des scènes, visiblement écourtées, portent-elles la trace de la précipitation avec laquelle cette pièce a été écrite. Ce qui prouve combien, plus tard aussi, le temps a toujours manqué à cette existence si laborieuse et si active, c’est que la Princesse d’Élide, jouée plusieurs fois à la cour, à des époques diverses, du vivant même de Molière, est toujours restée dans ce singulier état, sans que l’auteur ait jamais eu le loisir nécessaire pour lui donner au moins l’apparence de l’achèvement.
Représentée pour la première fois à Versailles le 8 mai 1664, la Princesse d’Élide fut reprise la même année, au mois de juillet, et jouée quatre fois à Fontainebleau, l’une au moins devant le légat d’Alexandre VII, le cardinal Chigi, venu pour apporter à Louis XIV les satisfactions exigées au sujet des violences commises par la garde corse du Pape contre les gens de l’ambassadeur de France, et auquel on cherchait à dissimuler ou au moins adoucir ce que cette ambassade avait de pénible, en lui faisant la plus splendide réception. Selon la Gazette, le légat trouva le spectacle « tout à fait agréable, et digne des plaisirs d’une cour si galante. »
En août 1669, la troupe du Roi va à Saint-Germain, et y représente quatre fois encore la Princesse d’Élide. La Gazette nous apprend qu’elle fut jouée devant un hôte nouveau de Louis XIV, le prince de Toscane. On voit que les occasions solennelles n’ont pas manqué à Molière pour terminer sa pièce : il ne put en profiter.
À la ville, la première représentation de la Princesse d’Élide avait eu lieu le 9 novembre 1664. Voici la liste des représentations :
C’était, en tout, vingt-cinq représentations à Paris. La mention de frais extraordinaires qui se trouve au Registre de la Grange, l’énumération qui en est faite dans un autre des registres de la Comédie, prouvent que la Princesse d’Élide fut donnée au public avec ses agréments de musique et de danse.
La pièce jouée de nouveau, nous l’avons dit, à la cour, ne le fut plus à la ville, du vivant de Molière.
Après sa mort, elle a été reprise plusieurs fois sous Louis XIV, et aussi sous Louis XV, et chaque fois son succès à la cour est plus sensible qu’à la ville. C’est aussi qu’à la cour on pouvait faire valoir l’œuvre du musicien avec celle du poète, et déployer un luxe de mise en scène interdit au théâtre de la Comédie. Lorsqu’en 1722, après avoir été redonnée au public, elle fut, le 14 février, jouée devant le Roi, l’Opéra tout entier concourut à l’exécution des intermèdes. En 1728 encore, elle fut reprise au mois d’août pour le public ; puis, au mois de décembre, elle fut représentée par ordre à la cour avec beaucoup de magnificence et d’éclat. La destinée de cette comédie semble avoir été de plaire surtout là où elle a été représentée la première fois ; et comme c’était pour la cour en effet que Molière l’avait écrite, on voit qu’au moins à cet égard il avait parfaitement atteint son but.
Depuis 1757, la pièce n’a plus été jouée au Théâtre-Français.
La distribution de la pièce dans sa nouveauté n’est pas douteuse comme celle de beaucoup d’autres. De même que pour toutes les comédies-ballets jouées à la cour, elle était indiquée dans le livret distribué aux spectateurs ; on la trouvera plus loin, p 140 et 141, et p 238.
Nous avons dit plus haut (p. 92, note 2), que Robert Ballard publia en 1664 un programme ou livret des Plaisirs de l’Île enchantée : nous en donnerons dans l’Appendice (p 234 et suivantes) toute la partie que ne rend pas inutile la Relation où est encadrée, dans notre édition, comme dans la plupart des précédentes, la Princesse d’Élide. Ce livret, de format in-4°, qui n’a point d’achevé d’imprimer, ne contient pas la comédie de Molière et s’arrête, avec le Ballet du Palais d’Alcine, à la fin de la troisième journée.
La Princesse d’Élide parut pour la première fois, chez le même libraire, dans un volume in-folio, imprimé la même année 1664, où nous n’avons pas trouvé non plus d’achevé d’imprimer. Le titre est :
LESPLAISIRSDE L’ISLEENCHANTÉE.
COVRSE DE BAGVE,
Collation ornée de Machines, Comediemeslée de Danse et de Musique, Ballet duPalais d’Alcine, Feu d’Artifice : Et autresFestes galantes et magnifiques ; faites par leRoy à Versailles, le 7 May 1664. Etcontinuées plusieurs autres Iours.
À PARIS
chez ROBERT BALLART, seul imprimeurdu Roy pour la Musique
M. DC. LXIV
AVEC PRIVILEGE DE SA MAIESTÉ
Ce volume, où la comédie de Molière est insérée, à sa place, dans la relation complète des fêtes, est de la plus grande rareté. Nous en avons vu deux exemplaires, dont l’un, avec reliure aux armes royales, est à la Bibliothèque nationale ; l’autre, aux armes de Colbert, appartenait à M. Ambroise-Firmin Didot. Cette édition a pour les deux premières journées 83 pages chiffrées, dont la dernière est marquée, par erreur, 71, et pour la suite 6 feuillets non chiffrés. Au haut du feuillet de titre de l’exemplaire de M. Didot est écrit, à la main : Bibliothecæ Colbertinæ. Dans le même exemplaire, le texte est accompagné de neuf grandes gravures, dessinées et gravées par Israël Silvestre, qui ne sont point dans le volume de la Bibliothèque nationale. Ces gravures sont de second état ; mais la bibliothèque de M. Didot renferme aussi ces neuf planches en premier état (c’est-à-dire sans aucun texte), ayant appartenu au roi Louis XIV. Il est possible que les gravures n’aient pu être prêtes pour l’édition de 1664 et que Colbert les ait fait joindre plus tard à son exemplaire. Peut-être ne furent-elles publiées qu’avec la belle réimpression du volume de 1664, faite à l’Imprimerie royale, et datée, au titre, de 1673, de 1674 à la fin du volume. Nous avons relevé un certain nombre de variantes dans cette édition, d’un format un peu plus grand que l’originale ; nous en avons trouvé un exemplaire à la Bibliothèque nationale, un autre dans celle de M. le baron James de Rothschild. Pour la distinguer du recueil de 1673, nous la désignerons par 1673a.
En 1665, il parut, avec un achevé d’imprimer du 31 janvier, une seconde édition, du format in-12, que, vu l’extrême rareté de l’in-folio de 1664, dont nous venons de parler, on considéra longtemps comme l’édition originale.
La première édition citée par Brunet, dans son Manuel du libraire (tome III, p 1803), de la Princesse d’Élide imprimée séparément et sans tout l’ensemble de la fête, est un in-12 de 1668, qui a néanmoins un titre dont le commencement ne convient qu’à cet ensemble : Les Plaisirs de l’Île enchantée ou la Princesse d’Élide, comédie de M. de Molière. On peut douter de l’exactitude de ce renseignement de Brunet : il y a à la Bibliothèque nationale un exemplaire de 1668 où la comédie n’est pas encore séparée de la Relation.
Les anciens recueils des Œuvres, à partir du premier (1666), donnent tous la Princesse d’Élide avec le cadre complet des Plaisirs, et mise à sa place dans ce cadre ; plus tard on l’a imprimée en tête et mis la Relation à la suite (voyez ci-après, p 107, seconde partie de la note).
Un des plus beaux in-folio de la collection Philidor, le n° 47, contient la copie de tout le texte des Plaisirs de l’Île enchantée (Relation, vers, devises, comédie), et celle de toute la musique que Lully composa pour les trois premières journées de ces fêtes, et qui dut beaucoup contribuer à leur agrément. Toute la moitié de cette copie qui est en dehors de la partition est tellement conforme à l’édition de 1682, qu’elle en a sans doute été simplement transcrite par Philidor. Nous avons cru ne devoir noter qu’un petit nombre de différences, et pouvoir négliger quelques rajeunissements de style, probablement involontaires, quelques changements et omissions dus aux distractions du copiste, ou à ses tentations d’abréger une tâche si longue ; mais la collation du texte original de 1664 avec les paroles mises en musique nous a fait recueillir quelques variantes et quelques détails de mise en scène qui nous ont semblé avoir leur intérêt.
Le catalogue suivant pourra donner une idée de l’importance qu’a la partition de Lully.
PREMIÈRE JOURNÉE : 1° une Ouverture ; 2° une Ire entrée pour les quatre Saisons, les douze Signes du zodiaque et les douze Heures ; 3° une Marche de hautbois pour le Dieu Pan et sa suite ; 4° un Rondeau pour les violons et flûtes allant à la table du Roi ; 5° une Suite du rondeau pour les violons et pour les flûtes.
SECONDE JOURNÉE, celle de la Princesse d’Élide. Avant le Ier intermède de la comédie : une Ouverture. À la scène Ire du Ier intermède : 1° une Ritournelle à deux parties hautes (de violons probablement) et basse chiffrée pour le Récit de l’Aurore ; 2° le Récit de l’Aurore, avec une basse chiffrée : ces basses chiffrées devaient indiquer un accompagnement de basse (de viole), de clavecin et de téorbe. À la scène IIde : 1° un trio, longuement développé, des Valets de chiens, avec une basse chiffrée pour l’accompagnement ; 2° une Entrée de Valets de chiens endormis ; 3° un deuxième Air de danse des Valets de chiens et des Chasseurs avec des cors de chasse ; 4° un troisième Air pour les Valets de chiens éveillés. – À la scène IIde du IId intermède : 1° un premier Air des Chasseurs et Paysans avec des bâtons ; 2° un deuxième Air pour les Chasseurs et Paysans. – À la scène IIde du IIIe intermède : 1° quelques phrases en récitatif, puis la première chanson du Satyre ; au-dessus du chant sont écrites deux parties de violons, et au-dessous une basse chiffrée ; 2° la seconde chanson du Satyre, accompagnée d’une simple basse chiffrée ; 3° une Ritournelle et Entrée pour les postures des Satyres (à trois parties seulement). – À la scène Ιre du IVe intermède : un premier air de Tircis. À la scène IIde : 1° un second air de Tirets ; 2° la chanson de Moron (Molière), suivie de deux phrases chantées par Tircis : tous ces airs sont accompagnés d’une basse chiffrée. – Au Ve intermède, une Ritournelle (à deux parties hautes et basse chiffrée), précédant le Dialogue de Clymène et Philis, qui est soutenu d’une basse chiffrée. – Au VIe intermède : 1° le premier couplet du Chœur de Pasteurs et de Bergères qui dansent ; le chant des quatre premiers vers est écrit à quatre parties, accompagnées d’une simple basse ; celui des deux premiers vers du refrain est donné à la voix haute, accompagnée d’une basse chiffrée ; puis le chœur achève, accompagné comme d’abord ; 2° un morceau écrit à cinq parties d’instruments ; 3° le second couplet du chœur, mais cette fois accompagné de six parties instrumentales, sauf pour les deux premiers vers du refrain chantés comme au premier couplet. On voit par la Relation (ci-après, p 217-219) que le compositeur avait réuni, pour l’exécution de ce finale à grand effet, toutes les voix et tous les instruments dont il pouvait disposer.
TROISIÈME JOURNÉE, où fut donné le Ballet du Palais d’Alcine. 1° Ire entrée, de quatre Géants et quatre Nains ; 2° IIde entrée, des huit Maures ; 3° IIIe entrée, des six Chevaliers et des six Monstres ; 4° IVe entrée, des Démons agiles ; 5° Ve entrée, des Démons sauteurs ; 6° VIe et dernière entrée, d’Alcine, Mélisse, Roger, et des Chevaliers.
L’édition d’Amsterdam de 1725 (4 volumes in-12), à laquelle Bruzen de la Martinière a peut-être donné quelques soins, et pour laquelle il paraît avoir composé une nouvelle Vie de Molière, contenant, comme le dit l’Avertissement, « bien des choses curieuses qu’on chercherait en vain dans les autres (éditions), » donne une Princesse d’Élide toute en vers, divisée en cinq actes, « telle qu’on la joue à présent sur le théâtre de Paris, » dit le titre ; et, comme pour faire croire que ces vers sont l’œuvre de Molière, l’éditeur nous apprend qu’elle n’avait « jusqu’à présent été vue (telle) qu’en manuscrit. » Telle qu’il la publie, il eût été difficile en effet de la produire en France.
C’est évidemment une autre version qu’on hasarda de réciter dans la maison de Molière, lors de la dernière reprise de décembre 1756. Le Mercure, qui parle de ces vers, est d’ailleurs loin d’en faire l’éloge ; il n’en rapporte rien et ne donne aucun renseignement sur l’auteur.
Nous ne savons pas davantage à qui attribuer et n’avons pas jugé autrement digne d’attention une Princesse d’Élide versifiée, qui fait partie d’un Recueil de pièces dramatiques anciennes et nouvelles, publié à Bouillon, Paris, Nancy, en 1785.
Une troisième traduction en vers a été imprimée (à Orléans) ; elle est comprise dans les « Pièces de Théâtre de M. Alexandre Pieyre, correspondant de l’Institut, » etc. (au tome Ier, 1811), sous ce titre : «





























