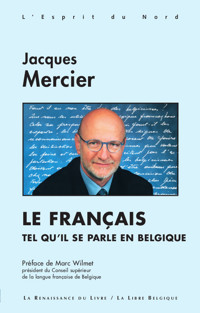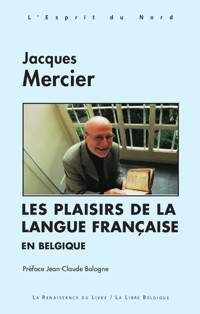
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Après le succès remarqué du
Français tel qu'il se parle en Belgique (2000), Jacques Mercier propose une "suite" intitulée :
Les Plaisirs de la langue française en Belgique.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Mercier est professeur émérite de l'université Paris-Sud Orsay.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Mercier
Producteur à la RTBF, créateur du Jeu des Dictionnaires et animateur de Forts en Tête, il est également l’auteur de nombreux ouvrages : romans, recueils de poésie ou beaux livres parmi lesquels Le Chocolat belge (éd. La Renaissance du Livre, 1997), Le Diamant (éd. La Renaissance du Livre, 1999), Le Grand Livre de l’eau (éd. La Renaissance du Livre, 2000) et À la table des grands chefs en Belgique (éd. La Renaissance du Livre, 2001). Il dirige également la collection “Les Maîtres de l’Imaginaire” (éd. La Renaissance du Livre).
Les textes de cet ouvrage ont été initialement publiés dans La Libre Belgique, entre 2000 et 2001. Pour la présente publication, il ont fait, de la part de l’auteur, l’objet d’une adaptation.
À Myriam, Qui a donné tout leur sens à certains mots.
Maquette :Fabienne Richard (Quadrato).
Correction : Isabelle Gérard.
Photographie de couverture : Aurélia Dejond.
© 2001,La Renaissance du Livre / La Libre Belgique www.renaissancedulivre.be ISBN 978-250705-3000
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
CollectionL’Esprit du Nord
Jacques Mercier
Les plaisirs
de la langue
française
en Belgique
Préface Jean-Claude Bologne
La Renaissance du Livre / La Libre Belgique
Préface
“L’homme qui apprendrait par cœur un dictionnaire finirait par y trouver du plaisir”, prétendait Flaubert. Et pourquoi pas ? Pourquoi le dictionnaire, plutôt, par exemple, que l’annuaire, les tables de logarithme ou les œuvres de M. François Coppée, est-il venu à l’esprit de l’ermite de Croisset quand il a cherché un exemple de tâche fastidieuse à laquelle la persévérance seule peut donner un attrait ? L’attitude est symptomatique des rapports ambigus que le Français entretient avec sa langue. C’est la plus belle, bien sûr, et pour cause, il n’en connaît pas d’autre ; c’est la matière d’innombrables chefs-d’œuvre, connus dans le monde entier, y compris la moitié de la Belgique, le quart du Canada et le cinquième de la Suisse. Mais c’est à coup de baguette qu’il en apprend les règles et du bout des lèvres qu’il utilise 0,3 % de son vocabulaire. D’ailleurs, depuis que la baguette a disparu des écoles, les règles se sont effacées des mémoires. Le français ? C’est beau comme un vase de Sèvres : dans une vitrine.
Quant au dictionnaire... On le sort pour les grandes occasions, quand il s’agit de convaincre l’interlocuteur de son bon droit, ou quand on écrit à un futur employeur. Pas étonnant qu’il ait si mauvaise presse. Le dictionnaire dicte, par définition ; le dictionnaire tape sur les doigts, sur les nerfs. Jadis, il plantait avec Littré de petites croix sur les mots hors d’usage, pour rappeler sans doute qu’il rime avec “cimetière”. Aujourd’hui, il vous juge, sourcils froncés, perruque en bataille : vieux, familier, populaire, vulgaire, ou pire, littéraire. Il rime toujours avec “cimetière”.
C’est pour cela que je suis attentif à tout ce qui nous apprend à aimer la langue plutôt qu’à la redouter, à utiliser les mots plutôt qu’à les ranger, à les juger ; tout ce qui nous rappelle que le français peut être ludique, magique, poétique, plutôt que scolaire et ennuyeux. Quand j’ai rencontré Jacques Mercier au Jeu des dictionnaires, c’est le mot “jeu” qui m’a d’abord séduit, et l’atmosphère que l’émission créait autour de la langue. Un mot inconnu, incongru, n’éveillait plus la honte de l’ignorance, mais l’enthousiasme de la découverte ; le mot connu, même, il arrivait qu’on le cache pour le plaisir de le redécouvrir. L’érudition cessait d’être pédante, et la connaissance, un fruit défendu. Qui a parlé de paradis ?
C’est cet enthousiasme et ce côté ludique que j’ai retrouvés dans les chroniques de La Libre Belgique et dans les recueils qui les rassemblent. Cette deuxième série propose aussi quelques jeux qui, au delà d’un enrichissement du vocabulaire, nous rappellent combien les mots aiment se frotter les uns aux autres, par homophonie, par communauté de racines, par champs sémantiques... Les mots, les expressions sur lesquels on s’interroge ne sont pas choisis au hasard des dictionnaires, mais au fil des conversations ou des rencontres. “L’autre soir, on me lance : C’est elle qui t’a monté le bourrichon !” La balise ? “Voilà un mot qui fut souvent utilisé le week-end dernier au cours des fêtes de Wallonie de Namur !” Le bestophe ? “Nous l’avons vu apparaître cet été comme titre d’une émission de télévision.” C’est avant tout le français dans son usage quotidien qui intéresse Jacques Mercier, car il rappelle que sur 1,2 million de mots (provisoirement) répertoriés, le français fondamental se contente de 3 500 termes environ. Si le chroniqueur aime dénicher quelques oiseaux rares, il ne se complaît pas dans une langue artificielle.
Les mots, les expressions, ne sont jamais détachés de leur terreau d’origine, de leur épaisseur historique, de leur emploi actuel. Comment comprendre “trier sur le volet” si l’on ignore que le mot désignait jadis une sorte de tamis destiné à trier les graines ? Comment expliquer “battre le briquet” sans évoquer la pierre à briquet,ou “de buten blanc” sans recourir à la langue militaire ? Mais à quoi bon ressusciter un passé mort s’il ne féconde plus le présent ? L’arrobe, poids jadis utilisé en Espagne, n’aurait aucun intérêt si le symbole @ qui le représente n’avait été remis à la mode par le courrier électronique.
C’est dans ce passage continuel du passé au présent que la langue reste un tissu vivant et non un outil inanimé. Dans les chroniques de Jacques Mercier, les mots vivent en liberté, et non parqués dans des zoos. S’il arrive à l’auteur de regretter une tournure fautive, d’en conseiller une meilleure, de rectifier un usage, ce n’est pas pour le plaisir malsain d’épingler une erreur, mais pour enrichir le discours ou éviter un malentendu. Souvent, le professeur est avec nous dans la classe et semble partager le plaisir de la découverte. Lorsqu’ilconstate que le fameux préfixe “e-” (electronic), utilisé désormais à tortet à travers dans sa prononciation anglaise (e-mail, e-commerce...), pourrait correspondre en français à un préfixe “i-” qui évoquerait “Internet” (i-jumelage), il s’en réjouit sans arrière-pensée : “C’est ce que j’appelle une belle opération de traduction !” On ne se sent plus coupable à lire ces chroniques. On se sent complice – on est à deux doigts de l’innocence... Qui a parlé de paradis ?
Pourtant, le ton peut se faire plus grave lorsque les structures fondamentales sont menacées. Le ravissement de l’explorateur n’est pas laxisme. Devant les excès du SMS, de l’orthographe phonétique ou du “macaronisme” internautique, on sent pointer l’inquiétude de l’amoureux sincère qui ne reconnaît plus sa langue. Le froncement de sourcils est passager, sans doute, car le ton n’est jamais professoral, mais le chroniqueur ne manque pas de nous signaler une alternative élégante. Jamais il ne nous impose une solution, mais nous savons à quoi nous renonçons par paresse ou par soumission aveugle à la mode. Gageons que sur la toile, quelques internautes francophones ou francophiles hésiteront désormais à sacrifier la “causette” au “chat”, le “fouineur” au “hacker” ou la “frimousse” au “smiley”... Non parce qu’une autorité pontifiante le leur aura interdit, mais parce qu’ils se seront sentis responsables de leur langue.
Jean-Claude Bologne,
philologue et écrivain
Choix bibliographique de Jean-Claude Bologne :
Dictionnaire commenté des expressions d’origine littéraire, éd. Larousse, 1989, 1999.Dictionnaire commenté des expressions d’origine biblique, éd. Larousse, 1991, 1999. Les Sept Merveilles, les expressions chiffrées, éd. Larousse, 1994. Voyage autour de ma langue, éd. Les Belles Lettres, 2001.
Jean-Claude Bologne est aussi l’auteur de romans (La Faute des femmes,éd.Les Éperonniers, prix Rossel 1989 ; Requiem pour un ange tombé du nid,éd.Fayard, 2001) et d’essais (Histoire de la pudeur, réed. Perrin, 1999, La Naissance interdite,éd. OlivierOrban, 1988 ; Histoire morale et culturelle de nos boissons,éd.Laffont 1991 ; Histoire du mariage en occident, réed. Pluriel 1998 ; Le Mysticisme athée,éd.Le Rocher, 1995) ; il est par ailleurs critique littéraire.
Introduction
L’utilisation de la langue française est un plaisir
La meilleure façon d’apprendre reste le jeu. Le titre Les plaisirs de la langue française en Belgique ne s’attarde donc pas seulement sur une quelconque et souvent captivante évasion, comme on le fait pour des jeux de lettres, mais aussi sur la notion d’apprentissage. Nous n’avons jamais fini d’apprendre et ce peut être même un signe de jeunesse que cette soif de connaître présente en nous. Le succès du premier volume, s’il nous a heureusement étonnés, nous a confortés aussi dans notre optimisme : vous partagez donc très nombreux cette envie de savoir, cette curiosité qui nous fait creuser jusqu’au Cœur des mots. Vos remarques, vos critiques, votre courrier (parfois électronique, j’y reviendrai) m’ont permis de dialoguer avec vous et ce n’est pas le moindre des intérêts de livres tels que ceux-ci. Nous allons poursuivre ensemble cette quête du sens et de l’origine des mots et des expressions avec de nouveaux billets parus dans le quotidien La Libre Belgique. Celui-ci, remarquons-le au passage, patronne également la célèbre dictée du Balfroid, qui associe le jeu, la compétition amicale et l’apprentissage de l’orthographe, tellement utile à l’âge des enfants en fin du premier cycle d’études.
Jean-Claude Bologne, qui me fait l’honneur et l’amitié de signer par ailleurs la préface, a écrit un essai remarquable sur la langue d’aujourd’hui, telle qu’elle est et telle qu’elle évolue, dans toutes ses composantes. “Nous habitons notre langue. Nous l’avons aménagée selon nos besoins, nos émotions, nos habitudes. S’il arrive que nous la violions, nos relations avec elle sont essentiellement du domaine de l’amour, et de la jalousie” (Voyage autour de ma langue, éd. Les Belles Lettres). Et de poursuivre : “J’aime choisir mes mots dans la garde-robe du vocabulaire, les conjuguer dans le lit (conjugal !) de la syntaxe, vêtir ma langue, au gré des modes, d’anglicismes (ses duffle-coat), de mots savants (ses uniformes) ou de néologismes féminisés (ses jupe-culottes).” L’auteur cite une anecdote amusante, que je reproduis volontiers pour vous : “On dit qu’à son patron qui lui reprochait des fautes d’orthographe, une secrétaire répliqua, piquée :“Dites donc, je connais mon français !” “Oui, le vôtre”, rétorqua le patron. L’un et l’autre avaient raison. Le français, c’est d’abord notre langue, à chacun d’entre nous, une langue personnelle forgée au cours des ans pour refléter au mieux nos propres pensées.”
Quant au jeu, vous pourrez vous y adonner sans honte dans la dernière partie du livre, où les homophones, expressions toutes faites, mots obsolètes ou vocabulaires spécialisés seront des prétextes à Jouer sur les mots et donc à mieux les connaître. C’est l’esprit des pauses du Jeu des Dictionnaires que vous retrouverez.
Une langue plus riche
“Si l’on parle de plus en plus l’anglais comme langue de communication courante sur la planète, le français reste très présent. Il a su conserver son image d’élégance et de raffinement à l’étranger. Cette permanence du prestige de notre langue est due à sa capacité conceptuelle et à son sens des nuances. Le français possède là un très net avantage sur la langue anglaise.” Ces propos rassurants de Henriette Walter dans Honni soit qui mal y pense (Laffont) doivent aussi nous inciter à mieux aimer notre langue, à l’entourer de nos soins, à ne pas trop la malmener. Ainsi l’auteur rappelle que certains emprunts à l’anglais sont malvenus en français. C’est le cas du “pub”, le débit de boisson, introduit dans les années 1970 et qui se lit comme “pub” de publicité. Mais ces termes ambigus disparaissent avec le temps et ses modes. Ainsi les mots auxquels on ajouta le suffixe “-ing” comme “footing”, mot qui n’existe pas en anglais, un comble ! Là aussi l’usage fait son choix, le “doping” est redevenu “dopage”, l’“aquaplaning” s’est traduit par le très francophone aquaplanage et le “living” est redevenu le “séjour”. Cela dit, Henriette Walter plaide non pour une guerre des langues mais pour une cohabitation qui peut devenir une histoire d’amour !
Nous ferons donc un sort aux mots franglais pour s’intéresser aussi aux Mots virtuels. Depuis quelque temps en effet une nouvelle forme d’orthographe a vu le jour sur les écrans des ordinateurs, sur les fenêtres verdâtres des téléphones portables. Comment évoluera-t-elle ? Pour le moment, les linguistes la qualifient de “macaronisme” parce qu’elle mêle plusieurs langues, l’anglais étant encore omniprésent dans ces nouveaux moyens de communication. Ainsi ces... “cyber-épistoliers” (néologisme utilisé dans la presse) écrivent plus facilement “Hi” que “Bonjour” pour des raisons évidentes de place. Mais c’est surtout l’orthographe phonétique qui étonne. Ainsi l’expression branchée “à plus !” largement répandue se traduit-elle par “A +” ; de la même façon le “c’est” est-il tout simplement transcrit par “C” et même “Je ne sais pas” devient couramment “Chais pas” ! Autre curiosité : l’intensité traduite dans les lettres, majuscules ou minuscules, répétées... On peut lire : Merciiiiiii ! ou Dépêêêêêêche !” La bande dessinée n’est pas loin quand on lit : “T’es fou !!!!!!!” Au rayon des dommages que cause cet usage, retenons l’absence d’accents, compte tenu de la difficulté de les trouver et de les encoder sur le tout petit clavier lorsqu’il s’agit du téléphone. Pour le reste, je crois que nous vivons une époque formidable, qui nous permet d’inventer des mots pour des concepts et des objets nouveaux. Nous en passerons quelques-uns en revue.
San-Antonio, grand iconoclaste et inventeur de la langue française et verte, avait écrit en forme de boutade : “ L’avenir du langage, c’est moi ! ” Il a raison : chacun de nous est dépositaire de l’avenir de la langue utilisée, en prolongeant son utilisation, en modifiant son sens, en y ajoutant des mots.
Jacques Mercier
I. Au cœur des mots
Le nombre de mots
Mais quel est le nombre de mots que contient notre belle langue française. Il faut tout de suite dire que le vocabulaire est probablement ce qui se modifie le plus vite dans une langue. André Gide notait déjà en 1904 dans son Journal : “Le nombre de choses qu’il n’y a pas lieu de dire augmente chaque jour”. De ce fait, l’évaluation du nombre précis de mots est difficile à réaliser. Depuis 1960 une équipe de chercheurs entreprend la rédaction d’un Trésor de la langue française avec un projet de seize volumes de mille quatre cents pages chacun. Le premier fut édité en 1971. On a recensé sur ordinateur les 175 000 mots différents dans les œuvres écrites aux xixeet xxesiècles, on y a ajouté 500 000 termes plus techniques, on y a joint à leur tour des centaines de milliers de néologismes enregistrés dans la langue depuis 1960, ce qui donne un total provisoire de 1 200 000 mots différents ! L’incroyable est que nous savons que dans la langue parlée, 1 500 mots suffisent pour le français “élémentaire” ou 3 500 mots pour le français “fondamental”. Avec ce mince bagage, on peut tenir une conversation quotidienne. Dans les années 1950, une enquête sur la langue parlée avait donné sur un total de 300 000 mots recueillis, seulement 8 000 mots différents et parmi eux 2 700 avec une seule apparition. Ce qu’il faut retenir c’est qu’existent les mots qu’on emploie – très peu – et les mots à notre disposition – des centaines de mille ! Gardons néanmoins en mémoire ce qu’écrit Alfred Tomatis : “Le don des langues n’est pas tant l’aptitude de les parler que celle de les entendre.”
Abracadabra
L’adjectif abracadabrant, qui signifie “extraordinaire et incohérent”, est né au xixesiècle du mot abracadabra entré lui-même dans notre langue française en 1560. Cette formule magique, que les enfants connaissent bien, provient de la langue hébraïque. Habracadabrah peut se traduire par “Que cela se passe comme c’est dit !” ou mieux “Que les choses dites deviennent vivantes !” Comme en hébreu les voyelles ne s’écrivent pas, la formule comporte dès lors neuf lettres : HBR, HCD, BRH. On peut les disposer de telle façon (c’est une explication de Bernard Werber dans L’Encyclopédie du savoir relatif et absolu) que l’on capte les énergies, une sorte d’entonnoir du ciel vers la terre... L’expression a été utilisée au Moyen Âge pour combattre les fièvres et bien sûr par les magiciens qui voulaient que les choses paraissent vivantes. Dans ses Ballades, Victor Hugo écrit : “De vos mains grossières,/ Parmi des poussières,/ Écrivez, sorcières : / Abracadabra.” Arthur Rimbaud de son côté a usé de son pouvoir de créateur poétique pour inventer un nouvel adjectif : abracadabrantesque ! On le trouve dans Le Cœur volé : “Ô flots abracadabrantesques, / Prenez mon cœur, qu’il soit lavé !”
Armistice
À propos de l’armistice de la guerre 14-18, que nous commémorons en célébrant l’anniversaire chaque 11 novembre, sachez que le mot (masculin, ne l’oublions pas !) a comme origine le mot armistitium du latin médiéval, composé de arma, “arme”, et de sistere, “arrêter”, sur le modèle de interstitium, “intervalle de temps” : soit suspension des armes. Le mot est critiqué, puis passe au féminin et enfin reprend toute sa force précisément avec l’arrêt des hostilités de celle qu’on appelle “la Grande Guerre”, c’est-à-dire la Première Guerre mondiale (l’arrêt de la Seconde est plutôt nommée “Victoire1”). On se souvient de la chanson intelligente de Georges Brassens : “Moi, mon Colon, celle que je préfère c’est la guerre de 14-18”. “Le 11 novembre 1918, un armistice, “généreux jusqu’à l’imprudence”, était accordé à l’armée allemande. Le soulagement des Français, après l’armistice du 11 novembre, qui mettait fin à plus de quatre ans de tuerie et d’angoisses, fut inexprimable”, explique Jacques Bainville dans son Histoire de France publiée en 1924. On dit conclure, signer un armistice, dénoncer l’armistice. Et le plus souvent l’armistice précède la conclusion d’une paix définitive.
1. Voir J. Mercier, Le Français tel qu’il se parle en Belgique, éd. La Renaissance du Livre, 2000, p. 210.
Audit
Le mot audit s’est répandu chez nous au cours des années 1970 en provenance de l’anglais (audit en anglais c’est “apurement, vérification des comptes”), mais avec une origine latine : auditus, “audition, ouïe”. Il s’agit donc de la procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion d’une entreprise. L’audit peut être interne ou externe. C’est devenu aussi la mission d’examen et de vérification de la conformité aux règles de droit, de gestion, d’une opération, d’une activité particulière ou de la situation générale d’une entreprise. On peut désigner la personne ou l’entreprise chargée de cette mission sous le même terme : un audit. Nous n’en sommes pas restés là, puisqu’ont suivi les mots auditeur et auditrice, dans la traduction bien sûr du mot anglais auditor, et le verbe auditer, en 1977, soit “contrôler sur le plan des finances et de la gestion”. On trouve, par exemple, dans une offre d’emploi parue cette année-là en octobre dans le magazine français L’Express : “Cherchons directeur chargé de conseiller et d’auditer les équipes marketing.” Évidemment, on comprend bien pourquoi ce mot s’est installé chez nous : il est du registre commercial, il est court, il a des racines communes, il est évident ! N’est-ce pas l’essentiel pour bien se faire comprendre ?
Avitaillement
Être Catering Manager à la SNCB est un travail intéressant qui concerne la restauration ferroviaire. On remarque une fois de plus que les termes anglais sont souvent donnés pour éviter les problèmes de traduction belgo-belge. Ce responsable l’est pour deux tâches : le service à bord et l’avitaillement. Oh, que voilà un joli mot et qui nous emporte loin du jargon anglo-saxon ! Le verbe avitailler nous vient du xiiiesiècle, formé de a (ad latin) qui marque le mouvement “vers” et de vitaille, “nourriture”, en ancien français. En principe, avitailler s’applique aujourd’hui à l’approvisionnement d’un navire en vivres et en matériel et au ravitaillement d’un avion en carburant. Mais pourquoi ne pas y ajouter le sens précis du travail sur un train ? L’avitaillement serait l’ensemble des opérations permettant de rassembler les denrées et les boissons ainsi que l’équipement pour assurer le service à bord. Toutes ces opérations ont lieu dans un centre d’avitaillement. Une fois que le train quitte la gare, l’avitaillement sera la restauration à la place, la vente des produits au bar buffet et la vente ambulante à l’aide d’un chariot qui traverse les différentes voitures (on ne dit “wagon” que pour les marchandises et les animaux) du train. Dans la gare de Bruxelles-Midi, existe donc le CAV-B, soit le Centre d’avitaillement de Bruxelles-Midi.
“Dans le Sud du Maghreb, le ksar est un centre de ravitaillement pour les nomades...” nous explique Augustin Bernard dans Afrique septentrionale et occidentale.
Balise
La balise est une chose qui indique le tracé d’une voie à suivre. La balise est aussi le fruit du balisier, une plante des régions chaudes originaire de l’Inde. Tout cela n’a d’autre part rien à voir avec le balèze (ou balaise), qui vient du provençal balès “gros”et désigne une personne forte physiquement ou intellectuellement ; souvent avec une connotation grotesque. Quoique ! Notre balise à suivre est d’origine portugaise. Au début du xvesiècle, la baliza était un dispositif de signalisation pour le repérage des ports. Il est passé par l’Espagne et puis est entré en France, devenant balise au cours du même siècle. Il s’appliquera au domaine de l’aviation et à celui de la route et du chemin de fer, au fil des découvertes. En réalité, le portugais l’a emprunté au bas latin palitium, qui avait donné l’ancien français palisse (et plus tard palissade). Retrouvons le mot dans l’éternelle Île mystérieuse de Jules Verne : “Le périmètre du corral fut donc tracé par l’ingénieur, et on dut procéder à l’abattage des arbres nécessaires à la construction de la palissade ; mais, comme le percement de la route avait déjà nécessité le sacrifice d’un certain nombre de troncs, on les charria, et ils fournirent une centaine de pieux, qui furent solidement implantés dans le sol.”
On sait aussi que balise est un mot du domaine de l’informatique. Il désigne une marque, un signe caractérisant.
Bestophe
Nous avons vu apparaître épisodiquement Le Bestophe comme titre d’une émission de télévision. Un peu comme Les Niouzz, il s’agit donc d’une francisation du mot et de l’expression anglaise : best of et news. Si le succès de telles émissions se confirme, il est fort possible que ces néologismes se maintiennent un temps dans notre langue. Ce n’est pas faute, pour best of, d’avoir attiré l’attention du public et des responsables sur les traductions possibles : “compilation, compile, succès, les meilleures chansons, anthologie, le meilleur de, l’optime” sont des substituts français plusieurs fois proposés. Ce qui est piquant, c’est que best of ne se trouve ni dans le dictionnaire français ni dans le dictionnaire anglais ! On trouve best-of-breed,“nec plus ultra” ou the best of luck ! (“bonne chance !”),mais pas ce résumé de deux mots. Cependant pour être de bon compte, notons que parmi les mots proposés celui de compile (souvent écrit “compil”) a suivi son petit bonhomme de chemin et est utilisé par les gens du métier ou les plus jeunes. C’est une réalité commerciale qui l’a imposé puisqu’il est dérivé de compilation, certes, mais surtout de la marque déposée “Compil’’. En 1990, les différents organismes de surveillance de la langue française proposaient une optime, dérivé du latin optimus, “le meilleur”, mais visiblement sans grand succès. On est loin de compilation, mot qu’utilisait Voltaire dans son Dictionnaire philosophique : “Cette compilation (livres sibyllins) fut publiée plusieurs fois avec d’amples commentaires, surchargés d’une érudition presque toujours étrangère au texte, que ces commentaires éclaircissent rarement.”
Bidule
Le mot bidule semble né dans les années 1940 et est sans doute un peu passé de mode. Ce fut le titre d’une très belle chanson de Paul Louka. Et d’ailleurs il baptisa Bidulement vôtre à la fin des années 1960 une émission de télévision, dont il fut le programmateur-présentateur-chanteur. Mais d’où vient ce mot ? Certains pensent qu’il est inspiré de bidoule, “mare boueuse”, dans le Pas-de-Calais et de berdoule, en rouchi. En picard, on dit aussi bédoule : “T’as tout plein d’bédoule à tés sorlés” (de boue sur tes souliers). D’autres affirment que les lycéens parisiens de l’après-guerre l’ont créé en s’inspirant de Sir Francis Biddle, procureur britannique au procès de Nuremberg. Pendant la guerre, bidule fut synonyme de “désordre” dans l’argot militaire. Par extension, c’est devenu plus couramment “machin, truc, petit objet quelconque”. “J’ai lu des choses, des machins, des trucs, des bidules, quoi !” écrit Jacques Prévert dans Choses et autres. Il désigne aujourd’hui le voyant lumineux des chauffeurs de taxis parisiens et aussi la longue matraque des unités de CRS.
Il y eut le verbe biduler qui donna ensuite bidouiller, soit arranger en bricolant, qui ne date que des années 1970. En 1975, on atteste bidouilleur.
Bistro(t)
Tout d’abord notons que le mot s’écrit indifféremment avec le “t” final ou sans celui-ci. Certains lui donnent une origine russe et l’anecdote raconte ceci : Le mot bystro en russe signifie “vite”. On raconte que les cosaques qui occupaient la ville de Paris en 1814 disaient “Bystro !” pour être servis plus rapidement. Mais cela semble inexact puisque le mot n’est enregistré que vers 1880 ! On a alors pensé au mot poitevin bistraud qui désigne le petit domestique aidant le marchand de vin. D’autres évoquent le mot bistingo, “cabaret” ou bistringue, une variante de bastringue... Dès lors on a pensé à une déformation de bistouille (mauvais alcool ou café mêlé d’alcool), de bis et touiller. Le bistro serait le lieu où l’on bistrouille, c’est-à-dire où l’on mélange du mauvais vin avec des produits chimiques. Finalement, on n’est sûr de rien. La vérité est que, depuis 1980, on appelle bistro non plus un café modeste mais plutôt un restaurant simple aux prix néanmoins élevés. “Dans son café-tabac-ministère, Guignebert avait davantage l’air d’être le patron du bistrot que le ministre de l’Information”, note Claude Roy (Nous).
Bobo
Les magazines branchés français, et surtout parisiens, utilisent à foison ce terme nouveau bobo. Le bobo fait partie d’une nouvelle race de consommateurs. Le terme est né aux États-Unis sous la plume de l’écrivain David Brooks, auteur du best-seller Les Bobos au paradis. On pense aussi à une origine plus française puisque Guy de Maupassant l’aurait utilisé dans Bel Ami en parlant de son personnage de Clotilde de Marelle il y a plus d’un siècle. Le bobo fait partie de la nouvelle classe dominante qui émergea avec l’ère de l’informatique. Il déteste l’alcool et le tabac. Il élève ses enfants avec une force tranquille et tolérante. Il fait partie des métiers de la publicité, des médias, du spectacle, de la mode. Il mange bio. Portefeuille à droite, il vote écolo. Autant dire que les commerciaux lui proposent des articles branchés mais proches du naturel, des vêtements chers mais sportifs. Le bobo se veut décalé mais pas rebelle. Et le mot lui-même ? Il groupe justement les premières syllabes de “bourgeois” et “bohême” qui définissent sa philosophie de vie. Ainsi ce dialogue entre deux bobos qui accompagne un dessin humoristique : “Le paradis ce serait un ordinateur bio, cultivé à la campagne, première pression à froid !” Et son interlocuteur de renchérir : “Et éthique !” Mais, si vous pensez que la mode est éphémère, vous pouvez garder au mot bobo son sens de “mal anodin” que chantait si bien Alain Souchon en téléphonant à sa mère : “Allô Maman, bobo !”
Bourrichon
L’autre soir, on me lance : “C’est elle qui t’a monté le bourrichon !” et je me suis donc demandé d’où venait cette expression plutôt que de répliquer, ce qui est un des avantages d’avoir la curiosité de sa langue. Il s’agit du diminutif de bourriche, “panier”, qui désigne la tête dans le langage populaire et correspond bien à son sens : “se monter la tête”. Gustave Flaubert a beaucoup aimé cette expression. On trouve dans ses Correspondances : “Je me perds dans toutes ses histoires. Il passe sa vie à se monter et à se démonter alternativement le bourrichon.” Il crée même des variations autour de l’expression. Ainsi lit-on ailleurs : “Il a le bourrichon très monté” ou “J’ai besoin de quelque chose d’extravagant pour remonter mon pauvre bourrichon.” Quand l’expression n’est pas pronominale, elle devient beaucoup plus péjorative : “Monter le bourrichon à quelqu’un”, c’est alors le tromper, lui donner des illusions. Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust écrit : “Non, c’est probablement sa petite grue qui lui aura monté le bourrichon. Elle lui aura persuadé qu’il se classerait parmi les intellectuels.”
Brimborion
Certains parents donnaient le petit nom de brimborion à leurs enfants lorsqu’ils étaient gentils et celui d’hurluberlu lorsqu’ils ne l’étaient pas. Quel étonnement d’apprendre que ce mot brimborion est l’abréviation du latin ecclésiastique brevarium, “livre de prières”. Ce sens a disparu au xviesiècle pour désigner ensuite une petite chose insignifiante le plus souvent, mais également quelqu’un de petite taille. “Le mouvement des humains, en bas, paraît s’accélérer, et sur le quai des brimborions s’empressent”, écrit A. Pieyre de Mandiargues dans La Marge. Le mot cependant est surtout utilisé au pluriel et désigne de menus objets de peu de valeur, synonyme de babioles. Ainsi Eugène Delacroix note-t-il dans son Journal : “Grande interruption dans ces pauvres notes de tous les jours : j’en suis très attristé ; il me semble que ces brimborions, écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu’elle s’écoule.”
Bulbe
Le mot bulbe est emprunté au xve siècle au mot latin bulbus, “oignon, partie renflée de la racine d’une plante”, qui lui-même vient du grec bolbos, “oignon de plante”. À l’origine et jusqu’au xviiiesiècle, le mot était féminin, il prit le genre masculin en passant dans le domaine de l’anatomie, où il désigne le renflement de certains organes, tels le bulbe de l’œil ou le bulbe rachidien. “Ces centres ganglionnaires commandent à tous les organes, règlent leur travail. D’autre part, grâce à leurs relations avec la moelle, le bulbe, et le cerveau, ils coordonnent l’action des viscères avec celle des muscles”, explique Alexis Carrel dans le célèbre L’Homme, cet inconnu. Par analogie de forme, le bulbe est aussi l’appellation de certaines coupoles dans l’architecture orientale, notamment russe. Aujourd’hui on parle aussi de bulbiculture et de bulbiculteur pour la culture des plantes à bulbes, et en particulier des tulipes. J’aime aussi le mot bulbille, qui désigne un petit bulbe qui se développe sur les organes aériens de certaines plantes.
“Un vieil homme tout moussu de barbe vend des perce-neige en pied, avec leur bulbe gangué de terre, et leur fleur en pendeloque qui a la forme d’une abeille”, écrit Colette dans La Vagabonde.
Caboulée
Caboulée est un mot savoureux parmi des centaines d’autres qu’il nous est loisible de découvrir dans les romans truculents d’Arthur Masson (“le Pagnol wallon”, comme qualifie le titre d’un livre qui lui est consacré1). Dans son deuxième livre Toine, maïeur de Trignolles, je lis dans le chapitre viii : “Tout de même, il atteignit ainsi l’angélus de midi. Mangeant ses pommes de terre grillées dans la braise, il grogna :
– Dji commince à n’n’awè assè di c’caboulée-là.
Il ne mangea donc que neuf pommes de terre, mais but beaucoup. Pendant qu’il mangeait, le soleil languide se dévoila un peu.” Une caboulée désigne en Wallonie une “chaudronnée destinée aux porcs”.
Et ce superbe adjectif peu usité languide ? C’est une version littéraire des mots mêlés “langoureux” et “languissant”. Il est d’origine latine : languidus veut dire “affaibli, amollissant”. En revanche le verbe languir est toujours bien en usage, en particulier dans faire languir, faire attendre longtemps, languir d’ennui ou se languir de, souffrir de l’absence de quelqu’un, qui est employé surtout dans le sud de la France. Dans Britannicus de Jean Racine, on récite :
“Ne faites point languir une si juste envie
Allez. Et nous, Madame, allons chez Octavie.”
Quant à alanguir, c’est un verbe transitif signifiant “rendre languissant”.
1. Christian Defaux, Arthur Masson, un Pagnol wallon, éd. La Renaissance du Livre, 2000.
Camaïeu
“Enfin, pour orner ses thermes comme pour peindre La Bataille d’Alexandre ou le portrait de La Boulangère, Rome, en peinture et en mosaïque, pratiquait un camaïeu d’ocres, hérité ou non des vases grecs.” Je cite André Malraux dans La Métamorphose des dieux pour ce mot étrange et pour tout dire fascinant qu’est camaïeu. C’est un mot venu du xiiesiècle : de l’arabe qamaeil, pluriel de “bouton de fleur”. Il s’est transformé en camaü et puis en kamaheu, “camée”. Le camée (c’est bien un nom masculin malgré sa finale) est une agate (améthyste ou onyx) sculptée en relief. Pierre Loti dans Jérusalem parle de “ces aimables prêtres arméniens aux profils de camée”. C’est aussi une peinture imitant parfois les bas-reliefs, où l’on n’emploie qu’une seule couleur avec des tons différents. C’est enfin une œuvre littéraire empreinte de monotonie ou d’une extrême discrétion. En principe, on doit dire des “camaïeux”, même si de grands auteurs ont utilisé le “s” pour noter la marque du pluriel.
Lorsqu’on dit en camaïeu, c’est être ton sur ton. Cela se dit en mode pour les couches de vêtements ou en gravure, en photographie.