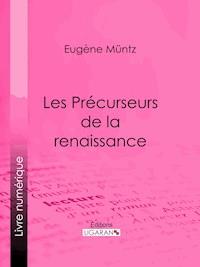
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait :"Ce n'est pas l'histoire des origines de la Renaissance que je présente au lecteur : retracer quelques-uns des épisodes qui caractérisent le mieux la reprise des études classiques, ces études qui ont renouvelé toutes les faces de la civilisation, telle est mon unique ambition."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335102123
©Ligaran 2015
Ce n’est pas l’histoire des origines de la Renaissance que je présente au lecteur : retracer quelques-uns des épisodes qui caractérisent le mieux la reprise des études classiques, ces études qui ont renouvelé toutes les faces de la civilisation, telle est mon unique ambition. Sous le titre de Précurseurs, je comprends ceux qui en Italie, ou plus exactement en Toscane, ont pressenti et ceux qui ont préparé l’avènement des idées nouvelles, artistes, archéologues, amateurs, depuis le XIIIe jusqu’au XVe siècle, depuis Frédéric II et Nicolas de Pise, jusqu’à Laurent le Magnifique. Mon travail ne dépasse pas le moment où la Renaissance sort de la période des tâtonnements et des luttes pour entrer dans celle du développement normal et régulier : avec Mantègne, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphael, l’ère des « chercheurs » prend fin ; celle des « trouveurs » commence ; par l’effet de leur génie, la Renaissance parvient en peu d’années à son complet épanouissement.
En comparant les progrès de la littérature à ceux de l’art, on ne peut s’empêcher de remarquer combien est variable et ondoyante l’influence que les milieux, pour nous servir d’un terme consacré, exercent sur les différentes formes de la pensée. L’écart se chiffre souvent par des siècles entiers. Parmi les grands noms qui personnifient le réveil des idées classiques, celui de Nicolas Pisano est le premier en date : le rénovateur de la statuaire italienne précède de près de soixante-dix ans les rénovateurs des humanités, Pétrarque et Boccace. Mais sa tentative était prématurée : bientôt, devant l’invasion du style gothique, le souvenir de l’antiquité se perd de nouveau dans le domaine des arts, tandis que, dans celui de la littérature, il acquiert de jour en jour plus d’intensité. Lorsque, au début du XVe siècle, les deux géants florentins, Brunellesco et Donatello, essayent de remettre en honneur les préceptes de leurs prédécesseurs grecs et romains, la culture générale s’était singulièrement développée ; ils pourront s’appuyer, dans leur tentative, sur un ensemble de connaissances qui avait complètement fait défaut aux contemporains de Nicolas Pisano. La peinture, à son tour, sera en retard sur l’architecture et la sculpture : à Florence l’influence des modèles classiques ne s’y fait sentir que vers la fin du XVe siècle ; auparavant le naturalisme y domine.
J’ai cru nécessaire d’insister tout particulièrement dans ces recherches sur une classe de champions de la Renaissance qui a été jusqu’ici trop négligée par les historiens d’art, je veux parler des archéologues et des collectionneurs. Mes efforts n’auront pas été stériles si j’ai réussi à montrer quels services ils ont rendus à l’art vivant : telle des médailles ou des pierres gravées conquises pour leur cabinet a été reproduite à l’infini par les artistes de leur temps ; leurs études, en apparence si abstraites, ont fourni aux novateurs la base scientifique dont ils avaient besoin. Parmi ces auxiliaires les Médicis occupent naturellement la place d’honneur ; des documents inédits m’ont permis de restituer le magnifique ensemble de leur musée et de définir le rôle joué par cette famille illustre, à laquelle l’Europe doit sa première École des Beaux-Arts.
La Renaissance, plusieurs fois menacée à Florence même, n’était pas suffisamment affermie lors de la mort de Laurent le Magnifique, pour que Savonarole ne pût espérer d’avoir raison d’elle. Plusieurs années durant l’antiquité est de nouveau proscrite. Mais le courant ne tarda pas à emporter ce dernier obstacle : Savonarole tombe, et l’héritier des Médicis, le fils de Laurent, Léon X, consacre définitivement, dans l’ordre littéraire et artistique, le triomphe des idées classiques.
Quelque éclatante que soit la Renaissance du XVIe siècle, la période antérieure, celle que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de première Renaissance, a droit, croyons-nous, à plus de sympathie, sinon à autant d’admiration. Tous les sentiments généreux se raniment au contact de l’antiquité. L’humanité redevient jeune en s’inspirant des souvenirs d’un passé déjà si lointain ; elle retrouve un idéal en regardant en arrière : la radieuse civilisation hellénique apparaît à ses yeux éblouis. Cependant si sa foi est ardente, si son enthousiasme est sans bornes, elle n’en sait pas moins se garder du défaut capital de la génération suivante : l’intolérance. Conciliation, progrès régulier et pacifique, tel est son mot d’ordre. En songeant aux excès du XVIe siècle, à la rapide décadence qui suivit l’âge d’or de la Renaissance, on regrette parfois de voir finir sitôt l’ère des Précurseurs.
Introduction. – Le XIIIe et le XIVe siècle. – Culte de l’antiquité à la cour de Frédéric II.– Nicolas de Pise et ses élèves. – Jean de Pise. – Les sculpteurs de la cathédrale d’Orvieto. – Giotto et son école. – Ambrogio Lorenzetti. – L’archéologie chez Dante et chez Pétrarque. – Cola di Rienzi. – Les collectionneurs et archéologues de Trévise et de Padoue. – L’art du médailleur retrouvé dans l’Italie septentrionale.
La renaissance des arts, c’est-à-dire la résurrection, aux approches du XVe siècle, des idées et des formes de l’antiquité classique, a été précédée d’efforts individuels qui n’ont le plus souvent pas abouti, mais dont il est nécessaire de tenir compte dans l’histoire de cette grande révolution. Les souvenirs plastiques du monde gréco-romain ont joué dans les préoccupations du Moyen Âge un rôle plus considérable qu’on ne le croit d’ordinaire. La force même des choses mettait à chaque instant nos ancêtres en présence des chefs-d’œuvre du passé : bon gré, mal gré, il fallait les regarder. Les uns ont vu en eux des monuments de l’idolâtrie, et à ce titre les ont réprouvés ; d’autres leur ont attribué des vertus magiques ; d’autres encore se sont laissés aller à l’admiration que leur causaient l’immensité des ruines romaines, la richesse de la matière première, la perfection de la main-d’œuvre. Ceux-ci, on peut l’affirmer, ont été les plus nombreux. Même pendant la période la plus sombre du Moyen Âge, l’Europe entière a subi la fascination que Rome, la ville antique par excellence, exerce depuis bientôt vingt siècles. Ce qui, de près ou de loin, attirait chaque année des milliers de visiteurs sur les bords du Tibre, ce n’était pas seulement la promesse des indulgences, le désir de prier sur les tombeaux des martyrs, de contempler les basiliques resplendissantes d’or et de pierres précieuses, c’étaient aussi les souvenirs laissés par les Césars. Après s’être entretenu avec une sorte d’incrédulité des merveilles de cette cité incomparable, on supputait avec stupéfaction le nombre de ses temples, de ses palais, de ses thermes, de ses amphithéâtres : des auteurs dignes de foi ne racontaient-ils pas qu’elle avait possédé jadis 36 arcs de triomphe, 28 bibliothèques, 856 bains publics, 22 statues équestres en bronze doré, 84 statues équestres en ivoire, des obélisques, des colosses innombrables ! Dès le XIIe siècle l’imagination populaire s’empare de ces témoignages, les transforme et les amplifie. Les légendes les plus bizarres prennent naissance et se répandent rapidement dans des ouvrages qui font autorité : la Descriptio plenaria totius urbis, la Graphia aurea urbis Romœ, enfin les Mirabilia civitatis Romæ. À la fin du XVe siècle encore, notre vaillant Charles VIII, voulant donner à ses sujets une idée de la ville dans laquelle il venait d’entrer, la lance au poing, fit traduire à leur usage un de ces recueils d’un autre âge. Quelques extraits, que je rapporte avec leur vieille orthographe, montreront avec quelle foi robuste on accueillait dans notre pays, jusqu’aux approches de la Renaissance, ces contes dignes des Mille et une Nuits :
« Dedens le Capitole estoit une grande partie du palais d’or aorné de pierres precieuses, et estoit dit valoir la tierce partie du monde, auquel estoient autant de statues d’ymages qu’ils sont au monde de provinces : et avoit chascune ymage ung tambourin au col disposé par art mathématique, si que quant aucune région se rebelloit contre les Rommains : incontinent l’ymage de cette province tournoit le dos à l’ymage de la cité de Romme, qui estoit la plus grande sur toutes les autres comme dame : et le tambourin qu’elle avoit au col sonnoit. Et adonc les gardes du Capitole le disoient au Sénat, et incontinent ils envoyoient gens pour expugner la province. »
DES CHEVAULX DE MARBRE
« Les chevaulx et hommes nuz dénotent que au temps de l’empereur Tyberii furent deux jeunes philosophes, c’est assavoir Praxiteles et Phitias, qui se dirent estre de si grande sapience que quelque chose que l’empereur, eulx absens, diroit en sa chambre, ilz le rapporteroient de mot à mot. Laquelle chose lz firent ainsi qu’ilz dirent. Et de ce ne demandèrent point de pécune, mais mémoire perpétuelle : si que les philosophes auroient deux chevaulx de marbre touchant à terre, qui dénotent les princes de ce siècle. Et qu’ilz sont nuz auprès des chevaulx dénote que les bras haulx et estendus et les doys reployez racontoient les choses advenir, et ainsi comme ilz sont nuz, ainsi la science de ce monde en leurs entendemens estoit nue et ouverte. »
De l’admiration à l’imitation il n’y a qu’un pas. Les artistes, à leur tour, se mettent à l’œuvre et puisent sans scrupules dans un héritage ouvert à tous. Sans doute plus d’un de ces emprunts est inconscient, ou bien ne sert qu’à faire éclater l’immense infériorité du copiste. L’influence de l’antique en est-elle moins saisissante ? Il faut surtout rappeler, dans cet ordre d’idées, les splendides créations des architectes de la période romane, le dôme, le campanile et le baptistère de Pise, le baptistère de Florence et la basilique de San Miniato, le dôme de Lucques et tant d’autres chefs-d’œuvre élevés à l’aide de principes que les novateurs de l’âge suivant, les champions du style gothique, devaient si audacieusement fouler aux pieds.
Analyser les sentiments dont les monuments antiques ont été le point de départ chez les hommes du Moyen Âge, dresser la liste des emprunts qui y ont été faits à partir de l’ère carlovingienne, serait un travail considérable et qui mériterait de former la matière d’un ouvrage distinct. Nous l’entreprendrons quelque jour. Mais comment ne pas accorder ici un souvenir à Nicolas Crescentius (le fils du célèbre tribun), qui, dès le XIe siècle, poussé par le désir de renouveler l’antique splendeur de Rome (« Romæ veterem renovare decorem »), fit construire avec des fragments antiques l’élégante petite maison du Ponte Rotto ! L’empereur Frédéric Barberousse (1121-1190) se souvint également de ces « antiquailles », lorsqu’il fit graver sur son sceau une vue de Rome, avec le Colisée. Mais c’est à son illustre petit-fils, Frédéric II (1184-1250), que revient l’honneur d’avoir plaidé le premier la cause de la Renaissance : il a le droit de figurer en tête des Précurseurs. Nous possédons de nombreux témoignages de son amour pour les monuments de l’art antique. Tantôt nous le voyons faire frapper les « augustales », ces imitations curieuses des monnaies de l’Empire romain, portant d’un côté son effigie couronnée de lauriers, avec l’épigraphe AVG. IMP. ROM. , et drapée à la façon des Césars ; de l’autre un aigle, les ailes éployées, avec l’épigraphe FRIDERICVS ; tantôt il achète pour une somme considérable, 230 onces d’or, une coupe d’onyx et d’autres curiosités. À Grotta Ferrata il enlève deux bronzes, une statue d’homme et une statue de vache servant de fontaine, pour les transporter à Lucera. L’église Saint-Michel de Ravenne lui fournit les colonnes monolithes dont il a besoin pour ses constructions de Palerme. Il entreprend même des fouilles, près d’Augusta, en Sicile, dans l’espérance de mettre à jour quelques vestiges de l’antiquité. Une fois, il est vrai, obéissant à d’impérieuses nécessités, il fit démolir plusieurs monuments romains de Brindes pour en employer les matériaux à la construction d’une citadelle ; il s’agissait, au moment de son départ pour la Palestine, de mettre la ville à l’abri d’un coup de main ; la raison d’État l’emporta sur les scrupules de l’antiquaire. – Il nous faudra attendre longtemps avant de retrouver une vue aussi nette de la supériorité de l’art antique.
L’œuvre rêvée par Frédéric II, en tant qu’amateur, son contemporain Nicolas de Pise (1207 (?)-1278) l’a réalisée en tant qu’artiste. Comment ne pas accorder une place d’honneur dans notre travail à ce Précurseur par excellence qui, en plein XIIIe siècle, a érigé en principe l’imitation de l’antique, et qui s’en est servi comme d’un miroir pour mieux voir la nature ! Sa tentative nous semble prodigieuse aujourd’hui encore ; elle suppose une puissance d’initiative que les Giotto, les Brunellesco, les Donatello, les Van Eyck ont à peine égalée. L’imitation ne se borne pas chez lui aux accessoires : ornements, costumes, armures ; elle ne se borne pas aux types ni aux proportions des figures, qui sont toutes trapues, comme dans les sarcophages romains de la décadence : l’esprit même de ses compositions, si graves, si austères, rappelle les modèles antiques.
L’érudition s’est appliquée dans les derniers temps, avec une ardeur singulière, à déterminer la patrie de Nicolas, ainsi que les origines de son style. Le maître est-il né en Toscane ou dans la Pouille ? A-t-il étudié sur les bords de l’Arno ou sur ceux de la mer Tyrrhénienne ? Les savants les plus autorisés n’ont rien négligé, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, pour résoudre ce double problème. Le doute était permis, en effet. Dans un document de 1266, Nicolas de Pise est qualifié de « Nicolaus Petri de Apulia ». On a traduit sans hésiter : « Nicolas, fils de Pierre, originaire de la Pouille ». Mais le dernier en date des commentateurs de Vasari, M. G. Milanesi, a voulu serrer de plus près la difficulté, et il a découvert qu’en Toscane même deux localités portaient le nom d’Apulia, l’une située près de Lucques, l’autre près d’Arezzo. C’était restituer du coup à la Toscane un fils dont elle peut à juste titre se montrer fière. M. Milanesi a complété sa découverte en soumettant à un nouvel essai de déchiffrement le fameux document qui donne Sienne pour patrie au père de Nicolas. Avant lui on avait lu : « Magistro Nichole quondam Petri de Senis ser Blasii Pisani ». À cette leçon erronée il faut substituer désormais celle de : « Magistro Nichole quondam Petri de Capella sancti Blasii Pisa… », c’est-à-dire : « maître Nicolas, fils de feu Pierre, de la paroisse de Saint-Blaise, à Pise ».
Si les revendications du patriotisme local étaient seules en cause, nous n’insisterions pas. Mais à cette question de nationalité se lie un problème d’un ordre supérieur. Où et comment s’est formé ce novateur de génie, dans quelles conditions s’est opérée la révolution, vraiment prodigieuse, à laquelle il a attaché son nom ? A-t-elle été préparée par des maîtres de second ordre, dont Nicolas n’a fait qu’appliquer les principes ; ou bien la toute-puissance du génie a-t-elle suffi pour provoquer cette brusque rupture avec le passé ? Si l’on admet, comme MM. Crowe et Cavalcaselle, Springer, Schnaase et d’autres archéologues, que notre maître ait étudié dans l’Italie, méridionale, où, sous l’influence de l’art byzantin plutôt que sous celle de l’art antique, la sculpture était alors relativement florissante, la genèse de ses idées s’explique de la manière la plus naturelle : il se serait inspiré des ouvrages aujourd’hui encore conservés à Capoue, à Salerne, à Amalfi, à Troja ; si, au contraire, comme l’affirment MM. Perkins, Dobbert, Milanesi, Hettner, Bode, il a reçu sa première instruction dans la Toscane même, quel effort prodigieux ne lui a-t-il pas fallu pour s’élever à ce point au-dessus des grossiers tailleurs d’images de Pise, de Florence, de Pistoie, de Lucques, pour entrevoir, à travers la nuit du Moyen Âge, la radieuse antiquité classique, pour créer de nouveau un art et un style !
Cette seconde hypothèse, qui est d’accord avec le témoignage de Vasari, a aujourd’hui pour partisans tous les esprits impartiaux. Les éléments constitutifs du style de Nicolas de Pise peuvent tous se ramener aux modèles dont l’artiste disposait dans sa ville natale même : à savoir les sarcophages ou les vases aujourd’hui conservés au Campo Santo et, parmi eux, en première ligne, le sarcophage qui représente l’histoire de Phèdre et d’Hippolyte, et qui reçut les ossements de la comtesse Béatrix, la mère de la fameuse comtesse Mathilde. Il compléta ces premières informations par des voyages entrepris dans les différentes villes de la Péninsule. On sait en effet que, à la fois architecte et sculpteur, successivement employé par Frédéric II et par Charles d’Anjou, par les Padouans, les Florentins, les Pisans, les Bolonais, les Pérusins, Nicolas eut l’occasion de parcourir l’Italie du nord au midi. Les innombrables antiques, alors encore répandues en tous lieux, lui fournirent l’enseignement le plus complet qu’un artiste pût ambitionner. À Venise, il étudia probablement les chevaux de bronze transportés dans cette ville en 1205 ; à Rome, les chevaux de Monte Cavallo, la statue équestre de Marc-Aurèle, la louve de bronze ; à Pavie, la fameuse statue équestre connue sous le nom de Regisol (les chevaux si fringants introduits dans les chaires de Pise et de Sienne prouvent à quel point il s’inspira, sous ce rapport, des modèles antiques), sans compter les œuvres moins monumentales dispersées jusque dans les moindres villages.
Chaire du Baptistère de Pise.
Dans son remarquable travail sur les origines du style de Niccolò Pisano, M. Dobbert a relevé les nombreux emprunts faits par son héros à ces antiquités pisanes qui devaient, trois siècles plus tard, inspirer encore Benvenuto Cellini. Nous suivrons, dans cette analyse, l’ordre même des sujets représentés sur la chaire du baptistère de Pise. Dans l’Annonciation, Marie rappelle une figure de femme, pleine de dignité, sculptée sur un sarcophage du Campo Santo. Dans la Nativité, l’artiste semble avoir pris pour modèle de sa Vierge la figure qui orne un petit vase d’albâtre, également conservé au Campo Santo ; dans l’Adoration des Mages, au contraire, il a copié, comme on sait, la Phèdre du fameux sarcophage de la comtesse Béatrix. Les chevaux représentés dans ce bas-relief procèdent de ceux du même sarcophage. Anna, dans la Présentation au temple, rappelle de la manière la plus frappante la nourrice de Phèdre, telle qu’elle est figurée sur un sarcophage conservé à Saint-Pétersbourg, au musée de l’Ermitage. L’homme barbu que l’on aperçoit dans le même compartiment ressemble, à s’y méprendre, au Bacchus indien figuré sur le beau vase antique du Campo Santo. Dans le Jugement dernier, enfin, on peut rapprocher un des diables d’une représentation très fréquente dans l’art antique : un génie se cachant le visage derrière un masque.
Les figures allégoriques de la chaire du baptistère témoignent d’une étude non moins assidue de l’art antique. Comme personnification du courage (Fortitudo), Nicolas a choisi Hercule. Notons cependant ici une lacune dans son érudition archéologique : si les formes athlétiques du héros rappellent bien le type consacré, en revanche, sa figure imberbe le fait trop ressembler à Apollon.
Les prédilections, ou plutôt le culte, de Niccolò Pisano s’affirment avec non moins de force dans un monument auquel on a assigné jusqu’à ces derniers temps la date de 1233, tandis qu’il est en réalité contemporain de la chaire du baptistère : nous voulons parler des bas-reliefs de la cathédrale de Lucques, et surtout de la Déposition de croix. En plaçant parmi les acteurs de cette scène lugubre un soldat chaussé de brodequins, la poitrine couverte d’une cuirasse, dont le bord inférieur est garni d’une jaquette de cuir, un manteau jeté sur les épaules, l’artiste s’est souvenu des hastaires de la Rome impériale, non des fantassins de son temps.
Des accents de même nature frappent dans la châsse de saint Dominique, à Bologne, l’Arca di san Domenico, sculptée par Nicolas en 1267. Dans le cheval tombé, l’artiste semble s’être servi de notes prises sur des sarcophages conservés à Rome. On remarque en outre une figure imitée d’un des esclaves du Capitole, et un éphèbe vêtu de la tunique grecque.
La chaire de Sienne (1266-1268) nous offre un exemple non moins caractéristique de l’ardente curiosité qui portait le fondateur de l’École pisane à rechercher partout les vestiges de ce monde détruit. Une des figures assises au pied du monument, celle qui tient une corne d’abondance, est exactement vêtue comme les dignitaires de la fin de l’Empire (les artistes du Moyen Âge confondaient parfois les premières productions de l’École byzantine avec celles de l’École romaine expirante) : le maître l’a très certainement copiée sur quelque bas-relief en ivoire. On pourra s’en assurer en la comparant au diptyque d’Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius, qui fut consul en 5179 : mêmes ornements stelliformes, même arrangement de la draperie. Nicolas a imité jusqu’à la rangée d’oves qui orne le fronton surmontant la chaise curule. Dans une autre composition de la même chaire, le Jugement dernier, les femmes vues de dos rappellent singulièrement les nymphes ou les Néréides antiques.
Chaire de la cathédrale de Sienne.
Dans la fontaine de Pérouse, sculptée par Nicolas de Pise en collaboration avec son fils Jean (1277), on remarque, au milieu d’une foule de personnages et de symboles appartenant au Moyen Âge, les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, leur mère Sylvia Rhéa, la louve qui les a allaités, comme aussi des scènes tirées des Fables d’Ésope, le Loup et la Cigogne, le Loup et l’Agneau, etc. Mais les réminiscences ne se bornent pas au choix des sujets : le mois d’avril, représenté sous les traits d’une femme debout, tenant une corne d’abondance et un panier de fleurs, est antique par l’arrangement des draperies aussi bien que par l’expression. Goliath est armé à la romaine. Le lion et les aigles figurés dans d’autres compartiments procèdent de ceux qui ornent les monuments de la Rome impériale.
Dans ses Origines de la Renaissance en Italie, M. Gebhart a porté sur l’ensemble de l’œuvre de Nicolas de Pise un jugement que nous sommes heureux de pouvoir placer sous les yeux de nos lecteurs, au moment de prendre congé du fondateur de l’École pisane : « Nicolas, dit-il, dans les chaires de Pise et de Sienne, et dans la châsse de saint Dominique à Bologne, ranima les traditions du grand art avec une gravité naïve et un goût déjà très sûr ; ce n’est point un néo-grec, ni un antiquaire superstitieux ; il s’est pénétré des principes les plus généraux de la sculpture antique : l’ordonnance harmonieuse des scènes, l’emploi habile de l’espace où beaucoup de personnages se meuvent dans un cadre étroit, la majesté tranquille des poses, le bel ordre des draperies, la noblesse des têtes. Mais son œil et sa main ont encore la pratique de la sculpture primitive : les mouvements sont d’une gaucherie timide, les figures sont parfois pesantes. Il donne l’impression des œuvres romaines de la fin de l’Empire… Nicolas de Pise, s’il a découvert et étudié la Grèce, n’a point renoncé à la nature, et, dans ses meilleurs morceaux, il est revenu à l’observation de la vie. C’est par là surtout qu’il se montre disciple intelligent des anciens… À partir de Nicolas de Pise, les maîtres italiens interprétèrent d’une façon très personnelle l’antique ; aucun d’eux ne le copia servilement, et c’est encore Nicolas, le premier et par conséquent le moins savant de tous, dont le ciseau eut les plus dociles réminiscences. »
Un des élèves et des collaborateurs les plus éminents de Nicolas, le frère Guglielmo de Pise (né vers 1238, mort après 1313), s’inspira de principes analogues, mais avec moins de parti pris. Dans la chaire de San Giovanni Fuorcivitas, à Pistoie, il a réussi, mieux que son maître, à concilier les réminiscences païennes avec les idées du christianisme ; pour rétablir l’harmonie, il lui a suffi d’imiter à la fois les modèles païens et les modèles chrétiens contemporains, c’est-à-dire les sarcophages des cinq premiers siècles. Certains de ses types, comme l’a fait remarquer M. Dobbert, rappellent le Zeus et l’Héra antiques ; ses soldats sont costumés et armés comme les légionnaires de l’Empire romain ; d’autres personnages portent la chlamyde nouée sur l’épaule. On remarquera surtout, dans la Descente aux limbes, la femme qui, à moitié couchée, dans l’attitude des divinités fluviales, tourne son dos nu au spectateur. Il est impossible de ne pas y reconnaître la copie d’un original antique. Son maître, on l’a vu, l’avait, dans le Jugement dernier, de Sienne, précédé dans cette voie. Un juge autorisé, M. le baron de Liphart, nous fait en outre remarquer l’analogie entre les trois guerriers couchés au premier plan, dans la Mise au tombeau, de la même chaire, et les amazones.
Le sentiment historique, tel est un des traits distinctifs de l’École de Nicolas de Pise. Elle ne recourt pas seulement aux marbres antiques en tant que modèles de style, mais encore en tant que documents. Tandis qu’au XIVe et au XVe siècle, peintres et sculpteurs donnent sans hésitation les costumes de leur temps aux acteurs de l’histoire sainte, leurs prédécesseurs du XIIIe siècle s’efforcent de restituer, au moyen de l’archéologie, le costume du Christ et de sa famille, des apôtres, des martyrs, absolument comme le firent, deux cents ans plus tard, les champions de la Renaissance. Fra Guglielmo a poussé très loin ces scrupules : ses apôtres portent la toge, la tunique, les sandales ; ils tiennent à la main le volume roulé. Dans la Descente du Saint-Esprit, il cherche en outre à reproduire fidèlement les types de la primitive Église, surtout dans les figures de saint Pierre, de saint Paul, de saint Jean. Comme chez les sculpteurs des sarcophages de Rome, de Milan, du midi de la France, absence complète de nimbes. J’insiste sur ce fait qui montre à quel point Nicolas de Pise et les siens dédaignaient la tradition médiévale, du moins en ce qui concernait les types, le costume, les attributs. Dans la scène qui vient d’être mentionnée, on remarquera aussi le groupement des apôtres : ils sont placés sur deux rangs, les uns derrière les autres, tout comme dans la curieuse mosaïque de la chapelle de Sant’Aquilino (église Saint-Laurent, à Milan). Une disposition peu différente se retrouve dans un autre bas-relief de la chaire : le Christ lavant les pieds des apôtres.
Le costume des femmes mérite une mention spéciale. Dans l’Annonciation et dans la Visitation, Marie et Élisabeth ont la tête à moitié couverte d’un pan de leur manteau, de manière à laisser libres le front et la plus grande partie de la chevelure : on dirait des matrones romaines.
Signalons encore la majesté, la liberté extraordinaire de l’aigle, aux cuisses empennées, qui sert de support au pupitre placé sur la chaire de San Giovanni Fuorcivitas. Pour apprécier les immenses progrès réalisés dans l’espace de quelques années, il faut le comparer à celui qui orne la chaire exécutée, peu de temps auparavant (en 1250), par Guido de Côme dans une autre église de Pistoie, San Bartolommeo. Chez ce dernier la grosseur du cou, la rondeur du corps, la lourdeur des serres et jusqu’aux plumes disposées en dents de scie, tout rappelle l’oiseau conventionnel, presque héraldique, si cher aux sculpteurs romans. On se croirait en présence d’un monument appartenant à un autre siècle et à un autre art.
En tant que membre de l’ordre de saint Dominique, Fra Guglielmo dut plus d’une fois réprouver les tendances trop païennes de son maître. La situation d’un autre disciple de Nicolas, Arnolfo di Cambio (mort en 1310), l’architecte du dôme de Florence, n’était pas moins délicate, mais pour d’autres motifs. On est surpris de voir ce maître, le promoteur d’un style s’écartant si singulièrement de la tradition antique, revenir à cette dernière, lorsqu’il échange le compas du constructeur contre le ciseau du statuaire. Hâtons-nous d’ajouter que l’écart n’est pas aussi considérable qu’on pourrait le croire. Dans son tombeau du cardinal de Braye, à Orvieto, Arnolfo a su donner à la Vierge une majesté sereine, une simplicité qui n’est pas exempte de grandeur, sans pousser l’imitation au même point que son maître. Son indépendance est encore plus entière dans le tabernacle de Saint-Paul hors les murs, près de Rome : si nous ne savions pas qu’Arnolfo est le disciple de Nicolas, nous aurions de la peine à le deviner en présence de ce monument hybride.
Le fils de Niccolò Pisano, Giovanni (1240-1320) passe, et à bon droit, pour le champion du naturalisme, dont l’irruption dans le domaine de la sculpture coïncide avec le triomphe du style gothique, et pour le véritable précurseur de Giotto. Nous n’avons pas à définir ici ce génie puissant, dramatique, parfois violent : Jean de Pise ne nous appartient que comme imitateur de l’antique. À cet égard, nous croyons être en droit de l’affirmer, on n’a pas suffisamment apprécié son rôle. Si dans sa chaire de l’église Saint-André, à Pistoie, les réminiscences antiques sont en petit nombre (les anges seuls, d’une beauté frappante, semblent pouvoir se ramener à des modèles grecs ou romains), si la profusion des figures et l’exagération du mouvement sont même en contradiction avec les traditions de la sculpture antique, en revanche, quelle dette le fils de Niccolò n’a-t-il pas contractée envers les anciens dans sa chaire de la cathédrale de Pise (1302-1311), dont notre École des Beaux-Arts possède le moulage complet ! Ici, au pied de la statue personnifiant la ville de Pise, on voit une femme étendant les mains pour cacher sa nudité, dans une attitude qui rappelle singulièrement la Vénus de Médicis ; ailleurs, dans le même groupe, une femme portant une corne d’abondance, et une autre couronnée de lierre. Puis viennent des aigles, des ions, qu’il n’est pas difficile de rattacher aux meilleurs modèles.
Ces emprunts ne font que mieux ressortir l’imperfection du modelé, la barbarie du style. Évidemment la culture générale n’était pas encore assez développée pour que ces hardis novateurs pussent trouver un point d’appui sérieux chez leurs contemporains. On n’est pas impunément en avance sur son siècle : Frédéric II en avait fait l’expérience, longtemps avant Jean de Pise. Malheur à ceux qui veulent aller trop vite !
Les réminiscences antiques occupent une place non moins considérable dans un autre cycle, dont on n’a pu jusqu’ici déterminer l’auteur, ou les auteurs, mais qui se rattache certainement à l’école de Jean de Pise. Nous voulons parler des bas-reliefs de la façade du dôme d’Orvieto. En les examinant avec soin, on y découvrira des traces multiples et non douteuses d’études archéologiques très étendues. L’abus des nus, la science du modelé, la hardiesse des raccourcis (par exemple dans la Mort d’Abel), certaine façon de draper, qui consiste à laisser à découvert l’épaule droite et une partie de la poitrine, suffiraient à témoigner d’une manière générale de ces tendances. Mais nous avons plus : les prophètes, tantôt couronnés de feuillage (pl. XXIII), tantôt les cheveux ceints d’une bandelette (pl. XXIV), peuvent se ramener à des prototypes romains. Il en est de même des soldats, tous copiés sur des bas-reliefs de l’époque impériale (pl. LV, LX). L’auteur d’ailleurs a eu soin de nous apprendre à quelle source il a puisé : le sarcophage à strigiles qui, dans la Nativité (pl. LI), sert de berceau à l’enfant Jésus, les sarcophages dont sortent les morts, dans la scène de la Résurrection (pl. LXVIII), ne laissent aucun doute à cet égard. Parmi ces derniers, à côté de sarcophages strigilés, on remarquera un sarcophage dont la partie antérieure est ornée de trois génies nus, supportant des guirlandes. Est-il besoin d’autres preuves ! Citons encore le trône d’Hérode (pl. LV), avec ses montants terminés en haut par des têtes, en bas par des griffes de lion, ainsi que le costume de Satan, dans la Tentation du Christ (pl. LVIII) : chlamyde jetée sur les épaules et fixée sur la poitrine par une fibule.
Chez Jean de Pise et chez ses adeptes, les souvenirs antiques détonnent parfois étrangement au milieu des excès du naturalisme. Un autre Pisan, André (1270-1348), l’élève et l’ami de Giotto, réussit à rétablir l’harmonie troublée par des novateurs trop fougueux : son point de départ, c’est la tradition médiévale, qu’il cherche à ennoblir et à purifier, en s’inspirant surtout de l’exemple de Giotto. Lui aussi cependant connaît l’art romain, et il l’imite à l’occasion, mais avec cette sagesse, cette distinction qui sont les traits fondamentaux de son talent. En supposant que les marbres conservés à Pise exercèrent sur Andrea une influence analogue à celle qu’ils avaient exercée sur Niccolò Pisano, Vasari a du moins pour lui la vraisemblance. Ne savons-nous pas, par Benvenuto Cellini, que, jusqu’en plein XVIe siècle, le Campo Santo fut pour les artistes toscans un véritable musée d’études ?
La porte de bronze du baptistère florentin (1330-1336) nous montre avec quelle habileté André de Pise sut mettre à profit des enseignements si précieux. Dans la Décollation de saint Jean-Baptiste, le bourreau brandit le glaive par un de ces mouvements à la fois vifs et rythmés dont les sculpteurs anciens avaient le secret. Dans un autre compartiment, le guerrier qui conduit saint Jean devant Hérode porte le costume romain. Mêmes réminiscences dans le bas-relief qui représente l’emprisonnement du saint.
Ghiberti et Vasari ont-ils dit vrai : les bas-reliefs du Campanile ont-ils réellement été exécutés d’après les dessins, ou même d’après les maquettes de Giotto ? On serait tenté de le croire, eu égard à l’extrême rareté des souvenirs classiques. Livré à lui-même, André de Pise aurait certainement accordé une place plus large à des motifs qui s’imposaient presque dans les compositions allégoriques du genre de celles dont le Campanile devait être orné. Nous n’avons rien à dire des sept premiers sujets : – la Création d’Adam ; celle d’Ève ; Adam labourant et Ève filant ; Jabel inventant les tentes ; Jubal inventant les instruments de musique ; Tubalcaïn travaillant l’airain ; l’Ivresse de Noé ; – l’antiquité n’avait rien à y voir. Mais quelle audace ne fallait-il pas, à une époque où la Grèce et Rome reprenaient possession de tous les esprits éminents, pour se passer de leur secours dans la représentation de l’Astronome, de l’Architecte, du Médecin, du Cavalier, des Femmes personnifiant le tissage, du Législateur, de Dédale essayant ses ailes ! Je me hâte d’ajouter que la postérité n’a pas à regretter cette tentative d’émancipation. Si les allégories d’André de Pise n’ont pas l’éclat de celles des Grecs et des Romains, en revanche elles nous charment par leur simplicité, leur sincérité. Qui ne préfèrera ce naïf cavalier du Moyen Âge, avec son cheval allant l’amble, avec son manteau flottant au vent, aux imitations les plus savantes ?
La dernière série, – la Navigation, la Guerre, l’Agriculture, le Commerce (homme debout dans une charrette tirée par deux chevaux), l’Architecture (homme assis et mesurant), – est la seule où l’artiste se soit résolu au rôle d’imitateur, et encore ne l’a-t-il fait que dans un bas-relief sur cinq. Je regrette de me trouver en désaccord pour l’explication de cette composition avec le dernier historien de Santa Maria del Fiore. Décrivant le bas-relief qui représente la Guerre, M. Cavallucci, qui suit en ce point les errements de Follini, croit reconnaître dans les deux acteurs Caïn et Abel. Mais le doute n’est pas possible : le personnage debout, avec ses formes athlétiques, la peau de lion jetée sur les épaules, la massue dans la main droite, ne saurait être qu’Hercule ; quant au personnage étendu à terre, c’est une des victimes du héros grec, Antée ou Cacus. Dès cette époque, ainsi qu’on le verra dans la suite de notre travail, Florence avait adopté pour symbole le grand redresseur de torts, le fils de Jupiter et d’Alcmène.
Jusqu’à ces derniers temps, on pouvait croire qu’un mouvement, analogue à celui dont Nicolas de Pise avait été le promoteur, s’était produit, quoique avec des proportions plus restreintes, dans le domaine de la peinture.
En examinant, à Rome, les mosaïques absidales du Latran et de Sainte-Marie-Majeure, qui n’a été frappé de la présence d’une foule de motifs essentiellement antiques : ici, un fleuve étendu dans les roseaux et penché sur son urne ; ailleurs, des génies nus folâtrant au milieu des eaux ; puis des rinceaux d’une rare élégance, au milieu desquels s’agite tout un monde d’oiseaux ou de quadrupèdes ? L’analogie de ces compositions avec celles d’un monument du IVe siècle, le mausolée de sainte Constance, ne semblait-elle pas prouver qu’une tentative de renaissance avait été faite dans la Ville éternelle vers la fin du XIIIe siècle, et n’autorisait-elle pas à ranger leurs auteurs, Jacques Torriti et son compagnon, Jacques de Camerino, parmi ces « Précurseurs » dont nous esquissons l’histoire ? Un examen approfondi nous a toutefois conduit à des conclusions différentes. Il est démontré aujourd’hui que les deux mosaïstes, dont le travail date du pontificat de Nicolas IV (1288-1294), se sont bornés à copier (peut-être même seulement à restaurer) les compositions existant à la même place depuis sept ou huit siècles.
Peut-être le rénovateur de la peinture italienne, Giotto, aurait-il, à l’instar de Nicolas de Pise, érigé en principe l’imitation de l’antique, s’il avait eu à sa disposition des modèles composés par ses prédécesseurs, les peintres d’Athènes et de Rome. Mais, tandis que les statues et les bas-reliefs antiques abondaient, rien n’était plus rare qu’une fresque de la bonne époque. Demander à un artiste du Moyen Âge, s’appelât-il Giotto, de traduire les enseignements de la statuaire dans le langage de la peinture, eût été trop imprudent ; le XVe siècle lui-même n’a pu aborder cette tâche si ardue qu’après une longue et pénible initiation. Aussi le fondateur de l’École florentine s’est-il contenté de copier de loin en loin quelque motif antique qui l’avait séduit par son élégance ou son originalité. D’imitation méthodique ou raisonnée, il ne saurait en être question ; l’influence antique est imperceptible si vous vous attachez à l’ordonnance de ses scènes, à ses types, à ses costumes, en un mot, aux éléments constitutifs de son style.
Il n’en est que plus intéressant de relever les emprunts que Giotto a faits, involontairement en quelque sorte, aux monuments de l’antiquité, et de le surprendre s’essayant à des imitations si peu appropriées à ses tendances générales.
Le berceau même de la peinture mystique, la basilique d’Assise, nous offre plusieurs exemples de ces préoccupations archéologiques : dans la scène qui représente saint François montant au ciel (église inférieure), on aperçoit, à droite, une colonne ornée de bas-reliefs qui se développent en spirale : c’est un souvenir de la colonne Trajane ou de la colonne Antonine.
Dans une fresque de l’église supérieure, Giotto a choisi son modèle à Assise même. Le temple, au fronton supporté par cinq colonnes cannelées, d’ordre corinthien, a bien certainement pour prototype le temple de Minerve, qui s’élève aujourd’hui encore dans la cité de saint François. L’artiste du Moyen Âge s’est d’ailleurs permis de singulières modifications : il a orné le fronton d’une rosace supportée par deux Victoires portant des palmes, et a incrusté l’architrave de mosaïques. Il a en outre donné à ses colonnes des formes grêles qui en font de véritables caricatures.
Dans cette même basilique d’Assise, Giotto a montré que, s’il consentait à emprunter aux anciens un motif de costume ou de décoration, il entendait, même pour les représentations les plus consacrées, garder une entière indépendance. Il lui était difficile, dans son Triomphe de la Chasteté, de ne pas accorder une place au dieu aveugle, éternel ennemi de la vertu à la glorification de laquelle il consacrait son pinceau. La renommée avait porté jusqu’à lui le nom de Cupidon ; aussi représente-t-il le dieu antique nu, ailé, un bandeau sur les yeux, armé de l’arc, et le carquois en sautoir. Mais examinez ce corps juvénile jusque dans sa partie inférieure, vous verrez qu’il se termine par des griffes de lion… « Desinit in piscem. » C’est ainsi que l’artiste a tenu à marquer son droit et à affirmer ses intentions. L’Amor (son nom est écrit à côté de lui) n’est pour Giotto qu’un auxiliaire du démon ; aussi le précipite-t-il dans l’Inferno, accompagné de la Mors (représentée sous forme de squelette) et de l’Immonditia.
Ne quittons pas Assise sans signaler les velléités archéologiques d’un collaborateur de Giotto : Pietro Lorenzetti, de Sienne. Dans la Cène (basilique inférieure), il a placé, au-dessus des colonnes, des génies ailés portant des cornes d’abondance. Dans le Christ à la colonne, les ornements en grisaille sont également imités de l’antique.
Simone Memmi, lui-même, le coryphée de l’École siennoise, a obéi à des préoccupations de même nature, quand, dans son Saint Martin devant l’Empereur (même basilique), il a donné à ce dernier le costume romain, la couronne de laurier et le bâton de commandement.
À Florence, l’influence de l’antiquité perce surtout dans les fresques de Santa Croce. Dans le Festin d’Hérode, l’édifice principal est surmonté de statues qui reposent sur des piédestaux très élevés, reliés entre eux par des guirlandes. Plusieurs de ces figures sont nues. On remarquera une disposition analogue dans la Découverte de la Croix, dans le





























