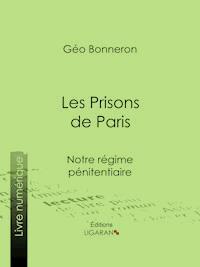
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est tout un monde, intéressant et mystérieux, que celui dans lequel nous nous proposons de promener le lecteur, un monde séparé et à peu près inconnu du reste du monde, avec ses rouages spéciaux, ses domaines, sa population heureusement restreinte et pourtant considérable ; un monde douloureux, en vérité, navrant, et d'où, malgré la nécessité d'une justice humaine et l'utile sévérité de nos lois, monte comme une clameur d'effroi et de pitié."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous tenons à remercier ici Messieurs les Directeurs des Prisons de Paris qui ont bien voulu nous aider dans la préparation de cet ouvrage.
Nos remerciements s’adressent d’une façon toute spéciale à MM. Durlin, directeur du Dépôt, Pons, directeur de la Conciergerie, Bondon, directeur de la Petite-Roquette, et Meugé, directeur de Saint-Lazare, qui, avec une bonne grâce et une amabilité parfaites nous ont fourni tous les renseignements dont nous avions besoin.
G.B.
Décembre 1897
La conception du régime pénitentiaire. – Peines physiques et peines morales. – Le monde des prisons.
C’est tout un monde, intéressant et mystérieux, que celui dans lequel nous nous proposons de promener le lecteur, un monde séparé et à peu près inconnu du reste du monde, avec ses rouages spéciaux, ses domaines, sa population heureusement restreinte et pourtant considérable ; un monde douloureux, en vérité, navrant, et d’où, malgré la nécessité d’une justice humaine et l’utile sévérité de nos lois, monte comme une clameur d’effroi et de pitié.
Trop souvent une certaine presse, encline à égarer l’opinion, cherche à attirer l’attention sur notre régime pénitentiaire, et, déclarant qu’elle voit par-dessus les murs, essaie d’en signaler des abus, de prétendues infamies. Nous n’avons l’intention ni de faire l’apologie de l’Administration, ni de la dénigrer systématiquement. Guidé par un souci constant de vérité et d’exactitude, nous nous proposons de montrer les choses telles qu’elles sont, forcément pénibles par leur raison d’être même, mais en réalité beaucoup plus humanitaires et philanthropiques qu’on ne le pourrait croire à première vue.
On peut affirmer sans crainte d’être démenti que notre système pénitentiaire français est en rapport avec les grands principes qu’a proclamés la Révolution. De ce côté, comme de bien d’autres, nous sommes en avance sur la plupart des peuples civilisés.
L’exécution et la nature des peines diffèrent essentiellement aujourd’hui de ce qu’elles étaient dans l’ancienne France, sous l’empire de l’ancien droit. Leur conception même a changé avec la marche en avant des idées.
Les prisons, autrefois, n’étaient guère que des lieux de dépôt. La détention était une mesure de sûreté ou de bon plaisir, ou un moyen de séquestration arbitraire, susceptible de se prolonger de la façon la plus abusive et la plus criante. Les privations, les sévices, les corrections manuelles s’y ajoutaient, l’aggravant trop souvent, jusqu’à en faire une sorte de martyre, un véritable supplice corporel. Les prisons fonctionnaient tant bien que mal, il n’y avait pas de système pénitentiaire. Il ne pouvait y en avoir. Les peines semblaient basées et graduées uniquement sur le degré de souffrance physique qu’elles occasionnaient. Tout était savamment combiné et mis en œuvre pour assurer cette souffrance, principal but à atteindre.
Alors, comme aujourd’hui, la législation était d’accord avec les mœurs. Les procédés de répression suffisants maintenant eussent été à cette époque « une véritable dérision ». Tout le monde acceptait et reconnaissait de bonne foi la légitimité des pires tortures. Le magistrat n’éprouvait aucune peine, aucun trouble de conscience à les décréter. Le peuple y assistait, s’y empressait quand il le pouvait, s’en amusait, convaincu qu’elles étaient nécessaires et méritées.
C’est à peine si quelques penseurs, allant témérairement de l’avant, osaient de loin en loin émettre de timides protestations. Voltaire lui-même, grand afficheur d’idées philanthropiques, n’écrivait-il pas à des amis, au temps où Beccaria publiait son Traité des Délits et des Peines : « Le bruit court que le R.P. Malaveda a été roué. Que Dieu en soit béni !… On m’écrit que trois jésuites ont été brûlés à Lisbonne ; voilà des nouvelles qui consolent ».
La souffrance physique fut d’ailleurs toujours regardée et recommandée par l’Église comme un moyen de racheter les péchés. « Mes amis, disait le grand apôtre de la charité, saint Vincent de Paul, aux prisonniers qu’il secourait, toutes forcées que soient vos peines, qui vous empêche de les supporter avec une résignation qui les rendra méritoires ?… Il n’y a de vrai mal que le péché, de vraies peines que les peines éternelles ».
Avec notre Code, une modification complète s’est produite. Plus de châtiments corporels, plus de sévices, plus de privations inutiles. Et l’on peut dire qu’à présent la peine des détenus est surtout, – exclusivement serait trop dire, – une peine morale. La détention n’est en quelque sorte que la garantie matérielle de cette peine, sans laquelle elle serait le plus souvent illusoire.
La loi ne permet plus de frapper le prisonnier ; et elle ne permet d’atteindre et de diminuer son existence corporelle qu’autant qu’il y a nécessité absolue.
Cependant, nous dira-t-on, il y a la peine de mort, qui reste des temps passés, avec son terrible caractère d’irrémédiabilité et d’implacabilité.
Il ne nous appartient pas, et nous n’avons pas l’intention d’entrer ici dans une dissertation sur l’utilité de la peine capitale, sur la possibilité d’arriver à la supprimer, comme l’ont réclamé au nom de l’Humanité et de la Morale des hommes de la plus haute valeur.
Nos lois ont gardé cette peine dans leur arsenal ; mais elles l’ont également modifiée, cherchant à l’amoindrir, à la cacher, la réduisant à sa plus simple expression.
Autrefois la peine de mort s’entourait de tout un appareil destiné à en augmenter l’effet physique. Pour les criminels un tant soit peu marquants, la fin, couronnant l’œuvre, n’arrivait qu’après complet épuisement de toute la gamme des tourments corporels. Et c’était mourir dix fois que mourir comme certains suppliciés dont les noms nous sont restés. Suivant les époques, suivant les cas, suivant aussi la personnalité des criminels on dosait et variait intelligemment l’intensité des supplices. L’égalité n’existait pas plus devant la mort qu’ailleurs. Les gentilshommes étaient décapités, les manants étaient pendus. Et tout cela se passait avec un luxe de mise en scène, une variété de souffrances préparatoires qui nous font frémir.
Aujourd’hui on emploie uniformément le mode de procéder reconnu le plus prompt et le plus radical. On a pour le malheureux qui attend en prison l’heure de l’expiation suprême toutes les attentions et tous les soins propres à lui faire oublier, à atténuer et engourdir sa sensibilité. On se borne à peu près pour lui à la surveillance rigoureuse qui est absolument nécessaire. Et quand enfin le moment de l’exécution est arrivé on prend garde de prolonger, ne fût-ce que de quelques minutes inutiles les derniers préparatifs ; si bien qu’entre l’instant où le condamné est réveillé et définitivement instruit de son sort et celui où sa tête roule sous le couteau triangulaire il s’écoule à peine plus d’un quart d’heure. Et il est probable que dans un temps peu éloigné les exécutions capitales se passeront dans un lieu réservé, hors des regards et des manifestations des foules avides de spectacles et d’émotions. Ce sera plus convenable, et tout aussi effectif au point de vue de l’exemple et de la crainte à inspirer. La peine de mort, actuellement, semble donc s’abriter derrière le besoin d’une protection sociale. La société, se trouvant vis-à-vis du criminel dans le cas de légitime défense, frappe et tue, mais uniquement pour se défendre et se sauvegarder.
Et si l’expression subsiste encore de dernier supplice ce n’est que par un souvenir d’autrefois, quand la mort décrétée par les juges terminait toute une série de châtiments corporels. En réalité, le mot supplice n’est plus applicable dans notre système pénitentiaire. Il n’y a plus de supplices. La peine de mort n’en est elle-même, à proprement parler, pas un.
On est assez porté à admettre que pour certaines gens la peine morale n’existe pas ; qu’il y a des individus assez dégradés, tombés assez bas dans l’abjection, pour que toute sensation autre que la sensation physique s’annihile et disparaisse chez eux. C’est là une erreur. Il est démontré qu’un voleur émérite, un assassin de parti-pris, peuvent encore souffrir moralement, et en fait souffrent moralement, bien qu’ils soient chauffés, nourris, promenés en prison suivant les règles de l’hygiène physique. La possibilité de la peine morale persiste chez tout individu doué de raison, envers et contre tout.
Sous la désignation de peine morale, on doit comprendre toute souffrance pouvant être endurée par l’âme, par le cœur, le cerveau, par toutes les fibres de l’être, sans que les conditions extérieures de l’existence, sans que les organes matériels de la vie en soient affectés. Le champ est donc vaste, et parmi les causes de ces souffrances morales on peut indiquer : la privation de la liberté, l’impuissance d’agir, de se révolter, de se venger, l’impuissance même de nuire, de faire le mal, l’impossibilité d’échapper à la justice calme et forte qui enserre le coupable et ne le lâche qu’après avoir obtenu de lui le paiement intégral de sa dette, le souvenir des choses passées, heureuses ou malheureuses, la rage contre des complices, voire contre des victimes…
Les châtiments d’aujourd’hui, pour être plus humains, pour être plus raisonnables et raisonnés, n’en sont pas moins effectifs que ceux d’autrefois, et n’en atteignent pas moins sûrement leur but moralisateur et préventif. Il ne faudrait cependant pas se leurrer de trop d’illusions sur l’effet des peines uniquement morales. Il est d’ailleurs à peu près impossible de les séparer complètement d’une certaine souffrance physique. La privation de la liberté, si elle peut être considérée comme peine morale, n’en garde pas moins un côté physique d’une importance considérable. Et il y a des coupables pour lesquels cette privation de liberté, et surtout la privation absolue de toute espèce de jouissance, presque de toute espèce de satisfaction, sont le plus palpable de la peine, ce qui les touche le plus et produit le plus sûrement sur eux la crainte et l’intimidation désirées.
Nous parlions en commençant du Monde des Prisons. Ce monde est réparti dans un nombre considérable d’établissements disséminés un peu partout sur l’étendue du territoire français, sans parler des colonies. Il présente, en une sorte de réduction attristante et peu flatteuse, l’ensemble des besoins et des nécessités de toute société organisée.
Qu’on songe, en effet, au nombre et à la diversité des services que réclament des établissements si divers, des personnes placées dans des conditions légales si différentes, depuis le criminel condamné à mort jusqu’au mineur de moins de seize ans, placé sous la surveillance de l’autorité pour des délits dont on saurait difficilement le rendre responsable, l’enfant vicieux dont on doit s’efforcer malgré de mauvais débuts de faire un honnête homme.
Le monde des prisons de Paris est particulièrement extraordinaire dans sa complexité et dans sa diversité. Il se renouvelle de jour en jour, d’heure en heure, en un mouvement incessant, un défilé interminable, à la fois toujours le même et toujours varié. Dans ce tourbillon passent et disparaissent tous les genres et tous les types. Toutes les classes, tous les échelons de l’échelle sociale y sont représentés : financiers manieurs de millions pris dans les poches d’autrui ; échafaudeurs de fortunes et d’entreprises énormes, encensés tant qu’ils furent heureux puis maudits dès que la fortune se détourna d’eux ; hommes du monde, agents d’affaires habitués à la vie fastueuse, rastaquouères de haute volée ; hommes politiques indignes, voire anciens ministres ; condamnés à des peines correctionnelles ; condamnés aux travaux forcés attendant leur relégation ou leur déportation ; condamnés en appel ; étrangers sous le coup de mesures d’expulsion ; inconnus énigmatiques qui ne veulent rien dire et dont il faut rechercher l’état-civil et la personnalité ; délinquants farouches, ou bons apôtres apparents ; escrocs, voleurs, souteneurs coutumiers d’attaques nocturnes ; chourineurs de barrières ; individus de mœurs ignobles ; et toute la tribu des vagabonds et des sans-gîte, épaves sociales échouant fatalement dans la débauche, l’ivrognerie, le crime.
Les prisons de province ont une clientèle plus restreinte et beaucoup plus uniforme, sauf les cas exceptionnels. On y rencontre surtout des délinquants régionaux, sortes d’habitués, puis les vagabonds, traîneurs de grands chemins, presque toujours plus malheureux que coupables.
Qu’on songe aussi avec quelle incessante vigilance, avec quel soin, quelle surveillance méticuleuse doivent être réglés tous les mouvements de la colossale organisation qui régit le monde des prisons. Les individus qui composent la population des maisons de détention sont en état de rébellion et d’hostilité contre la Société. La Société a été plus forte qu’eux, elle s’en est emparée, et elle a chargé l’Administration Pénitentiaire de les mettre et de les maintenir en état d’expiation. Dans cette lutte contre le mal, l’Administration ne peut donc compter sur la bonne volonté des intéressés. Elle doit, au contraire, s’attendre de leur part à une résistance qui ne désarmera jamais. C’est contre leur gré, en dépit de leurs révoltes, de leurs ruses, de leurs violences, et de leur désespérante inertie, qu’elle doit entreprendre et mener à bien en même temps que son œuvre d’expiation une œuvre de relèvement, si possible, et de retour vers le bien.
C’est à tort que certains publicistes ont essayé de démontrer que toute philanthropie devrait s’arrêter à la porte des prisons, et que les misérables enfermés dans les geôles n’ont plus droit à aucune pitié, à aucun encouragement, à aucun essai de guérison morale. « On dépense ce qui pourrait subvenir aux besoins de cent familles honnêtes pour essayer de tirer de son abjection un pauvre diable… » (P. Peltier d’Hampol.)
Sans un effort constant vers l’amélioration morale la détention ne serait trop souvent, en effet, qu’une œuvre de vengeance à laquelle il répugnerait à la Société puissante de s’abaisser.
C’est une partie de ce monde et de cette administration pénitentiaire que nous essaierons de montrer au public. Nous lui ferons voir en détail quelques-unes des maisons où fonctionnent les rouages de cette administration ; nous soulèverons un peu du toit de ces enfers sociaux.
Et ce sont les prisons de Paris qui nous fourniront les sujets de nos consciencieuses études.
Nous nous rendons compte des difficultés de cette tâche.
« Les établissements pénitentiaires doivent demeurer fermés, soustraits à la curiosité. Nul n’a le droit de se faire un spectacle de la pénible situation des condamnés », a dit avec raison dans un rapport par lui publié pour le Ministère de l’Intérieur, M. Herbette, directeur général des Services pénitentiaires.
Nous ne croyons pas aller trop loin, cependant, en publiant ce que nous avons pu apprendre sur les prisons parisiennes. Nous le répétons, nous n’avons nullement l’idée de chercher le scandale ou de critiquer les procédés de l’Administration.
La Société a le droit, croyons-nous, de connaître ses tares et ses misères. Elle a le droit de sonder l’étendue des plaies qu’elle ne peut pas guérir et avec lesquelles elle est obligée de vivre.
Et de cet examen, nous en avons la certitude, nos lecteurs ne garderont que pensées plutôt réconfortantes, en constatant les efforts accomplis chaque jour, pour la justice et pour le bien, contre les forces innombrables du mal.
Avantages et inconvénients des deux systèmes. – La réforme des prisons.
La peine matérielle garantissant la peine morale, et ayant d’ailleurs par elle-même une valeur considérable, est la privation de la liberté. Cette peine doit être proportionnée aux principes de justice et aux nécessités de la répression.
Pour assurer la privation de la liberté, il y a deux systèmes : le système de la détention en commun et le système de la détention individuelle ou cellulaire.
De toute évidence, il existe entre les deux procédés une différence radicale, et si l’on admet la supériorité et les meilleurs résultats de l’un, on se trouve forcément amené à abandonner l’autre dans la pratique.
La détention cellulaire ou individuelle, sans aucune communication avec personne, soit par la parole, soit même par la vue, implique d’elle-même une aggravation sensible de la peine, en même temps que plus de dignité dans la façon de subir cette peine.
Les statistiques publiées par l’Administration ont depuis longtemps démontré l’augmentation constante de la récidive. On en a voulu voir la raison dans un fonctionnement défectueux du système pénitentiaire ; et tous les hommes compétents, non seulement de France mais des autres nations civilisées, ont cherché le remède à ce mal. On a mis en avant comme un moyen d’une efficacité certaine le régime de l’emprisonnement cellulaire. Il a été publié sur ce sujet, dans les différents pays, des monceaux de volumes, le régime cellulaire ayant tout de suite eu ses détracteurs acharnés en même temps que ses défenseurs convaincus. Ici on préconisait la détention individuelle pour toutes les peines sans distinction de durée. Là on la repoussait entièrement. Ailleurs, enfin, on l’acceptait, mais seulement pour les peines d’une durée minime. C’est ce dernier système qui a prévalu en France.
Le régime cellulaire a eu son origine aux États-Unis, où il a commencé à être mis en pratique pour les grands criminels vers la fin du siècle dernier. La conception première en appartient à un jurisconsulte et criminaliste anglais nommé Jérémie Bentham, qui pour ses efforts philanthropiques mérita de recevoir de la Convention le titre de citoyen français.
Le régime de l’emprisonnement cellulaire a lui-même été appliqué suivant deux systèmes différents : le système dit Auburnien et le système Philadelphien ou Pensylvanien.
Le système Auburnien, ainsi appelé parce qu’il fut expérimenté d’abord à Auburn, État de New-York, ne comporte la séparation individuelle que durant la nuit ; il laisse pendant la journée les condamnés travailler et prendre leurs repas en commun, sous la condition du silence absolu.
Le système Philadelphien a eu sa première application à Philadelphie, à la prison de Cherry-Hill. Il sépare individuellement les détenus pendant le jour comme pendant la nuit. Ce système est celui qui a été reconnu le plus avantageux et le meilleur ; il a presque partout triomphé sans conteste et est appliqué ou applicable dans les limites du possible dans toutes les maisons de courte peine. Au début, il fut vicié par des rigueurs exagérées. Les législateurs le poussèrent jusqu’à ses extrêmes limites et il devint une véritable séquestration : les condamnés, enfermés dans leurs cellules sans en jamais sortir, n’avaient aucune communication avec le monde extérieur, pas même avec leurs gardiens. Aujourd’hui, le système cellulaire, tel qu’il est appliqué généralement, n’est pas du tout la séquestration absolue. C’est la séparation des détenus entre eux. Mais le condamné doit avoir avec les employés de la prison, les aumôniers, les membres des Sociétés de Patronage, des communications journalières. Il se livre dans sa cellule à un travail constant, tempéré par la lecture et par l’étude. Il y reçoit l’instruction scolaire qui lui manque et l’éducation morale qui le préservera d’une rechute. Il en sort une ou deux fois par jour pour faire des promenades dans un préau solitaire. (Garraud.)
Le régime cellulaire a été pour la première fois élaboré en France, en 1840 par une commission nommée par la Chambre des Députés.
Il reçut alors un commencement d’exécution. On construisit (de 1845 à 1850) la Maison d’arrêt de Mazas, exécutée strictement d’après le système cellulaire.
Déjà en 1833, on avait appliqué à la Petite-Roquette, maison d’éducation correctionnelle, le système d’isolement pendant la nuit, en maintenant pour la journée le travail en commun sous la condition d’un silence sévère.
À la suite des premiers essais qui laissèrent quelque peu à désirer, le régime cellulaire fut violemment attaqué dans la Presse, et jusqu’à la Tribune des Chambres. Un revirement se produisit, et le décret du 27 août 1853 en décida l’abandon.
De 1853 à 1856, on lui substitua le régime de séparation par quartiers, qui établissait parmi les détenus des divisions basées sur la situation sociale, l’âge, la durée des peines, l’état de récidive, la plus ou moins bonne conduite pendant la détention. Cette classification n’allait pas sans de grandes difficultés. Sur quoi l’établir d’une façon certaine et judicieuse ? Il ne pouvait y avoir de criterium absolu. Et forcément elle restait, dans beaucoup de cas, arbitraire et livrée à l’appréciation souveraine du directeur de la prison ou des gardiens.
Enfin un mouvement s’est dessiné en faveur d’un retour, complet cette fois, au régime cellulaire. Une enquête parlementaire fut prescrite à ce sujet par l’Assemblée Nationale en 1872, et des Rapports consciencieux et très édifiants furent présentés au nom de la Commission par MM. Bérenger et d’Haussonville. À la suite de cette enquête, la loi du 5 juin 1875 a réglé pour l’avenir les conditions et procédés de détention.
L’article premier de cette loi stipule que « les inculpés, prévenus et accusés, seront individuellement séparés pendant le jour et la nuit ». On ne saurait trop louer cette disposition. C’est surtout aux prévenus, peut-être innocents, en tout cas non encore reconnus coupables, qu’il importe d’épargner la corruption résultant de la vie en commun avec la population démoralisée et démoralisatrice des prisons.
Quant aux condamnés à l’emprisonnement correctionnel, la loi les partage en deux classes : ceux qui sont condamnés à un emprisonnement inférieur à un an et un jour, et ceux qui sont condamnés à plus d’un an et un jour.
Les condamnés à un an et un jour et au-dessous subissent leur peine dans les prisons départementales et sont soumis à l’emprisonnement individuel.
Pour les condamnés à plus d’un an et un jour, l’emprisonnement cellulaire est seulement facultatif. Ils peuvent, sur leur demande, être soumis à ce régime.
La durée de peine sous le régime de l’emprisonnement cellulaire est de plein droit réduite d’un quart quand elle est supérieure à trois mois ; ce qui revient à dire qu’au-dessus de trois mois trois journées d’emprisonnement en cellule sont comptées comme quatre journées de prison commune.
Cette nouvelle façon de procéder fait donc bénéficier les condamnés d’une notable diminution dans la durée des peines ; et l’on comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir pour eux non seulement à s’y soumettre mais encore à la réclamer.
Aucun condamné n’est contraint à l’emprisonnement cellulaire pendant plus de neuf mois. S’il passe plus longtemps en cellule c’est qu’il le veut lui-même, l’a demandé et obtenu, dans son propre intérêt, désireux de rapprocher le plus possible l’époque de sa libération, même au prix d’une captivité incontestablement plus dure qu’il juge pouvoir supporter.
Si nous en croyons les rapports établis et publiés par l’Administration pénitentiaire, le régime cellulaire ainsi pratiqué ne présente pas d’inconvénients au point de vue de la santé du détenu ; d’autant plus qu’il ne s’oppose à aucune mesure d’hygiène, à aucun exercice. Les promenades dans les locaux à ces destinés peuvent être effectuées par chaque condamné individuellement, sans communication avec ses semblables.
Cependant, nous devons dire pour être complets, que certains économistes se sont prononcés nettement contre le régime cellulaire, affirmant que malgré les déclarations optimistes et peut-être intéressées de l’Administration, en dépit de ses préoccupations d’hygiène et des mesures par elle prises, il ne peut manquer d’être préjudiciable à la santé de ceux qui le subissent. Spécialement, depuis l’application de ce régime les cas d’aliénation mentale seraient devenus beaucoup plus fréquents parmi les prisonniers, les suicides seraient plus nombreux. – Ces affirmations ne manquent malheureusement pas d’une certaine exactitude. Dans les premiers temps du régime cellulaire, des faits regrettables se sont produits, notamment à Mazas, qui avait acquis dès sa création la plus douloureuse renommée. Il sévissait dans cette prison de véritables épidémies de suicide. Un inspecteur de la Sûreté, opposé au régime cellulaire, avait réussi à se faire un album édifiant à cet égard. Cet album représentait soixante détenus de Mazas dans la position où ils avaient été trouvés suicidés dans leurs cellules. Plusieurs s’étaient non pas étranglés mais étouffés par la simple compression du cou qu’ils avaient appuyé sur le bord de leur lit tendu. Jusqu’au dernier moment, le moindre mouvement, le plus faible effort eut suffi pour les ramener à la vie. Et ce mouvement, cet effort, ils ne l’avaient pas tenté, dans leur folie de mourir, dans leur rage d’en finir avec la misérable existence qu’on leur faisait mener.
Ce sont là des cas exceptionnels. Heureusement. Et maintenant que le travail fonctionne régulièrement dans les prisons cellulaires, les cas de suicide et de folie sont retombés à des proportions normales.
Il y a parmi les condamnés des catégories bien tranchées. Et l’on comprend facilement combien il doit être pénible pour un homme ayant à passer quelques mois en prison, en raison d’une première faute pouvant très bien rester unique, de se trouver constamment mélangé à la tourbe des voleurs de profession et des pires malfaiteurs. Le régime cellulaire supprime cette malsaine promiscuité dont les déplorables résultats sous tous les rapports n’ont été que trop démontrés.
La détention cellulaire, du reste, est, à de très rares exceptions près, toujours réclamée par les détenus qui en sont à leur première condamnation ; tandis que les récidivistes la redoutent et recherchent avidement la société de leurs codétenus. Ce fait seul suffirait presque à démontrer la supériorité du régime de l’emprisonnement cellulaire sur le régime de la détention en commun.
Dans les prisons de longue peine le régime peut, d’après notre législation, s’améliorer par une sorte d’alliance ou de transaction entre les deux systèmes. Dans ce système mixte, la détention individuelle est réservée pour la nuit, et la vie en commun est maintenue pendant la journée, au moins en ce qui concerne le travail et les repas. C’est une application du système Auburnien.
L’une des grandes objections opposées dans la pratique au régime cellulaire, c’est qu’il complique considérablement la question du travail, dont nous nous occuperons en un prochain chapitre. Mais cette difficulté n’est pas insurmontable, et dans les maisons de détention récemment construites suivant le modèle cellulaire, l’Administration en a su triompher.
La loi du 5 juin 1875 a décidé que toutes les prisons pour courtes peines ne pourraient plus être construites et aménagées que suivant le type cellulaire. Les vieilles prisons devront être transformées au fur et à mesure que les ressources des départements propriétaires, aidés par l’État, le permettront. La réforme sera longue à accomplir entièrement.
Il existe déjà en France un bon nombre de prisons construites, aménagées et dûment classées suivant toutes les règles de la détention individuelle. De plus, dans toutes les maisons appliquant encore le système de la détention en commun ont été arrangés des quartiers spéciaux et des chambres séparées, permettant d’appliquer le régime individuel à un nombre considérable de détenus.
À Paris, il n’y a pour le moment que trois maisons de détentions satisfaisant dans leur ensemble aux conditions de l’isolement cellulaire : Mazas, la Maison de justice ou Conciergerie, et la Petite-Roquette. Mazas est resté à cet égard la prison-type et compte 1135 cellules. C’est la plus importante prison cellulaire de France. La Conciergerie n’en compte que 76, mais en aura bientôt un plus grand nombre.
La prison de la Santé se composait jusqu’à ces derniers temps de deux parties. Dans l’une, de 500 cellules, l’emprisonnement cellulaire était pratiqué de jour et de nuit ; dans l’autre, également de 500 cellules, on appliquait le régime Auburnien. Des aménagements actuellement en cours en feront une prison tout à fait cellulaire.
Le Dépôt, près la Préfecture de Police, sorte d’antichambre des autres prisons, n’est disposé qu’en partie pour la détention individuelle. Il comprend 197 cellules réparties en deux quartiers, dont 91 pour les hommes et 96 pour les femmes, plus 8 cellules d’aliénés ou cabanons. Il y règne donc, étant donné le nombre d’individus qui s’y trouve constamment, une promiscuité regrettable là plus que partout ailleurs, les détenus n’y étant que prévenus, souvent innocents, ou en tout cas toujours réputés tels jusqu’à preuve du contraire. La moitié à peu près des personnes amenées au Dépôt doit subir le régime de la salle commune.
Les autres prisons parisiennes : Saint-Lazare, la Grande-Roquette, Sainte-Pélagie, ne sont pas aménagées pour l’emprisonnement individuel. Le régime en commun continue à y être appliqué. Il existe pourtant à Sainte-Pélagie un certain nombre de cellules installées dans des conditions défectueuses. Il y a également à la Grande-Roquette environ 240 cellules ne répondant pas aux conditions d’hygiène désirables et qui servent pour le régime auburnien.
Ces prisons ne sont guère utilisables pour le régime cellulaire. Le seul parti à prendre est de les démolir. Il est décidé en principe que les prisons préventives devront seules rester à l’intérieur de Paris et que les prisons de peine seront reconstruites hors de la ville dans des endroits suffisamment éloignés des agglomérations urbaines.
Mazas, la Grande-Roquette, les maisons de correction de Saint-Lazare et de Sainte-Pélagie, sont destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins éloigné. Quand ?… Chez nous, on sait que rien ne dure comme ce qui est décrété provisoire. Mazas et Sainte-Pélagie seront probablement démolis dans le courant de 1898.
En 1825, la Préfecture de Police réclamait déjà la reconstruction de la prison de Saint-Lazare. En 1884, un vœu a été adopté par le Conseil général de la Seine tendant à la suppression de cette maison dans le plus bref délai possible. Un projet de la Préfecture de Police consisterait à faire de Saint-Lazare une maison de traitement exclusivement réservée aux femmes malades.
Au milieu de tous ces projets, la vieille prison du Faubourg-Saint-Denis continuera vraisemblablement encore longtemps à servir d’épouvantail à toute une partie de la population féminine de Paris.
Nécessité du travail. – Difficultés. – Conditions du travail. L’Entreprise et la Régie. – Les gains du prisonnier.
L’obligation de travailler est au même titre que la privation de liberté, un élément essentiel des peines de la réclusion et de l’emprisonnement. (Code pénal, art. 12 et 40.)
La nécessité du travail dans les prisons est en tant que principe au-dessus de toute contestation sérieuse et de bonne foi.
Sans le travail comment maintiendrait-on l’ordre dans les établissements pénitentiaires ? Et pour quelle raison dispenserait-on de cette universelle obligation, imposée à tous les honnêtes gens, des êtres qui sont en rébellion contre les lois sociales, et que l’État est obligé de nourrir et d’entretenir à grands frais ?… Il n’est que juste d’employer les forces et l’activité des détenus à récupérer la Société, dans une certaine mesure, des dépenses qu’elle est obligée de faire pour eux. On ne saurait condamner la masse des honnêtes gens à travailler constamment pour entretenir en prison l’armée des criminels. Combien de fois n’a-t-on pas entendu dire en parlant de tel ou tel individu condamné à une détention plus ou moins longue : « En voilà encore un qui va nous coûter cher ! » Cela n’est malheureusement que trop vrai ; les criminels coûtent gros à l’État, c’est-à-dire à nous. Et chaque année les dépenses de l’Administration pénitentiaire grèvent le Budget dans des proportions considérables. L’État a donc le droit incontestable d’imposer aux détenus un travail quelconque et de bénéficier dans une sage et équitable mesure du produit de ce travail.
S’il est utile à la Société, le travail n’est pas moins utile et nécessaire au prisonnier lui-même. Il a un effet moralisateur et réconfortant. Il démontre au prisonnier que son énergie et sa bonne volonté peuvent encore servir à quelque chose, à quelqu’un. Il l’occupe, lui donne une certaine somme de distraction, et lui procure pour l’époque de sa libération des ressources sans lesquelles il serait le plus souvent amené à retomber tout de suite dans l’ornière du crime, puis de la prison.
L’oisiveté dans les prisons serait désastreuse, les plus pervertis y trouveraient la satisfaction de leurs instincts de paresse. Les moins tarés, si on les privait de travail, se verraient arracher les moyens de relèvement et la possibilité d’améliorer matériellement leur pénible situation. Si, dans la vie libre, on a pu dire que l’oisiveté est la mère de tous les vices, quels résultats n’aurait-elle pas chez des individus dépourvus de sens moral, en proie aux instincts les plus vils, sollicités par toutes les passions ? Le travail est encore plus nécessaire en cellule que dans la détention en commun. C’est dans le système cellulaire surtout qu’il devient un adoucissement à la peine du condamné, un véritable soulagement. Si l’on voulait faire apprécier à un paresseux les bénéfices du travail, on n’aurait qu’à l’abandonner seul, sans occupation, en proie à ses pensées, à son imagination, à ses passions, dans ce vide épouvantable, où la notion de l’existence semble s’abolir, où le temps s’imprécise, où l’on ne sait plus, dans la monotonie invariable des instants, si l’on a vécu un jour, une semaine ou un mois, et où tout s’en va à la dérive… Le détenu en cellule a donc surtout besoin d’être protégé contre l’inaction. Alors que les détenus en commun accepteraient volontiers le repos, lui ne saurait se passer de travailler. Aussi l’Administration, malgré les difficultés que présente cette tâche, fait-elle les plus louables et les plus sérieux efforts pour donner aux détenus cellulaires l’emploi constant de leurs forces et de leur temps.
Normalement, la privation de travail en cellule est considérée comme punition disciplinaire ou complément de punition, et n’est appliquée que comme telle.
« Le travail dans les prisons a un but multiple. C’est : 1° un châtiment ; 2° une mesure d’ordre ; 3° un moyen moralisateur ; 4° une économie pour l’État ; 5° et une préparation au reclassement après la libération ». (Dalloz.)
Les condamnés seuls sont astreints au travail obligatoire. Les prévenus, jouissant encore d’une partie de leurs droits individuels, ont droit à l’oisiveté. Ils peuvent lire, écrire, recevoir des visites avec l’autorisation du juge d’instruction, ne rien faire si bon leur semble. Mais souvent ils sont les premiers à demander du travail ou à accepter celui qu’on leur propose.
Les condamnés politiques jouissent d’une distinction. Ils ne sont pas non plus obligés de travailler. Cette distinction repose sur l’ancien principe, aujourd’hui reconnu pour faux, que le travail est surtout une aggravation de la peine.
Cette situation spéciale faite aux condamnés politiques a été combattue par différents auteurs. MM. Laborde et Dalloz, notamment, demandent que ces condamnés « dont les méfaits ont troublé l’ordre social, contribuent eux-mêmes, quelle que soit la nature de leur méfait, à alléger les charges qu’impose à l’État l’exécution des peines qu’ils ont encourues ».
Il est à remarquer aussi que d’après les articles 21 et 40 du Code pénal, une différence semblerait devoir exister entre les condamnés simplement correctionnels et les condamnés à la réclusion. Aux premiers serait accordée la faculté de faire un choix parmi les divers travaux en usage dans la prison où ils sont détenus. Les réclusionnaires, au contraire, seraient astreints, sans aucune espèce de choix ou d’option possible, au genre de travail qu’il convient à l’Administration de leur fixer. Cette différence est purement théorique. Dans la pratique, elle n’a jamais été observée. Et pour les uns comme pour les autres c’est l’Administration ou l’entrepreneur qui détermine et règle la distribution du travail, en tenant compte des capacités de chacun et surtout des besoins du service.
Les condamnés à mort ne sont pas soumis à l’obligation du travail.
La grande question relativement au travail dans les prisons n’est donc pas de savoir si les détenus doivent travailler, mais bien de quelle façon ils doivent travailler, dans quelles conditions, comment leur travail doit être organisé et réglementé.
C’est là que l’Administration se heurte à des difficultés nombreuses, à des problèmes complexes ; difficultés qui tiennent à trois ordres d’idées principaux : le système de travail (entreprise ou régie), les plaintes et réclamations de la main-d’œuvre et de l’industrie privées, et le salaire des détenus.
Dans les maisons de longue peine ou Maisons Centrales l’organisation du travail est relativement aisée. De vastes ateliers peuvent y être aménagés, où peuvent fonctionner des machines demandant le concours d’ouvriers expérimentés. La détention se prolongeant durant des années, les détenus ont le temps de faire au besoin une sorte d’apprentissage et d’acquérir une certaine habileté dans les travaux auxquels ils sont employés.
Dans les prisons de courte peine, spécialement avec le régime cellulaire, donner un travail constant et utile à des hommes dont la détention ne dure parfois que quelques jours ou quelques semaines, et dont les professions et les aptitudes sont des plus diverses, semble une tâche aux difficultés presque insurmontables.
Le labeur imposé ne doit pas être improductif et inutile. Il faut que d’une façon quelconque il profite à la Société, et qu’en outre il puisse préparer le détenu à gagner sa vie honnêtement quand il sera rendu à la liberté. Astreindre le condamné à un travail inutile serait l’abaisser au rang de bête dont on use les forces physiques derrière les barreaux d’une cage. L’Administration, qui ne cesse jamais d’envisager la possibilité d’un relèvement moral, ne saurait s’abaisser à de semblables procédés.
Il est malheureusement impossible de mettre toujours entre les mains des détenus des métiers pouvant leur être utiles dans la vie libre. Toutes les professions manuelles ne peuvent être exercées en prison. L’Administration a dû choisir les plus faciles, celles exigeant le moins de préparation ; et elle est obligée de cantonner chaque détenu dans une spécialité, dans une partie de fabrication. On peut regretter cet état de choses ; mais comment faire autrement ?… On ne saurait non plus reprocher à l’Administration de soumettre tous les détenus indifféremment à des travaux modestes, à des besognes d’artisan, et de ne pas autoriser certains, d’une classe sociale plus élevée et de facultés plus cultivées, à employer leurs talents ou leurs aptitudes personnelles. Le principe de l’égalité dans l’exécution des peines s’oppose à toute espèce de distinction et de sélection, surtout dans les prisons de détention en commun.
Le rêve serait que chaque détenu put exercer en prison le métier qu’il exerçait précédemment dans la vie libre, ou qu’il aurait dû y exercer s’il avait été laborieux et honnête. Mais ce n’est là qu’un rêve totalement irréalisable.
Le travail en cellule, donnant au condamné une existence individuelle tout à fait séparée de celle de ses codétenus et d’eux inconnue, peut permettre l’exercice pour certains de professions plus relevées, auxquelles leur situation sociale paraît les destiner. Dans ses intéressants travaux préparatoires du dernier Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, M. Herbette, directeur de l’Administration pénitentiaire en France, fait, en effet, remarquer que, dans le régime cellulaire, on peut se départir dans une notable mesure de la grande sévérité avec laquelle on applique l’égalité devant la peine et devant le travail. Il admet que les condamnés en cellule pourraient être autorisés à exercer « les professions même les moins usuelles et les plus relevées, pourvu qu’elles n’exigent pas de relations libres et directes avec d’autres personnes ». Selon lui, « rien ne s’opposerait à ce que certains détenus ne reçoivent et exécutent dans leurs cellules des commandes spéciales et des travaux particuliers ».
Ce sont là des idées généreuses et philanthropiques qui seront peut-être appliquées dans un avenir plus ou moins lointain, mais par lesquelles il ne faudrait sans doute pas se laisser séduire trop entièrement. Où s’arrêterait-on dans cette voie ? Permettrait-on à un littérateur, condamné pour vol, par exemple, de passer ses journées à écrire dans sa cellule sous le fallacieux prétexte qu’il a un roman en train et que ses aptitudes ne lui permettent pas d’autre genre de travail : De même un peintre pourrait-il transformer sa cellule en atelier où il préparerait et exécuterait des tableaux ?… Ne serait-ce pas amoindrir sensiblement la peine de pareils détenus ?
L’Administration pénitentiaire a pour assurer le travail dans les prisons deux modes de procéder, deux systèmes principaux : l’Entreprise et la Régie.
Dans le système de l’Entreprise, elle fait appel à des entrepreneurs qui soumissionnent par voie d’adjudication publique les services d’entretien et de nourriture des détenus, et qui s’engagent à leur fournir du travail, le tout suivant des règlements généraux ou spéciaux, et d’après les clauses d’un cahier de charges. Le bénéfice du travail du prisonnier leur est abandonné en échange.
Avec le système de la Régie, l’Administration fait confectionner pour ses besoins propres, ou pour ceux d’autres services de l’État, ce dont elle a besoin. Elle se charge d’assurer elle-même l’entretien des prisonniers et bénéficie de leur main-d’œuvre.
Quelquefois, l’Administration a une troisième façon de procéder : la demi-régie, ou demi-entreprise. Elle prend alors des sous-traitants ou confectionnaires et leur donne le droit d’exploiter pour leur compte un ou plusieurs genres spéciaux de travail ou de fabrication qu’elle ne pourrait pas utiliser pour elle-même.
Le système de l’Entreprise est le plus ancien. Il est encore le plus généralement appliqué. La plupart des Maisons Centrales, d’arrêt, de justice et de correction y sont soumises. Mais à la date du 15 février 1893 toutes les prisons de la Seine ont été placées sous le régime de la Régie.
Lequel de ces trois systèmes doit ou plutôt devrait être préféré ?… Lequel présente les plus grands avantages, non seulement pour l’Administration mais encore pour les prisonniers eux-mêmes ?…
C’est évidemment la Régie.
Écoutons, sur ce sujet, M. Garraud qui a savamment traité des questions pénitentiaires :
« Au premier cas (Entreprise), un entrepreneur général assume toutes les charges de la prison ; il entretient et nourrit les détenus, leur fournit du travail et leur paie une rétribution. Aussi tout le produit du travail lui est abandonné, et, de plus, il reçoit de l’État, par jour et par détenu, une allocation qui varie, surtout par suite de la différence du prix des vivres dans chaque région, de 30 à 35 centimes. Au second cas (Régie), c’est l’État qui procure directement le travail aux détenus, les nourrit, les entretient, leur paie un salaire, mais recueille toutes les recettes provenant de leur industrie. Parfois les deux systèmes sont combinés, l’État passe des marchés spéciaux avec certains entrepreneurs qui exploitent moyennant une somme déterminée une ou plusieurs branches d’industries organisées dans la région.
La différence entre le système de la Régie et celui de l’Entreprise est caractéristique, car dans le premier l’État conserve la direction absolue du travail et il peut l’organiser dans un but pénitentiaire ; dans le deuxième, l’État délègue une partie de l’administration de la prison à un traitant qui a pour but unique de rendre son exploitation commerciale lucrative. Les avantages de l’Entreprise, au double point de vue économique et financier, ont fait oublier ses inconvénients au point de vue pénitentiaire. »
Presque unanimement les auteurs qui ont étudié l’organisation pénitentiaire condamnent le système de l’Entreprise. Il nous suffira de citer MM. d’Haussonville (Établissements pénitentiaires), Ortolan (Éléments de droit pénal), H. Joly (Le combat contre le crime), Laborde… Les Cours d’appel, consultées dans l’enquête préalable au vote de la loi du 5 juin 1875, se sont prononcées à une grande majorité en faveur de la Régie. Et l’Entreprise a été en principe reconnue mauvaise et condamnée par le Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, en 1890.
Le système de la Régie devrait seul être en usage dans les prisons. De même que les fonctionnaires de l’État ont seuls qualité pour régler tous les instants et tous les modes de la vie pénitentiaire, « ils devraient avoir seuls le droit de réglementer le travail dans l’intérêt même de l’œuvre dont ils ont la charge, et sans autre préoccupation que celle des intérêts bien multiples dont ils ont le souci ». (Herbette.)
La Régie a le défaut de ne pouvoir en tout temps assurer pour le compte de l’État un travail certain à tous les détenus. Elle nécessite un nombre considérable d’employés et de fonctionnaires, en même temps commerçants et industriels. Ces fonctionnaires doivent être des hommes dévoués et scrupuleusement intègres ; il leur faut se préoccuper constamment de toutes les conditions du travail, se tenir au courant du prix des matières premières dans leur région, étudier, pour les appliquer si possible, les perfectionnements, les inventions, les découvertes, ménager l’intérêt des autres administrations aussi bien que des particuliers. Ce système expose l’État à des pertes souvent considérables. La première condition de succès pour l’Administration faisant travailler en régie est, en effet, d’avoir une clientèle. Il faut qu’elle place ses produits dans des conditions rémunératrices, ce en quoi elle ne réussit pas toujours ; car elle est, en tant qu’État, dans l’impossibilité morale de profiter de certaines occasions, de négocier telles « bonnes affaires » qu’un particulier ayant moins de scrupules, sinon moins d’honnêteté, ne laisserait pas échapper. Aussi l’État avec le système de la Régie s’efforce-t-il dans la mesure du possible de ne travailler que pour lui, d’être à la fois producteur et consommateur. C’est ainsi qu’il fait confectionner dans différents établissements pénitentiaires des vêtements de détenus, des uniformes de gardiens, et des effets d’équipement militaire. C’est ainsi encore qu’il a installé dans la Maison Centrale de Melun, des ateliers d’imprimerie et de papeterie d’où sortent en grande quantité les imprimés et les registres administratifs.
Le système de la Régie est celui que préfèrent de beaucoup les condamnés. Ils éprouvent une sorte de soulagement à travailler pour l’Administration elle-même, plutôt que de voir le produit de leur main-d’œuvre enrichir des entrepreneurs plus ou moins rapaces. Leurs gains ne sont pas plus élevés sous l’un ou l’autre système, mais il est à noter que les plaintes sont beaucoup moins fréquentes avec la Régie. Le prélèvement opéré sur la main-d’œuvre prend alors un caractère de pénalité plus évident, et le détenu ressent moins cette impression que des gens spéculent sur son malheur, que sa peine et son travail servent à édifier la fortune d’industriels.
Le prisonnier, qui ne réfléchit guère et ne voit que ce qui lui tombe immédiatement sous le sens, considérera toujours l’entrepreneur comme un exploiteur cherchant à réaliser sur lui tous les bénéfices possibles par tous les moyens possibles. Et il faut bien reconnaître que dans plus d’un cas il n’aura pas tort.
L’Entreprise, il importe de ne pas l’oublier, n’implique pas l’abdication absolue des droits de l’Administration entre les mains d’un entrepreneur qui deviendrait par ce fait tout puissant dans la prison. Elle est réglementée par des cahiers de charges longuement étudiés et où tout est prévu et spécifié. Ces cahiers de charges sont constamment soumis à l’examen de fonctionnaires compétents, qui tiennent compte de tous les abus à eux signalés, écoutent toutes les plaintes, modifient et révisent les divers articles, de manière à diminuer autant que faire se peut les inconvénients du système. L’Administration, justement soucieuse de ses prérogatives et de sa mission moralisatrice, garde tous ses droits à l’égard de l’entrepreneur. Celui-ci doit se borner exclusivement aux genres de travaux en usage dans la prison pour laquelle il a traité. Il ne peut en aucun cas les modifier, les augmenter, ou les supprimer sans une décision des agents de l’État. Les prix, les salaires à allouer aux détenus sont fixés par ces agents, qui sont seuls compétents pour tout ce qui touche les punitions et le service intérieur. Les employés de l’entreprise, les contremaîtres chargés de répartir la besogne et de la diriger, n’ont le droit de pénétrer dans la prison qu’avec l’autorisation des fonctionnaires de l’État ; ils y sont assujettis aux règlements et leur exclusion peut toujours être exigée ; l’État surveille également la fourniture des habillements et des aliments. Il a seul qualité pour juger les réclamations et les différends de quelque nature qu’ils soient.
Étudié au point de vue économique, le travail dans les prisons paraît avoir des effets regrettables.
Si l’on admet que ce travail doit être utile, productif, donner un rendement, mettre au jour des objets à écouler, il faut s’attendre forcément aux protestations et aux réclamations de l’industrie privée. Toute la besogne faite dans les prisons, semble, en effet, autant de retiré à l’entreprise et à la main-d’œuvre libres. Si les prisonniers ne fabriquaient pas tels ou tels articles, le consommateur, État ou public, serait obligé pour ces articles de s’adresser à la fabrication libre. Un grand nombre d’objets manufacturés dans les prisons à des prix très inférieurs sont jetés sur le marché, forçant les travailleurs honnêtes à abaisser leurs propres prix ou à changer leur genre de fabrication. La concurrence est difficile, pour ne pas dire impossible, attendu les conditions de régularité forcée dans lesquelles on travaille en prison, le peu de dépenses d’entretien nécessitées et le nombre considérable de mains pouvant être utilisées. Si le travail effectué en prison laisse assez fréquemment à désirer comme fini et comme perfection, il ne s’en impose pas moins au public à cause de son bon marché. Presque tous les objets vendus à vil prix, les jouets de quelques sous que promènent les camelots ou qui s’étalent à l’étalage des bazars, ont vu le jour dans les maisons pénitentiaires. C’est le triomphe de la main-d’œuvre à prix réduit.
Aussi les récriminations sont-elles constantes de la part des industriels et des petits fabricants obligés de compter avec cette énorme production. Des campagnes ont été menées dans la presse contre une concurrence aussi redoutable ; on a été jusqu’à demander la suppression totale du travail pénitentiaire pour sauvegarder les droits du travail libre, – remède qui serait bien pire que le mal.
Ces plaintes et ces récriminations ont leur raison d’être, on est obligé de le reconnaître ; mais elles ont été considérablement exagérées. À entendre certaines personnes, le mauvais état des affaires, la stagnation de nombreuses industries, n’auraient pas d’autre cause que la concurrence désastreuse, écrasante, créée par le travail des prisons. Les gens dont les affaires périclitent, ou simplement qui ne réalisent pas les bénéfices rêvés, cherchent toujours une raison à mettre en avant. Et rien n’est plus facile que de charger l’Administration pénitentiaire, de faire chorus avec la foule de ses détracteurs. L’industrie française chôme, le commerce ne gagne pas ce qu’il voudrait, il faut quelqu’un à qui s’en prendre, et c’est l’Administration pénitentiaire, la pelée, la galeuse d’où vient tout le mal !…
La main-d’œuvre utilisée dans les prisons, ne devrait-elle pas, normalement et dans une société fonctionnant bien, être utilisée au dehors ?…
L’Administration se préoccupe vivement d’ailleurs de la concurrence qu’elle peut créer à l’industrie libre, et elle s’applique, sinon à la supprimer entièrement, du moins à ne pas la rendre trop sensible. Pour cela, elle répartit dans un grand nombre de maisons, sur tous les points du territoire, la masse d’ouvriers qu’elle asservit à son travail forcé. Elle emploie cette main-d’œuvre puissante à un nombre considérable de travaux et de fabrications les plus disparates, elle diversifie le plus possible les industries, de façon que la production des détenus, s’éparpillant sur une variété énorme d’objets, ne pèse plus aussi lourdement sur le marché extérieur. Elle règle les effectifs de ses ateliers en tenant compte du nombre d’ouvriers libres employés dans la région aux mêmes travaux. Enfin elle examine soigneusement la question des salaires et des prix de main-d’œuvre, prenant en considération tous les éléments d’appréciation, s’inspirant de l’avis des chambres de commerce, voire des chambres syndicales, demandant quelquefois l’opinion des principaux industriels de la région.
Les règlements de l’Administration la mettent du reste constamment à même de faire cesser les abus de la concurrence s’ils se produisent et sont dûment constatés. Elle a recours pour cela à la révision des tarifs, au changement de genre de travail, à la modification de ses ateliers, etc.
« L’Administration française, dit M. Herbette, établirait avec aisance que, sauf de menus incidents toujours faciles à faire cesser et n’ayant qu’un effet minime dont les causes précises restent souvent douteuses, la concurrence des prisons ne produit à Paris et en province aucun dommage sérieux que l’on ait pu constater ».
On peut objecter que la voix de M. Herbette n’est en somme que la voix de l’Administration prêchant pour son saint, c’est-à-dire pour elle-même, et naturellement portée à l’optimisme…
À combien peut s’élever par jour le gain des détenus ?
Il n’y a pas de gain fixe. Les détenus sont tous payés aux pièces, c’est-à-dire en raison de la somme de travail par eux fournie. Les genres de travaux n’étant pas les mêmes partout les salaires peuvent être plus élevés dans certaines prisons ; ils peuvent même varier d’un atelier à l’autre dans la même prison. En tout cas, la différence n’est pas énorme. Elle ne va jamais au-delà de quelques sous par jour, ce qui est déjà fort appréciable… en prison et même ailleurs. La différence dans les gains tient surtout, et d’une façon bien plus sensible, au plus ou moins d’habileté des travailleurs, et à la dose de bonne volonté qu’ils apportent à leur travail. Il y a des détenus qui, réfractaires à toute obéissance, ne travaillent que contraints et forcés, indifférents à toute considération de bénéfices et d’amélioration. Ceux-là arrivent à des gains dérisoires de 40 à 50 centimes par jour. D’autres travaillent avec acharnement, s’appliquent, mettent tous leurs soins à la besogne. Ceux-là atteignent des salaires de 2 et 3 francs par jour. On en a vu, paraît-il, arriver à gagner 150 francs par mois.
Nous examinerons les gains plus en détail et de façon plus précise au cours de notre visite dans les différentes prisons.
Aux termes de l’article 72 du Règlement, le produit du travail est réparti par portions égales entre le détenu et l’entrepreneur, ou l’Administration si la prison est en régie. Il revient donc au condamné cinq dixièmes. La moitié de ces cinq dixièmes est disponible pour lui, pour ses besoins journaliers ou ceux de sa famille ; il a le droit de s’en servir pour améliorer et augmenter, dans des limites fixées, sa nourriture, au moyen d’achats faits à la cantine. L’autre portion est mise en réserve pour lui former une sorte de masse, un pécule qu’on lui donne à sa libération afin de lui faciliter la rentrée dans la vie honnête. Les récidivistes voient diminuer le chiffre de leurs dixièmes.
Les intéressés se plaignent de n’être pas suffisamment payés ; leur travail, disent-ils, vaut beaucoup plus que les gains qu’on leur accorde. Les entrepreneurs prétendent qu’ils sont obligés de se récupérer des pertes résultant pour eux de l’inexpérience et du mauvais vouloir des détenus. Ceux-ci, de leur côté, affirment que la perte provenant de l’inexpérience et de l’inhabileté est à peu près nulle en de raison la facilité des travaux, et que la perte résultant de la malveillance de certains devrait être supportée non par la collectivité mais par ceux qui sont les coupables, et punie par des châtiments personnels.
Malgré les dires des détenus, nous ne pensons pas qu’il soit possible d’élever leurs salaires dans des proportions appréciables.
En ce qui concerne les travaux des femmes, ils sont en général si peu payés dans la vie libre, ils se confondent si souvent avec les emplois subalternes, que les femmes prisonnières ne se plaignent guère de la modicité de leurs gains. On a même constaté dans plusieurs cas que les salaires des établissements pénitentiaires, pour certains travaux accomplis par les femmes, étaient plus élevés que ceux obtenus pour les mêmes travaux par les ouvrières libres.
En considérant les prix accordés aux condamnés et les retenues qu’ils ont à subir, on peut se demander ce que deviennent la femme et les enfants d’un père de famille travailleur, qu’une faute quelconque jette en prison pour quelques semaines ou pour quelques mois. Il faut admettre, en effet, que les prisons ne renferment pas que d’affreuses crapules, récidivistes forcenés, chevaux de retour, clients habituels de l’Administration. Un ouvrier en somme honnête, un homme ayant à nourrir à lui seul toute une famille, peut se trouver jeté en prison à la suite d’une faute, d’un délit perpétré dans un moment d’égarement ou d’aberration. Comment vivront alors les siens, privés de leur gagne-pain ? Dans ces cas spéciaux, l’Administration qui ne veut pas la mort du pécheur se montre très large. Et quand elle est bien sûre d’avoir affaire à un homme malheureux plutôt que malhonnête, elle lui fournit un travail rémunérateur en ne retenant que le strict nécessaire pour son entretien. Le reste est mis à la disposition de la femme et des enfants. Le fait se produit assez fréquemment dans les prisons parisiennes, notamment à la Santé. Et les détenus qui ont été l’objet de cette mesure de faveur se sont toujours loués des procédés de l’Administration à leur égard.
On pourrait écrire indéfiniment sur le travail pénitentiaire. Mais nous devons nous borner. Les lecteurs que ce sujet pourrait intéresser n’auront que l’embarras du choix : les ouvrages à lire fructueusement ne manquent pas, il y en a des bibliothèques entières.
Dans la seconde partie de ce livre, nous aurons d’ailleurs l’occasion de détailler les différents genres de travaux effectués dans les prisons de Paris, et d’en voir de plus près le fonctionnement.
L’administration et le règlement intérieurs. – Les directeurs, les employés, les gardiens. – La discipline et les punitions disciplinaires.
Depuis leur organisation jusqu’en 1888, les prisons de la Seine étaient administrées par le Préfet de Police sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.
Un décret du 28 juin-20 septembre 1887, les a, après une longue enquête, rattachées directement au Ministère de l’Intérieur, les soumettant aux mêmes conditions d’administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements. Ce décret a retiré au Préfet de Police le droit de nomination des directeurs et des différents fonctionnaires, et ne lui a laissé que « les attributions qu’il exerçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet du département de la Seine, en ce qui concerne les prisons ».
Tout ce qui touche l’administration et le fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévu et régi par le décret des 11-16 novembre 1885. Ce décret, soigneusement étudié par les hommes les plus compétents, est un véritable monument. Il ne laisse rien à l’imprévu, règle et détermine tout par le menu.
Nous le suivrons ici dans ses principales lignes.
Le personnel de direction et de surveillance varie naturellement suivant l’importance des maisons. Il est fixé pour chaque établissement par le Ministre de l’Intérieur.
Le Directeur est le représentant dans la prison de l’Administration pénitentiaire. Il est responsable de la marche et du fonctionnement régulier de tous les services. Tous les ordres émanent de lui ; et quand ils sont donnés par une autorité supérieure, c’est seulement par son intermédiaire qu’ils doivent être transmis au personnel placé sous ses ordres.
La direction d’une prison est une œuvre fort délicate et très difficultueuse. Elle exige de celui qui en est chargé de l’intelligence, de l’énergie et du cœur. Et si au point de vue du résultat à obtenir l’amélioration des locaux, du régime et des services divers joue un grand rôle, la capacité et la compétence du directeur sont surtout à considérer. Tel fonctionnaire dévoué, se consacrant entièrement à son service, saura tirer un excellent parti de l’établissement le plus imparfait, et réussira là où tel autre, moins convaincu, ayant moins de cœur et de connaissances, échouerait totalement.
Les détenus se louent presque toujours des Directeurs. Ils reconnaissent leur dévouement et gardent un durable souvenir des marques d’intérêt qu’ils ont reçues d’eux. La plupart des directeurs conservent des lettres que leur ont adressées des prisonniers après leur libération, pour le remercier et leur dire ce qu’ils deviennent.
Les Directeurs sont divisés en quatre classes, basées sur le mérite personnel et ne tenant en rien à la résidence, à telle ou telle maison. Un même directeur peut sans changer d’établissement être successivement élevé de la quatrième à la première classe. Le traitement varie en proportion. À Paris, un directeur de 1re classe touche annuellement 6 000 francs ; les émoluments des directeurs de 2e classe sont de 5 500 francs ; ceux d’un directeur de 3e classe de 5 000, et ceux d’un directeur de 4e classe de 4 500 francs.
Les Directeurs sont logés dans les établissements qu’ils dirigent.





























