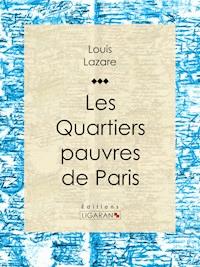
Extrait : "Nous avons une ambition, une seule, c'est de renseigner fidèlement l'autorité sur la situation des quartiers pauvres de Paris. Si le 20e arrondissement est le dernier dans l'ordre numérique, il a droit à la priorité dans nos réclamations, parce qu'il est le plus malheureux."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034585
©Ligaran 2015
Nos articles publiés dans le journal le Peuple Français sur les quartiers pauvres de Paris ont eu un retentissement qu’il était facile de prévoir.
Ce retentissement, nous le considérons comme le présage d’une véritable Renaissance administrative.
En effet, jamais à aucune époque les habitants de Paris n’ont discuté plus chaleureusement les actes de l’administration municipale ; on les interprète avec vivacité dans les salons, dans les ateliers, dans la rue, partout.
Cette disposition des esprits est excellente ; ces discussions, bientôt, produiront un frottement électrique, d’où jaillira la lumière sur les actes de nos administrateurs.
Non seulement les Parisiens veulent savoir comment on a dépensé les deux milliards mis à la disposition de l’autorité municipale, mais ils croient encore avec raison qu’ils ont droit à l’honneur d’être consultés sur la direction nouvelle qu’il importe d’imprimer au plus tôt à toutes les grandes opérations de la ville de Paris.
C’est évidemment pour leur faciliter l’initiation aux actes de M. le Préfet de la Seine que bon nombre des lecteurs du Peuple Français nous ont engagé à reproduire, en les développant, nos articles publiés dans ce journal, et d’en composer autant de brochures que la Ville de Paris renferme de quartiers pauvres.
Notre ouvrage profitera grandement de la réunion de nos articles en un volume. En effet, tout en exprimant notre reconnaissance envers le journal qui nous a donné une hospitalité si courtoisement généreuse, il n’en faut pas moins reconnaître cette vérité que le fractionnement d’une œuvre administrative, qui laisse toujours le lecteur en suspens, énerve l’écrivain dont le travail souffre d’être ainsi déchiqueté. Puis il se sent à l’étroit, toujours gêné, sur le lit de Procuste, dans une feuille politique.
En administration municipale, l’écrivain n’admet pas de système et ne distingue aucune nuance politique. Il professe un principe, un seul, mais il est huit fois séculaire, constamment vrai, toujours jeune de droiture et de pureté. Ce principe inflexible le fait chêne, jamais roseau. Il sait qu’il remplit une obligation d’honneur, un devoir toujours sacré que nos anciens et dignes échevins de Paris traduisaient en ces termes, que le temps n’a pas déflorés :
Gardons-nous de donner la picorée à notre ambition, que tous nos actes soient inspirés par ce désir constant de réaliser le plus de bien possible en faveur du pauvre et menu peuple, à cette fin que sa reconnaissance rende la tâche du souverain plus facile, plus heureuse et mieux méritante aux regards de Dieu !
Selon nous, l’administration municipale actuelle a méconnu ces sages maximes ; c’est parce qu’il a sommes l’adversaire du Préfet de la Seine. Que de bien ce magistrat pouvait réaliser, que de sympathie il pouvait conquérir au grand profit de l’autorité, quelle sainte mission, enfin, il avait à remplir !
Disons tout ce qu’il pouvait faire, et voyons ce qu’il a fait.
C’était une grande et généreuse pensée que lui donnait à traduire le souverain par la transformation du centre de Paris. En effet, depuis des siècles, le centre de cette ville était sillonné de ruelles étroites et malsaines ; toute une population d’artisans et d’ouvriers naissait, souffrait, mourait sans sortir d’une atmosphère putride. C’était faire acte d’humanité que de mettre un terme à cet entassement de chair humaine, de complicité permanente avec toutes les épidémies, fauchant de préférence nos classes laborieuses.
Mais en les forçant de quitter le centre de Paris, où le prix des locations cessait d’être accessible à nos ouvriers, l’humanité commandait de leur accorder de justes compensations.
Il fallait, en même temps qu’on élargissait les voies de l’intérieur de Paris, qu’on faisait le vide par de grandes trouées, improviser aux extrémités de la ville de modestes et nombreuses constructions en rapport avec cette formidable émigration.
Il fallait, dès le jour où cette grande mesure de l’extension des limites de Paris était arrêtée en principe, s’abstenir de toute opération luxueuse dans les quartiers riches ou aisés, en vue d’économiser les ressources de la ville pour donner le strict nécessaire aux quartiers pauvres.
Loin de là, les travaux de luxe ont été continués, poursuivis avec une activité plus fiévreuse encore ; des avenues, des boulevards sans nombre ont été créés, improvisés, surtout à l’ouest de la ville, au moment où nos classes laborieuses étaient repoussées au loin.
Tandis que l’administration municipale dépensait les millions par centaines pour ces nouvelles voies et les abords si mal compris, si difformes du nouvel Opéra, les taxes d’octroi de Paris frappaient dans l’ancienne banlieue, brutalement annexée, nos artisans et nos ouvriers. Ils étaient refoulés dans ces localités, véritables Sibéries, sillonnées de ruelles étroites, de chemins tortueux, sans pavage, sans éclairage, sans marchés, privées d’eau, où tout manquait enfin.
Voyons ce qu’a produit l’accumulation monstrueuse des grands travaux, principalement à l’ouest de Paris :
L’augmentation foudroyante de la population dans le sens dangereux des classes nécessiteuses. En effet, cette exagération devait exercer une attraction irrésistible sur les cultivateurs, les artisans et les ouvriers de nos provinces.
Le soir, à la veillée, lorsque le maître d’école, le savant de la commune faisait la lecture du Grand Journal, une commotion électrique parcourait tout l’auditoire, écoutant ce passage, qui semblait emprunté aux Mille et une Nuits :
On dépense en travaux de luxe dans Paris, chaque année, une centaine de millions.
Il semblait à ces bons paysans qu’il pleuvait dans la capitale de l’or, des perles et des diamants. Les jeunes, en grand nombre, ont émigré, les vieux sont restés.
– Mais, répond le Préfet, c’est l’achèvement des voies de fer, qui toutes rayonnent sur Paris, qui est la cause réelle de cette émigration.
– Assertion fausse et calculée, réplique la province ; les cultivateurs et les artisans de nos villes secondaires sont venus envahir la ville de Paris avec la pensée d’y travailler moins durement, d’y vivre plus à l’aise en gagnant davantage.
Lorsque le magistrat, pour excuser son exagération, vient nous dire ensuite en forme de consolation : la mortalité a diminué relativement dans Paris.
Parbleu ! c’est facile à comprendre. M. le Préfet enlevait à la province les jeunes et les valides, qui sont venus naturellement augmenter la durée moyenne de l’existence dans Paris.
Cette exagération désordonnée des travaux à l’ouest de la ville a produit également une hausse excessive des terrains, un agiotage, triste et honteuse réminiscence de cette frénésie excitée sous la régence du duc d’Orléans par le tripotage sur les actions du Mississipi.
Que de fortunes imméritées et scandaleuses ! Le sens moral de Paris, d’où part le premier rayonnement qui éclaire le monde, n’est-il pas continuellement offensé par ce contact de la richesse qui ne doit qu’au hasard ou à la spéculation le droit d’insolence qu’elle s’arroge ?
Ce qu’il y a de plus affligeant encore, lorsqu’on remue cette boue de spéculation véreuse, c’est d’y trouver des noms qu’il semblait impossible d’y ramasser, tant leur notoriété devait être pour eux une obligation d’honneur et de loyauté.
Enfin l’exagération des dépenses superflues en faveur des quartiers riches devait amener fatalement l’interruption prolongée des travaux urgents dans les quartiers pauvres, et cela peu de temps avant les élections.
En effet, à peine l’administration municipale avait-elle jeté par terre de splendides hôtels des rues de la Paix, Louis-le-Grand et du boulevard des Capucines, dont huit seulement ont coûté plus de 17 millions, qu’elle renvoyait, faute d’argent, les ouvriers travaillant dans les chantiers établis dans la zone annexée.
Paris avait mis huit siècles à devenir une grande capitale. En moins de soixante années, Paris a plus que doublé son étendue et triplé sa population.
Mais le vrai peuple parisien, homogène, sans croisement, cherchez-le maintenant.
Il est étouffé, aplati sous plusieurs couches provinciales. Quel contraste il faisait avec cette variété, ce mélange de peuplades, de caractères opposés, de natures différentes ou hostiles, ayant abandonné, pour se jeter sur Paris comme sur une proie, père, mère, femme et enfants, tout ce qui fait la joie pure de ce monde par l’accomplissement du devoir !
Qu’a produit cette agglomération provinciale dans Paris ? De longs et cruels chômages et l’avilissement du salaire par une concurrence fiévreuse, au grand détriment des ouvriers parisiens. L’industrie et le commerce seraient pour eux suffisamment rémunérateurs ; mais, comme il faut qu’ils partagent avec les provinciaux et les étrangers, leur gain diminuant, c’est le pain des enfants que cette concurrence ruineuse a rogné.
Enfin, voici le bilan de la situation actuelle de Paris :
Sur deux millions d’habitants, la capitale ne compte pas vingt-cinq mille personnes véritablement riches, cent soixante mille à peine jouissent d’une certaine aisance ; puis une population flottante de cent mille provinciaux ou étrangers, en tout trois cent mille qui dépensent largement.
Mais en face de ce contingent de richesse et d’aisance, se dresse une agglomération formidable d’ouvriers et d’artisans, dont les trois quarts manqueraient du nécessaire si le travail leur faisait défaut durant un mois seulement.
Les arts ont groupé dans Paris toutes leurs merveilles, le luxe toutes ses séductions, les plaisirs toutes leurs variétés ; mais tout ce luxe, toutes ces séductions, toutes ces merveilles sont enfermés, cerclés, bloqués dans une ruche immense. Autour de la Cité Reine se dresse une formidable cité ouvrière : l’une est parée de soie, de velours et de diamants, l’autre n’a d’ordinaire que son vêtement de travail.
Ô folie ! avoir appelé à sons de trompe toute cette population ouvrière de la province, pour constituer une majorité pauvre dans Paris ! Avoir mis toutes les séductions aux prises avec toutes les convoitises, la satiété avec la faim, le superflu avec la misère !
Qu’on demande donc enfin à M. le Préfet de la Seine combien son administration a créé, d’un côté, d’amis dévoués à l’autorité, et, de l’autre, quel est le nombre d’adversaires dont elle a grossi les rangs !
Nous avons une ambition, une seule, c’est de renseigner fidèlement l’autorité sur la situation des quartiers pauvres de Paris.
Si le 20e arrondissement est le dernier dans l’ordre numérique, il a droit à la priorité dans nos réclamations, parce qu’il est le plus malheureux.
Le tableau de sa misère, nous l’empruntons à ses magistrats eux-mêmes :
XXe arrondissement. – Mairie de Ménilmontant.
HIVER 1868-1869.
Le maire, les adjoints et les administrateurs du bureau de bienfaisance.
À MM. les habitants de Paris.
À l’approche de l’hiver, nous venons adresser un nouvel appel à votre charité.
Le 20e arrondissement, formé de Ménilmontant, de Charonne et de la partie la plus malheureuse de Belleville, se trouve être aujourd’hui, par l’augmentation toujours croissante de sa population indigente et son manque absolu de ressources intérieures, un des plus pauvres de Paris.
Nos ménages inscrits, qui, il y a quatre ans, étaient au nombre de 2 000, ont doublé maintenant et représentent 12 000 individus secourus ; de plus, les malades soignés par notre bureau depuis le 1er janvier de cette année jusqu’à ce jour ont atteint le chiffre de 6 000, sans compter 1 200 accouchements opérés par nos sages-femmes.
C’est donc avec confiance que nous nous adressons à vous. Votre offrande, quelle qu’elle soit, sera accueillie avec reconnaissance, et grâce à votre concours nous pourrons soulager d’une manière plus efficace les misères plus nombreuses qui nous entourent et qui grandissent encore avec la saison rigoureuse.
Agréez, etc…
Morel Fatio, maire, président ; Héret et Le Blévec, adjoints-présidents ; Milan, administrateur, vice-président ; Merché, administrateur, ordonnateur ; Meunier, administrateur, secrétaire honoraire ; Saugé, Bonnet, Bouvier, André, Collaux, Bégard, Hagène, Gewer, Garlin, administrateurs.
Ce document officiel ne donne qu’une idée bien affaiblie de la misère dont souffre le vingtième arrondissement.
Outre les personnes secourues, il existe un plus grand nombre de nécessiteux qui n’ont pas droit à l’inscription réglementaire.
Il en est du vingtième comme du treizième ; ils sont frères par l’indigence. Or le maire du treizième arrondissement s’exprime en ces termes dans un appel semblable à la charité publique :
À MM. les habitants de Paris.
Quinze mille indigents inscrits, comprenant cinq mille ménages ; un plus grand nombre de nécessiteux n’ayant pas droit à l’inscription réglementaire, mais qu’il faut absolument secourir : tel est le bilan de nos misères, etc…
LEBEL, maire ; D’ENFERT et ROBIN, adjoints. »
Un simple calcul de proportion entre la population du treizième et celle du vingtième nous permet d’affirmer que ce dernier arrondissement, renfermant à peine cinquante mille habitants, compte au moins vingt-cinq mille nécessiteux.
Maintenant, d’où vient cette population ? De quelle manière s’est-elle recrutée ? Quels sont ses besoins, et comment les satisfaire ? À chacune de ces questions nous allons faire une réponse nette et précise.
Rappelons d’abord pour mémoire la circonscription du 20e arrondissement de Paris. Il est limité au midi par les anciens boulevards extérieurs, au nord par la voie militaire, à l’ouest par la grande rue de Belleville, à l’est par l’avenue de Vincennes.
On sait que nos arrondissements excentriques ont été formés, depuis 1860, par l’annexion à Paris d’une grande partie des anciennes communes constituant ce qu’on appelait la banlieue de cette ville.
Il importe de faire ici un rapprochement qui n’est pas sans intérêt. Quelle était, il y a un siècle, la situation de cette zone qui a plus que doublé l’étendue de Paris ?
Pour répondre à cette question, nous traçons sur un plan de 1769 les boulevards extérieurs qui n’ont été formés qu’en vertu d’une ordonnance du bureau des finances à la date du 16 janvier 1789. Puis, sur ce même plan de 1769 nous indiquons la ligne circulaire que décrit de nos jours le talus gazonné des fortifications. Eh bien ! dans cet emplacement si considérable, qui renferme plus de 44 millions de mètres superficiels, on comptait, en 1769,52 habitations princières avec des parcs magnifiques, des bois d’une vaste étendue, puis des champs, des prairies immenses toujours cultivés avec soin, parce que leurs produits, fleurs, fruits et légumes, se vendaient à beaux deniers dans la grande ville.
Châteaux, parcs, bois, prairies, presque tout a été démoli, abattu, morcelé, détruit.
Maintenant, limitons nos études au 20e arrondissement, et voyons quelle était sa situation il y a un siècle environ.
À peu près au contre de ce territoire, vers l’ouest, se dressait l’ancien château de Ménilmontant, qu’on appelait, vers le milieu du siècle dernier, le retrait Pompadour. Ce château est maintenant occupé par un orphelinat desservi par des religieuses, bonnes et douces sœurs de charité qui suivent une règle différente de celle que pratiquait la belle damnée, comme l’appelait Marmontel alors qu’il papillonnait autour de Cotillon II. Mais, puisque le mot charité s’est heureusement trouvé sous notre plume, disons que la marquise de Pompadour, courtisane à Versailles, avait parfois du cœur à Ménilmontant.
Dans un acte établissant la propriété d’un champ depuis 1768, nous lisons ces mots :
… Lopin de terre d’un quart d’arpent environ avec maisonnette, au lieu dit les Montibœufs, donnés par Mme de Pompadour à Jeanne-Mathurine Bécheux, gardeuse de moutons, pour lui faire une dot et qu’elle épouse son amoureux, Pierre-Eustache Corterousse, nourrisseur à Charonne.
Le château de Ménilmontant, ce retrait Pompadour avec ses dépendances, absorbait le quart environ du 20e arrondissement actuel. Après la mort de la marquise, ses héritiers démembrèrent cet ancien domaine, dont une partie fut achetée par Mme Favart ; que courtisait un peu militairement le maréchal de Saxe, sans préjudice de l’abbé Voisenon. Plus tard, le Père Enfantin fonda tout à côté la maison des Saint-Simoniens.
Le parc de Ménilmontant était limité au sud-est par un autre domaine appelé le Mont-Louis, et qui appartenait aux R.P. Jésuites ; c’est aujourd’hui le cimetière du Père-Lachaise. Le chemin dit des Partants séparait le Mont-Louis du parc de Ménilmontant. À peu près au milieu de ce chemin, on voyait encore, il y a une vingtaine d’années, un petit bâtiment en forme de rotonde, et qu’on appelait le Pavillon du Roi.
Ce fut dans ce pavillon, d’où l’on dominait tout Paris, que se retirèrent, le 2 juillet 1652, le jeune roi Louis XIV et le cardinal Mazarin pour assister à la bataille Saint-Antoine. Vers la fin de l’action, un aide de camp apporta une dépêche du vicomte de Turenne ; le roi fit signe au cardinal d’en prendre lecture. Elle contenait, dit-on, ces mots :
Je tenais M. le prince entre les murailles de la Bastille et une ligne de fer, quand Mademoiselle, faisant ouvrir les portes, a fait pointer les canons de la forteresse sur les troupes royales. Il faut que je me retire lorsque j’allais vaincre.
Au moment où Mazarin achevait sa lecture, un dernier coup de canon se fit entendre ; alors Son Éminence, se tournant vers un groupe d’officiers :
Mademoiselle, dit le cardinal, avait la prétention d’épouser le roi de France, voilà un boulet de canon qui vient de lui enlever son mari.
Dans ce même champ des Partants, maintenant limité à l’ouest par la rue du Retrait, aujourd’hui dénommée improprement rue du Ratrait, Fieschi, Pépin et Morey essayèrent leur machine infernale, dont l’effet fut si cruellement meurtrier dans la journée du 28 juillet 1835.
L’emplacement occupé de nos jours par le 20e arrondissement était complété, il y a un siècle, par la Ferme du Chanu, les vignobles des Panoyaux, des Montibœufs, le clos des Cendriers et les dépendances du parc Saint-Fargeau, dont le propriétaire était appelé, en raison de la vaste étendue de son domaine, Marquis de Carabas.
Ces terrains, en grande partie, devinrent propriétés nationales, et furent achetés successivement par les fermiers ou domestiques des grands seigneurs qui les avaient possédés avant la révolution. Communément les acquéreurs les payèrent en assignats, dont la valeur représentative en numéraire ne dépassa pas huit sous le mètre. Ces paysans ne tardèrent par à s’enrichir, et plusieurs y gagnèrent des fortunes de 3 à 400 000 fr.
Les champs et les prairies de Charonne et de Ménilmontant furent morcelés à l’infini, lorsque les Parisiens firent irruption dans la banlieue. Cet envahissement des ouvriers de Paris augmenta sensiblement par le fait des démolitions dans le centre de la ville.
Bien que le vase ne fût pas plein, il débordait avant l’extension des limites de la capitale.
Enfin, ce territoire du 20e arrondissement, qui renfermait à peine 2 500 habitants en 1769, en compte aujourd’hui près de 50 000. – Nous allons faire connaître leurs réclamations.
Il est une question des plus graves, parce qu’elle intéresse au plus haut degré nos arrondissements excentriques : c’est le déplacement des classes laborieuses qui, du centre de la ville, ont été successivement refoulées aux extrémités par suite des immenses travaux exécutés dans l’intérieur de l’ancien Paris.
Ce qu’il importe surtout de faire connaître exactement à l’autorité supérieure, c’est la situation fâcheuse que nos ouvriers ont subie, alors que l’ancienne banlieue, dans laquelle ils s’étaient réfugiés en grand nombre, s’est trouvée frappée instantanément du payement des taxes d’octroi de Paris.
On va voir tout ce qui manque à nos arrondissements excentriques, sous le rapport du nécessaire.
Les études que nous avons faites ne s’appliquent pas seulement au 20e, elles embrassent toute la zone annexée ; le tableau de ses misères est à peu près le même dans tous nos arrondissements excentriques, le 16e excepté.
Dès sa nomination à la préfecture de la Seine, le 23 juin 1853, M. Haussmann se préoccupe de la question du plan d’ensemble de Paris dont le magistrat poursuit activement la réalisation, mais jusqu’à l’ancien mur d’octroi seulement. Le préfet ne songe pas alors le moins du monde à la zone immense que Paris doit absorber bientôt. Il continue le prolongement de la rue de Rivoli ; il commence en 1854 le boulevard depuis décoré du nom de Sébastopol, puis d’autres trouées ici, là, partout dans l’ancien Paris.
57 rues ou passages sont supprimés, 2 227 maisons jetées par terre et plus de 25 000 habitants, presque tous ouvriers, contraints d’abandonner à l’instant le centre de la ville, sont repoussés vers les extrémités. Ce déplacement, qui suivit la progression des travaux dans le centre de Paris, fut une émigration forcée, comme on va le voir. En effet, les terrains bordant les nouvelles voies avaient été chèrement payés par l’expropriation, et les maisons importantes construites sur leur emplacement ne pouvaient renfermer de locations dont le prix fût accessible à nos classes laborieuses.
Loin de nous la pensée d’amoindrir l’action bienfaisante des nouvelles voies, de ces grands ventilateurs si précieux pour la salubrité d’une ville comme Paris. Ce qu’il importe de constater ici, c’est l’absence complète d’un système administratif dont l’application intelligente et humaine devait avoir pour résultat de suivre ces migrations successives de la population ouvrière, à laquelle il fallait procurer, dans les quartiers excentriques l’équivalent des avantages dont elle jouissait au milieu de Paris, qu’on la forçait d’abandonner.
On devait, en même temps qu’on faisait le vide dans l’intérieur de la ville pour l’assainir, on devait favoriser à tout prix les constructions modestes dans les quartiers éloignés, à cette fin que le trop plein se déversât jusqu’aux extrémités.
Aucun percement utile et pouvant servir d’heureuse dérivation au flot populaire qui montait rapidement ne fut réalisé dans ces premières années. On démolissait, on jetait par terre des maisons par centaines dans le centre de Paris, sans se préoccuper de l’installation des émigrants aux confins de la ville.
Les travaux continuant et même augmentant, les émigrants se portèrent en foule dans les quartiers avoisinant l’ancien mur d’octroi, principalement vers les faubourgs du Temple, Saint-Antoine et Saint-Marceau.
Comme la pioche des démolisseurs avait aussi son contrecoup dans nos provinces, qui entendaient dire, répéter, ressasser qu’on dépensait dans la capitale des millions par centaines, les cultivateurs et les ouvriers quittèrent en foule leurs champs et leurs villes secondaires pour fondre sur Paris.
De là ce renchérissement des petites locations par l’augmentation foudroyante de la population ouvrière. Il arriva bientôt que ces locations devinrent insuffisantes dans l’ancien Paris ; alors nos classes laborieuses, enjambant le mur d’octroi, se portèrent en grand nombre dans l’ancienne banlieue, principalement à Belleville, à Ménilmontant, à Charonne, aux Ternes, à Montrouge, Vaugirard et Grenelle.
Qu’a fait l’administration municipale ? Elle a frappé tout à coup des taxes d’octroi de Paris des communes qui n’étaient pas le moins du monde parisiennes et n’avaient participé en rien aux améliorations de la ville.





























