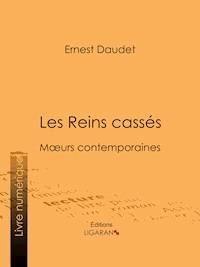
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Minuit ; cinq mille personnes dans les salons du palais de l'Élysée ; la fête battait son plein. Une vapeur lourde voilait la flamme des bougies, tremblant effarée dans le cristal des bobèches, sous le coup de vent qui montait du tourbillon des danseurs. Sur les vitres des fenêtres closes et le long des boiseries, elle traçait des sillons humides à travers les ors et les blancs de la décoration."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À
Me EDGARD DEMANGE
AVOCAT
Souvenir reconnaissant
E.D.
Minuit ; cinq mille personnes dans les salons du palais de l’Élysée ; la fête battait son plein. Une vapeur lourde voilait la flamme des bougies, tremblant effarée dans le cristal des bobèches, sous le coup de vent qui montait du tourbillon des danseurs. Sur les vitres des fenêtres closes et le long des boiseries, elle traçait des sillons humides à travers les ors et les blancs de la décoration.
De tous côtés, les yeux ne percevaient que couleurs éblouissantes, les peintures des plafonds, les nuances variées des tentures, le chatoiement des toilettes, les broderies des corsages sous les dentelles, et, sur ce kaléidoscope mouvant, l’éclat des poitrines nues et le profil des visages sous les ondes des cheveux où s’entremêlaient les bijoux et les fleurs.
Le bruit des pieds sur le parquet se mêlait à la rumeur confuse des voix, que dominait, par intervalles, le son des orchestres placés dans les salles de danse. Les flots de la foule remplissaient la grande galerie, y formaient un double courant entre les chaises rejetées à droite et à gauche, âprement défendues par les occupants, prises d’assaut aussitôt que quelqu’une se trouvait libre. On n’avançait qu’avec lenteur. C’était une confusion d’épaules blanches et d’habits noirs, tour à tour rapprochés et séparés, au fur et à mesure que la file, grossie de nouveaux arrivants, s’allongeait à ses extrémités.
Suffoquée par la chaleur, lasse d’être restée longtemps debout, madame Rocroix s’appuyait languissamment au bras de Fargues.
– Lucien, une chaise, soupira-t-elle ; je suis hors d’état d’aller plus loin.
– Il faut d’abord sortir d’ici. Encore un effort, Régine, le temps d’arriver au salon diplomatique, où vous trouverez un refuge.
– M’y laissera-t-on entrer, seulement ? Une préfète n’est quelqu’un que dans son département. Ici, ce n’est rien.
– Ici, ma chère, vous êtes aussi bien qu’ailleurs une très jolie femme. Et puis, à mon bras, vous passerez partout.
Un sourire traversa le clair regard de Régine. Sa petite tête, noyée dans la masse des cheveux d’or, se redressa d’un mouvement de confiance et d’orgueil. Ils continuaient à avancer à pas lents, au gré de la foule, qui tantôt les poussait en avant, tantôt les ramenait en arrière. Pendant quelques instants encore, elle se joua d’eux, comme la mer d’une épave, avant de les déposer sur le rivage, c’est-à-dire à l’entrée du salon diplomatique, autour de laquelle se groupaient les curieux et que défendait un huissier. L’air impassible, il ne la laissait franchir qu’à quelques personnages connus de lui ou qui se nommaient en passant et devant lesquels il s’inclinait.
Le jeune député de l’Ariége, que de récents succès de tribune désignaient déjà comme un futur ministre, obtint de cet important fonctionnaire la faveur d’un obséquieux salut. Pressant le bras de Régine sous le sien, il allait pénétrer dans le salon réservé, lorsque entre l’huissier et lui se dressa, lui barrant la route, un homme de haute taille, maigreur d’ascète, barbe grise, cheveux taillés en brosse sur un front qui n’en finissait pas, regard fiévreux et assombri, un pauvre hère mal à l’aise dans un habit de coupe ancienne, fripé par un long séjour au fond d’une malle, un de ces habits qui révèlent la détresse des jours sans pain et le suprême effort tenté pour s’y soustraire.
– Vous ici, Baret ! dit à demi-voix Lucien.
– Madame la préfète, monsieur le député, votre humble serviteur.
– Vous avez donc laissé votre journal ?
– Oh ! pour quelques jours seulement, le temps de me retremper dans Paris, dans ce foyer de l’universelle lumière. J’ai même voulu profiter de la circonstance pour assister à une fête républicaine.
– Êtes-vous satisfait de celle-ci ?
– Trop de splendeurs ! Elles n’ont rien de démocratique. Je m’y sens dépaysé. Après tout, n’est-ce peut-être que le défaut d’habitude. C’est la première fois que j’entre dans un palais sans être en armes.
– Vraiment !…
– Le 24 février et le 4 septembre, on m’a vu aux Tuileries. Mais je n’y étais que pour en chasser les tyrans.
L’huissier, qui écoutait dédaigneusement l’entretien, se sentit tout troublé. Il avait reçu la phrase en pleine poitrine, en même temps que tombait sur lui un regard de violent défi.
– Aujourd’hui, heureusement, il n’y a plus de tyrans, dit Régine souriante, en essayant d’entraîner Lucien.
– Il y a encore des privilèges, objecta Baret avec amertume. Ce salon dont on m’interdit l’accès, tandis que d’autres s’y prélassent… est-ce là de l’égalité ?
– Je crains que non, répliqua Fargues railleur ; mais ne trouvez pas mauvais que je rende grâces au privilège, puisqu’il me permet de faire asseoir madame la préfète, qui ne tient plus debout. Au revoir, monsieur le rédacteur.
Il entrait avec Régine dans le salon diplomatique. Baret restait à la porte, humilié, déconfit sous l’œil narquois de l’huissier qui maintenant triomphait.
– C’est donc pour cela que nous avons fait des barricades ! grommela le journaliste. Toi, tout député que tu es, je te dirai tes vérités un de ces matins, dans le Radical de Foix. Peut-être comprendras-tu que la presse a droit à des égards.
– Circulez, messieurs, circulez ! cria l’huissier.
Dans le salon réservé se trouvait l’élite des invités du président de la république, les ambassadeurs, les ministres, des généraux, tous papillonnant autour des femmes ou devisant entre eux gravement. À l’exception d’un petit nombre, composé des politiques nouvellement éclos, ils portaient pour la plupart un grand cordon sous leur habit ou des rubans autour du cou. Des croix en brochette, des plaques scintillaient sur les uniformes. La foule qui passait de l’autre côté de la porte ouverte se désignait ces privilégiés vers qui elle jetait des regards d’envie.
À l’entrée de Fargues et de madame Rocroix, un mouvement s’était produit parmi les hauts personnages à qui la courtoisie du chef de l’État et un usage ancien offraient un refuge contre la cohue d’un bal officiel. Fargues devenait célèbre. Sa personne attirait l’attention. Quant à Régine, femme d’un humble préfet de troisième classe, toute fraîche débarquée de son département, quoiqu’elle en fût à ses débuts dans le monde de Paris, elle recueillait, à première vue, les hommages que sont assurées de recevoir partout la jeunesse et la beauté.
Elle s’était assise sur un divan circulaire, à l’ombre d’un palmier dont les feuilles vertes, descendant très bas, caressaient l’or de ses cheveux. Une splendeur, cette chevelure flamboyante. D’un côté, elle couvrait le front de ses boucles rudes et frisottantes ; de l’autre, elle s’allongeait sur le cou, inondant la blancheur ivoirine de la nuque grasse, pointillée de poils follets qui criblaient la peau d’étincelles. Des yeux larges et clairs se dégageait une séduction irritante, d’un charme étrange, si pénétrant que la pureté des traits semblait voilée par l’expression de ce regard où se révélaient les ardeurs d’une âme passionnée. Le corsage de la robe blanche emprisonnait étroitement le buste, dont la perfection éclatait dans la nudité des épaules et des bras. Ni bijoux ni fleurs n’altéraient l’élégante simplicité de cette toilette, qui témoignait du goût le plus sûr et s’embellissait de l’adorable perfection de ce qu’elle était destinée à couvrir et laissait deviner, comme de ce qu’elle laissait voir.
Fargues s’était éloigné pour serrer les mains tendues vers lui. Il se perdit un moment parmi les groupes, puis il reparut accompagné d’un homme entre deux âges, avec lequel il venait d’échanger quelques mots, et qu’il conduisait à madame Rocroix.
– Madame, dit-il, voici M. le ministre de l’intérieur, qui a désiré vous être présenté.
Régine se leva sans empressement, en femme déjà sûre du pouvoir qu’elle va exercer. Elle fit au ministre incliné devant elle une belle révérence et demeura debout, les yeux fixés sur son éventail, dont ses doigts déroulaient les feuilles. Fargues s’écartait discret. Le ministre maintenant invitait madame Rocroix à s’asseoir et sollicitait la faveur de prendre place à côté d’elle, ce qu’elle accordait en murmurant :
– C’est beaucoup d’honneur pour moi.
Ils étaient l’un près de l’autre, elle le regard abaissé, lui jouant avec son lorgnon, se donnant des airs de familiarité, coulant l’œil dans le corsage au ras duquel se dessinait, sous la ruche, la naissance de la gorge.
– J’ai voulu, dit-il, vous exprimer moi-même, madame, le chagrin que me cause la détermination qu’a prise votre mari et qu’il m’a annoncée hier. Il veut nous quitter, il a tort, et je me plais à croire que vous empêcherez ce coup de tête.
– « Coup de tête » est injuste, monsieur le ministre.
– L’administration tient aux bons fonctionnaires, madame. M. Rocroix est un de nos meilleurs préfets.
– Est-ce pour cela que, depuis trois ans, on le laisse à Foix où je meurs d’ennui ?
– Vous n’y resterez pas toujours, et, à la recommandation de notre ami Lucien Fargues, j’ai déjà songé à donner de l’avancement à M. Rocroix.
– Quel avancement ? Vous croirez avoir beaucoup fait en nous envoyant dans une préfecture de seconde classe où vos successeurs nous oublieront !
– Vous êtes ambitieuse, madame.
Régine releva la tête, plongea ses yeux dans ceux de son interlocuteur :
– Voyons, monsieur le ministre, vous semble-t-il que je sois faite pour rester en province ?
– Non, madame, je reconnais que, pour une personne telle que vous, il n’y a que Paris. Mais il n’est pas impossible de vous y appeler.
– Comment, je vous prie ?
– En ouvrant le conseil d’État à votre mari.
– Est-ce un engagement que vous prenez ?
– À condition que vous m’accorderez un an pour le tenir.
– Un an ! Eh ! monsieur le ministre, serez-vous encore au pouvoir dans un an ?
– C’est invraisemblable, avoua-t-il en souriant.
– Vous voyez donc ! Votre bonne volonté ne peut rien pour nous. Nous avons considéré toutes choses, mon mari et moi, et c’est après avoir mûrement réfléchi que nous nous sommes décidés à quitter l’administration.
– Vous me rendrez au moins cette justice que j’ai tenté de vous y retenir.
– Je vous en sais gré, monsieur le ministre. Justement, voilà M. Rocroix. On lui défend la porte.
– Allons désarmer le cerbère qui la garde.
Le ministre s’était levé. Il offrit son bras à Régine. Ils se dirigèrent vers l’entrée, d’où André Rocroix faisait des signes à sa femme.
– Laissez passer monsieur, ordonna le ministre à l’huissier.
André se glissa dans le salon, saluant, souriant, se confondant en excuses. C’était un petit homme d’environ trente-cinq ans, gros, rougeaud, épaules trapues, grands pieds, mains épaisses, serrées dans des gants trop étroits.
– Remerciez M. le ministre, André, lui dit sa femme ; il vient d’insister obligeamment pour vous retenir au service de l’État.
– Hier déjà M. le ministre a insisté, lorsqu’il m’a fait l’honneur de me recevoir, et j’ai dû lui exposer les motifs qui rendent ma résolution irrévocable.
– Irrévocable, répéta Régine.
– Oui, je sais que vous voulez vous consacrer aux affaires, dit le ministre.
– Je viens d’accepter de faire partie du conseil d’administration de la Compagnie des Gisements aurifères de la Nouvelle-Zélande, avec le titre d’administrateur délégué. Une affaire splendide.
– Il est certain que vous gagnerez là plus d’argent que dans les fonctions publiques. Je n’ose donc vous blâmer, monsieur, et, si je regrette un préfet de votre valeur, je me réjouis en pensant que votre décision va fixer madame parmi nous. Veut-elle me permettre de la présenter au président de la république ?
– J’allais vous le demander, monsieur le ministre.
Ils remontèrent vers le haut du salon, et la présentation eut lieu. Le président adressa quelques compliments au mari et à la femme. Quand ce fut fini, le ministre ramena celle-ci dans le groupe principal, où elle se trouva bientôt entourée de plusieurs personnages qui avaient sollicité l’honneur de lui être nommés.
Son succès était éclatant. Quoiqu’elle n’eût vécu jamais à Paris, elle se sentait aussi à l’aise parmi cette élite des puissants du jour que dans les salons de sa modeste préfecture, où, depuis qu’elle y vivait, elle avait eu le loisir d’apprendre le métier de reine. Elle se savait belle. Sa beauté lui donnait une assurance qui imposait autant aux vieux diplomates accoutumés à faire la roue devant les femmes les plus illustres de la société européenne, qu’aux membres du gouvernement, pour la plupart frais émoulus de leur petite ville, et à qui le suffrage universel avait ouvert récemment la vie publique.
Fargues assistait de loin au triomphe de son amie. Quoique leur liaison, née dans l’oisiveté de la vie de province, datât déjà de trois années, et qu’il n’en portât plus le joug qu’avec impatience, il lui semblait que, ce soir-là, l’adorable créature dont il possédait le cœur, métamorphosée et embellie par les hommages que provoquait sa beauté, était une maîtresse nouvelle qui allait lui rendre les illusions et les ardeurs de l’amour qui commence. Il la comparait aux autres femmes, la trouvait plus séduisante qu’aucune d’elles. Cette épreuve redoutable, qui attend à Paris toute provinciale à ses débuts dans le monde, Régine la subissait en se jouant. Elle en sortait victorieuse. Cette victoire la rendait plus belle aux yeux de son amant, mécontent et étonné de se sentir repris.
Il fut brusquement tiré de sa rêverie. Une main se posait sur son épaule. Il se retourna. André Rocroix lui souriait et lui dit à demi-voix :
– Je veux vous apprendre la bonne nouvelle, mon cher. J’ai fini avec Thélinge. Dans huit jours, l’assemblée générale des actionnaires ratifiera ma nomination. J’ai un traitement de trente mille francs…
– M. Thélinge fait bien les choses.
– Ce n’est pas tout. Il me donne mes cent actions statutaires. Avec leur revenu, mon traitement, mon droit au vingt pour cent que le conseil prélève sur les bénéfices sociaux, c’est, au bas mot, soixante mille francs par an, ce qui ne m’empêchera pas d’entrer dans d’autres affaires.
– Celle-ci est-elle sûre, au moins ?
– En pouvez-vous douter ? Des mines d’or, d’une richesse…
– Il y a tant de mines sans minerai !
– Thélinge couvre de son patronage l’entreprise nouvelle. C’est une garantie, cela.
– Oui, s’il est aussi riche qu’on dit.
– Il est riche à millions… Des maisons dans Paris, une terre seigneuriale près de Compiègne, des capitaux dans toutes les grandes spéculations…
– Et surtout, s’il est honnête homme, continua le député. Bien des rumeurs fâcheuses ont circulé déjà.
– Et sur quel financier n’en circule-t-il pas ! Celui dont nous parlons est monté trop haut pour n’avoir pas d’envieux. Pour moi, je n’ai qu’à me louer de son désintéressement, de sa générosité, de sa droiture. Je n’oublierai jamais qu’il vient de me mettre le pied à l’étrier.
– Il ne me reste donc qu’à vous féliciter, ce que je fais de grand cœur.
– Oh ! il ne tiendrait qu’à vous de mériter les mêmes compliments. Il y a place pour vous dans notre conseil, où nous serions très heureux de compter un député, et, si l’idée vous vient d’imiter mon exemple…
– Moi, je suis rivé à la politique, dit Lucien avec conviction.
– Oui, la turlutaine du portefeuille. Vous voulez être ministre, c’est entendu. Je n’insiste pas.
– Madame Rocroix sait-elle ce que vous venez de m’apprendre ?
– Je n’ai pu lui en dire qu’un mot tout à l’heure devant le ministre.
– Hâtez-vous donc de lui faire connaître ces grands résultats.
André ne bougeait pas. Son regard allait, non sans trahir un peu d’embarras, de Fargues qui l’observait, à sa femme, qu’il apercevait, à l’autre extrémité du salon, superbe et hautaine, dans un groupe d’hommes empressés autour d’elle.
– C’est que je voulais vous charger de les lui raconter vous-même, dit-il, hésitant, et aussi de la ramener quand elle quittera le bal.
– Vous ne l’attendez pas ?
Rocroix se pencha résolument vers son ami :
– J’ai promis à Marguerite d’aller la prendre dans sa loge après le spectacle. Je n’ai que le temps de la rejoindre. Rendez-moi le service d’expliquer mon départ à Régine. Je compte sur vous.
Comme s’il redoutait d’être retenu, il s’éloigna sans attendre une réponse. Il avait déjà disparu que Lucien n’était pas encore remis du trouble soudainement déchaîné en lui par ce trait de la confiance du mari qu’il trompait, et par la certitude d’être, durant cette nuit, le libre compagnon de Régine.
Au même moment, elle se trouva devant lui, toute radieuse, quasi grisée par le foudroyant succès qu’elle venait d’obtenir.
– Où est André ? demanda-t-elle.
– Il vient de partir, en me priant de rester à vos ordres et de vous accompagner quand vous voudrez rentrer.
– C’est lui qui… ! Elle prit le bras de l’amant qu’elle obligea à mesurer son pas sur le sien, et, toujours souriante, quel que fût son émoi, elle reprit : – Où est-il allé ?
– Il m’a parlé d’un rendez-vous avec M. Thélinge… une affaire à conclure.
– Allons donc, Lucien, ne mentez pas. Je sais ce qu’elles sont, les affaires que les maris traitent après minuit… Celle dont vous a parlé André s’appelle Marguerite Chardin. Oui, c’est cette femme qu’il est allé retrouver, comme autrefois, lorsque, prétextant l’obligation de conférer avec le ministre, il me laissait à Foix pour venir la rejoindre. Je la connais, cette liaison, je la connais depuis longtemps. Au reste, je ne m’en plains pas. Je suis même presque tentée de m’en réjouir. Les infidélités de mon mari ne justifient-elles pas mon amour pour vous ?
– Plus bas, Régine ! supplia Lucien.
– Dis alors que tu m’aimeras toujours, continua-t-elle, en se pressant contre lui d’un mouvement de chatte amoureuse.
Il se taisait, essayant de lutter encore contre la séduction qui, brusquement, le reprenait quand il croyait s’y être à jamais dérobé, et, de nouveau, le livrait à Régine, désarmé, vaincu. Mais elle le regardait sans avoir même l’air de comprendre qu’il avait tenté de lui échapper, et ses yeux répétaient comme ses lèvres :
– Dis-le, dis-le, que tu m’aimeras toujours !
Le rédacteur en chef du Radical de Foix n’avait pas quitté le seuil du salon diplomatique. Sous le regard défiant et hautain de l’huissier, il s’était assis à droite de la porte, pour mieux voir. Le journalisme est un sacerdoce aux impérieuses exigences ; c’est le devoir d’un homme qui tient une plume de surveiller de près, avec une vigilance jacobine, les divertissements de la bourgeoisie républicaine, élus du peuple et puissants du jour.
Ces divertissements indignes des âmes austères qu’ont trempées et durcies les épreuves de la démocratie irritaient Baret jusqu’à l’exaspération, mettaient sur ses lèvres des cris vengeurs. Ah ! quelle satire éloquente et foudroyante il comptait envoyer le lendemain à son journal ! Ministres, diplomates, généraux, personnages à rubans et à crachats, toute cette clique dorée qui se pavanait dans le salon réservé, l’huissier lui-même, vil esclave qui s’enorgueillissait de sa chaîne, insigne de son servage, n’avaient qu’à se bien tenir. Il allait les signaler au mépris et aux vengeances du peuple souverain.
Il dénoncerait ces pompes aristocratiques, renouvelées des temps de décadence. Il demanderait si c’est afin de payer les frais de ces saturnales honteuses, auxquelles, d’ailleurs, on néglige de l’appeler, que le peuple plie sous le poids des impôts ; si les fonctionnaires n’émargent au budget qu’à seule fin de faire la fête loin de leur poste ; si les députés ont le droit de consacrer au plaisir les veilles qu’ils doivent aux intérêts de leurs électeurs.
Tandis qu’il arrêtait par la pensée les grandes lignes de son article, autour de lui la fête continuait. Deux heures avaient sonné. Les invités venus uniquement pour faire acte de présence à la réception présidentielle commençaient à se retirer. On circulait plus librement dans la grande galerie. Dans deux salons, on dansait.
Sous les massifs de plantes vertes, qu’étoilaient des fleurs épanouies, les orchestres jouaient des valses dont les accords se brisaient contre les croisées du jardin où la buée tiède traçait des sillons à la surface polie des vitres. Au dehors, dans la cour d’honneur pleine de tumulte, cris, rires, piétinement des chevaux sur le sable, roulement des voitures, les huissiers appelaient les gens. Sous les tentes du perron, fouettées par la bise froide, ces appels se succédaient. Noyé dans la lumière, le vieux palais resplendissait agité, vivant, vibrant, vomissant par ses ouvertures flamboyantes la rumeur qui de la base au faîte le secouait.
À l’entrée du salon diplomatique, la foule s’amassait plus nombreuse. L’huissier venait d’en ouvrir la porte à deux battants. Baret se leva. Mêlé aux groupes, il vit sortir, précédé d’autres huissiers, qui écartaient les curieux et se frayaient au milieu d’eux un passage, un cortège composé du président de la République et de ses principaux invités, qu’il conduisait, pour le souper, vers les salles du buffet, non encore accessibles aux profanes. Baret se cuirassa dans son mépris ; un sourire amer plissa ses lèvres ; il ajoutait mentalement à son article une phrase railleuse et cruelle.
Mais, tout à coup, dans ce cortège où il ne connaissait personne, il aperçut madame Rocroix. Pour une minute, son ressentiment se fondit sous l’éclat de la grâce exquise et de la royale beauté de la jeune femme. Un vieillard vêtu d’un uniforme étranger, brodé d’or et chamarré de décorations, lui donnait le bras. Elle marchait lentement à son côté, imposante, la tête haute, traînant derrière soi, sur le tapis, un flot de dentelles.
– Voyez donc la belle personne avec l’ambassadeur d’Autriche, observa quelqu’un près de Baret. Qui est-elle ?
– Je l’ai remarquée déjà ce soir, mais j’ignore son nom.
Baret intervint d’un air pénétré.
– Madame Rocroix, « l’épouse » du préfet de l’Ariége.
Il était très fier d’avoir pu la nommer. Il fit même un pas vers elle, pour se faire remarquer, espérant que, devant tout ce monde, elle allait le favoriser d’un salut ou d’un sourire. Cette marque d’attention, en flattant sa vanité, eût versé un baume dans son cœur, aigri ce soir-là plus que jamais par le sentiment surexcité de son obscurité et de son isolement. Mais madame Rocroix ne regardait pas de son côté. Elle passa sans le voir. Ce fut une blessure nouvelle sous le coup de laquelle il improvisa d’un trait la fin du terrible article.
Quand ce fut fini, la foule s’était dispersée, l’huissier avait disparu, l’accès du salon diplomatique demeurait libre. Il y entra, fatigué de sa longue veille, du silence douloureux gardé pendant toute cette soirée, durant laquelle il n’avait trouvé personne à qui dire un mot. Ses jambes ne le portaient plus ; dans son estomac vide, la faim criait. Il allait s’asseoir, lorsqu’il aperçut Lucien Fargues, debout près d’une fenêtre entrouverte, écoutant avec indifférence un personnage qui lui parlait, très animé.
– Il faudra bien qu’il m’adresse la parole, pensa-t-il.
Il se campa résolument devant la porte, décidé à attendre le député pour le saisir au passage, rendu fiévreux et perplexe par la crainte que l’autre cherchât à l’éviter. Mais son anxiété se dissipa vite. Fargues se dirigeait de son côté, l’air affable, et, arrivé près de lui, prit familièrement son bras en disant :
– Êtes-vous revenu de vos préventions, mon cher Baret ?
– Mes préventions contre qui, monsieur le député ?
– Contre le gouvernement, à ce qu’il m’a semblé tout à l’heure.
– Tout à l’heure, je pensais ce que je pense encore : c’est qu’en république il ne devrait y avoir ni faveurs ni privilèges.
– Allons donc ! je vais vous prouver que les privilèges ont du bon. Il est tard ; vous devez être affamé comme moi. Si je n’avais pas eu le plaisir de vous rencontrer, ou si je vous abandonnais là, vous n’arriveriez au buffet que maltraité, bousculé, porté par la foule ; vous seriez obligé de conquérir à coups de poing votre souper. Mais, sous ma protection, vous allez boire et manger à votre gré, très à l’aise, en brillante compagnie. Vous voyez bien que si les privilèges n’existaient pas, il faudrait les inventer. Venez, venez, et ne nous calomniez pas parce que nous cherchons à rendre notre république aimable. Nous boirons à sa prospérité.
Baret était touché à l’endroit sensible. Subitement, la perspective d’un bon repas le déridait, apaisait ses haines, emportait de sa mémoire, par lambeaux, les ardentes élucubrations de tout à l’heure. Vainement il essayait de se composer une attitude hautaine, de manifester par quelque trait son incorruptibilité, les belles phrases se dérobaient, et, quand il fallut répondre, il ne put que balbutier avec mauvaise grâce :
– Je vous suis bien reconnaissant.
– Il n’y a pas de quoi, mon cher, et je voudrais mériter votre reconnaissance par un service plus effectif.
– Oh ! vous le pouvez, monsieur le député, répliqua Baret, à qui l’émotion n’enlevait pas sa présence d’esprit.
– Comment ?
– En m’aidant à trouver un emploi dans un journal de Paris.
– Vous voulez quitter Foix, nous abandonner ?
– Je suis las de vivre en province.
– Vous y êtes rédacteur en chef.
– Oui, un journal qui tire à cinq cents exemplaires et où je fais tous les métiers : directeur, rédacteur, caissier, préposé aux abonnements, correcteur, et même, à certains jours, colleur de bandes. Colonel sans soldats ! Est-ce une position pour moi ? Oh ! monsieur le député, se sentir une valeur, un cerveau où les idées s’allument, bouillonnent, jaillissent, débordent ; voir les autres monter haut, arriver, et soi-même rester en bas, humble, misérable ; n’être rien quand le parti pour lequel on s’est désespérément battu est triomphant… j’en ai assez ! Il me faut un théâtre plus vaste que Foix : il me faut Paris, ce Paris où j’ai vécu jadis, où j’ai toujours rêvé de revenir. Là, seulement, le talent trouve l’occasion de se produire ; là seulement, je pourrai utiliser les services que j’ai rendus à la cause républicaine, services trop vite oubliés et qui méritaient mieux que ce qu’on m’a donné, cette position misérable où je ne peux rien ni pour moi, ni pour la république.
– Eh ! mais, vous êtes éloquent à vos heures, mon cher !
– On me l’a dit, jadis, quand je poussais le peuple aux barricades.
– Ne rappelez donc pas ces souvenirs, si vous voulez devenir quelqu’un. Aujourd’hui que nous sommes le gouvernement, à qui de nous voulez-vous qu’ils soient agréables, puisqu’ils ont trait à une révolte contre les pouvoirs établis ? Et puis, les barricades, c’est le vieux jeu. Nous avons un moyen de défense et d’attaque bien autrement redoutable que les pavés et les fusils.
– Lequel ?
– Le bulletin de vote.
– On corrompt le suffrage universel.
– Eh bien, mettez-vous du côté des corrupteurs, et nous vous pousserons.
Baret n’eut pas le temps de se demander s’il devait protester ou rire. Fargues l’entraînait joyeusement à travers les groupes qui se formaient aux abords du buffet, s’apprêtant à envahir la salle dont les portes encore closes s’entrouvraient de temps en temps pour laisser passer les rares favorisés à qui leur rang social ou la bonne grâce des officiers de la maison présidentielle en donnait l’accès. C’est à l’un de ces officiers, debout devant l’entrée, que Fargues s’adressa, à demi-voix :
– Votre consigne est-elle inviolable, mon commandant ?
– Ni pour vous, ni pour vos amis, mon cher député.
– Alors je vous prie de la lever en faveur de l’un d’eux, monsieur Baret.
Baret se rengorgeait, emboîtant le pas derrière Fargues. Mais ce dernier s’arrêta surpris. À trois pas de lui, il venait d’apercevoir, en se retournant, deux personnes, un homme d’âge mûr et une jeune fille ; l’homme, petit, svelte, physionomie mélancolique et sévère, figure fine encadrée par de courts favoris grisonnants ; la jeune fille appuyée à son bras, jolie, blonde avec des yeux noirs, mince, élégante d’attitude, très simplement vêtue d’une robe bleue en tulle.
– Oh ! monsieur, que je suis heureux de vous rencontrer ! s’écria Fargues. Mademoiselle…
Il saluait très respectueusement.
– Vous devez être étonné de nous trouver ici, mon cher. C’est ma fille qui a désiré venir, et vous voyez ce qu’elle fait de moi ; elle me traîne au buffet.
– Le temps seulement de boire un verre d’eau, mon père.
– J’aurai l’honneur de vous l’offrir, mademoiselle, dit Fargues avec empressement.
L’officier attendait, la main sur le bouton de la porte. Fargues lui présenta les nouveaux venus : M. le juge d’instruction Deloraine, mademoiselle Noémi Deloraine.
– Passez vite, répondit avec courtoisie le commandant.
Fargues et ses amis entrèrent dans la salle du buffet, dont la porte se referma derrière eux. Baret les avait suivis. Mais sa physionomie s’était rembrunie. Son regard, un moment éclairé par un sourire de vanité satisfaite, redevenait haineux et méchant. Il se rapprocha du député et trouva moyen de lui parler sans être entendu par d’autres que par lui.
– Vous connaissez M. Deloraine ?
– J’ai l’honneur de le compter parmi mes amis. C’est un des plus éminents magistrats du tribunal de la Seine.
– Lui ! C’est un suppôt de la réaction. Il a voulu me faire condamner naguère.
– Soyez convaincu qu’il vous croyait coupable…
– Je l’étais, en effet, répliqua fièrement Baret, coupable d’avoir voulu défendre les institutions républicaines contre les entreprises des monarchistes. Nous étions alors dans la crise du Seize-Mai.
– Oui, je me souviens, vous étiez venu à Paris, et vous aviez signé un appel aux armes, délit prévu par des lois que les maîtres du jour avaient le droit de vous appliquer.
– Quoi ! c’est vous, monsieur, qui dites cela !
– Je dis qu’il est regrettable que M. Deloraine se soit trouvé de leur côté. Mais, ceci posé, il faut bien reconnaître qu’il n’a fait que remplir son devoir. Du reste, les poursuites ont été abandonnées.
– Contre son gré et grâce à mes amis…
– Enfin, vous n’avez pas été condamné. Il vous est donc aisé d’oublier.
– Je n’oublie jamais, répliqua Baret d’un ton farouche.
Ces paroles s’échangeaient rapidement, à demi-voix.
M. Deloraine, quoiqu’il ne pût les entendre, devinait qu’il était question de lui. Soucieux de sa fille, qui attendait, au bras de Fargues, la fin de l’entretien, il essayait de la distraire, en lui désignant divers personnages, sans cesser toutefois de suivre de son regard railleur et pénétrant le mouvement des lèvres de Baret. Le journaliste semblait peu disposé à quitter la place. Mais Fargues était à bout de patience.
– Vous voilà dans le sanctuaire, mon cher, dit-il. Je ne vous retiens pas ; vous êtes libre. Venez me voir un de ces matins. Nous nous entretiendrons de ce qui vous intéresse.
Tout à mademoiselle Deloraine, il s’éloigna.
– Il me préfère un magistrat de la réaction, murmurait avec amertume le journaliste, irréparablement blessé. Voilà de quelles âmes viles s’entourent des gens qui se disent républicains, de quels monarchistes ils se font les complices ! Ah ! mes maîtres, je vous démasquerai.
Il était devant le buffet ; il avala rageusement, coup sur coup, deux verres de vin de Champagne pour ouvrir son gosier aux innombrables sandwiches et petits fours qu’il se proposait d’engloutir.
– Il m’a paru que le sieur Baret n’était pas satisfait notre rencontre, disait M. Deloraine à Fargues.
– Vous avez compris !…
– J’ai quelques clients du même genre. Fort heureusement, ils sont peu redoutables… Comment connaissez-vous celui-ci ?
– Il dirige la feuille radicale de Foix, et pour ce motif je le ménage… Et puis il finira par venir habiter Paris ; il est homme à se tailler un rôle dans les réunions publiques… On ne sait ce qui peut arriver… Peut-être un jour l’aurai-je pour collègue à la Chambre…
– On peut tout attendre des mœurs politiques de ce temps, objecta gravement M. Deloraine.
Ils s’étaient mêlés aux gens qui assiégeaient le buffet. Entre les surtouts de fleurs et les pièces d’argenterie, les victuailles appelaient les gourmandises, viandes froides reposant sur un lit de gelée, chaufroids enveloppant dans leur transparence les ortolans bouffis et les cailles dépecées. Les pyramides de fruits s’écroulaient au contact des mains hardies ; la mousse du champagne écumait dans les coupes de cristal, et le bordeaux allumait aux parois des verres sa couleur sombre comme le sang d’une victime sacrifiée.
Le long de la haute table, la foule se pressait, debout, circulante, exigeante, surexcitée, grossie peu à peu de nouveaux arrivants, malgré la sévérité des consignes. Une poussée sépara M. Deloraine de sa fille. Elle se trouva seule avec Lucien. Il ne s’occupait plus que d’elle, empressé à la servir, attentif à la protéger. Elle mangeait et buvait du bout des lèvres, distraite, tout émue des prévenances dont elle était l’objet.
Il y avait entre eux de doux souvenirs. Ils s’étaient connus à Cauterets, deux ans auparavant, rapprochés par les hasards de la vie d’hôtel. Fargues en était encore à ses premiers succès de tribune. Mais, déjà, sa réputation commençait. C’est moins à elle cependant qu’à sa courtoisie, son caractère, sa bonne mine, qu’il devait d’avoir été favorablement accueilli par les Deloraine : le père, un magistrat de haute intelligence, de mœurs austères, tolérant pour les idées nouvelles, bien qu’il ne les partageât pas ; la fille, une âme forte sous une enveloppe délicate, une de ces créatures qu’on ne peut approcher sans subir le charme qui se dégage d’elles, rendue plus séduisante par le contraste que formaient la mélancolie imprimée dans son regard et sa jeunesse rayonnante. Fargues fut conquis le jour même où il les connut.
Quelques semaines vécues en commun, embellies par la douceur et l’imprévu d’un temps consacré aux distractions et au repos, cimentèrent cette amitié, que la vie de Paris, quand ils l’eurent reprise, ne détruisit pas. Ils se voyaient peu. Les Deloraine vivaient retirés. Fargues était tout entier à ses devoirs politiques, à son ambition, à ses passions, à ses triomphes. Il portait le joug d’une liaison qui versait la fièvre dans ses veines. Mais il songeait souvent à la charmante fille rencontrée là-bas comme une apparition. Quand s’offrait à lui l’occasion d’échanger quelques mots avec elle, il pouvait constater qu’elle ne l’oubliait pas ; que, pour elle comme pour lui, le passé conservait un attrait incomparable ; qu’il s’y mêlait même une douceur attendrissante, où dominait, à travers le souvenir de paroles affectueuses et de silences éloquents, le parfum de quelques fleurs furtivement échangées par enfantillage ou plaisanterie, durant les excursions dans la montagne.
Ce soir-là, ces choses revenaient à la mémoire de Lucien comme un flot montant et envahissant. Elles rafraîchissaient son âme, elles y apaisaient les flammes allumées par l’ardent amour de Régine, et jusqu’à cette excitation maladive qui, tout à l’heure, lui avait arraché une promesse de l’aimer toujours, alors que depuis longtemps il ne l’aimait plus et n’était attaché à elle que par l’habitude de la voir ou la crainte de l’affliger. Il comparait l’enfant pure et chaste dont il devinait le cœur, ouvert et prêt à l’accueillir, à la femme passionnée dont la jalousie et les exigences troublaient son repos, lassaient son dévouement ; celle qu’il pourrait associer à sa vie, chérir librement, sans contrainte, et celle dont il ne pouvait goûter la tendresse qu’en se cachant et au prix de compromissions qui, l’enthousiasme et les illusions dissipés, lui semblaient dégradants et indignes de lui.
Noémi avait fini de souper. Il la ramena un peu en arrière, hors de la foule. Ils s’assirent à l’écart : elle simple, sereine, attentive à ce qu’il disait ; lui attentionné, dissimulant mal son désir de plaire. De sa place, il apercevait Régine, entourée de divers personnages, riant avec eux, leur tenant tête, buvant à longs traits la flatteuse admiration qu’ils lui versaient en paroles dorées, plus douces à ses oreilles que ne l’était à ses lèvres le vin dont ils emplissaient son verre. Il n’enviait pas leur bonheur : il souhaitait, au contraire, qu’ils demeurassent auprès d’elle, qu’elle l’oubliât pour quelques instants. Que ne pouvait-elle l’oublier pour toujours !
– Je voudrais retrouver mon père, monsieur, dit Noémi.
– Oh ! un moment encore, mademoiselle, supplia-t-il. Il y a si longtemps que je n’ai eu le plaisir de vous voir !
– N’est-ce pas un peu par votre faute ? Notre maison ne vous est-elle pas ouverte ?
– La crainte de paraître indiscret…
– Voilà une excuse peu digne de vous. Indiscret ! Pourquoi ? Mon père ne vous a-t-il pas prouvé qu’il est toujours heureux de vous recevoir !
– Monsieur votre père, oui ; mais vous !
– Moi ! j’aime tous ceux qu’il aime.
Elle lui répondait sans crainte, à demi-voix, en le regardant dans les yeux, un peu surprise par son langage dont elle ne comprenait ni l’embarras ni les réticences, trop femme déjà pour ne pas soupçonner qu’entre elle et Lucien un lien se formait, mais bien loin de deviner la séduction qu’exerçait sur lui son chaste regard où rayonnait l’intelligence, ses bras fins et blancs aux lignes suaves, sa chevelure soyeuse relevée sur le cou flexible, dont chaque mouvement révélait la grâce harmonieuse d’un tout parfait. Elle n’était ni vaine ni coquette. Elle s’ignorait.
– Vous me faites regretter la rareté de mes visites, mademoiselle, reprit Lucien.
– Ne regrettez rien, monsieur, et venez moins rarement. C’est l’unique moyen de vous faire pardonner et de prouver que vous n’oubliez pas les jours heureux passés ensemble, il y a deux ans.
– Vous ont-ils donc laissé un bon souvenir ?
– Pourquoi voulez-vous me le faire avouer de nouveau ? Ne le savez-vous pas ?
Lucien resta silencieux, tout vibrant d’une émotion soudaine et contenue, qui prenait son cœur et le livrait à mademoiselle Deloraine. Puis, il murmura :
– J’irai chez vous souvent, puisque vous m’y encouragez.
– Nous verrons comment vous tiendrez cette promesse, dit Noémi avec un sourire qui trahissait quelque incrédulité.
Elle se leva pour partir. M. Deloraine revenait de leur côté, l’appelait d’un signe. Elle alla à sa rencontre et lui annonça la visite prochaine de Fargues.
– Il sera le bienvenu, répondit M. Deloraine.
À pas lents, suivis par Lucien, qui s’ingéniait à les protéger contre les heurts, ils regagnaient la porte. La foule, rendue impatiente par une longue attente, prenait d’assaut la salle du buffet, que venait d’abandonner le président de la république, et bruyante comme un forum.
Dans la rumeur tumultueuse des voix, on entendait le choc des assiettes et des verres, des bruits de disputes, des plaintes de femmes, des adjurations adressées aux maîtres d’hôtel, qui ne savaient plus à qui répondre. Le long de la table une lutte s’engageait, on s’arrachait les morceaux, des bouteilles circulaient de main en main, brusquement arrêtées au passage par les plus hardies. C’est au milieu de ce vacarme que Lucien prit congé des Deloraine. Il les vit se perdre dans le flot pressé des invités.
– Me voilà ! dit une voix près de lui.
On lui saisissait le bras ; on l’entraînait vers la sortie. C’était Régine ; elle voulait partir. Dans l’antichambre, ils trouvèrent le valet de pied loué pour la nuit. Il leur donna les manteaux et alla chercher la voiture. Ils attendirent son retour, debout sur le perron du palais, heureux de respirer l’air glacé du dehors. Dans la clarté pâle du matin, le froid redoublait. Les feux s’éteignaient. Les cochers avaient l’onglée, pestaient sur leur siège, en secouant d’une main nerveuse les rênes détendues sur les harnais des chevaux ensommeillés.
La voiture arriva. Au moment d’y monter après Régine, Fargues aperçut encore mademoiselle Deloraine et son père qu’un fiacre emportait. Il aurait voulu que Noémi le vît. Mais il ne put même se pencher pour se faire remarquer. Lasse et dolente, Régine s’était appuyée contre lui, la tête sur son épaule, en murmurant de tendres paroles. Elle paralysait ses mouvements, le tenait prisonnier, et à son insu, lui faisait sentir la chaîne forgée de ses mains.
Maintenant, la voiture, cahotant sur le pavé des rues, les ramenait chez eux, dans cette maison meublée de l’avenue Montaigne où Régine, en arrivant à Paris, avait voulu descendre parce que Lucien y habitait. Ils étaient donc libres de se faire illusion, de croire qu’ils ne seraient plus séparés, puisqu’au bout de cette nuit de plaisir, le même toit allait les abriter. Mais cette pensée pleine de douceur et de charme pour l’amoureuse Régine devenait intolérable à son amant. Ils étaient l’un contre l’autre, la main dans la main. Lucien sentait sur sa joue l’haleine caressante de sa maîtresse, dont l’attitude trahissait l’amour. Mais, près d’elle, il demeurait insensible, tout à la vision du regard virginal qui, ce soir-là, s’était reposé sur lui.
Au Vaudeville.
Une étroite pièce au second étage, éclairée par deux becs de gaz brûlant à toute flamme, au-dessus d’une table de toilette, surchauffant l’air imprégné de l’âcre parfum d’eaux de senteur et de poudres odorantes. Sur l’étoffe peinte qui couvrait les murs, des photographies couronnées de laurier doré, représentant une jeune femme sous divers costumes. En face de la toilette, un large divan ; un peu partout, des fauteuils, des chaises sur lesquels étaient étalés des vêtements de théâtre. Au fond, sous un rideau, d’autres costumes suspendus. Sur le parquet, un tapis. C’était la loge de Marguerite Chardin.
Quoique la représentation fût terminée depuis une demi-heure, elle s’y trouvait encore, mais non pas seule. Sur le divan, un homme était assis. Cheveux crépus, moustache fauve, fièrement relevée au coin des lèvres, physionomie fine et vivante. Il souriait à Marguerite debout devant lui et dont il tenait les mains.
Vêtue de sa robe de ville, enveloppée d’un manteau noir doublé de fourrures, son chapeau sur la tête, prête à partir, elle écoutait avec complaisance les propos de ce galant dont l’élégance et la bonne grâce opéraient sûrement. Elle lui résistait encore du bout des lèvres. Mais son attitude trahissait un lent consentement aux prières qu’il lui adressait, moitié plaisant, moitié sérieux.
– Non, pas ce soir, c’est impossible, je vous assure.
– Impossible ! Pourquoi… ma petite amie, puisque je suis amoureux ?
– Laissez-moi le temps de savoir si je vous aimerai… Plus tard, je ne dis pas !
– C’est une promesse, cela. Autant la tenir maintenant que plus tard.
– Maintenant, je ne suis pas libre. J’attends mon seigneur et maître.
– Mais s’il ne vient pas ?
– Oh ! c’est bien invraisemblable, puisqu’il m’a dit qu’il me prendrait ici après la représentation.
Autour d’eux, l’habilleuse allait et venait, ramassant les jupes éparses, les bas jetés sur le tapis, mettant toutes choses en ordre, indifférente au vulgaire roman qui s’ébauchait en sa présence.
– Allons, je n’ai plus qu’à périr de désespoir.
– Ou à vivre d’espérance.
– Me le conseillez-vous ?
– Devinez si vous pouvez.
– Ma petite Marguerite !
Il l’attirait à lui, la suppliait des yeux et des lèvres ; elle détournait la tête, le corps renversé, les bras tendus comme pour échapper à l’obsession de l’ardent regard qui poursuivait le sien.
– Voici monsieur, dit tout à coup l’habilleuse.
Un léger coup s’était fait entendre à la porte. Marguerite n’eut que le temps de s’arracher à l’étreinte qui la tenait captive. Sans attendre qu’on lui répondît, André Rocroix venait d’ouvrir. Il était sur le seuil, surpris de trouver avec sa maîtresse cet inconnu qui se levait à son entrée brusquement, en prenant son chapeau. Marguerite s’avança vers lui.
– Vous voilà donc ! Je ne vous attendais plus.
– Je n’ai pu quitter l’Élysée plus tôt, répondit-il.
– Mon ami M. Aimery Gérard, continua Marguerite, en présentant ce dernier. Elle ajouta ensuite, en désignant André : – M. Rocroix, préfet de l’Ariége.
Les deux hommes se saluèrent sans dire un mot, se toisant du regard, tandis que l’artiste, pressée de les voir se séparer, quittait la loge. Ils descendirent derrière elle, jusque dans la rue, rogues, cérémonieux, guindés. Au ras du trottoir, la voiture d’André attendait. Avant d’y monter, Marguerite se tourna vers Aimery Gérard :
– À bientôt, dit-elle en lui tendant la main.
Il s’inclina pour lui baiser le bout des doigts, et resta là, tête nue, jusqu’au moment où la portière du coupé se fut refermée sur André, à qui mademoiselle Chardin avait fait une place à côté d’elle, sans cesser de sourire avec grâce à l’amoureux qu’elle abandonnait, en lui laissant pour le consoler la conviction qu’elle ne l’abandonnait qu’à contrecœur.
En moins de dix minutes Marguerite et André furent rendus à l’extrémité du boulevard Malesherbes où habitait l’artiste. Pendant ce court trajet, ils avaient gardé le silence. Ils le gardaient encore en montant l’escalier, elle allant devant, lui derrière, un peu essoufflé par l’ascension des quatre étages. Une femme de chambre qui veillait, en attendant sa maîtresse, avait ouvert la porte. André suivit Marguerite dans le salon, où deux lampes étaient allumées et où régnait une chaleur douce.
– Je suis très lasse et vais me mettre à l’aise, dit-elle.
Resté seul, il ôta son chapeau et sa pelisse, s’assit devant le feu, dans un fauteuil, heureux de se reposer, bercé par le silence de la nuit que troublait à peine le sourd roulement des voitures qui passaient en bas sur le boulevard, imprimant aux vitres de longues vibrations. Marguerite rentra bientôt, vêtue d’une robe de chambre qui dessinait son corps souple. Elle avait défait ses cheveux. Leurs ondes noires et brillantes, descendant sur les épaules et le long du dos jusqu’aux reins, serrées à leur extrémité par un ruban de soie blanche, encadraient sa figure jeune et fière, embrasée par le feu du regard dont la pâleur mate du teint avivait l’expression railleuse.
Elle alla à la cheminée, s’accouda au marbre, en tendant ses pieds à la flamme, et regardant André qui se levait, lui dit :
– Que vous voilà morose, monsieur le préfet ! – Il se taisait. Une grosse moue d’enfant plissait ses lèvres, révélant son mécontentement : – Est-ce un effet du bal de l’Élysée ?
– Le bal de l’Élysée ! J’étais tout joyeux en le quittant pour vous rejoindre. Mais ce que j’ai vu tout à l’heure…
– Qu’avez-vous donc vu ?
– La femme que j’aime, oublieuse de mon long dévouement, me donnant un rival…
Un éclat de rire interrompit ce reproche.
– Jaloux, maintenant ! Jaloux, vous ! C’est complet. Ah çà, mon cher, d’où sortez-vous ? De ce que je suis votre maîtresse, en résulte-t-il que je doive éloigner de moi les gens qui offrent de m’être utiles ? M. Aimery Gérard, que vous avez trouvé dans ma loge, est un peintre déjà célèbre, très connu, très lancé, très à la mode, très influent. Abonné de la Comédie française, abonné de l’Opéra, il a la main dans tous les théâtres et dans tous les journaux, des amis dans tous les partis. Il me veut du bien. Faut-il décourager sa bonne volonté, en lui interdisant même de venir me voir ?
– Il faut se contenter de la mienne.
– Que tu es bête, mon pauvre André ! Voyons, est-ce toi qui me feras entrer au Théâtre-Français ?
– Ne vous ai-je pas tirée de la province où, il y a trois ans, vous étiez encore ?
– Oui, après m’avoir connue à Foix, vous avez eu le mérite de deviner que là je n’étais pas à ma place ; vous êtes parvenu à me procurer un engagement à Paris. Mais quel engagement ! Utilité à Cluny !
– Vous n’y êtes pas restée, et le Vaudeville vous a accueillie…
– Le Vaudeville, parlons-en ! Jusqu’ici je n’y ai eu que des pannes… comme dans la pièce du jour : cinq toilettes, et rien à dire.
– Eh ! soyez patiente. Vous aurez aussi de beaux rôles. En attendant, vous êtes à Paris, et cela, vous me le devez.
– Soit. Mais, en aidant à transformer ma vie, vous ne songiez pas à moi seulement ; vous songiez aussi à vous. Vous m’aimiez…
– Follement, comme je vous aime encore.
– Dans une petite ville, je ne pouvais être la maîtresse du préfet sans le compromettre. Vous avez trouvé plus prudent de m’envoyer à Paris, où vous veniez souvent et où nous pourrions nous voir librement. C’est à vos craintes que j’ai dû de débuter à Cluny.
– Vous pourriez dire : à mon amour, surtout.
– Oh ! je n’entends pas diminuer le prix du service que vous m’avez rendu. Je ne l’oublierai jamais. Mais je peux dire, sans l’oublier, que, si je veux devenir sociétaire du Théâtre-Français, je devrai recourir à des influences plus puissantes que la vôtre.
– À celle de vos nouveaux amants, par exemple.
Marguerite eut un joli mouvement de raillerie sans colère, qui la rapprocha d’André.
– N’est-ce donc rien de savoir que tu m’as quand tu veux, et ne peux-tu me laisser diriger ma vie à mon gré ?
– Jamais je ne me résignerai à un partage.
– Qui parle de partage ?
– M. Aimery Gérard, sans doute.
– Que t’importe, s’il n’obtient rien de ce qu’il demande, si je me sers de lui sans lui rien accorder ! Encore une fois, est-ce toi qui m’imposeras rue Richelieu ? Tu n’as ni relations ni influence dans ce monde-là. Un préfet, est-ce que cela compte à Paris ?
– Je ne suis plus préfet. J’ai donné ma démission pour ne plus te quitter.
– Tu as brisé ta carrière à cause de moi ! s’écria mademoiselle Chardin, mécontente et attendrie à cette révélation. Quelle folie !
– Je n’ai pas brisé ma carrière. J’ai trouvé une situation meilleure.
En quelques mots, il raconta les changements survenus dans sa vie. Désormais, il habiterait Paris. Il y serait plus riche qu’il n’était à Foix. Les occasions de grossir sa fortune allaient se présenter, fréquentes et nombreuses. Il aurait conquis rapidement l’influence. Tous ses efforts tendraient à faire monter sa maîtresse, aussi haut qu’il espérait monter lui-même.
– Tu iras là où tu veux aller, lui disait-il ; mais ne permets qu’à moi de t’y conduire. Avec moi, ton existence sera facile. Il n’est rien à quoi je ne sois prêt pour te rendre heureuse.





























