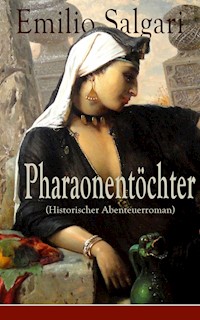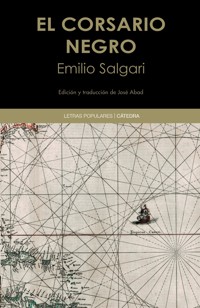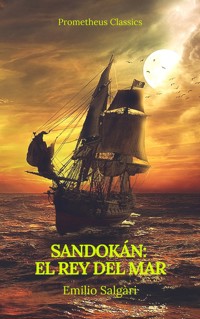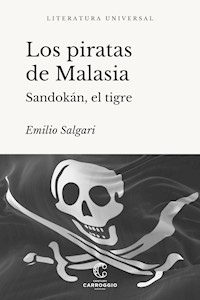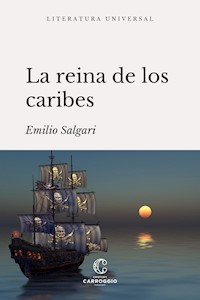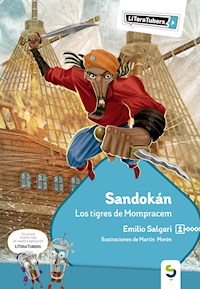1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Extrait
| CHAPITRE PREMIER
UN DRAME EN MER
— Au feu !...
— Ohé !... Petit Tonno !... Est-ce que tu rêves !...
— Au feu !...
— Mais tu as donc bu, drôle ?...
— Non... Je vois de la fumée...
— Dans une telle obscurité !... Le petit devient fou...
Une voix à l’accent traînard de nos hommes du Midi retentit violemment sur le tillac du navire :
— La chaloupe fuit !... Que saint Janvier envoie aux profondeurs ces damnés loups de mer !...
— Aux profondeurs ?... Qui donc ?... tonne une voix, à proue...
— Ils fuient... Les voilà, là-bas, qui s'en vont à toutes rames. Que le diable fasse une bouchée de ces canailles !..
— Et le feu a éclaté à bord !
Une explosion de cris et de demandes s'éleva au milieu des ténèbres:
— Les misérables !...
— Ils ont incendié le brigantin !...
— Mais non...
— Oui... La fumée sort de la cambuse.
— Mille tonnerres...
— Capitaine... Officier de quart...
— Ohé ! Tout le monde sur le pont.
— Que saint Marc nous aide!
— Aux pompes !... Aux pompes !...
— Et ces brigands-là s'enfuient !...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
CHAPITRE PREMIER UN DRAME EN MER
CHAPITRE II SUR LE GRAND' MAT
CHAPITRE III L'ATTAQUE DU REQUIN
CHAPITRE IV TERRE !... TERRE...
CHAPITRE V LES MONSTRES DE L’OCÉAN
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII LE TIGRE
CHAPITRE VIII LA CABANE AÉRIENNE
CHAPITRE IX LES ARBRES VÉNÉNEUX
CHAPITRE X LE PAIN DES ROBINSONS
CHAPITRE XI LE MIAS PAPPAN ET LE BOA CONSTRICTOR
CHAPITRE XII LES SINGES A LA PÊCHE AUX CRABES
CHAPITRE XIII A TRAVERS LES BOIS
CHAPITRE XIV DU MIEL ET DES POMMES DE TERRE DOUCES
CHAPITRE XV UN TERRIBLE QUART D’HEURE
CHAPITRE XVI UNE LUMIÈRE MYSTÉRIEUSE
CHAPITRE XVII LES TRACES D’UNE ANCIENNE COLONIE
CHAPITRE XVIII LE SERPENT A LUNETTES
CHAPITRE XIX LES BABIROUSSAS
CHAPITRE XX NOUVELLES DÉCOUVERTES
CHAPITRE XXI UNE CAPSULE AU MILIEU DE LA FORÊT
CHAPITRE XXII LE « TIA-KAU-TING »
CHAPITRE XXIII LE PILLAGE DES PIRATES
CHAPITRE XXIV ASSIÉGÉS DANS LA CAVERNE
CHAPITRE XXV L’OURAGAN
CHAPITRE XXVI LE LANCEMENT DE LA « ROMA »
CHAPITRE XXVII LES INCENDIAIRES DE LA « LIGURIA »
CHAPITRE XXVIII UNE TRISTE DÉCOUVERTE
CHAPITRE XXIX LE MALTAIS
CHAPITRE XXX LES NAUFRAGÉS
CHAPITRE XXXI SUR LE ROCHER
CHAPITRE XXXII LES SIGNAUX ENTRE L’ÎLE ET LE ROCHER
CHAPITRE XXXIII LE NAUFRAGE DE LA JONQUE
CHAPITRE XXXIV LES TAGALS
CHAPITRE XXXV LA FAMILLE DES ROBINSONS
Notes
EMILIO SALGARI
LES ROBINSONS ITALIENS
roman
Paris
Jules Tallandier Editions
1897
Raanan Editeur
Livre 699 | édition 1
LES ROBINSONS ITALIENS
CHAPITRE PREMIERUN DRAME EN MER
— Au feu !...
— Ohé !... Petit Tonno !... Est-ce que tu rêves !...
— Au feu !...
— Mais tu as donc bu, drôle ?...
— Non... Je vois de la fumée...
— Dans une telle obscurité !... Le petit devient fou...
Une voix à l’accent traînard de nos hommes du Midi retentit violemment sur le tillac du navire :
— La chaloupe fuit !... Que saint Janvier envoie aux profondeurs ces damnés loups de mer !...
— Aux profondeurs ?... Qui donc ?... tonne une voix, à proue...
— Ils fuient... Les voilà, là-bas, qui s'en vont à toutes rames. Que le diable fasse une bouchée de ces canailles !..
— Et le feu a éclaté à bord !
Une explosion de cris et de demandes s'éleva au milieu des ténèbres:
— Les misérables !...
— Ils ont incendie le brigantin !...
— Mais non...
— Oui... La fumée sort de la cambuse.
— Mille tonnerres...
— Capitaine... Officier de quart...
— Ohé ! Tout le monde sur le pont.
— Que saint Marc nous aide!
— Aux pompes !... Aux pompes !...
— Et ces brigands-là s'enfuient !...
Un homme à moitié nu, de taille moyenne, mais robuste comme un jeune taureau, le visage recouvert d'une barbe épaisse, s'élança hors de l’écoutille du cadre de poupe et demanda d'une voix puissante :
— Qu’arrive~t-il, ici?
L’officier de quart, qui venait de quitter la dunette de proue, courut à sa rencontre en lui disant d'une voix brisée :
— Mon capitaine... les deux rebelles se sont enfuis !
— Les deux Maltais ?
— Oui, mon capitaine.
— Quand?
— A Instant.,
— Mais, par où donc ? N'étaient~ils pas enchaînés ?
— C’est vrai... Mais ils ont brisées les chaînes, paraît-il.
— Sang de mercure !... Donnez-moi un fusil et ordonnez qu'on les poursuive, sinon je...
— C’est impossible, mon commandant.
— Qui a dit cela? hurla le capitaine.
— Le feu a éclaté à bord.
En entendant ces mots, le capitaine recula de deux pas et sa figure énergique et bronzés s’altéra.
— Le feu à bord ! s’écria-t-il. Et la poudre que nous avons ici... Six quint-aux... De quoi nous faire sauter...Et bien haut !... Suivez-moi, monsieur Balbo, et toi, maître d'équipage, fais apprêter les pompes et plonger les manivelles. l
Il s'élança sur le gaillard d'avant suivi de son second et enveloppa d'un regard la mer qui s'étendait sous ses yeux.
A cinq cents mètres du navire apparaissait une tache sombre qui, parfois, se confondait avec les flots couleur d’encre et s'éloignait du coté du sud, rapide. Quoique la distance fût déjà considérable, l'on entendait les coups redoublés de quelques rames.
— Les misérables! fit le capitaine avec un geste de colère. Et pas le moindre souffle pour nos voiles sur cette mer damnée !
— Laissez-les donc aller se faire pendre ailleurs, mon capitaine, dit le second.
— Et si le navire allait sombrer '?... Ils nous ont privés de l’unique chaloupe que nous avions. Le canot, vous le savez bien, les vagues nous l'ont arraché la semaine dernière.
— Nous construirons un radeau.
— Oui... dit le capitaine Martino comme se parlant à lui-même. S’il nous reste du temps !... Aux pompes !… Aux pompes, ou nous sommes tous perdus!
Il allait descendre du gaillard d’avant lorsqu'un espoir, comme un éclair, traversa son esprit.
— Monsieur Balbo, donnez-moi le porte-voix.
— Que voulez-vous faire?
— Silence... Hâtez-vous..
Le second bondit sur le pont, descendit par le petit escalier, pénétra dans la chambre commune de l’équipage, s’empara du porte-voix du maître d’équipage et revint le remettre au capitaine.
La voix vigoureuse de l'homme de mer retentit comme un son de clairon couvrant les ordres précipités du second, les cris des matelots et la rumeur des pompes qui commençaient de fonctionner.
— A bord! avait tonne le capitaine. A bord ou je vous fais pendre aux vergues du grand mât.
Une voix lointaine, venant du large, répondit d`un ton ironique :
— Bonne chance à tout le monde.
— A bord et je vous pardonnerai tout!
— Non !...
— Nous vous poursuivrons et nous vous tuerons, canailles !
Pas une voix ne répondit à cette menace dernière : la chaloupe avait disparu dans les ténèbres.
- Dieu vous punira, dit le capitaine d'une voix sourde. Aux pompes et que Dieu nous protège !
En attendant, le maître d’équipage avait fait préparer les pompes de poupe et de proue, avait fait jeter les sondes à l’eau, apporter sur les ponts toutes les bailles et les seaux disponibles.
Les douze matelots qui composaient l’équipage étaient parés aux barres attendant avec angoisse les ordres du capitaine.
Une épaisse fumée, imprégnée d’une forte odeur de goudron et de matières grasses, s’échappait par intervalles des fentes de 1'éc0utille. Le feu avait dû se déclarer dans la cambuse, qui se trouvait près de la chambre commune de l’équipage, et, de là, avait dû se communiquer à la charge de la cale.
Le capitaine avait ordonné d'ouvrir l’écoutille afin de constater la gravité de l’incendie. Le maître et quelques matelots soulevaient déjà les barres de fer qui remplacent les cadenas.
A l’intérieur, on entendait un bourdonnement sourd, comme un chuchotement de voix profondes, puis des détonations comme si des récipients remplis de liquides alcooliques éclataient, tandis que le goudron, entre les jointures du tillac, commençait à bouillir par la chaleur qui se dégageait de l'incendie souterrain.
Nul ne bronchait; mais, sur le visage de chacun, on lisait une profonde angoisse. Ces visages brûlés par le soleil équatorial et par les vents de la mer étaient devenus pales; ces fronts, d’habitude sereins même au milieu des tempêtes, s'étaient froncés.
On s'apprêtait à ôter la dernière barre de fer lorsque l’écoutille, comme refoulée par une secousse mystérieuse, se souleva violemment et se renverse sur le tillac. s
Tout a coup, une flamme énorme, semblable à une colonne de feu, jaillit des profondeurs de la cale, s'allongea du côté des voiles des huniers et du grand mât, illumina d'une sinistre clarté la nuit, jeta sur les flots des reflets de sang.
Un haut cri d'horreur retentit sur le tillac du malheureux navire, et se perdit loin, très loin sur la mer.
Tous avaient eu le même mouvement de recul pour ne point être enveloppés par cette flamme monstrueuse qui se contorsionnait avec les contractions sauvages des serpents; jusqu’aux hommes occupés aux pompes, tous avaient soudainement abandonné les traverses.
— Tout le monde à son poste, ordonna le capitaine.
Le maître d’équipage seul, un vieillard à barbe blanche, aux traits énergiques, s'avança pour approcher la sonde de l’embouchure de la cale.
Le capitaine pâlit.
Il saisit une hache oubliée sur le cabestan et, la levant, il menaça d'un ton de voix qui n'admettait point de réplique :
— Tout le monde à son poste, ou je vous fais sentira le poids de cette arme !...
L’équipage savait par expérience que le commandant n'était pas un homme avec lequel on pût plaisanter.
Après une courte hésitation, il revint aux pompes, tandis que deux ou trois matelots, ne trouvant pas à s’y employer, s'occupaient des bailles.
La colonne de feu, après avoir menacé le grand hunier, s'était courbée et se glissait lentement dans la cale; mais de l’écoutille grande ouverte jaillissaient, par intervalles, de lourdes nuées d'une fumée épaisse et noirâtre que la douceur du soir laissait s'appesantir sur le tillac, et des gerbes ,d’étincelles apparaissaient et s’élevaient lentement, pour aller s’éteindre sur les flots noirs de l’océan.
Lorsque le premier moment de terreur fut passé, chacun se remit avec acharnement au travail, sachant que, s'i1s ne parvenaient à éteindre le feu, une mort certaine et horrible les attendait, n'ayant désormais à bord plus une seule chaloupe.
Les pompes fonctionnaient avec rage, sans trêve, versaient des torrents d'eau dans les profondeurs ardentes de la cale ; les hommes des bailles s'épuisaient à vider leurs récipients, au milieu de la fumée et des étincelles.
Le capitaine et le second, qui s'étaient retirés vers la poupe, abattaient a grands coups de hache une partie de la muraille de bâbord. Ils paraissaient vouloir enlever le matériel pour construire un radeau.
Ils allaient franchir la dunette lorsqu’un nouveau personnage, sortant de sa cabine, apparut sur le tillac.
C’était un homme ayant à peine dépassé la trentaine, de taille au-dessus de la moyenne, à la poitrine vaste, aux larges épaules, aux membres musclés sans être pour cela disproportionnés.
Son visage large et anguleux, au menton pointu, était pâle, légèrement bronzé par le haie du vent de la mer ; son front spacieux, que traversait une seule ride précoce, disait combien cet homme était réfléchi ; ses yeux couronnés de deux épais sourcils, nettement arrondis, étaient profonds et, parfois, ils avaient de tels étincellements que l'on eût dit qu’ils pénétraient jusqu'aux derniers replis des cœurs ; ses lèvres serrées, à l'ombre d’une moustache rougeâtre, indiquaient que cet homme était doué d’une énergie inébranlable.
En voyant ces nuées de fumée, ces gerbes d’étincelles qui s'élevaient à travers la mâture du voilier, ces reflets de sang qui illuminaient les faces des matelots, il fronça les sourcils, mais n'exprima la moindre terreur.
— Un incendie? dit-il en s'adressant au capitaine.
Si je ne m’étais pas réveillé, vous m’auriez laissé rôtir paisiblement dans ma cabine !...
—C'est vous, monsieur Emilio? demanda le capitaine en se montrant sur la dunette.
— Moi-même, mon commandant.
— Venez donc nous aider, si vous tenez à votre vie.
— L’affaire est donc grave?
— Très grave, monsieur. La cale est tout en feu et...
— Quoi?
— Nous courons le danger de sauter tous bien haut, acheva le capitaine a mi-voix pour ne pas se laisser entendre des matelots.
— Et comment ?...
— Nous avons six quintaux de poudre au-dessous du chargement de coton.
Celui qui venait d'être appelé « monsieur Emilio ›› tressaillit, puis, bondissant sur l’escalier de la dunette avec une adresse à. rendre jaloux le plus habile des gabiers de bord, il rejoignit les deux officiers
— Nous sommes donc à la merci de Dieu, dit-il en s’emparant d’une hache.
— Oui, et je ne sais si nous aurons le temps d'achever un radeau.
— Jadis, j'ai été officier de marine comme vous, mon capitaine, et, pour de pareilles constructions, je m'y connais. Mettons d’abord la bouée à l’eau et ensuite nous attaquerons le grand mât. Ce sera pour nous un premier point d’appui.
— Bien parlé, monsieur Emilio.
On détacha la bouée et on la jeta à la mer en l’attachant à un grelin; puis, les trois hommes attaquèrent vigoureusement le grand mât.
Désormais, ils n’avaient plus aucun espoir de sauver le voilier.
L’incendie, malgré les efforts 'désespérée de l’équipage entier attelé aux pompes, se développait rapidement, menaçant toute la mâture.
La flamme, un instant domptée, revint à travers la cale, enveloppant et brûlant les voiles et les cordages.
L’effroyable explosion devenait imminente.
Le capitaine et le second, qui s’acharnaient au travail avec de formidables coups de hache, pâlissaient sensiblement, et leur compagnon aussi semblait commencer à perdre un peu de son admirable sang-froid.
Parfois, ils s’arrêtaient et restaient aux écoutes, comme pour mieux percevoir le craquement des bois qui se fendaient ou le bruit des ferrets qui tombaient deux par deux.
— Vite... vite !... répétait le capitaine.
Tout à coup, le mât coupé oscilla avec un long crépitement, s’abattit sur la muraille de bâbord, la réduisit en morceaux, plongea dans les eaux illuminées par l’extrémité du petit mât, entraînant dans sa chute toutes les vergues, les voiles et les cordages.
Presque au même instant, une sourde détonation gronda dans les entrailles enflammées du navire..Une partie de la poudre venait d'éclater.
Le capitaine poussa un cri de désespoir.
— Tout le monde à la mer !... La poudre ! la poudre !
la pou...
Il n’acheva pas. Tandis que les plus agiles franchissaient d'un bond le bastingage, une effrayante explosion ébranla la mer.
Une flamme gigantesque jaillit des écoutilles, livide ; le pont et les flancs du voilier écartelés s’éparpillèrent avec une violence extrême; toute cette masse qui surnageait se souleva et rebondit sur les flots.
Pendant quelques instants, une nuée erra sur l'océan ; ensuite, ce fut sur les eaux une chute sifflante de toutes sortes de débris, et la carcasse du voilier éventré, envahie par l'eau qui pénétrait abondamment par les fentes, disparut dans les profonds abîmes de la mer de Sulu.
CHAPITRE IISUR LE GRAND' MAT
La Liguria avait quitté Singapore le 24 août 1840 et se dirigeait à. Aragne, la ville la plus peuplée des îles Mariannes, chargée de cotons travaillés destinés aux caps de ces îles, d'une importante cargaison d'armes et de six quintaux de poudre pour les possessions espagnoles.
Quoique sa construction remontât a neuf années déjà dans un chantier génois, la Liguria était encore, à cette époque,›un beau voilier aux flancs solides, aux formes élégantes, comme la généralité des navires construits par les Liguriens, au puissant éperon et portant merveilleusement sa mature haute de brigantin.
Martino Falcone, le capitaine, était un de ces loups de mer de la carrière, plein d’audace et d’énergie. Il avait acheté ce navire avec ses économies, et, en vrai descendant de Cristoforo Colombo, il entreprit de longs voyages, beaucoup plus dangereux, mais bien plus rémunérateurs aussi que ceux du grand et petit cabotage.
Il choisit un peu, dans chaque port de la mer Adriatique et de la mer Tyrrhénienne, de braves matelots et s'en fut hardiment aux Indes, à l'Extrême-0rient et vers le grand océan Pacifique, sans souci des tempêtes, des cyclones des mers de Chine et des dangereuses roches de la Malaisie et de la Polynésie.
Pendant neuf années, il parcourut toutes ces mers avec une chance enviable, gagna des sommes assez rondes, affrontant, toujours victorieux, les tourbillons orageux, la furie des vents, sans changer ses courageux matelots dont il n’eut jamais a se plaindre; mais, dans son dernier voyage, cependant, sa fortune sembla vouloir l’abandonner.
Surpris par une tempête à l’entrée du détroit de la Malaque, tandis que de Bangoon il se rendait a Singapore, son navire se trouva si endommagé qu’il dut, aussitôt parvenu à destination, le remettre dans un chantier pour de longues réparations. Cet accident devait avoir pour lui des suites fatales.
Deux de ses plus vaillants matelots, lassés d'un si long repos, rompirent l’engagement pour s'embarquer sur d’autres navires, de manière que, lorsque le moment du départ fut arrivé, on dut avoir recours à deux autres hommes afin de compléter l’équipage.
Le mauvais vouloir du sort le fit tomber sur des matelots maltais débarqués la, depuis quelques semaines, d’un navire anglais. Pourquoi donc avaient-ils quitté le navire qui, des eaux de la Méditerranée. Les avait amenés sur les côtes de la Malaque ?... Nul ne le savait, et le capitaine Martino, qui préférait avoir à bord des matelots de la Méditerranée, et autant que possible des Italiens, ne chercha pas à le savoir, d’autant plus que le voilier anglais était parti déjà depuis un certain temps en direction des ports du Céleste Empire.
Quelques jours après, il devait se repentir de ses nouveaux engagés. Aussitôt que l’on se trouva en pleine mer, loin des côtes de la Malaque, les deux Maltais commencèrent à se montrer rebelles à tout ordre.
Ils travaillaient le moins possible, n”achevaient jamais leurs quarts de garde, ni de jour, ni de nuit; ils désobéirent aux ordres du maître d’équipage d’abord, à ceux du second ensuite, et enfin a ceux du capitaine lui-même.
Devant faire une halte à Varauni pour une cargaison d’huiles camphrées à destination des îles Mariannes, le capitaine songea à se débarrasser des Maltais; mais, lorsqu'on atteignit la capitale du royaume de Bornée, ils se montrèrent si sages et repentis, et cela depuis quelques jours déjà, que, grâce à leurs prières, ils.parvinrent à se faire garder à bord.
C’est la aussi que le capitaine Falcone, sur les recommandations particulières du consul hollandais, reçut sur son navire, en qualité de voyageur, celui qu°on a entendu appeler « monsieur Emilio ».
Ce monsieur n’était point Hollandais: c’était tout simplement un Italien comme l’équipage entier de la Iiguría. Il était Vénitien et était établi depuis plusieurs années à Bornée où il avait gagné de fortes sommes en exploitant le camphre.
Autrefois officier de marine, ensuite explorateur pour le compte du gouvernement hollandais, plus tard très riche négociant, M. Emilio voulait désormais explorer pour son propre compte les îles du grand Océan.
Très instruit, aimable, énergique autant que le capitaine, il avait été un compagnon charmant pour tout le monde, se faisant aimer aussi bien des matelots que des officiers.
La navigation avait été entreprise sous les plus heureux auspices, la mer étant très douce et le vent favorable.
La Liguria avait déjà perdu de vue les côtes du Bornée et traversait la mer de Sulu, enserrée entre le groupe des Philippines au nord et à l’est, la longue et fine île Palavan à l'ouest et les rives septentrionales du Bornée, lorsqu’une violente dispute éclata a bord. Elle devait avoir, hélas ! de terribles suites, à cause des deux turbulents matelots.
Ils avaient refusé de prendre part à la manœuvre, tandis que le voilier courait de longues bordées, ayant le vent opposé ; alors, un bouillant Palermitain, las de voir ces deux fainéants les mains dans les poches, perdit patience et leur allongea deux formidables horions.
Les Maltais, plus bouillants encore que le Sicilien, tirèrent leurs couteaux et assassinèrent un pauvre Catanais qui était venu à 1'aide de son compatriote.
Les cris des combattants attirèrent sur le pont le capitaine qui, s'emparant vivement d’une manivelle, abattit, d’un bon coup sur le dos, les deux rebelles, les fit enchaîner et descendre à fond de cale, pour les livrer ensuite aux autorités espagnoles du Quam.
L’on croyait la paix revenue lorsque, un soir, tandis que, dans un calme parfait, le voilier se trouvait immobilise au beau milieu de la mer de Sulu, les deux Maltais, qui avaient sans doute en leur possession une lime, parvinrent à rompre leurs chaînes et à s'évader sur l'unique chaloupe restée à bord et qui, selon la coutume de nos navires, était restée suspendue à la poupe.
Mais ce n’était pas tout: les deux misérables avaient, pour se venger sans doute, mis le feu à la cambuse, et peut-être aussi aux cotons.
Les lecteurs connaissent le reste : après deux heures, le navire sautait, éventré par l’explosion de la poudre, et sa carcasse fumante s’engouffrait sous les flots ténébreux de la mer de Sulu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’écho de l’effroyable détonation se mourait à peine lorsque, au milieu du gargouillement causé dans l’eau par la chute des débris incandescents du malheureux navire, on perçut comme une plainte humaine lointaine.
Tantôt, cette voix retentissait aiguë, claire, tantôt étouffée, comme si la gorge qui l’émettait s’emplissait, par intervalles, de l’eau des vagues que provoquait le gargouillement.
Une forme sombre s’agitait au milieu de l'écume, disparaissait un instant, réapparaissait en agitant les bras avec une énergie suprême.
Quel était donc cet heureux qui avait pu survivre à l’horrible catastrophe, lorsque tous les autres, peut-être, avaient suivi le navire dans les abîmes sans fond de la mer ?...
La lune qui, à ce moment-là, naissait effleurant l’horizon et jetant ses reflets argentée sur les ondes, laissa entrevoir un survivant.
C’était un matelot, jeune encore, n'ayant pas plus de vingt-cinq a vingt-huit ans, au teint bronzé, aux traits marqués, aux yeux noirs et vifs, à la barbe et aux cheveux noirs aussi ; un de ces types en somme qu'on rencontre fréquemment sur les rivières du levant et du ponant de la Ligurie, qui sont de vrais matelots audacieux et ardents.
Quoique fraîchement échappé au terrible danger et seul, sur cette mer qui semblait habitée par des requins, monstres très féroces et ordinaires habitants des mers de la Chine et de la Malaisie, il paraissait rassuré et tranquille.
Il nageait avec une énergie surhumaine, il se haussait sur les flots et, entre deux secousses des mains et des pieds, il appelait :
— Ohé !... De ce côté-ci !...
Pas une voix ne répondait, hors le bruit que causait le gargouillement à la place où le navire avait sombré et où les eaux s'agitaient encore. Ils étaient donc tous morts, officiers et matelots ?... Ah! maudits, maudits misérables qui avaient tout détruit avec leur incendie !
Le matelot avançait toujours en quête d’une épave pour avoir au moins un point d'appui, mais la lune n’éclairait pas assez la mer; il fallait attendre qu'elle se Levât plus haut encore sur l’horizon.
Son appel retentit pour la vingtième fois: il lui sembla entendre, de loin, une voix.
Il s'arrêta haletant, retenant son souffle, se couchant sur l'eau pour éviter de remuer les bras et les jambes, et resta aux écoutes, plongé dans une profonde angoisse.
Non, il ne s'était point trompé I... A deux ou trois cents mètres devant lui, des voix se renouvelaient.
— Des camarades !... s'écria-t-il très ému. Donc, ils ne sont pas tous morts ?
Une lame faillit l’envelopper ; d'un coup de talon, il se souleva et projeta un regard devant lui.
Il lui sembla discerner, sur les flots argentés, deux formes humaines et une masse sombre d'où émergeaient deux antennes. Un cri jaillit de sa poitrine:
— Hé !... la-bas... A moi... les camarades! -
Une voix claire, aiguë, venant du large, lui répondit
aussitôt :
— C'est de ce côté-ci !
— Qui êtes-vous ?
— Albani et le petit Tonno.
-- M. Emilio et le mousse, murmure le matelot.
Puis, à haute voix :
— Et le capitaine ? demanda-t-il.
— Disparu.
— Avez-vous trouvé une épave ?
-- Le grand mât; dépêchez-vous.
-- Voilà !
Et le matelot, dans de nouveaux efforts, épuisait ses dernières forces. Désormais, à la clarté azurée de la lune, il distinguait clairement ses compagnons qui se tenaient à cheval sur le grand mât. Il allait les atteindre, lorsqu'il entendit à quelques pas derrière lui une chute sourde et un soupir rauque.
Il se retourna vivement, mais il ne vit qu'un flot d'écume qui s'élargissait en forme de cercle.
— Ce doit être un cadavre qui remonte à la surface de l’eau, pensa~t-il en frissonnant.
Un cri partant du côté de l’épave s’éleva sur la mer.
— Prenez garde, matelot !…
— Qu'y a-t-il ? demanda le nageur, inquiet.
— Vous avez un requin à vos trousses.
— Grand Dieu !
— Avez-vous un couteau ?
— Mon couteau de manœuvre.
— Tenez-le prêt. Je vais à votre secours.
Une chute, puis un jet d’eau s'éleva, étincelant.
M. Emilio avait abandonné le mât et accourait d’une haleine à l’aide du matelot dans l’assaut de la bête affamée.
Le nageur, qui savait par expérience quel formidable ennemi il devait combattre, en proie à une poignante angoisse, s’était soudainement arrêté, repliant les jambes dans la crainte de se les sentir amputer d'un instant à l’autre.
Il avait cependant tiré de sa ceinture sa navaja espagnole, un couteau à la lame très aiguisée, très mince, longue d’un demi-pied; arme très dangereuse surtout dans les mains d’un homme résolu.
Nul autre bruit ne parvenait à ses oreilles; mais son trouble grandissait de plus en plus, puisque le requin pouvait l’atteindre sous l’eau et le couper en deux d’un seul coup de mâchoire.
Soudain, il vit émerger brusquement, à moins de dix mètres, une tête énorme où s'ouvrait une gueule pareille à un tonneau sans fond et armée de plusieurs rangées de dents triangulaires.
— Au secours !... cria le malheureux.
— N'ayez crainte, répondit une voix. Nous sommes deux à le combattre !
CHAPITRE IIIL'ATTAQUE DU REQUIN
M. Albani, ex-officier de marine, et sans doute nageur émérite, apparut derrière le requin. La lune faisait briller le couteau qu’il serrait entre ses dents.
Au moment où le monstre allait plonger, par une dernière brassée, Albani se trouva à côté du matelot qui n’osait plus se mouvoir, tout en ayant l’arme à la main.
— N'ayez crainte, Enrico, dit M. Emilio d'une voix calme, s'il nous assaille, il aura son compte.
— Est-ce qu’il nous attaquerait par-dessous ? demanda le matelot qui se rassurait en se sachant aidé d’un si courageux compagnon.
— La lune éclaire l'eau et nous permettra de le voir :
attendez.
Il plongea, jeta sous les flots un rapide coup d’œil, mais il ne vit rien. Il revint à leur d’eau, regarda autour de lui, et, cette fois, il discerna à une vingtaine de pas un léger bouillonnement qui annonçait bien l’imminente apparition d'un corps gigantesque.
— Il est derrière nous, dit-il. Prenez votre couteau entre vos dents et hâtons-nous de battre en retraite vers le mât.
— Ne nous attaquera-t-il pas ?
— Je ne le crois pas; il aura assez de cadavres sans avoir recours aux vivants, répondit M. Emilio en soupirant.
— Mais croyez-vous donc que tous les autres soient morts ?
— Je le crois; hâtons-nous.
Et, très rapidement, ils nagèrent du coté du mât en retournant sans cesse la tête pour s'assurer qu'ils n’étaient pas poursuivis; mais on eût dit que le monstre ne songeait plus à eux. Il apparaissait et disparaissait, émettant de rauques soupirs, frappant de sa queue sur l’eau qui s'élevait comme une lame, mais il se tenait loin ; il avait sans doute trouvé d’autres proies sans courir aucun danger.
En quelques minutes, les nageurs atteignirent le grand mât où les attendait leur compagnon, le petit Tonno.
Ce dernier survivant était mousse sur la Liguria.
C’était un garçonnet de quinze ou seize ans, svelte comme un singe, bien développé, à la figure intelligente et malicieuse.
Il avait de grands yeux noirs découpés en amandes, le profil régulier rappelant celui des races gréco-albanaises, une petite bouche de femme aux lèvres vermeilles, les joues un peu bronzées bien remplies, les cheveux tout noirs. Il avait été recueilli et embarqué sur la Liguria, trois ans auparavant, par le défunt capitaine Falcone, qui Pavait trouvé mourant de faim sur les plages d'Ischia. ll n'avait connu ni son père, ni sa mère, seulement il se rappelait bien qu'il avait passé sa toute première enfance en compagnie d’un vieux pêcheur, avec lequel il avait vécu jusqu’au jour où ce vieillard s’éteignit. Reste seul, il avait erré un peu partout, tantôt sur les plages, tantôt dans les campagnes des îles, vivant de crabes ou de fruits volés la nuit; mais l'hiver survint, il se sentit exténué; il ne lui restait plus que la peau sur les os, et il tomba mourant sur le rivage. Ce fut alors que le capitaine, passant par là, en se rendant chez une vieille parente l’aperçut et le recueillit.
Ubaldo, dit le « petit Tonno ››, tel était son nom, n’en ayant jamais eu d’autre, aida ses compagnons à monter sur le grand mât, tout en se préoccupant de ne point le faire retourner.
— Ouf !... fit le matelot en secouant l'eau qui avait trempé ses vêtements... si cela avait duré encore une demi-heure, j'aurais été voir le fond comme un boulet de canon.
— Et tu aurais été coupé en deux par ce grand mangeur d’hommes, n’est-il pas vrai, camarade ? dit le mousse.
— Sans le secours de M. Emilio, je ne sais pas si, à l'heure qu'il est, mes jambes feraient encore partie de mon corps. Merci, monsieur ; je n’oublierai jamais...
— Ne parlons pas de cela, Enrico, interrompit M. Albani. Songeons à nous tirer d’embarras, car notre situation n’est vraiment pas gaie.
— Je ne demande pas mieux.
— N’as-tu entendu aucun cri ?
— Non, monsieur. Je crois que nos malheureux compagnons sont tous morts.
— Pauvre capitaine ! pauvres matelots !... Maudits soient les traîtres !
— Dieu les punira. Même avec une chaloupe, ils n'iront pas loin ; car ils ne doivent pas avoir avec eux beaucoup de vivres.
— Il n'y avait qu’une bouteille vide, dit le petit Tonno avec son accent traînant des Méridionaux. C’est moi qui ai nettoyé la chaloupe hier matin.
— Apercevez-vous des épaves ? demanda M. Emilio.
— Je ne vois qu’un tonneau qui surnage là-bas, dit le matelot.
— « S`il était rempli au moins !...
— ll me semble qu'il est vide, car il y en a plus de la moitié sur l’eau.
— Pourtant, il devrait y avoir des épaves. Les vergues et le mât de misaine doivent surnager ; je voudrais les voir auparavant.
— Qu'espérez-vous faire, monsieur ?
— Il pourrait y avoir des naufragés à recueillir.
— Ah! bah! .fit le matelot en secouant la tête. Ils auraient répondu à vos appels et aux miens.
— Les épaves peuvent être loin et... Mais ne vous semble-t~il pas que nous sommes déjà très éloignés du lieu de la catastrophe ?
— En effet, monsieur, il me semble bien que nous nous en éloignons.
— C'est peut-être le courant qui nous entraîne.
— Je le crois aussi.
— Cela est grave.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il nous éloigne des épaves, tandis que nous aurions pu, peut~être, trouver du bois, pour nous construire un radeau, et peut-être aussi une caisse ou un tonneau contenant des vivres.
— Essayons d'appeler encore une fois, monsieur, dit Ubaldo, le petit Tonno. Si l'un de nos camarades a pu avoir la vie sauvée, nous tâcherons de le rejoindre ou il viendra à nous.
— Essayons, dit Albani.
Trois sonores appels tonnèrent:
— Ohé !... Ohé !... Ohé !...
Ils se mirent attentivement aux écoutes, mais pas une voix ne répondit.
Ils répétèrent l’appel, mais ce fut en vain. Ils percevaient seulement les gargouillements de l'eau et le soupir rauque du requin.
— Ils sont tous morts, dit le matelot. Il ne reste que nous de vivants, mais qui sait quel triste sort nous attend, dans l'immensité de la mer !
— Il ne faut point désespérer, dit M. Albani. Dieu nous a préservés de la mort, et ce n’est sans doute pas pour nous livrer à la faim, à la soif, ou aux dents de ces bêtes affamées.
— Mais comment. avons-nous pu échapper à la catastrophe ?
— Parce que nous étions déjà à l’eau lorsque le navire a éclaté.
— Vous, mais pas moi, monsieur, dit Enrico. Je franchissais le bastingage de proue quand je me suis senti projeter en l’air au milieu d'une nue de fumée, et puis plonger dans l’eau, tandis qu’autour de moi tombaient en sifflant des débris de toutes sortes. Vous dire comment je suis revenu sur l'eau vivant, je ne le sais.
— C’est un vrai miracle que les fragments du navire ne t'aient pas tué.
— Je le crois. Et maintenant, qu'allons-nous faire ?
Parviendrons-nous a nous sauver, ou nous acheminons-nous vers une lente et déchirante agonie ?
M. Albani ne souffla mot : les yeux fixés sur la lune qui, au milieu d’un ciel serein, suivait paisiblement son cours, il semblait absorbé dans une profonde méditation. Songeait-il au moyen de se tirer d'une situation qui devenait,d’heure en heure plus grave, ou bien aux dernières paroles du matelot ?...
Ses compagnons, aussi rêveurs, aussi tristes que lui, se tenaient vigoureusement à cheval sur l’épave de la Liguria, plongeant leurs yeux dans l'infini de la mer, dans l'espoir peut-être d'apercevoir sur la ligne argentée de l’horizon une tache obscure ou un point lumineux indiquant la présence d'un navire qui pourrait les sauver.
— Ecoutez-moi, dit tout à coup, en se secouant, l’ancien marin. Savez-vous exactement où se trouvait la Liguria au moment de la catastrophe ? Toi, Enrico, tu étais de quart si je ne me trompe ?
— A l'est des îles de Sulu.
— A quelle distance ?
— Je l’ignore. Lorsque le capitaine a marqué le point, je n’étais pas là.
— Et moi non plus, dit le petit Tonno.
— Nous nous trouvons peut-être à deux ou trois cents milles de l’Archipel, dit M. Albani, comme se parlant à lui-même.
— Je le suppose, répondit Enrico.
— C'est une distance énorme pour des gens qui n'ont pas un canot, ni une gorgée d’eau, ni un biscuit.
— Sans compter que l’archipel de Sulu est habité par les plus méchants pirates de la Malaisie, ajouta le matelot.
— Voyons, dit M. Albani, voyons où nous conduit ce courant qui nous éloigne du lieu du désastre.
— Attendez, fit le petit Tonno, j’ai dans la poche une petite boussole ; c'est un cadeau du capitaine.
Il tira le précieux objet, le mit en évidence sous les rayons lunaires, regarda l’aiguille.
— Nous allons du côté est, ajouta-t-il.
— Du côté de l’archipel ? demanda le matelot.
— Oui, affirma M. Emilio.
— Quelle vitesse peut donc avoir ce courant ?
— Peut-être un mille et demi à l'heure.
— En supposant que l’archipel soit à trois cents milles de nous, combien de temps nous faudrait-il pour y parvenir ?
— Deux cents heures, c'est-à-dire huit jours et huit heures. _
— Ventre d’un requin !... grommela le matelot. De quoi mourir de faim tout à notre aise !...
— Si ce n'est pas de faim, ce sera certainement de soif, dit M. Emilio. Avec la. chaleur qui règne sur cette mer, nous ne pourrons pas résister.
— Et puis, huit jours sans fermer l’œil ! ajouta petit Tonno. J'ai peur de ne revoir jamais plus lschia et Naples.
— Et moi, le père Merlotti, l’aubergiste de la rue Sottoripa, un de mes bons amis, dit le matelot. Adieu. Gênes !...
— Il nous reste encore du temps pour mourir, mes amis, dit M. Emilio. Il est vrai que ces parages sont très peu fréquentés par des navires; mais il peut en passer un qui nous sauve, comme nous pouvons aussi être repoussés du côté d'une île de l’archipel. Il en est quelques-unes qui s’éloignent du groupe principal et, qui sait, l’une d’elles se trouve peut-être très près de nous.
— Pour l’instant, je n'en aperçois guère.
— Nous n'avançons que depuis une demi-heure,
Enrico. Il faut attendre jusqu’à demain matin ou après demain.