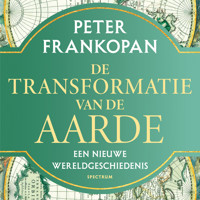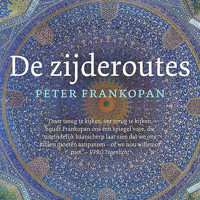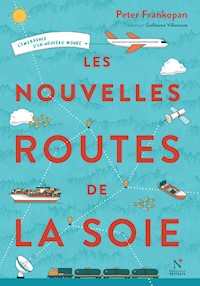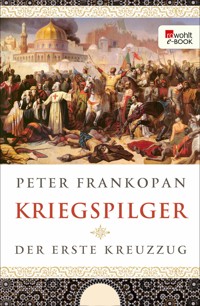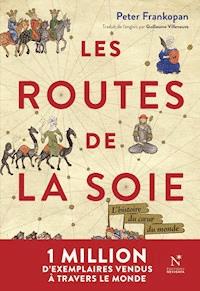
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Les Routes de la Soie
- Sprache: Französisch
D’Alexandre le Grand aux nouvelles Routes de la Soie, 2500 ans d’histoire comme vous ne l’avez jamais lue.
Avec son « histoire du cœur du monde », Peter Frankopan renverse notre récit traditionnel, qui gravite autour de la Grèce antique, de Rome et de l’irrésistible ascension de l’Occident. Une approche réductrice, qui mérite une relecture urgente et approfondie.
L’auteur élargit la perspective et tourne son regard vers « une région située à mi-chemin entre Orient et Occident, qui va des rives orientales de la Méditerranée jusqu’à la mer Noire et à l’Himalaya ». C’est là qu’il place le curseur de sa lecture de l’histoire.
Salué par la presse internationale comme le « plus important livre d’histoire publié depuis des décennies », Les Routes de la Soie est un voyage grisant à travers les siècles, de l’Europe à la Chine, décentrant avec audace le regard du lecteur pour éclairer d’une lumière nouvelle notre compréhension du monde.
Redécouvrez l'Histoire avec ce livre incontournable salué à plusieurs reprises par la critique et figurant parmi le palmarès des 25 livres de l'année du Point !
EXTRAIT
"Depuis l’origine des temps, le centre de l’Asie fut le lieu de création des empires. Les plaines alluviales de Mésopotamie, alimentées par le Tigre et l’Euphrate, ont fourni la base de la civilisation elle-même – car c’est dans cette région que se sont formées les premières villes et cités. L’agriculture systématique s’est développée en Mésopotamie et dans tout le « Croissant fertile », bande de terre très productive aux riches ressources en eau, qui s’étend du golfe Persique au littoral de la Méditerranée. C’est là aussi que certaines des premières lois connues ont été publiées il y a près de 4 000 ans par Hammourabi, roi de Babylone, qui y détaille les devoirs de ses sujets et édicte de féroces châtiments en cas de transgression."
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"On a tous rêvé de lire une histoire de l'humanité en 700 pages. On rêve tous aussi de partir en voyage sur les chemins du monde et de son passé. L'historien anglais comble ces deux aspirations en nous entraînant sur une quinzaine de routes qui jalonnent deux mille cinq cents ans d'échanges et de tumultes." - Le Point
"Un livre courageux et ambitieux, foisonnant de connexions surprenantes." - New York Review of Books
"Une histoire du monde dont l'auteur déplace le centre de gravité vers l'est. Il fallait oser, et le résultat est brillant." - The Economist
"Un livre d'une grande érudition qui éclaire des horizons aussi vastes que les régions qu'il traverse." - Sunday Times
"Peter Frankopan, professeur d'histoire à Oxford, resitue l'importance du continent dans les équilibres passés et à venir, et égratigne au passage notre "européocentrisme"." - Christian Makarian, L'express
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1971, Peter Frankopan est historien et professeur à l’Université d’Oxford, où il dirige le Centre de recherches byzantines. Également enseignant aux Universités de Yale, Harvard, Princeton et Cambridge, il est l’auteur d’une Histoire de la Première croisade (2012), unanimement saluée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1321
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Jessica, Katarina, Flora, François et Luc
« Nous avons fait halte dans le pays d’une tribu de Turcs… nous en avons vus qui adorent les serpents, d’autres qui adorent le poisson, d’autres qui adorent les grues. »
Ibn Fadlan, Voyage chez les Bulgares de la Volga
« Moi, le Prêtre Jean, je suis le souverain des souverains et dépasse les rois de la terre entière par les richesses, la vertu et la puissance… Le lait et le miel coulent librement dans nos domaines ; le poison ne peut y faire de mal et les garrulantes grenouilles n’y coassent pas. Il n’y a ni scorpions, ni serpents qui rampent dans l’herbe. »
Lettre apocryphe du Prêtre Jean à Rome et à Constantinople, XIIe siècle
« Il a un très grand palais, au toit tout entier d’or fin. »
Christophe Colomb, note de recherches sur le Grand Khan d’Orient, fin du XVe siècle
« Si nous ne faisons des sacrifices relativement modiques, si nous n’altérons dès maintenant notre politique en Perse, nous mettrons tout à la fois en danger l’amitié anglo-russe et découvrirons dans un avenir assez proche (…) une situation où l’existence même de l’Empire sera menacée. »
Sir George Clerk à Sir Edward Grey, ministre des Affaires étrangères, 21 juillet 1914
« Le président gagnerait, même si nous restions les bras croisés. »
Le chef d’état-major de Nursultan Nazarbayev, président du Kazakhstan, peu avant l’élection de 2005
Carte 1 : Villes principales, anciennes et présentes, sur les Routes de la Soie
Préface
Enfant, l’un de mes biens les plus chers était une grande carte du monde. Elle était épinglée au mur près de mon lit et je la scrutais chaque soir avant de m’endormir. Avant longtemps, j’eus appris par cœur les noms et situations de tous les pays, noté leurs capitales ainsi que les océans, les mers et les fleuves qui s’y jetaient ; les noms des principales chaînes de montagne et des déserts, tracés en impérieuses italiques, excitants d’aventure et de danger.
Avec l’adolescence, mon malaise grandit devant l’optique constamment étroite de mes cours de géographie scolaire, laquelle ne se focalisait que sur l’Europe et les États-Unis, en omettant l’essentiel du reste du monde. On nous avait enseigné l’histoire des Romains en Grande-Bretagne ; la conquête normande en 1066 ; Henri VIII et les Tudors ; la Guerre d’indépendance américaine ; la révolution industrielle sous le règne de Victoria ; la bataille de la Somme ; l’essor et la chute de l’Allemagne nazie. Je regardais ma carte et comprenais que d’immenses régions du monde avaient été passées sous silence.
Pour mon quatorzième anniversaire, mes parents m’offrirent un livre de l’anthropologue Eric Wolf et c’est lui qui m’enflamma. L’histoire de la civilisation, aussi paresseuse qu’admise, écrivait-il, est celle qui veut que « la Grèce antique ait engendré Rome, que Rome ait engendré l’Europe chrétienne, l’Europe chrétienne la Renaissance, que la Renaissance ait engendré les Lumières, et celles-ci la démocratie politique et la révolution industrielle. L’industrie, mâtinée de démocratie, aurait à son tour accouché des États-Unis, lesquels incarnent le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. »1 Je reconnus aussitôt l’histoire exacte qu’on m’avait racontée : le dogme du triomphe politique, culturel et moral de l’Occident. Mais cet exposé était erroné ; il y avait d’autres façons de considérer l’histoire – des façons qui ne consistaient pas à envisager le passé du point de vue des vainqueurs de l’histoire récente.
J’étais mordu. Il m’apparut soudain évident que les régions dont on ne nous parlait pas s’étaient perdues, étouffées par le récit répétitif de l’essor de l’Europe. Je suppliai mon père de m’emmener voir la Mappa Mundi de Hereford qui faisait de Jérusalem sa cible et son centre, l’Angleterre et les autres pays occidentaux étant déportés sur le côté, quasi négligeables. Quand j’entendis parler des géographes arabes dont les ouvrages s’illustraient de portulans qui semblaient sens dessus dessous et plaçaient la mer Caspienne au centre, je fus hypnotisé – comme je le fus quand je découvris à Istamboul une importante carte médiévale turque qui portait en son cœur une ville du nom de Balasaghun, dont je n’avais même pas entendu parler, qui ne figurait sur aucune carte, dont la position même est restée incertaine jusqu’à récemment et qui fut pourtant jadis tenue pour le centre du monde.2
Je voulais en savoir davantage sur la Russie et l’Asie centrale, sur la Perse et la Mésopotamie. Je voulais comprendre les origines du christianisme envisagé depuis l’Asie ; ce que les habitants des grandes villes du Moyen Âge – par exemple Constantinople, Jérusalem, Bagdad et Le Caire – avaient pensé des croisades ; je voulais découvrir les grands empires d’Orient, les Mongols et leurs conquêtes, comprendre à quoi ressemblaient deux guerres mondiales, non depuis les Flandres ou le front ouest, mais depuis l’Afghanistan ou l’Inde.
J’eus donc beaucoup de chance de pouvoir apprendre le russe au collège, sous la houlette de Dick Haddon, brillant personnage qui avait travaillé dans les services secrets de la marine et qui tenait que la meilleure manière de comprendre la langue et la doucha (l’âme) de la Russie était d’en pratiquer l’éblouissante littérature et la musique paysanne. J’eus encore plus de chance quand il proposa des leçons d’arabe aux élèves intéressés. Il fit connaître à une demi-douzaine d’entre nous la culture et l’histoire islamiques et nous immergea dans les beautés de l’arabe classique. Ces langues m’aidèrent à ouvrir un monde qui attendait d’être découvert, ou, comme je le compris vite, d’être redécouvert par certains d’entre nous à l’Ouest.
Aujourd’hui, on consacre beaucoup d’attention à mesurer l’impact vraisemblable d’une croissance rapide de l’économie chinoise ; on suppute qu’elle induira le quadruplement de la demande d’objets de luxe dans la prochaine décennie. Ou bien l’on étudie les mutations sociales de l’Inde où plus de gens disposent d’un téléphone mobile que d’une chasse d’eau3. Or ni la Chine ni l’Inde, selon moi, n’offrent le meilleur point de vue pour considérer le passé du monde et son présent. En réalité, et pour des millénaires, ce fut la région sise entre Orient et Occident, reliant l’Europe au Pacifique, qui constitua l’axe de rotation du globe.
Ce milieu entre l’est et l’ouest, qui court en gros des rivages orientaux de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu’à l’Himalaya, on jugera peut-être qu’il paraît peu prometteur pour regarder le monde. C’est une région qui abrite aujourd’hui des États évoquant l’exotique et le périphérique, tels le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan, le Tadjikistan et les pays du Caucase ; on l’associe à des régimes instables, violents, qui menacent la sécurité internationale, à l’image de l’Afghanistan, de l’Iran, l’Irak et la Syrie, ou qui méconnaissent les meilleures pratiques de la démocratie, tels la Russie et l’Azerbaïdjan. Dans l’ensemble, c’est une région constituée d’États déstructurés ou en voie de destruction, dirigés par des dictateurs qui remportent les élections nationales avec d’incroyables majorités, dont les familles et les amis ont la haute main sur d’immenses conglomérats, possèdent d’innombrables biens et détiennent le pouvoir politique. Ce sont des lieux où les droits de l’homme sont bafoués, où la liberté d’expression touchant les questions de foi, de conscience et de sexualité, est limitée, où le contrôle des médias décide de ce qui est rapporté ou pas par la presse.4
Si de tels pays peuvent nous paraître sauvages, ce ne sont pas des trous perdus, d’obscurs terrains vagues. En réalité, le pont qui relie l’est et l’ouest est le carrefour même des civilisations. Loin d’être à la marge des affaires mondiales, ces pays se trouvent en leur centre – comme ils le sont depuis l’aube de l’histoire. C’est là que naquit la civilisation, là selon beaucoup que l’Homme fut créé – dans le jardin d’Eden, « planté par le Seigneur Dieu », doté de « toute espèce d’arbres séduisants à voir et bons à manger » dont on pensait généralement qu’il se situait dans les riches contrées entre le Tigre et l’Euphrate.5
C’est sur ce pont unissant l’est et l’ouest que furent fondées les grandes métropoles il y a près de 5 000 ans, où les villes de Harappa et Mohenjo-daro, dans la vallée de l’Indus, furent les merveilles du monde antique, peuplées de dizaines de milliers d’habitants, aux rues surplombant un système d’égouts élaboré qu’on ne verrait pas en Europe avant des milliers d’années.6 D’autres grands centres de civilisation comme Babylone, Ninive, Uruk et Akkad en Mésopotamie étaient renommés pour leur faste et leur architecture novatrice. Entre-temps, un géographe chinois d’il y a plus de deux millénaires a noté que les habitants de la Bactriane, région traversée par l’Amou-Darya (l’Oxus) et englobant le nord de l’Afghanistan actuel, étaient des négociants et marchands légendaires ; sa capitale accueillait un marché d’une immense richesse, où les produits venaient de très loin pour repartir aussi loin.7
C’est l’endroit où les grandes religions du monde ont pris vie, où le judaïsme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme ont joué des coudes. C’est le chaudron où les groupes de langues ont rivalisé, où les langues indo-européennes, sémitiques et sino-tibétaines frétillaient à côté des altaïques, turques et caucasiennes. C’est là que de grands empires ont crû puis décru, là que les conséquences des affrontements culturels ou personnels se sont fait sentir à des milliers de kilomètres. En se tenant là, on découvre de nouvelles manières d’envisager le passé et un univers profondément interconnecté, où ce qui s’est produit sur tel continent a eu un impact sur tel autre, où les répliques des événements intervenus sur les steppes d’Asie centrale ont pu être perçues en Afrique du Nord, où les événements de Bagdad ont eu des échos en Scandinavie, où les découvertes des Amériques ont modifié les prix des denrées en Chine et induit une demande supplémentaire de chevaux sur les marchés de l’Inde septentrionale.
Ces vibrations se sont propagées sur un réseau qui s’évase dans toutes les directions, celui des routes parcourues par les pèlerins et les guerriers, les nomades et les marchands, où denrées et produits ont été achetés et vendus, les idées échangées, modifiées, enrichies. Elles ont transmis non seulement la prospérité, mais aussi la mort et la violence, la maladie et les fléaux. À la fin du XIXe siècle, ce réseau tentaculaire de relations a été baptisé du nom de Seidenstrassen, les Routes de la Soie, par un éminent géologue allemand, Ferdinand von Richthofen (l’oncle du « Baron Rouge », l’as de la Première Guerre mondiale).8 Ce nom leur est resté depuis lors.
Ces itinéraires constituent le système nerveux central du monde, reliant ensemble peuples et lieux, mais ils se trouvent sous la peau et sont invisibles à l’œil nu. Tout comme l’anatomie explique la manière dont le corps fonctionne, c’est en comprenant ces connexions que nous comprenons la marche du monde. Pourtant, en dépit de son importance, cette partie de l’univers a été oubliée par l’histoire généralement enseignée. Cela résulte en partie de ce qu’on a appelé « l’orientalisme » – cette théorie véhémente, essentiellement négative de l’Orient, qui l’a tenu pour sous-développé et inférieur à l’Occident et donc indigne d’une étude sérieuse.9 Mais cela vient aussi de ce que le récit du passé est si prégnant, si bien installé qu’il ne peut plus accueillir une région qu’on a longtemps jugée périphérique à l’histoire de l’essor de l’Europe et de la société occidentale.
De nos jours, Jalalabad et Hérat en Afghanistan, Falloudja et Mossoul en Irak, Homs et Alep en Syrie paraissent synonymes de fondamentalisme religieux et de violence fanatique. Le présent a emporté le passé telle une avalanche : le temps n’est plus où le nom de Kaboul évoquait des visions de jardins plantés et entretenus par le grand Babur, fondateur de l’empire moghol en Inde. Le Bagh-i-Wafa (« Jardin de la Fidélité ») comportait un bassin entouré d’orangers et de grenadiers, outre un champ de trèfles, dont l’empereur était extrêmement fier. « C’est la plus belle partie du jardin, un superbe spectacle quand les oranges se colorent. Vraiment ce jardin est admirablement situé ! »10
De même, les opinions modernes sur l’Iran ont obscurci les gloires de son histoire plus reculée, celle du pays qui le précéda, la Perse, naguère synonyme de bon goût en toutes choses, depuis le fruit servi au dîner jusqu’aux éblouissants portraits en miniature de ses artistes légendaires, en passant par le papier sur lequel écrivaient les érudits. Un ouvrage magnifiquement réfléchi de Simi Nishapuri, bibliothécaire de Mashhad dans l’est du pays, vers 1400, rapporte avec un luxe de détails les conseils d’un bibliophile qui partageait sa passion. Quiconque envisage d’écrire, lui conseille-t-il solennellement, doit savoir que le meilleur papier de calligraphie se fabrique à Damas, Bagdad ou Samarcande. Le papier venu d’ailleurs « est en général rugueux, périssable et fait des pâtés ». Songez bien, prévient-il, qu’il vaut la peine de teinter légèrement le papier avant d’y écrire « car le blanc agresse les yeux et les plus beaux exemples de calligraphie observés emploient tous du papier teinté. »11
Des endroits dont les noms sont quasi oubliés ont jadis dominé l’histoire, telle Merv, qu’un géographe du Xe siècle qualifie de « cité délicieuse, belle, brillante, étendue et agréable » et de « mère du monde » ; ou Ray, non loin de la moderne Téhéran, laquelle était si glorieuse aux yeux d’un autre écrivain à peu près contemporain, qu’elle pouvait être tenue pour la « mariée de la terre » et la « plus belle création du monde. »12 Piquetant l’échine de l’Asie, ces villes s’enfilaient comme des perles, reliant le Pacifique à la Méditerranée.
Les centres urbains rivalisaient, l’émulation des dirigeants et des élites suscitait une architecture toujours plus ambitieuse et des monuments spectaculaires. Des bibliothèques, des lieux de culte, des églises et des observatoires à la taille et au rayonnement culturel immenses ponctuaient la région, reliant Constantinople à Damas, Ispahan, Samarcande, Kaboul et Kachgar. Des villes analogues accueillirent de brillants érudits qui donnèrent un grand élan à leurs disciplines. On ne se souvient aujourd’hui que d’une poignée d’entre eux – des hommes comme Ibn Sina, plus connu sous le nom d’Avicenne, al-Biruni et al-Khwarizmi – des géants dans le domaine de l’astronomie et de la médecine ; mais il y en avait beaucoup d’autres. Durant des siècles avant l’ère moderne actuelle, les centres d’excellence intellectuelle de ce monde, les Oxford et les Cambridge, les Harvard et les Yale ne se situèrent pas en Europe ou en Occident, mais à Bagdad et Balkh, Boukhara et Samarcande.
Il y avait une excellente raison pour que les cultures, les villes et les peuples jalonnant les Routes de la Soie se développent et prospèrent : tout en commerçant et échangeant des idées, ils apprenaient les uns des autres, s’empruntaient les uns aux autres, en suscitant davantage de progrès en philosophie, dans les sciences, les langues et les religions. Le progrès était essentiel, l’un des dirigeants du royaume de Zhao dans le Nord-Est de la Chine ne le savait que trop, à l’une des extrémités de l’Asie il y a plus de 2 000 ans. « Avoir le talent de suivre les modes d’hier, déclare le roi Wu-ling en 307 avant notre ère, ne suffit pas à améliorer le monde d’aujourd’hui. »13 Les dirigeants du passé comprenaient combien il importe de ne pas se laisser distancer.
La cape du progrès allait toutefois se déplacer au début des temps modernes, par suite de deux grandes expéditions maritimes qui intervinrent à la fin du XVe siècle. Il suffit de six ans, dans les années 1490, pour jeter les fondations d’une perturbation majeure des systèmes d’échange établis depuis longtemps. D’abord, Christophe Colomb traversa l’Atlantique, ouvrant la voie à la connexion de deux grandes masses terrestres jusqu’alors inexplorées avec l’Europe et au-delà ; puis, à peine quelques années plus tard, Vasco de Gama réussit à contourner l’Afrique et gagner l’Inde, traçant ainsi de nouveaux itinéraires. Ces découvertes changèrent les schémas d’interaction et de commerce en opérant un déplacement remarquable du centre de gravité politique comme économique du monde. Soudain, l’Europe occidentale cessait d’être une région écartée pour se trouver au centre d’un système croissant de communication, de transport et d’échanges commerciaux : d’un seul coup, elle devenait le nouvel intermédiaire entre Orient et Occident.
L’essor de l’Europe enclencha une féroce bataille de pouvoir – et pour le contrôle du passé. En même temps que les rivaux s’affrontaient, l’histoire était remodelée pour mettre en relief les événements, les thèmes et les idées utilisables dans les affrontements idéologiques parallèles à la lutte pour les ressources et la maîtrise des mers. On sculpta des bustes de grands politiciens et généraux revêtus de toges pour leur donner l’air de héros romains du passé ; on édifia de magnifiques bâtisses neuves dans le grand style classique en s’appropriant les gloires du monde antique comme si l’on en descendait directement. On tordit et l’on manipula l’histoire pour créer un récit péremptoire où l’essor de l’Occident n’était pas seulement naturel et inévitable, mais la suite logique de ce qui avait précédé.
Bien des légendes m’ont incité à porter un regard différent sur le passé du monde. Mais l’une d’elles s’en distinguait. Selon la mythologie grecque, Zeus, le père des dieux, lâche deux aigles, chacun à l’une des extrémités de la terre, en leur ordonnant de voler l’un vers l’autre. Une pierre sacrée, l’omphalos – le nombril du monde – est déposée à l’endroit de leur réunion pour permettre la communication avec le divin. J’ai appris plus tard que le concept de cette pierre fascine depuis longtemps les philosophes et les psychanalystes.14
Je me rappelle avoir scruté ma carte en entendant ce conte pour la première fois, en me demandant où se seraient rencontrés les aigles. Je les imaginais s’envolant du rivage ouest de l’Atlantique et du littoral chinois sur le Pacifique pour aller vers l’intérieur des terres. La position précise changeait, selon l’endroit où je posais les doigts pour commencer à mesurer des distances égales depuis l’est et l’ouest. Mais je tombais toujours quelque part entre la mer Noire et l’Himalaya. Je restais éveillé la nuit, à repenser à la carte du mur de ma chambre, aux aigles de Zeus et à l’histoire d’une région jamais mentionnée dans les livres que je lisais – et qui n’avait pas de nom.
Il y a peu, les Européens divisaient l’Asie en trois grandes zones – le Proche, le Moyen et l’Extrême-Orient. Pourtant, en grandissant, chaque fois que j’entendais parler des problèmes actuels ou lisais quelque chose à leur sujet, il semblait que la deuxième, le Moyen-Orient, avait changé de sens, et même de situation, pour en venir à désigner Israël, la Palestine et la région environnante, et parfois le golfe Persique. Et je ne comprenais pas pourquoi l’on me serinait l’importance de la Méditerranée comme berceau de la civilisation, quand il paraissait tout à fait évident qu’elle n’en était pas vraiment originaire. Le vrai creuset, la Méditerranée au sens propre – le centre du monde – n’était pas une mer séparant l’Europe et l’Afrique du Nord, mais il se trouvait en plein cœur de l’Asie.
Je forme ici l’espoir de pouvoir inciter le lecteur à étudier hardiment des peuples et des lieux qui ont été ignorés par les savants durant des générations, en formulant de nouvelles questions et en ouvrant de nouveaux domaines de recherches. J’espère susciter de nouvelles interrogations sur le passé, la remise en cause et l’examen des truismes. Surtout, j’espère inspirer au lecteur de ce livre un nouveau point de vue sur l’histoire.
Worcester College, Oxford, avril 2015
Chapitre 1
La Création de la Route de la Soie
Depuis l’origine des temps, le centre de l’Asie fut le lieu de création des empires. Les plaines alluviales de Mésopotamie, alimentées par le Tigre et l’Euphrate, ont fourni la base de la civilisation elle-même – car c’est dans cette région que se sont formées les premières villes et cités. L’agriculture systématique s’est développée en Mésopotamie et dans tout le « Croissant fertile », bande de terre très productive aux riches ressources en eau, qui s’étend du golfe Persique au littoral de la Méditerranée. C’est là aussi que certaines des premières lois connues ont été publiées il y a près de 4 000 ans par Hammourabi, roi de Babylone, qui y détaille les devoirs de ses sujets et édicte de féroces châtiments en cas de transgression.1
De tous les royaumes et empires nés dans ce berceau, le plus grand fut celui des Perses. Ils l’étendirent rapidement au VIe siècle, à partir du sud de l’Iran actuel, et finirent par dominer leurs voisins, jusqu’aux rivages de l’Égée. Ils conquirent l’Égypte et s’étendirent vers l’est jusqu’à l’Himalaya. S’il faut en croire l’historien grec Hérodote, ils devaient beaucoup de leur succès à leur ouverture d’esprit. « Les Perses sont très enclins à adopter les coutumes étrangères », écrit-il : ils étaient prêts à abandonner leur propre vêtement quand ceux de l’ennemi vaincu leur paraissaient supérieurs, ce qui les incita à copier les Mèdes comme les Égyptiens.2
Cette disposition à adopter de nouvelles pratiques ou idées fut un facteur décisif permettant aux Perses d’édifier un système administratif qui facilita la bonne marche d’un empire constitué de maints peuples différents. Une bureaucratie très qualifiée gérait efficacement le quotidien de l’État, enregistrait tout, depuis les paiements versés aux ouvriers de la maison royale jusqu’aux autorisations en quantité et qualité des denrées achetées et vendues sur les marchés ; elle se chargeait aussi de l’entretien du réseau routier maillant l’empire, lequel faisait l’envie du monde antique.3
Ces routes reliant le littoral de l’Asie Mineure à Babylone, Suse et Persépolis permettaient de parcourir plus de 2 500 kilomètres en une semaine, exploit merveilleux pour Hérodote qui note que ni la neige, ni la pluie, la chaleur ou l’obscurité ne pouvaient ralentir la rapide transmission des messages.4 L’investissement agricole, le développement de techniques d’irrigation inédites pour améliorer les rendements favorisaient l’essor des villes en permettant l’alimentation des populations proches, toujours plus nombreuses – non seulement dans les riches terres agricoles de part et d’autre du Tigre et de l’Euphrate, mais aussi dans les vallées arrosées par les puissants Oxus et Iaxartès (l’Amou-Darya et le Syr-Darya actuels), ainsi que dans le delta du Nil, après sa conquête par les armées perses en 525 avant notre ère. L’empire perse était un pays de cocagne reliant la Méditerranée au cœur de l’Asie.
Il incarnait un phare de stabilité et de beauté, comme l’illustre l’inscription trilingue taillée dans la falaise de Behistun. Rédigée en perse, en élamite et en akkadien, elle rapporte comment Darius le Grand, l’un des plus célèbres rois, réprima révoltes et rébellions, repoussa les invasions, sans faire de tort ni aux pauvres ni aux puissants. Garde le pays sûr, ordonne l’inscription, veille justement sur le peuple car la justice est la fondation du royaume.5 La tolérance des minorités pratiquée par les Perses était légendaire : l’un de leurs rois n’était-il pas qualifié de « Messie », de béni par « Dieu, roi du Ciel » par suite de sa politique, dont notamment la libération des juifs de leur exil babylonien ?6
Le commerce florissant de l’ancienne Perse assurait aux rois les revenus leur permettant de financer leurs expéditions militaires contre des cibles qui venaient encore accroître les ressources de l’empire. Le commerce satisfaisait aussi leurs goûts notoirement extravagants. Des bâtiments spectaculaires furent érigés dans les immenses cités de Babylone, Persépolis, Pasargade et Suse, où le roi Darius édifia un magnifique palais en utilisant la meilleure qualité d’ébène et d’argent égyptiens, du cèdre du Liban, de l’or fin de Bactriane, du lapis-lazuli et du cinabre de Sogdiane, de la turquoise de Khwarezm et de l’ivoire de l’Inde.7 Les Perses étaient renommés pour leur goût du plaisir : selon Hérodote, il leur suffisait d’entendre parler d’une nouvelle volupté pour la désirer.8
Ce marché commun était sous-tendu par un pouvoir militaire agressif qui permettait tout à la fois d’étendre et de protéger les frontières. La Perse était confrontée à des menaces endémiques au nord, monde dominé par les nomades qui vivaient de leurs bêtes sur des pâturages semi-arides, les steppes, s’étendant depuis la mer Noire jusqu’en Mongolie, via l’Asie centrale. Ils étaient connus pour leur férocité – on disait qu’ils buvaient le sang de leurs ennemis et se taillaient des habits dans leurs crânes, parfois qu’ils mangeaient la chair de leurs propres pères. Il fallait toutefois entretenir des rapports complexes avec eux, quelle que fût leur réputation brouillonne et imprévisible, car c’étaient d’importants fournisseurs d’animaux, en particulier d’excellents chevaux. Ils pouvaient provoquer des désastres, comme le jour où Cyrus le Grand, l’architecte de l’empire perse au VIe siècle, périt en tâchant de soumettre les Scythes : on fit circuler sa tête dans une outre pleine de sang, nous rapporte un auteur, afin que la soif de pouvoir qui l’avait inspiré fût enfin assouvie.9
Il s’agissait toutefois d’un rare revers qui n’arrêta pas l’expansion des Perses. Les capitaines grecs envisageaient l’Orient avec un mélange de peur et de respect ; ils cherchaient à profiter des tactiques de combat perses comme à emprunter leur technologie. Plusieurs auteurs grecs, tel Eschyle, ont commémoré dans leurs tragédies et la littérature les succès remportés sur les Perses, la résistance héroïque des Grecs aux tentatives d’invasion, pour célébrer leur prouesse militaire et démontrer la faveur des dieux.10
« Je suis venu en Grèce » dit Dionysos dans les premiers vers des Bacchantes, depuis l’Orient « aux rues pavées d’or », un lieu où les plaines de Perse sont gorgées de soleil, où les villes de Bactriane sont ceintes de murailles protectrices, où des tours magnifiquement construites surveillent les régions littorales. L’Asie et l’Orient étaient les contrées qu’avait fait danser Dionysos, au son des mystères divins, bien avant celles des Grecs.11
Nul n’avait mieux étudié ces ouvrages qu’Alexandre de Macédoine. Quand le jeune général monta sur le trône en 336 après l’assassinat de son père, le brillant Philippe, on ne pouvait douter de la direction où le porterait sa quête de gloire. Il ne songea pas un instant à l’Europe qui n’avait rien à offrir : pas de villes, pas de culture, nul prestige, nulle récompense. Pour Alexandre comme pour tous les Grecs de l’Antiquité, la culture, les idées et les occasions à saisir – comme les menaces – venaient de l’est. Rien d’étonnant à ce que son regard se porte sur la plus grande puissance du temps, la Perse.
Après avoir chassé les gouverneurs perses de l’Égypte par une attaque éclair en 331, Alexandre lança un assaut massif sur le cœur de l’empire. La confrontation décisive eut lieu plus tard cette même année sur les plaines poudreuses de Gaugamèle, près de l’actuelle Erbil, dans le Kurdistan irakien. Il infligea une défaite spectaculaire à l’armée incomparablement plus nombreuse de Darius III, peut-être parce qu’il était parfaitement dispos après une bonne nuit de sommeil : d’après Plutarque, Alexandre insistait pour se reposer avant d’affronter l’ennemi, en dormant si profondément que ses capitaines inquiets devaient le secouer pour le réveiller. Vêtu de sa tenue préférée, il coiffa un beau casque, si brillant « qu’il étincelait comme l’argent le plus fin », se saisit d’une fidèle épée dans la main droite et mena ses troupes à la victoire écrasante, qui leur ouvrit les portes d’un empire.12
Instruit par Aristote, Alexandre avait grandi en sentant d’immenses espoirs peser sur ses épaules. Il ne trompa pas les attentes. Après avoir pulvérisé les armées perses à Gaugamèle, il avança vers l’est. L’une après l’autre, les villes se rendaient et le conquérant s’emparait des territoires contrôlés par les vaincus. Des sites d’une taille, d’une richesse et d’une beauté légendaires tombaient devant le jeune héros. Babylone se rendit ; ses habitants jonchèrent la route d’accès de fleurs et de guirlandes et l’entourèrent d’autels ployant sous l’encens et les parfums. On lui amena en cadeaux des lions et des léopards en cage.13 Alexandre et ses hommes se furent bientôt emparés de tous les jalons de la route royale reliant les principales villes de Perse, comme du réseau assurant la communication entre le rivage d’Asie Mineure et l’Asie centrale.
Bien que certains érudits récents l’aient qualifié « d’ivrogne et de délinquant juvénile », Alexandre semble avoir montré une sensibilité étonnante dans son traitement des territoires et des peuples nouvellement conquis.14 Il était souvent très souple s’agissant des croyances et pratiques religieuses locales, plein de tolérance et même de respect ; ainsi, on nous rapporte qu’il fut choqué par la profanation de la tombe de Cyrus le Grand : non seulement il la restaura, mais il fit châtier ceux qui avaient vandalisé le sanctuaire.15 Il veilla à ce que Darius III, assassiné par l’un de ses propres officiers, reçût des funérailles conformes à son rang et fût inhumé à côté des autres princes perses après qu’on eut retrouvé son cadavre abandonné dans un chariot.16
Si Alexandre fut capable d’amasser toujours plus de territoires sous son égide, ce fut aussi parce qu’il était prêt à s’en remettre aux élites locales. « Si nous voulons, non seulement traverser l’Asie, mais la conserver, » aurait-il dit, « nous devons nous montrer clément avec ces gens ; la stabilité et la durée de notre empire dépendront de leur loyauté. »17 Les fonctionnaires locaux et les anciennes élites furent laissées en place pour administrer les villes et les territoires nouvellement conquis. Alexandre lui-même se mit à adopter des titres et des mises perses traditionnels pour souligner son acceptation des coutumes locales. Il se dépeignait volontiers, non comme un conquérant et un envahisseur, mais comme le dernier rejeton d’un antique royaume – en dépit des hurlements moqueurs de ceux qui disaient à qui voulait l’entendre qu’il n’avait apporté que malheur et imbibé la terre de sang.18
Il faut se souvenir que la plupart de nos informations sur les campagnes, les succès et la politique d’Alexandre nous viennent d’historiens postérieurs, dont les relations des exploits du jeune général sont souvent très idéalisées ou pétries d’enthousiasme.19 Malgré tout, bien qu’il faille examiner prudemment la manière dont les sources nous exposent la chute de la Perse, l’allure à laquelle le conquérant ne cessa de repousser sa frontière à l’est constitue un indice à elle seule. Ce fut un énergique fondateur de villes, qui lui durent souvent leur nom mais qui en portent aujourd’hui un autre, dont Hérat (Alexandrie en Arie), Kandahar (Alexandrie en Arachosie) et Bagram (Alexandrie du Caucase). La construction de ces relais – et la consolidation de ceux se situant plus au nord, vers la vallée de Ferghana – constellait de nouvelles pointes l’échine de l’Asie.
Les nouvelles villes aux puissantes défenses, tout comme les places fortes et les forts isolés étaient d’abord édifiés pour se défendre des menaces constituées par les tribus des steppes, si enclines à lancer des attaques dévastatrices sur les communautés rurales. Le programme de fortification d’Alexandre visait à protéger les contrées récemment conquises. Plus loin à l’est, au même moment exactement, des inquiétudes similaires suscitaient les mêmes réactions. Les Chinois avaient déjà forgé le concept de huaxia, c’est-à-dire celui du monde civilisé, face aux défis des peuples de la steppe. Un plan intensif de construction étendit un réseau de fortifications qui devait prendre le nom de Grande Muraille de Chine ; il était inspiré par le même principe qu’Alexandre. L’expansion sans une défense était inutile.20
Au IVe siècle avant notre ère, Alexandre continuait à batailler sans relâche, tournait bride dans l’Hindou Kouch, marchait vers l’Indus dont il descendait la vallée, tout en créant de nouvelles places fortes dotées de garnisons – bien qu’il se heurte désormais aux protestations régulières de ses hommes las et pleins de nostalgie. Au moment de sa mort, à l’âge de 32 ans, en 323 à Babylone, dans des circonstances qui restent mystérieuses, ses succès militaires ne pouvaient qu’être jugés prodigieux.21 La rapidité et l’étendue de ses conquêtes donnent le vertige. Ce qui n’est pas moins impressionnant – quoique bien plus souvent passé sous silence – c’est l’ampleur de son héritage et la manière dont les influences helléniques se sont mêlées à celles de la Perse, de l’Inde, de l’Asie centrale et finalement de la Chine aussi. Bien que la mort soudaine d’Alexandre soit suivie d’une période de turbulence et de guerres intestines entre ses principaux capitaines, un chef émergea bientôt dans la partie orientale des nouveaux territoires : un officier né en Macédoine septentrionale, du nom de Séleucos, qui avait pris part aux plus grandes expéditions du roi. À peine quelques années après la mort de ce dernier, il était gouverneur de territoires s’étendant du Tigre jusqu’à l’Indus ; ils étaient si vastes qu’ils évoquaient davantage un empire qu’une partie de celui-ci. Il fonda une dynastie, celle des Séleucides, qui devait régner durant près de trois siècles.22 On tient souvent volontiers les victoires d’Alexandre pour une brillante série de gains éphémères et beaucoup jugent son legs de courte durée. Or il ne s’agissait pas là de réussites transitoires : elles marquaient l’orée d’un nouveau chapitre pour la région située entre Méditerranée et Himalaya.
Les décennies qui suivirent la mort d’Alexandre connurent un programme méthodique et déterminé d’hellénisation, à mesure que les idées, les thèmes et les symboles de la Grèce antique étaient introduits en Orient. Les descendants de ses généraux se rappelaient leurs racines grecques et les mettaient en exergue, par exemple sur les monnaies frappées dans les grandes villes stratégiquement situées sur les routes commerciales ou dans les centres d’une grande importance agricole. La forme de ces pièces se standardisa ; le portrait du souverain régnant sur l’avers, dont les mèches étaient retenues par un diadème, la tête toujours tournée sur la droite comme l’avait fait Alexandre ; une image d’Apollon au revers, identifié par des lettres grecques.23
Le grec était parlé et lu dans toute l’Asie centrale et la vallée de l’Indus. À Aï-Khanoum, au nord de l’Afghanistan, ville neuve fondée par Séleucos, on avait gravé des maximes delphiques, dont celles-ci :
Étant enfant, deviens bien élevé.
Jeune homme, maître de toi-même.
Au milieu de la vie, juste.
Vieillard, de bon conseil.
À ta mort, sans chagrin.24
Le grec était utilisé chaque jour par les fonctionnaires plus d’un siècle après la mort d’Alexandre, comme le prouvent les reçus d’impôts et des documents relatifs à la solde des soldats de Bactriane datant de 200 environ avant Jésus-Christ.25 De fait, cette langue pénétra profondément dans le sous-continent indien. Certains des édits publiés par l’empereur maurya, Asoka, le plus grand des premiers princes indiens, comportent une traduction grecque juxtalinéaire, évidemment dans l’intérêt de la population locale.26
L’énergie des échanges culturels, lors de cette collision entre l’Europe et l’Asie, est stupéfiante. Les statues du Bouddha ne commencent d’apparaître qu’après l’installation du culte d’Apollon dans la vallée de Gundhara et l’Inde occidentale. Les bouddhistes, se sentant menacés par le succès des nouvelles pratiques religieuses, décidèrent de créer leurs propres représentations. En effet, il existe non seulement un rapport chronologique, mais aussi figuratif dans les premières statues du Bouddha : il semble qu’elles aient emprunté leurs proportions à Apollon, si grand était l’impact des influences grecques. Jusqu’alors, les bouddhistes s’étaient volontairement abstenus de toute représentation ; la rivalité les obligeait désormais à réagir, emprunter et innover.27
Certains autels, ornés d’inscriptions grecques, d’images d’Apollon et d’exquises miniatures en ivoire représentant Alexandre, dans le Tadjikistan actuel, nous révèlent la grande pénétration des influences venues de l’ouest.28 Il en allait de même du sentiment d’une supériorité culturelle importée par les Méditerranéens. Ainsi, on attribuait généralement un grand savoir scientifique aux Grecs d’Asie. « Ce sont des barbares, nous dit l’hymne intitulée Gargi Samhita, mais la science astronomique est née chez eux, raison pour laquelle ils doivent être honorés comme des dieux. »29
Selon Plutarque, Alexandre aurait veillé à faire enseigner la théologie grecque jusqu’en Inde. Il en résulte que les dieux de l’Olympe furent révérés dans toute l’Asie. Les jeunes gens, en Perse et ailleurs, étaient élevés en lisant Homère, en « déclamant les tragédies de Sophocle et d’Euripide », et le grec était enseigné dans la vallée de l’Indus.30 Cela pourrait expliquer certains emprunts dans telle ou telle grande œuvre littéraire. On a suggéré, par exemple, que le Mahabharata, cette grande épopée sanskrite des premiers temps, s’est inspirée de l’Iliade et de l’Odyssée, s’agissant du thème de l’enlèvement de la princesse Sita par Ravana, écho direct du rapt d’Hélène de Sparte par le Troyen Pâris. Les influences et l’inspiration s’exercèrent aussi dans l’autre sens : certains érudits tiennent que l’Énéide emprunte à des textes indiens.31 Idées, thèmes et histoires parcouraient les grand-routes, propagés par les voyageurs, les marchands et les pèlerins : les conquêtes d’Alexandre avaient ouvert la voie à l’élargissement des points de vue chez les peuples envahis, ainsi que chez ceux des contrées limitrophes, voire au-delà, lorsqu’ils se frottaient à de nouvelles idées, de nouvelles images et nouveaux concepts.
Les cultures des sauvages steppes elles-mêmes furent influencées, comme le démontrent les objets funéraires exquis enterrés avec les personnages de haut rang dans les tombeaux de Tillia Tepe au nord de l’Afghanistan : ils révèlent les influences artistiques de la Grèce, tout comme celles de la Sibérie, de l’Inde et au-delà. Dans le monde des nomades, les objets de luxe s’échangeaient contre du bétail et des chevaux, ou en guise de tribut pour rétablir la paix.32
Le rattachement des steppes à un monde interdépendant et interconnecté fut hâté par les ambitions croissantes de la Chine. Sous les Han (206 av.-220 après J.-C.), des vagues d’expansion repoussèrent les frontières encore plus loin, pour finir par atteindre une province qu’on appela Xiyu (ou « régions de l’ouest »), le Xinjiang d’aujourd’hui (« nouvelle marche »). Elle se trouvait au-delà du corridor du Gansu, une route longue de 1 000 kilomètres reliant l’intérieur de la Chine à l’oasis de Dunhuang, carrefour à la lisière du désert du Taklamakan. Là, on pouvait opter pour l’itinéraire du nord ou du sud, tous deux parfois dangereux, qui convergeaient vers Kachgar, elle-même située à la jonction de l’Himalaya, du Pamir, du Tien Shan et de l’Hindou Kouch.33
L’expansion des horizons de la Chine entraîna une cohésion de l’Asie. Ces réseaux avaient jusqu’ici été bloqués par les Yuezhi et surtout les Xiongnu, tribus nomades qui, comme les Scythes d’Asie centrale, étaient un sujet d’inquiétude constante tout en étant d’importants partenaires commerciaux pour le bétail : les auteurs Han du IIe siècle avant notre ère nous apprennent que des dizaines de milliers de têtes furent achetées aux peuples des steppes.34 Mais c’étaient les besoins en chevaux des Chinois qui étaient quasi insatiables, alimentés par la nécessité de garder sur pied une force militaire efficace pour maintenir l’ordre intérieur et répondre aux attaques et razzias des Xiongnu ou d’autres tribus. Les bêtes de l’ouest du Xinjiang, fort appréciées, pouvaient faire la fortune des chefs tribaux. On mentionne un chef Yuezhi qui négocia des chevaux contre une vaste quantité de denrées qu’il revendit ensuite à d’autres, en décuplant son investissement.35
Les montures les plus renommées et précieuses étaient élevées dans la vallée de Ferghana, de l’autre côté de la chaîne spectaculaire du Pamir qui chevauche l’actuel Tadjikistan et le Nord-Est de l’Afghanistan. Très prisées pour leur force, elles sont censées avoir été enfantées par des dragons selon les auteurs chinois ; ils leur attribuent une sudation sanglante (hanxue ma) ; de fait, leur transpiration de toute évidence rouge était due à un parasite local ou à la peau inhabituellement fine de ces chevaux, dont les vaisseaux étaient susceptibles d’éclater pendant l’effort. Certains spécimens particulièrement beaux devinrent des célébrités à part entière, auxquels on dédia des poèmes, des sculptures et des tableaux ; on les désignait souvent sous le vocable de tianma, « chevaux célestes ».36 Certains étaient même emmenés dans l’au-delà avec leur maître : un empereur fut inhumé en compagnie de quatre-vingts de ses destriers favoris – le tombeau était gardé par les statues de deux étalons et un guerrier de terre cuite.37
Les relations avec les Xiongnu, lesquels régnaient sur les steppes de Mongolie et les pâturages du Nord de la Chine, n’étaient pas toujours sans nuages. Les historiens ont qualifié la tribu de barbare, prête à manger de la viande crue et à boire du sang ; en vérité, affirme l’un d’eux, il s’agit d’un peuple « qui a été abandonné par le ciel. »38 Les Chinois préféraient verser un tribut plutôt que risquer des raids sur leurs villes. Des émissaires étaient régulièrement envoyés aux nomades (lesquels étaient encouragés dès la petite enfance à chasser les rats, les oiseaux, puis les renards et les lièvres) et l’empereur s’enquérait poliment de la santé de leur chef suprême.39 Un système formel de tributs s’instaura grâce auquel les nomades recevaient des denrées de luxe, dont du riz, du vin, des tissus, contre la paix. À leurs yeux, l’article le plus important était la soie : ils la chérissaient pour sa texture et sa légèreté, à l’usage de doublage pour les vêtements et le couchage. Elle symbolisait en outre le pouvoir politique et social : c’est en s’enveloppant dans une volumineuse quantité de soie précieuse que le chanyu (le chef suprême des tribus) soulignait son propre statut et récompensait ceux qui l’entouraient.40
Les fonds versés contre cette paix étaient considérables. En l’an 1 avant notre ère, par exemple, les Xiongnu reçurent 30 000 balles de soie et autant de soie grège, ainsi que 370 vêtements.41 Certains fonctionnaires aimaient à croire que l’amour du luxe affiché par la tribu en causerait la perte. « Aujourd’hui, (vous avez) ce faible pour les objets chinois » lança un émissaire audacieux à un chef tribal. Les coutumes des Xiongnu changeaient, dit-il. Il prédit avec assurance que la Chine « finirait par réussir à triompher de toute la nation des Xiongnu. »42
C’était là un vœu pieux. En fait, la diplomatie qui entretenait la paix et les bonnes relations avait des conséquences aussi bien financières que politiques : verser un tribut était ruineux et la marque de l’infériorité. À la fin, les maîtres Han de la Chine se décidèrent à régler leur compte aux Xiongnu pour de bon. On s’efforça d’abord de prendre le contrôle méthodique des riches régions agricoles de Xiyu, à l’ouest ; les nomades durent refluer tandis que les Chinois s’emparaient du corridor du Gansu au cours d’une série de campagnes qui s’échelonnèrent sur dix ans pour s’achever en 119 avant l’ère chrétienne. À l’ouest se dressaient les montagnes du Pamir et au-delà un nouveau monde. La Chine avait ouvert une porte menant à un réseau transcontinental ; ce moment marque la naissance des Routes de la Soie.
L’expansion de la Chine vit croître l’intérêt pour ce qui se trouvait derrière l’horizon. On ordonna à des fonctionnaires d’enquêter et d’écrire des rapports sur les régions d’outre-mont. L’un de ces rapports subsiste sous le titre Shi Ji (« Rapports historiques ») dû au fils du Grand Historiographe (Taishi) de la cour impériale, Sima Qian, qui continua de travailler à sa relation en dépit de la disgrâce et de la castration l’ayant frappé pour avoir osé défendre un jeune général intrépide qui avait mené ses troupes à la défaite.43 Il expose avec soin ce qu’il a pu découvrir des histoires, des économies et des armées des peuples de la vallée de l’Indus, de la Perse et de l’Asie centrale. Les royaumes de l’Asie centrale sont faibles, note-t-il, à cause de la pression exercée par les nomades refoulés par les forces chinoises. Leur centre d’intérêt s’est déplacé. Les habitants de ces royaumes sont « peu habiles aux armes, écrit-il, mais de bons commerçants », aux marchés florissants dans la capitale Bactres, « où l’on achète et vend toutes sortes de biens. »44
Le commerce entre la Chine et le monde au-delà se développait lentement. Parcourir les itinéraires longeant le désert de Gobi n’était pas facile, en particulier après la Porte de Jade, le poste-frontière que franchissaient les caravanes sur la route de l’ouest. Aller d’une oasis à l’autre sur un terrain périlleux s’accomplissait difficilement, qu’on traverse le désert du Taklamakan ou les défilés du Tien Shan ou encore le Pamir. Il fallait affronter des extrêmes de température, d’où notamment la grande valeur du chameau de Bactriane. Assez résistant pour braver les conditions du désert, cet animal a la prescience des tempêtes de sable mortelles, observe un auteur ; tous les chameaux se mettent « aussitôt à blatérer ensemble » – signal invitant les marchands et les chefs de caravanes « à se couvrir le nez et la bouche et à les emmitoufler de feutre ». Mais l’animal était à l’évidence une girouette faillible : des sources évoquent des routes jonchées de cadavres et de carcasses de chameaux en grand nombre.45 Dans un contexte aussi éprouvant, il fallait que les récompenses justifiassent les risques pris. Bien qu’on trouve à vendre du bambou et des toiles du Sichuan à des milliers de kilomètres de là sur les marchés de Bactriane, c’était d’abord les marchandises rares et de grande valeur qu’on transportait sur de longues distances.46
La première était la soie. Elle jouait plusieurs fonctions importantes dans le monde antique, outre sa valeur pour les tribus nomades. Sous la dynastie des Han, on s’en servait, parallèlement au numéraire et aux céréales, pour payer les soldats. C’était en un sens la monnaie d’échange la plus fiable : on n’arrivait pas à battre suffisamment de numéraire qui, d’ailleurs, ne se diffusait pas dans toute la Chine ; la difficulté était redoublée quand il fallait payer des soldes puisque les théâtres d’opération étaient souvent écartés, dans des régions où l’argent était quasi inutile. Quant aux grains de céréales, ils finissaient par pourrir. Du coup, les balles de soie grège servaient régulièrement de monnaie d’échange, pour payer ou, comme dans tel monastère bouddhiste d’Asie centrale, pour mettre à l’amende les moines ayant enfreint les règles de leur fondation.47 La soie devint une monnaie internationale aussi bien qu’un produit de luxe.
Le contrôle du commerce par les Chinois s’attacha également à encadrer les transactions des négociants venus de territoires étrangers. Une collection remarquable de 35 000 textes de la ville de garnison de Xuanquan, non loin de Dunhuang, nous donne une image saisissante des allées et venues quotidiennes dans cette ville sise à l’entrée du corridor du Gansu. Grâce à eux, rédigés sur des tablettes de bambou et de bois, nous apprenons que les visiteurs entrant en Chine devaient s’en tenir à des itinéraires fixes, qu’ils recevaient des laissez-passer écrits et que des fonctionnaires les comptaient régulièrement pour s’assurer que tous ceux qui avaient pénétré dans le pays finissaient par rentrer chez eux. Comme sur un registre moderne d’hôtel, on prenait des notes sur chaque visiteur – que dépensait-il pour se nourrir ?, d’où venait-il ?, quelle était sa fonction et où allait-il ?48
Il faut voir dans ces mesures, non une surveillance soupçonneuse, mais plutôt le moyen de savoir précisément qui entrait dans le pays et le quittait, et surtout celui d’enregistrer la valeur des denrées vendues et achetées dans l’optique des frais de douane. La complexité des techniques et leur mise en œuvre précoce illustrent comment les cours impériales de la capitale, Chang’an (l’actuelle Xian) et celle de Luoyang à partir du Ier siècle après J.-C., abordaient un monde qui semblait rapetisser sous leurs yeux.49 Nous tenons la mondialisation pour un phénomène tout à fait récent. Or, il y a 2 000 ans aussi, c’était une donnée de la vie, un mixte d’occasions à saisir, de problèmes, d’incitation aux progrès technologiques.
De fait, les évolutions se produisant à des milliers de kilomètres contribuèrent à stimuler la demande d’articles de luxe comme l’aptitude à les payer. En Perse, la parentèle de Séleucos fut déposée vers 247 par un certain Arsace, un homme dont l’origine est obscure. Ses descendants, les Arsacides, renforcèrent leur mainmise sur le pouvoir puis entreprirent de l’étendre, en récrivant habilement l’histoire pour conjuguer les idées grecques et perses en un tout de plus en plus cohérent et vigoureux, une nouvelle identité. Il en résulta une époque de stabilité et de prospérité.50
Mais c’est ce qui se passait en Méditerranée qui fournit la plus grande impulsion. Une petite ville située à un endroit peu prometteur, à mi-hauteur du rivage occidental de l’Italie, avait peu à peu réussi à se transformer de trou de province en puissance régionale. S’emparant des cités-États côtières l’une après l’autre, Rome en vint à dominer la Méditerranée occidentale. Au milieu du Ier siècle avant J.-C., ses ambitions avaient pris une immense importance. Son attention se tournait tout entière vers l’Orient.
Rome s’était muée en un État intensément compétitif, l’un de ceux qui exaltaient la puissance militaire et acclamaient la violence et le meurtre. Les jeux du cirque formaient la base du divertissement populaire : on y célébrait brutalement la domination sur les peuples étrangers et la nature. Des arcs de triomphe étaient autant de rappels, dans toute la ville, des victoires militaires pour la population grouillante. On cultivait avec soin le militarisme, l’intrépidité et l’amour de la gloire, caractéristiques primordiales d’une cité ambitieuse dont l’allonge ne cessait de s’étendre.51
La colonne vertébrale du pouvoir romain, c’était son armée, affûtée et entraînée selon d’inflexibles critères. On attendait des soldats qu’ils puissent parcourir plus de 35 kilomètres en cinq heures, tout en portant au moins 50 livres d’équipement. Leur mariage n’était pas seulement désapprouvé mais ouvertement interdit afin que des liens étroits se nouent entre les recrues. Ces corps de jeunes gens très entraînés, en pleine forme, ardents, qu’on avait élevés dans la confiance de leurs aptitudes et l’assurance de leur destin, formaient le roc sur lequel Rome était bâtie.52
La conquête de la Gaule (environ la France actuelle plus les Pays-Bas et une partie de l’Allemagne occidentale), en 52 avant notre ère, rapporta de substantielles dépouilles, assez pour provoquer une variation du prix de l’or dans l’empire romain.53 Mais il n’y avait qu’un petit nombre d’endroits de ce type à envahir en Europe – et peu d’entre eux paraissaient prometteurs. Ce qui assurait la grandeur des empires, c’était un nombre important de villes, productrices de revenus imposables ; ce qui les dotait d’une culture remarquable, c’était leurs artisans et leurs artistes qui expérimentaient de nouvelles pratiques quand de riches patrons se disputaient leurs services et les récompensaient pour leur savoir-faire. Il était peu probable que des régions comme la Grande-Bretagne fournissent des ajouts lucratifs aux territoires romains : comme en attestent des messages de soldats en garnison là-bas, griffonnés sur ardoise et renvoyés au pays, cette province était synonyme de lugubre et stérile relégation.54
Mais l’évolution impériale de Rome eut peu de rapport avec l’Europe ; elle n’a pas consisté à contrôler un continent dépourvu des ressources et des villes où prospéraient consommateurs et contribuables. Ce qui propulsa Rome dans une autre dimension, ce fut sa réorientation vers la Méditerranée orientale et au-delà. Son succès et sa gloire sont nés d’abord de la prise de l’Égypte, puis de son amarrage en Orient, en Asie.
Dirigée pendant près de trois siècles par les descendants de Ptolémée, l’un des gardes du corps d’Alexandre le Grand, l’Égypte avait bâti une fabuleuse richesse fondée sur le Nil, dont les crues produisaient de prodigieuses récoltes de céréales. Celles-ci, outre qu’elles alimentaient la population locale, fournissaient un bel excédent qui permit à Alexandrie, à l’embouchure du fleuve, de devenir la plus grande métropole du monde, comme le rapporte un contemporain qui estime sa population à quelque 300 000 habitants durant le Ier siècle avant notre ère.55 Les expéditions de céréales étaient soigneusement contrôlées : les capitaines devaient prêter serment au nom du roi à chaque chargement de galère, après quoi ils recevaient un reçu d’un délégué du scribe royal. Alors seulement le chargement des céréales pouvait commencer.56
Rome lorgnait depuis longtemps sur l’Égypte. Elle sauta sur sa chance quand la reine Cléopâtre se fut laissée entraîner dans un conflit intriqué pour gagner la suprématie politique après l’assassinat de Jules César. Après s’être malheureusement rangée du côté de Marc-Antoine lors de la bataille d’Actium en 31 avant notre ère, la dirigeante égyptienne se retrouva vite confrontée à l’armée romaine conduite par Octavien, doué d’une habileté politique hors pair, qui fondait sur Alexandrie. À la suite d’une série de décisions défensives mêlant grande négligence et incompétence caractérisée, Cléopâtre se suicida, soit par une morsure de serpent venimeux, soit qu’elle ingérât elle-même du poison. L’Égypte tomba comme un fruit mûr.57 Octavien, parti de Rome en général, la regagna en chef suprême, avec un nouveau titre qui lui serait bientôt décerné par un Sénat reconnaissant : Auguste. Rome était devenue un empire.
La prise de l’Égypte transformait les fortunes de Rome. À présent qu’elle contrôlait les vastes récoltes de la vallée du Nil, le prix des céréales s’effondra, ce qui donna un coup de fouet au pouvoir d’achat. Les taux d’intérêts dégringolèrent, passant de quelque 12 % à 4 % ; ce phénomène, à son tour, alimenta rapidement la hausse bien connue qui résulte de l’afflux d’un capital bon marché : les prix immobiliers augmentèrent.58 Le revenu disponible grandit si vite qu’Auguste put relever de 40 % le cens nécessaire pour entrer au Sénat.59 Comme l’empereur aimait à s’en vanter, il avait trouvé une Rome construite en briques, mais la laissait en marbre.60
Cette explosion de richesse résultait de l’appropriation brutale, par la puissance conquérante, des impôts collectés par l’Égypte comme de ses énormes ressources. Des équipes de percepteurs se répandirent partout pour imposer une nouvelle taxe par tête, payable par tous les hommes de 16 à 60 ans. Les exemptions étaient rares – elles concernaient par exemple les prêtres, qui devaient s’être fait enregistrer dans les registres des temples.61 Le processus s’inscrivait dans un système qu’on a pu qualifier d’« apartheid antique ». Il s’agissait d’augmenter au maximum le flux d’argent retournant à Rome.62
Ce processus de captation de revenus se répéta ailleurs, à mesure que les tentacules de l’expansion économique et militaire impériale s’étendaient davantage. Peu après l’annexion de l’Égypte, des assesseurs furent dépêchés en Judée pour faire un recensement, à nouveau pour veiller au calcul exact des impôts. Si l’on suppose que cette opération s’effectua sur le modèle utilisé en Égypte, qui imposait d’enregistrer toutes les naissances et les morts ainsi que les noms des hommes adultes, l’arrivée ici-bas de Jésus-Christ fut notée par un fonctionnaire qui se souciait moins de savoir qui étaient le nourrisson et ses parents que de ce que cette naissance représentait, en terme de main d’œuvre et de contribution futures supplémentaires, pour l’empire.63
Les yeux de Rome s’écarquillaient devant le monde rencontré en Orient. L’ Asie avait déjà acquis la réputation de s’y connaître en luxe indolent et qualité de vie. Elle était incroyablement riche, écrit Cicéron, ses récoltes légendaires, la variété de ses denrées incroyable, la taille de ses troupeaux et cheptels tout simplement stupéfiante. Ses exportations étaient colossales.64 Telle était la richesse de l’Asie que les Romains jugeaient que ses habitants pouvaient se permettre de s’y livrer au plaisir et à l’oisiveté. Rien d’étonnant si c’est en Orient que les soldats romains sont entrés dans l’âge adulte, selon Salluste : c’est là qu’ils apprirent à faire l’amour, à s’enivrer, à goûter les statues, les tableaux et l’art. Cela n’était guère positif, du moins aux yeux de l’historien. L’ Asie était peut-être « pleine de volupté et de charme », mais « ses plaisirs eurent tôt fait d’amollir l’énergie guerrière des soldats. »65 Vu sous ce jour, l’Est était l’antithèse de tout ce qu’incarnait l’austère et martiale Rome.
Auguste lui-même fit un effort méthodique pour comprendre ce qui se cachait au-delà des nouvelles frontières de l’Orient. Des corps expéditionnaires furent dépêchés vers le royaume d’Axoum dans l’Éthiopie actuelle comme vers le royaume sabéen du Yémen ; le golfe d’Aqaba fut exploré alors même que le pouvoir romain sur l’Égypte se mettait encore en place.66 Puis, en l’an 1 avant notre ère, Auguste ordonna de mener une exploration détaillée des deux rives du golfe Persique pour s’enquérir du commerce dans la région et voir comment les routes maritimes se rattachaient à la mer Rouge. Il supervisa également l’exploration des routes terrestres qui s’enfonçaient en Asie centrale via la Perse. C’est vers cette époque que fut publié un texte intitulé Stathmoi Parthikoi (« Étapes parthes ») ; il relevait les distances entre des sites majeurs à l’est, établissant soigneusement la position des lieux les plus importants depuis l’Euphrate jusqu’à Alexandropolis, la moderne Kandahar d’Afghanistan, en Orient.67
Les horizons des négociants s’élargissaient substantiellement. Selon le géographe Strabon, quelques années après le début de l’occupation de l’Égypte, 120 bateaux romains appareillaient chaque année pour l’Inde depuis le port de Myos Hormos en mer Rouge. Les échanges commerciaux avec l’Inde ne firent pas que grandir : ils explosèrent, comme nous le démontrent les vestiges archéologiques, d’une extraordinaire richesse, trouvés dans le sous-continent. On a exhumé des amphores romaines, des lampes, des miroirs et des statues de dieux dans un très large éventail de sites, dont Pattanam, Kolhapur et Coimbatore.68 Les monnaies datant des règnes d’Auguste et de ses successeurs sont si nombreuses sur le littoral occidental de l’Inde et les îles Laquedives, que certains historiens ont soutenu que les dirigeants du cru, en Orient, se servaient de pièces romaines d’or et d’argent pour leur propre monnaie ou qu’ils fondaient ces métaux pour les réutiliser.69
La littérature tamoule de la période rapporte une histoire analogue, en évoquant l’arrivée des marchands romains avec exaltation. Un poème cite « le vin frais et parfumé » débarqué de « bons bateaux » par les Romains. Un autre est enthousiaste : « Les beaux et grands navires… arrivent, en apportant de l’or, éclaboussant d’écume blanche les eaux de la Periyar (le fleuve) et s’en retournent chargés de poivre. Ici, la musique des vagues ne cesse jamais et le grand roi présente aux visiteurs les produits rares de la mer et de la montagne. »70 Une autre source encore décrit avec lyrisme les négociants européens installés en Inde : « Le soleil brillait sur les terrasses ouvertes, sur les entrepôts voisins du port, sur les tourelles dont les fenêtres ressemblaient à des yeux de daim. Dans divers lieux… l’attention du spectateur était attirée par la vue des demeures des (Occidentaux) dont la prospérité ne diminuait jamais. »71 Les Stathmoi Parthikoi nous apprennent quelles étaient les denrées attendues par les Romains en Inde occidentale ; ils précisent où les marchands pouvaient se procurer des métaux recherchés comme l’étain, le cuivre et le plomb, mais aussi la topaze, et où l’ivoire, les pierres précieuses et les épices étaient facilement disponibles.72
Le commerce avec les ports de l’Inde ne se limitait pas, cependant, aux produits originaires du sous-continent. Comme l’ont montré les fouilles du port de Berenike, sur la mer Rouge, en Égypte, un éventail de denrées venues d’aussi loin que le Viêt-Nam et Java parvenaient jusqu’en Méditerranée.73 Les ports de l’Inde, de part et d’autre, servaient de grands bazars pour les marchandises arrivant de tout l’Extrême-Orient et de l’Asie du Sud-Est ; ils les réexpédiaient vers l’Ouest.74 À quoi il fallait ajouter les denrées et produits de la mer Rouge, zone commerciale dynamique par elle-même, outre sa fonction de truchement entre la Méditerranée et l’océan Indien et au-delà.75
Les citoyens fortunés de Rome étaient désormais à même de satisfaire les goûts les plus exotiques et onéreux. Les observateurs de la bonne société se plaignaient de dépenses quasi obscènes et déploraient l’étalage à la mode des excès.76 Le Satyricon de Pétrone nous en dresse un tableau idéal. L’épisode le plus fameux n’en est-il pas le banquet de Trimalcion, esclave qui a pu se racheter et amasser une fortune ? La satire est acide par sa description des goûts des super-riches. Trimalcion ne veut que ce qui coûte le plus cher : du faisan apporté tout exprès de la rive orientale de la mer Noire ; de la pintade d’Afrique ; des poissons rares et ruineux ; du paon empanaché, et bien d’autres choses encore, présentées en surabondance. La mascarade grotesque consistant à présenter plat après plat – oiseaux vivants enfermés dans un cochon entier qui s’envolent quand on le met en perce, ou cure-dents en argent remis aux invités – est une parodie féroce de la vulgarité et des excès de la richesse neuve de la Ville. Ce boom, parmi les plus importants de l’Antiquité, a suscité l’une des grandes expressions littéraires d’amère critique à l’égard des nouveaux riches*.77
Cette nouvelle abondance mettait Rome et sa population en contact avec de nouveaux mondes et de nouvelles mœurs. Le poète Martial renvoie à l’internationalisme et au surcroît de connaissances de cette période dans une élégie sur une jeune esclave morte, quand il la compare à un lys intact, à de l’ivoire indien poli, à une perle de la mer Rouge, et qualifie ses cheveux de plus fins que la laine d’Espagne ou les mèches blondes du Rhin.78 Alors que les couples désireux d’avoir de beaux enfants faisaient naguère l’amour au milieu d’images érotiques, nous rapporte un auteur juif scandalisé, « ils amènent à présent des esclaves israélites qu’ils attachent au pied de leur lit » pour se stimuler et parce qu’ils peuvent se le permettre.79 Tous n’étaient pas impressionnés par les nouvelles habitudes : le Tibre a été submergé par les eaux de l’Oronte, le fleuve qui traverse la Syrie et la Turquie méridionale, déplorera plus tard le satiriste Juvénal – en d’autres termes, la décadence asiatique a détruit les vieilles vertus romaines ; « allez-y donc, dit-il, si vous plaisent les prostituées barbares aux mitres bariolées. »80
Aux yeux de certains conservateurs, un article en particulier mobilisait l’indignation : la soie de Chine.81