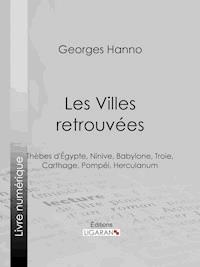Les Villes retrouvées: Thèbes d'Égypte, Ninive, Babylone, Troie, Carthage, Pompéi, Herculanum E-Book
Georges Hanno
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Les Villes retrouvées" de Georges Hanno nous plonge dans l'univers fascinant de l'archéologie en explorant sept cités mythiques de l'Antiquité : Thèbes d'Égypte, Ninive, Babylone, Troie, Carthage, Pompéi et Herculanum. Chaque chapitre de l'ouvrage est une invitation à voyager dans le temps, à travers les ruines et les vestiges de ces villes légendaires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Hanno s'appuie sur les découvertes archéologiques les plus récentes pour dresser un portrait vivant et détaillé de ces cités, évoquant leur grandeur passée et les mystères qui les entourent. Le livre s'adresse autant aux passionnés d'histoire qu'aux amateurs de récits captivants, offrant une perspective unique sur l'évolution des civilisations et des cultures anciennes. En mettant en lumière les dernières avancées scientifiques et technologiques utilisées dans les fouilles, l'auteur nous montre comment ces villes, autrefois ensevelies sous les sables du temps, renaissent peu à peu, dévoilant leurs secrets et leurs trésors. Cette exploration érudite et accessible permet de mieux comprendre les dynamiques sociales, politiques et économiques qui ont façonné ces centres urbains, tout en soulignant leur influence sur le monde contemporain. "Les Villes retrouvées" est une véritable odyssée archéologique, riche en découvertes et en réflexions, qui nous invite à redécouvrir notre passé commun et à nous interroger sur l'avenir de notre patrimoine historique. L'AUTEUR : Georges Hanno est un auteur et chercheur passionné par l'archéologie et l'histoire des civilisations anciennes. Bien que peu de détails soient disponibles sur sa vie personnelle, Hanno est reconnu pour sa capacité à rendre accessibles des sujets complexes à un large public. Ses écrits se distinguent par une rigueur scientifique alliée à une narration vivante, ce qui lui permet de captiver ses lecteurs tout en leur apportant des connaissances précises et approfondies. "Les Villes retrouvées" est l'une de ses oeuvres majeures, dans laquelle il met en lumière les découvertes archéologiques qui ont permis de ressusciter des cités mythiques de l'Antiquité. Hanno s'appuie sur une vaste documentation et collabore régulièrement avec des experts du domaine pour enrichir ses ouvrages. Son approche pédagogique et son style clair et engageant font de lui une figure respectée dans le milieu académique et parmi les amateurs d'histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
INTRODUCTION : Les villes anciennes
Chapitre I : Thèbes d’Égypte
Chapitre II : Ninive et Babylone
Chapitre III : Troie
Chapitre IV : Carthage
Chapitre V : Pompei et Herculanum
Conclusion
INTRODUCTION
Les villes anciennes
L’homme est né sociable et il est né industrieux. Son industrie le porte à se procurer un abri. Son instinct de la société le porte à rapprocher son séjour de celui de son semblable.
Sitôt que les hommes se réunissent en société les voilà bâtisseurs. L’art de la pierre est un des premiers arts qu’ils connaissent. Ils remuent la terre et font des remparts ; ils taillent le bois et font des maisons ; ils soulèvent des monolithes et font des temples.
Ainsi naquirent certainement les premières villes.
Mais ces maisons, ces poutres mal équarries, mal jointes, ces levées de terre, ces rangées de pierre sacrées les protègent peu contre les attaques du dehors. La crainte pèse sur la tribu qui dort. Les bêtes fauves, le lion, l’ours, le loup, rôdent et veillent tout autour, profitent d’un moment de lassitude, pénètrent et font leur terrible razzia.
Il faut fuir : quel est l’abri le plus sûr, le rempart infranchissable ? L’eau. C’est donc dans les marais, au milieu des lacs que s’élèveront les premières cités. On bâtira sur pilotis des Venises lacustres où l’on pourra s’abriter et se défendre, dormir en paix loin du danger, et commencer le lent et paisible progrès de l’industrie humaine.
Les cités lacustres. – Mais pour construire la ville elle-même que de peines ! il faut couper des arbres énormes, il faut les tailler en pointe ; il faut les porter au bord du lac, il faut les piquer dans la vase et les enfoncer jusqu’au roc. Ce n’est pas tout : entre ces troncs debout, d’autres s’enlace ront pour faire treillis ; des pierres sont jetées dans les interstices et consolident tout l’ouvrage. En effet quelle force ne lui faut-il pas afin qu’il résiste à la terrible massue des vagues dans les jours de tempête !
Pour accomplir un pareil travail ces hommes anciens n’avaient que des outils de pierre, des silex aiguisés en forme de hache. L’usage du fer et même du cuivre leur était encore inconnu. Pour abattre un arbre on le brûlait au pied, lentement, avec précaution ; pour le dégrossir, on se servait alternativement du feu et du couteau de silex. Quant au procédé qu’ils employaient pour dresser ces poutres et les fixer dans le fond du lac, on n’a pu encore s’en rendre un compte exact. On voit bien que quelques tribus se contentaient de maintenir les arbres debout en entassant à leurs pieds des amas de pierres ; mais d’autres troncs pénètrent dans le sol. L’effort qu’il fallait pour obtenir ce résultat semble aujourd’hui même prodigieux. Cependant l’on connaît des cités lacustres dans lesquelles on a compté jusqu’à 40 000 pilotis.
Quels étaient le degré de civilisation, les mœurs, les usages de ces anciens architectes ? La patiente et lente étude des débris innombrables trouvés dans les stations lacustres soulève peu à peu le voile qui semblait devoir couvrir éternellement ces problèmes.
Bourgade lacustre
Les plus anciennes haches (trouvées à Saint-Acheul)
On a découvert de nombreux instruments en silex, les uns ayant la forme de haches, d’autres celle de couteaux, de scies, de têtes de flèche. On a trouvé de nombreux débris de poterie ; ces poteries affectent quelquefois la forme de molettes de tisserand. Nos aïeux ne se contentaient pas pour se vêtir de la peau des animaux tués par eux à la chasse. On a retrouvé en assez grande quantité des morceaux d’étoffe tissés avec du chanvre et de la toile ; et ces précieux débris remontent à l’âge de pierre.
Haches en pierre
Que dis-je ? ils n’ignoraient pas la culture du blé ni l’usage du pain : la tourbe des lacs nous a conservé des espèces de gâteaux plats et ronds, faits de grains grossièrement écrasés ; des pommes et des poires séchées. Nos ancêtres avaient auprès d’eux des animaux domestiques : les bœufs, les chevaux, les moutons. Tout ce monde vivait pêle-mêle dans des habitations suspendues au-dessus des eaux.
Têtes de lances
Cette civilisation antique qui apparaît peu à peu et lentement à la lumière (la première découverte de cités lacustres est de 1853) cette civilisa tion, dis-je, est d’une époque bien antérieure à celle où César conquit les Gaules. Ce n’est point ici le lieu d’en discuter la véritable date : contentons-nous de dire, pour en établir une évaluation approximative, que les cités datent de l’âge de pierre ; qu’à cet âge a succédé une civilisation pendant laquelle les instruments de pierre furent remplacés par des outils de bronze ; et que ce ne fut qu’après un nouveau et lent progrès de l’industrie que l’homme apprit à se servir des instruments de fer, instruments avec lesquels les Gaulois combattirent contre les légions romaines.
Têtes de flèches
À cette heure, on connaît plus de 200 de ces villes ou villages anciens dont le souvenir même n’avait laissé aucune trace dans l’histoire des hommes ; et les investigations, remarquons-le, n’ont porté que sur un des points les plus restreints du champ immense ouvert aux recherches des historiens et des antiquaires.
Pour trouver maintenant d’autres restes des villes anciennes, il faut se transporter en Orient : c’est là que la tradition met le berceau de l’humanité.
Débris de chanvre et de toiles
Si ces pays ont eu aussi leurs âges de pierre et de bronze, ç’a été dans des temps tellement reculés que peu de traces en sont parvenues jusqu’à nous. Les plus vieilles tombes de ces contrées renferment des objets en or, en bronze et en fer, couteaux, hachettes, faux, bracelets, boucles d’oreilles ciselées. À côté on trouve encore, et ils étaient concurremment employés, des instruments et des armes en silex taillé et poli, têtes de flèches, haches et marteaux. Le métal le plus répandu est le bronze ; c’est en bronze que sont tous les instruments usuels. Quant au fer il est plus rare et ne sert encore que comme métal précieux.
Haches en pierre polie
Voilà tout ce que la science nous apprend de plus positif sur ces origines.
Les villes bibliques. – En somme, si loin que l’on remonte, dans l’histoire de ces régions, on trouve déjà debout les énormes empires de l’Asie centrale et la vieille Égypte. La civilisation est arrivée à un tel progrès que le concert des sciences humaines préside à la construction des gigantesques monuments qui nous apportent le souvenir de ces âges reculés : l’astronomie, la mécanique, le calcul, l’écriture, les arts du dessin, la poésie, toutes les branches de l’industrie humaine ont groupé leur effort autour d’un seul de ces édifices, d’une seule des pierres qui y sont employées.
La Bible d’ailleurs place la construction de la première ville dans des temps bien reculés : c’est Caïn lui-même qui l’éleva :
« Caïn s’étant donc éloigné de la face du Seigneur habitait errant sur la terre sur la rive à l’orient d’Éden. Mais il eut de sa femme un fils, Hénoch, et il bâtit une cité, et lui donna le nom d’Hénoch du nom de son fils. »
Ce serait probablement une recherche superflue que d’entreprendre de déterminer le lieu où fut bâtie cette aînée de toutes les villes élevées par la main des hommes. Mais il n’est pas sans intérêt de noter les ruines d’autres cités nommées bientôt après par la Genèse et qui ont été découvertes et étudiées par la science moderne. C’est celles que Nemrod, le fort chasseur devant l’Éternel, bâtit dans la plaine de Sennaar.
C’est Babylone, c’est Ninive, c’est Chalè, c’est Resen. Cette dernière ville était située entre Ninive et Chalè,
« et c’était la grande ville », dit le récit ancien. Comme nous le verrons plus tard, Ninive et Babylone cachées sous le sable ont survécu en quelque sorte à leur destruction ; Chalè aussi a été découverte et ses ruines, relevées près du village de Kalah Skerkat, comptent parmi les plus belles de la Mésopotamie.
Resen enfin a été identifiée avec l’antique Larissa des Grecs, et complète ainsi le quadrilatère de ces anciennes cités dont le vénérable récit de la Bible nous a transmis les noms.
Mais à côté de ces découvertes dont l’ensemble suffit pour attester la haute valeur historique du témoignage de la Bible, combien d’autres recherches semblent devoir rester toujours sans résultats. Il est des villes – et combien ! – dont les noms même ne sont point parvenus jusqu’à nous ; on peut leur appliquer le vers d’Horace
| Vixere fortes ante. Agamenmona.
« Il y eut des héros avant Agamemnon ; mais aucun poète ne les a chantés, ils sont tombés dans l’oubli. » Ainsi des villes. Il en est beaucoup dont le nom est le seul souvenir qui nous reste de leur antique existence. Qu’étaient autrefois et où sont maintenant Badaca d’Elem, Naditou, Khamanou de la Chaldée, qui toutes portaient le nom de villes royales : Si l’on a identifié ou à peu près Our la Bituminée (aujourd’hui Mougheir), qui lançait ses vaisseaux à travers le golfe Persique, jusque dans la mer des Indes, ce n’est qu’avec hésitation et à tâtons, pour ainsi dire, qu’on place sur la carte de ces anciennes régions l’Orech de la Bible, et Sépharvaïm, et Sirgilla, et Karrak et Ségos ; et pourtant « c’est dans l’enceinte de ces vieilles cités aujourd’hui perdues que se fit l’énorme croisement de races et d’idées d’où sortirent la nation et la civilisation chaldéenne. »
Il en est d’autres encore qui ne nous ont transmis quelque lambeau de leur histoire que mêlé au sinistre souvenir de la catastrophe qui les a fait disparaître. Tandis que leurs sœurs, plus heureuses, tombaient peu à peu dans la cendre et dans l’oubli, elles, avec plus de gloire et plus de malheur, semblent brûler encore dans la nuit des temps et attirent l’œil inquiet de l’historien, comme ces volcans dont la clarté fumeuse flambe sur un lointain horizon.
Ainsi sont Gomorrhe et Sodome : « Et le Seigneur dit : La clameur contre Sodome et contre Gomorrhe s’est multipliée, et leurs péchés se sont accrus ; je descendrai et je verrai si leurs œuvres ont ou non mérité cette clameur... C’est pourquoi le Seigneur a fait tomber sur les deux cités une pluie de soufre et de feu, et il a détruit leur cité et toute la région d’alentour, et tous les habitants des villes, et tous les verts produits de la terre. »
Contre le feu vivant, contre le feu divin,
De larges toits de marbre ils s’abritaient en vain :
Dieu sait atteindre qui le brave ;
Ils invoquaient leurs dieux ; mais le feu qui punit
Frappait ces dieux muets dont les yeux de granit
Soudain fondaient en pleurs de lave !
Ainsi tout disparut sous le noir tourbillon,
L’homme avec la cité, l’herbe avec le sillon ;
Dieu brûla ces mornes campagnes ;
Rien ne resta debout de ce peuple détruit.
Et le vent inconnu qui souffla cette nuit,
Changea la forme des montagnes.
Aujourd’hui le palmier qui croit sur le rocher
Sent sa feuille jaunir et sa tige sécher
A cet air qui brûle et pèse ;
Ces villes ne sont plus ; et, miroir du passé,
Sur leurs débris éteints s’étend un lac glacé
Qui fume comme une fournaise !
Nous avons cité quelques-unes des villes connues par les récits de la Bible ; mais l’étude des débris des civilisations antiques apprend de jour en jour l’existence de peuples anciens puissants et riches qui jusqu’ici dormaient dans l’oubli et le silence. Quand un monarque assyrien avait promené sa redoutable férocité sur les frontières de son empire, quand il avait refréné les révoltes de ses satrapes, contenu ses vassaux dans le devoir, conquis des terres nouvelles et jeté bien loin l’effroi de son nom, il s’arrêtait enfin au pied de quelque roc énorme et là taillait dans la pierre le nom des peuples qu’il avait soumis et des cités qu’il avait renversées.
Voici l’inscription du redoutable Touklat-habal-hasar : « Le dieu Assour mon Seigneur me dit de marcher, je disposai mes chars et mes armées et je m’emparai des forteresses du pays d’Itui et du pays d’Ayu, sur les pics élevés des montagnes impénétrables, aiguës comme la pointe d’un poignard et qui n’offraient pas de passage à mes chars. Je laissai mes chars dans la plaine et je pénétrai dans la montagne tortueuse. Je couvris de ruines le pays de Saranit et d’Ammanit ; depuis un temps immémorial ils n’avaient pas fait leur soumission. Je me suis mesuré avec leurs armées dans le pays d’Arouma, je les ai châtiés, j’ai poursuivi leurs guerriers comme des bêtes fauves, j’ai occupé leurs villes, j’ai emporté leurs dieux. J’ai fait des prisonniers, je me suis emparé de leurs biens et de leurs trésors, j’ai livré les villes aux flammes, je les ai démolies ; je les ai détruites ; j’en ai fait des ruines et des décombres ; je leur ai imposé le joug pesant de ma domination, et, en leur présence, j’ai rendu des actions de grâces au dieu Assour, mon Seigneur. »
« Car je suis Touklat-habal-asar, le roi puissant, le destructeur des méchants, celui qui anéantit les bataillons ennemis. »
Les villes syriennes. – Quand, dans le cours de ces excursions, quel-qu’un de ces promeneurs de massacres allait du côté de la mer occidentale, il rencontrait des peuples déjà arrivés aussi à une civilisation bien avancée. Ces peuples étaient tous d’une même famille et tous, si l’on en croit les anciens récits, venaient du pays même des Assyriens. Dans des âges très reculés leurs ancêtres avaient quitté les bords du Golfe Persique et les environs de la ville d’Our pour venir, à la suite de longues pérégrinations s’installer sur les bords de la Méditerranée.
C’est le pays que les modernes appellent Syrie, pays étroit, resserré entre les sables de l’Arabie et la mer, sillonné par des chaînes de montagnes hautes et épaisses. Plutôt une côte qu’une province, plutôt le grand chemin entre l’Asie et l’Afrique qu’un lieu de séjour pour des peuples stables et puissants. – Pays toujours traversé et jamais conquis, par sa forme naturelle, il a dû subir toutes les dominations, et aussi éviter d’être le siège d’aucune ; en somme, région riche, bien située. C’est par là que se fait naturellement le transit des produits de l’Orient et de ceux de l’Occident.
Le pays étant fait pour le commerce, les peuples qui l’habitaient étaient des commerçants. Combien citerons-nous ici de villes que leur situation rend en quelque sorte immortelle ; qui apparaissent dès la plus haute antiquité et qui ont survécu jusqu’à nos jours, en vertu de cette loi historique qui fait que des groupes d’hommes subsistent là où aboutissent les grands chemins de l’humanité ? C’était, en remontant le cours de l’Euphrate, au gué le plus méridional, Thapsaque ; au gué central, Karkémish ; au gué du nord, dans les montagnes, Samosate.
Des trois villes, toutes grandes et riches, la plus importante était Karkémish. Les fêtes religieuses connues de toute l’antiquité étaient l’occasion de foires célèbres où se rencontraient toutes les jaunes figures des commerçants orientaux.
Plus au sud on trouvait Batna, Halep aux champs altérés, puis Damas ; Damas, ville fertile, à l’entrée du désert, ville ombreuse, ville pleine de verdure, de gaieté et de vie, aux confins des sables arides et étouffants de la pierreuse Arabie.
Aujourd’hui encore sa vue arrache au voyageur qui débouche de l’Anti-Liban un cri de joie et d’admiration : L’impression de ces campagnes richement cultivées, de ces vergers délicieux, séparés les uns des autres par des rigoles et chargés des plus beaux fruits, est celle du calme et du bonheur. Vous vous croyez à peine en Orient dans ces environs de Damas, et surtout au sortir des âpres et brûlantes régions de la Gaulonitide et de l’Iturée. Ce qui remplit l’âme, c’est la joie de retrouver les travaux de l’homme et les bénédictions du ciel. Depuis l’antiquité la plus reculée jus-qu’à nos jours toute cette zone qui entoure Damas de fraîcheur et de bien-être n’a eu qu’un nom, n’a inspiré qu’un rêve : celui de « paradis de Dieu. »
Aux avantages d’un climat si favorable, Damas en joignait un autre : protégée par l’Anti-Liban, séparée par lui du grand chemin de la côte, elle reposait tranquillement dans ses vergers, laissant passer devant elle les fureurs belliqueuses des puissants despotes, ses voisins de l’Orient.
Sur les bords de la mer s’étageaient les villes des Phéniciens, plus puissantes, plus célèbres, mais aussi plus exposées, et que leur retraite au sein des eaux ne suffisait pas toujours à protéger. Il passait quelquefois des Alexandres qui jetaient des digues pour arriver jusqu’à elles.
C’était Gebel ou Byblos qui se vantait d’être la ville la plus vieille du monde et d’avoir été construite par les dieux. C’était Bérouth, c’était Sidon « la fleurie » avec son beau port, elle aussi s’appelait orgueilleusement « le premier-né de Canaan ». Au milieu des eaux on avait bâti Arad ; et Tyr, la reine de la mer. Faut-il citer plus au sud les noms d’Acca, de Mageddo, de Joppé, d’Ascalon, de Gaza, dont la gloire pâlit à côté de celle de leur brillante sœur. Si nous rentrons dans l’intérieur des terres, nous trouvons bien d’autres cités encore. Elles étaient déjà puissantes en ces temps anciens et opposaient aux rois de l’Assyrie une rude résistance ; la plupart d’entre elles existent encore aujourd’hui et attestent la prodigieuse vitalité qui émane de ces fertiles provinces.
Nous avons déjà cité Kadesh ; il faut ajouter Tibeskah qui devint plus tard la célèbre et opulente Baalbek ou Héliopolis, la ville du soleil. Ses ruines entassées sont encore aujourd’hui un des grands spectacles de l’Orient. Les Romains y ont, dans des temps postérieurs, épuisé tous leurs efforts, comme s’ils avaient voulu tenter d’effacer par l’étalage de leur luxe et de leur puissance celle des anciens rois qui avaient embelli les contrées voisines.
Il faut enfin citer la ville des villes, celle que son influence morale sur le monde a mise en un plus haut degré de gloire entre toutes ses sœurs, celle vers laquelle se tournent encore avec respect et avec amour les yeux de la moitié du monde occidental, Jérusalem.
Chacune des villes de la Syrie et de la Palestine était à la tête de petits États tantôt confédérés, tantôt ennemis. Cette région présentait à peu près l’aspect politique de l’Italie au Moyen Age. Divisés entre eux ces fils d’un même sol résistaient mal aux invasions étrangères que leurs dissensions attiraient même quelquefois. Par contre chacun de ces petits États avait une activité personnelle, une force d’absorption et d’expansion qui en devait en faire au plus haut degré les intermédiaires, les instructeurs et les colonisateurs de l’Ancien Monde.
Il n’est pas inutile de constater qu’en dehors de Baalbek, qui est toute moderne relativement, nous ne trouvons pas ici de ces ruines magnifiques dont le vaste spectacle appelle la curiosité du voyageur et l’étude de l’historien. Il a fallu toute la reconnaissante attention que mérite de l’Occident la patrie de Cadmus, la mère du commerce, de la religion, la colonisatrice des bords méditerranéens pour que des savants éminents s’appliquassent à relever les traces relativement minimes de cette ancienne civilisation. Les Phéniciens construisaient peu ou plutôt construisaient mal. Des huttes faites de bois et d’argile les abritaient tous.
La mission en Phénicie, dirigée par M. Renan, n’a trouvé que des traces bien incomplètes de leur ancienne architecture. On a voulu leur en faire un reproche : « Si l’architecture, a-t-on dit, est le critérium le plus sûr de l’honnêteté, du sérieux, du jugement d’une nation ; si l’historien peut juger les peuples et les époques par la solidité et la beauté des édifices qu’ils ont laissés, c’est seulement par le défaut de ces qualités chez les Phéniciens qu’on peut s’expliquer le néant de leur œuvre d’architecture ».
Ce jugement est sévère et j’ajouterai qu’il me semble reposer sur une erreur d’argumentation. Non, les monuments durables ne sont pas toujours le critérium le plus sûr de l’honnêteté, du sérieux et du bon sens chez un peuple. Ils ne sont souvent au contraire que les témoins immortels de la folie d’un despote et du malheur de ses sujets.
Je n’en veux citer qu’un exemple ; c’est le plus éclatant de tous : Qui a construit les Pyramides de Giseh ? Est-ce une Égypte sage, réglée, développant librement la nature de son génie propre et de sa civilisation ? Non ; c’est la fantaisie barbare de quelques Pharaons maudits par leurs sujets, et qui n’ont pas même trouvé dans les flancs de ces édifices l’orgueilleux tombeau qu’ils prétendaient s’y réserver.
Certes, toutes ces ruines anciennes sont étonnantes. Méritent-elles l’admiration du sage ? J’en doute. Que de misères ne représentent-elles pas ! L’amas de douleurs qu’a coûtées leur construction ne dépasserait-il pas la plus haute d’entre elles de plus de cent coudées ? On s’étonne, et nous aurons l’occasion de nous étonner plus d’une fois, devant ces prodiges de la force. On s’écrie : Quelle civilisation avancée ! Pourrions-nous soulever de tels blocs ? Ne sommes-nous pas dégénérés ? – Non pas ; disons-le ici, une fois pour toutes. Tant de monuments merveilleux mettent souvent au cœur une grande tristesse. Si c’est une bien glorieuse histoire que celle des rois qui les projetèrent, c’est une bien mélancolique histoire que celle des malheureux – sujets ou prisonniers – qui les élevèrent. Cet idéal de l’architecture ancienne, qui consistait à faire colossal et éternel, est une préoccupation de peuples jeunes et presque de barbares ; le résultat atteint n’est nullement à comparer avec l’effort dépensé.
Il y a dans les carrières voisines de Baalbek d’immenses blocs de marbre monolithes taillés de la main des anciens peuples. Ils sont tout prêts, bons à être transportés et mis en place ; cependant ils sont restés là ; la force a manqué à ceux qui les avaient choisis. Cette fois, le rêve despotique a été plus loin que le possible. Le tyran a été battu par la nature. On a cru que ces blocs avaient été façonnés ainsi par les Romains. De leur énormité même, M. Oppert conclut avec raison que ce n’est point à eux qu’il faut les attribuer. Ils avaient le sens de l’utile et de la pratique trop développé pour tenter une pareille folie ; ils eussent coupé ces blocs en plusieurs morceaux faciles à transporter, quitte à les ajuster et à les rejoindre par du ciment quand ils eussent été en place. Et cependant les Romains étaient – même en architecture, – un peuple plein de sérieux et de jugement.
Il en fut ainsi des Phéniciens ; race de commerçants et d’industriels avant tout, ils devaient avoir le sens très éveillé pour les choses utiles, possibles.
Certes, ils n’ignoraient ni l’art ni la science ; ce sont leurs architectes que Salomon fit venir pour bâtir le temple de Jérusalem. Ils ont instruit les premiers ouvriers de la Grèce, ils savaient bâtir, décorer, orner avec goût, ils mélangeaient adroitement la pierre, le bois et le métal dans leurs constructions ; mais l’effort qu’ils dépensaient était toujours en proportion de ce qu’ils voulaient et de ce qu’ils pouvaient.
Leurs villes devaient être belles ; les ruines de ces villes sont peu intéressantes, faut-il le regretter ? Oui peut-être pour les archéologues ; mais non certainement pour l’ancien peuple phénicien lui-même, et non encore au point de vue réel de la civilisation. Car en somme si les Phéniciens n’avaient pas été ces hardis commerçants, ces navigateurs audacieux, tenant peu au sol, rapides à l’ouvrage, prompts dans le dessein, plus prompts encore dans l’exécution, tirant habilement parti des circonstances actuelles et sachant y conformer leurs besoins et leurs ambitions, ils n’eussent point eu d’occasion de porter loin de chez eux ces arts et ces sciences qu’ils avaient inventés ou qu’ils avaient empruntés à leurs voisins plus immobiles. Ce n’est pas l’Égypte qui a instruit le monde, quoi qu’en ait dit la Grèce menteuse. En réalité c’est la Phénicie ; et les descendants des Pélasges, des Hellènes et des Gaulois doivent se féliciter encore du génie hardi, industriel, mercantile, si l’on veut, qui lança sur les mers la communicative civilisation des Phéniciens.
La colonisation phénicienne. – Sur toute la ceinture du bassin méditerranéen les hardis marins de la Syrie portèrent l’influence féconde du vieil Orient. Ce furent eux qui avec Cadmus « l’inventeur des lettres » fondèrent Thèbes, et instruisirent la Grèce. Toutes les îles de l’Archipel leur appartinrent.
Sur la côte de l’Asie Mineure ils trouvèrent, déjà établi, un empire puis-sant, qui sous le nom de royaume de Midas est resté célèbre dans les légendes de la Grèce ; il ne fallut pas moins que l’épée d’Alexandre pour trancher le nœud gordien, seul souvenir de cette antique domination. « Près des sources du Sangarios, en Phrygie, un voyageur anglais, Leake, découvrit au commencement du siècle une vallée pleine de tombeaux antiques. Ces tombeaux sont d’une époque inconnue, mais de beaucoup antérieure à la domination grecque et romaine ; leur caractère tout indigène nous révèle le style architectural des vieux phrygiens. La langue même des inscriptions est purement phrygienne, et cette langue, avec l’alphabet encore incomplètement déchiffré, qui nous en a conservé les rares débris, reste enfermée dans les limites de l’ancien royaume où régna la dynastie de Midas. Dans toute l’étendue du pays où se trouvent ces restes vénérables du peuple indigène, on ne voit que de rares débris des monuments appartenant à l’époque Romaine ; il semble que les conquérants successifs de la contrée aient ignoré ces vallées solitaires où plus tard des familles chrétiennes vinrent chercher un refuge contre la persécution du paganisme, peut-être aussi contre l’invasion musulmane.
Quelques tombeaux, des ruines de forteresses et des bas-reliefs inexpliqués, c’est tout ce qui nous reste de ces rois de Phrygie, si célèbres au début de l’histoire grecque par leur richesse, leur amour pour les chevaux et l’adoration fanatique qu’ils rendaient à la mère des dieux (Cybèle) et à Dyonisos. »
C’est dans cette contrée encore que M. G. Perrot a découvert les ruines de l’antique Ptérium dont quelques lignes d’Hérodote formaient toute l’histoire. Le trône de ses vieux rois est renversé, enfoui sous terre auprès des fondations de leur palais et des restes de murailles que Crésus démolit ; il est reconnaissable aux deux lions de pierre qui le gardaient autrefois et qui gisent encore aujourd’hui près de lui dans la poussière comme des serviteurs fidèles morts aux pieds de leurs maîtres et reposant dans le même tombeau.
Sur cette côte les Phéniciens établirent leur domination partout où la résistance du pays ne fut point assez forte pour les rejeter à la mer. Un peu plus au nord ils rencontrèrent encore un empire redoutable que tous les efforts de la Grèce conjurée ne purent abattre qu’après dix ans de combats : c’est Pergame, l’ilion chantée par Homère ; la ville dont M. Schliemann atout récemment découvert les restes vénérables.
Suivrons-nous plus loin les marins de Tyr et de Sidon dans le cours de leurs nombreuses pérégrinations ? Pénétrerons-nous avec eux dans la Propontide, sur les noires eaux du Pont-Euxin, où, d’après la légende, les Symplégades écrasaient les galères à la sortie du Bosphore ? Ils étaient attirés dans ces régions lointaines par la réputation des mines d’or, d’argent et d’étain du Caucase ; les premiers ils ouvrirent ces veines abondantes que des fouilles séculaires n’ont pas épuisées.
Rentrons plutôt à la suite de l’Hercule Tyrien dans des régions plus connues et où ses efforts devaient avoir plus de gloire et ses établissements plus de durée.
C’est en Grèce d’abord ; dans la Grèce, amante des fables, qui leur paye le tribut de sa reconnaissance en célébrant dans ses légendes l’enlèvement d’Europe par Zeus, et les voyages de Cadmos à la recherche de sa sœur.
Plus loin encore c’est l’Italie, la Sicile, la Sardaigne qui les reçoivent et qui leur fournissent encore l’ambre, la pourpre, les métaux précieux et usuels. Mais là, comme ailleurs, leur domination s’étend peu dans l’intérieur des terres ; ils se heurtent à la solide confédération des Etrusques. S’ils échangent avec elle quelques-uns de leurs produits et s’ils influent sur le développement de la civilisation italienne, ce n’est qu’à la faveur de négoce ; ils ne fondent pas de domination politique. C’est qu’ici encore les Phéniciens avaient rencontré une nation qui s’était développée par elle-même et que la force de l’originalité nationale avait repoussé l’influence de l’importation étrangère.
La civilisation des Étrusques est encore un des problèmes les plus ardus que présente l’étude de l’antiquité. Il nous manque ici la clef naturelle de toute histoire : la connaissance de la langue.
Vases de Clusium
Les Étrusques nous ont laissé bien des objets précieux, bien des vases que nous collectionnons avec soin et que nous imitons même, bien des tombeaux, bien des inscriptions, bien des documents de toutes sortes ; l'antiquité classique a laissé sur cette race nombre de renseignements épars. Mais il manque le trait de lumière qui coordonne cet ensemble confus et donne à chacun de ces restes sa véritable valeur. L'Étrurie, on l’a dit, est pour nous ce qu’était l’Égypte avant Champollion.
Murs de Norha
Pour ne parler ici que de ce qui nous intéresse directement, qui ne connaît cette célèbre fédération des douze cités étrusques. Des murs énormes les entouraient faits à l’image de ceux qu’avaient autrefois construits les Pélasges. Leurs assises immenses formées de pierres jointes sans ciment, et non taillées, faisaient croire aux anciens qu'elles avaient été entassées les unes sur les autres par des géants. Chacune de ces villes, dont les plus célèbres étaient Véies, Céret, Clusium, Chiusi, Volterra était à la tête d’un peuple qui prenait part aux délibérations et aux entreprises de la confédération, mais qui conservait à l’égard de ses associés une sorte d’indépendance jalouse.
Ces peuples, d’abord unis, partant de Toscane leur centre commun, conquirent ou colonisèrent une bonne partie de l’Italie. Au nord ils occupèrent l’Ombrie et fondèrent Mantoue, Pérouse, Melpum, Adria, qui donna son nom à la mer Adriatique ; dans la Toscane, le val d’Arno et celui de la Chiana furent desséchés, la Maremne assainie et six des douze capitales bâties sur cette côte maintenant inhabitable.
Car les Étrusques furent avant tout un peuple industriel, appliqué aux travaux des champs et de la maison, habiles ouvriers, fins ciseleurs, les meilleurs potiers du monde antique ; l’agriculture chez eux était en grand honneur ; la charrue est souvent représentée sur leurs vases. Persuadés qu’eux-mêmes et leurs dieux devaient mourir au bout de mille ans, ils s’appliquaient surtout à tout ce qui pouvait donner à l’homme des jouissances immédiates, perçaient des routes, ouvraient des canaux, desséchaient les marais et construisaient à leurs morts de solides tombeaux. « Ainsi, dit M. Duruy, se réalisa ce problème que l’antiquité n’a presque jamais su résoudre, de grandes villes au milieu de campagnes fertiles, l’industrie et l’agriculture, la richesse et la force : Sic fortis Etruria crevit. »
Leurs conquêtes et leurs établissements au sud du Tibre ne furent pas moins importants que ceux que nous avons signalés dans le nord ; jusqu’au jour où ils rencontrèrent sur les bords mêmes de ce fleuve la puissance romaine contre laquelle leur confédération, déjà disjointe, se brisa. La campagne de Rome leur doit Fidènes et Tusculum. Rome leur doit une bonne partie de son éducation ; l’art d’élever des voûtes que la Grèce elle-même semble avoir ignorée ; la science des augures, si importante dans sa politique.
En Campanie s’élevèrent Volturnum qui fut plus tard Capoue, Nola, Acerrœ ; Herculanum et Pompéi, dont la fin désastreuse a fait des villes à jamais célèbres. « Du haut des rochers de Sorrente que couronnait le temple de la Minerve Étrusque, ils guettaient les navires assez hardis pour s’aventurer dans les golfes de Naples et de Salerne, et leurs longues galères couraient jusqu’aux côtes de la Corse et de la Sardaigne où ils eurent des établissements. » Mais quelque importantes que fussent leurs expéditions maritimes, jamais leur puissance ne prit en ce sens l’extension de celle des Phéniciens ; ils se bornèrent le plus souvent aux deux mers qui baignent les côtes de l’Italie. Là ils régnèrent longtemps ; de là ils éloignèrent les Phéniciens et essayèrent de chasser les Grecs. Ceux-ci finirent par vaincre à leur tour. Mais les Phéniciens n’eurent jamais sur cette côte fameuse les établissements importants dont ils ont semé toute la côte méditerranéenne.
Tombeau étrusque
Les Phéniciens d’ailleurs ne s’étaient laissés effrayer ni par cette résistance, ni par les difficultés redoutables des pas de Charybde et de Scylla. Ils avaient franchi la mer Thyrrhénienne et avaient abordé aux rivages méridionaux de la Gaule. Là ils avaient apporté les arts, introduit la culture de la vigne, fondé Narbonne, Nîmes, Arles, les plus anciennes villes de notre France.
Un peu plus au sud, les îles Baléares les recevaient et l’Espagne leur offrait ses richesses. C’est le Pérou des anciens. Ils ne tarissent pas d’éloges et d’enthousiasme sur les plaines fortunées de la Bétique. L’or, disait-on, y coulait dans le gravier des fleuves, les ruisseaux étaient de lait, les arbres suaient le miel, les cavales y étaient fécondées par le vent. Assis sur les bords extrêmes du rivage occidental, on voyait, disait-on, le soleil baisser sur l’horizon et plonger tout à coup dans la mer comme un feu qui s’éteint. Là les Phéniciens fondèrent Abdère, Malaca, Gadès (Cadix), Hispalis (Séville), en un mot, les villes les plus importantes de l’Espagne méridionale.
Ils ne s’arrêtèrent pas encore, ils franchirent le grand pas du Gibraltar, rompirent le détroit, séparèrent les colonnes d’Hercule,... et là, debout sur la poupe, le marin Phénicien put voir au loin s’étendre la haute mer, l’Océan immense, et rêver dans le mirage de la brume les fortunés rivages des Hespérides et de l’Atlantide.
Autour de l’Europe, autour de l’Afrique ils naviguèrent, allant, allant toujours poussés par la soif du gain, bravant tous les courants, les vents contraires, les mers froides, inconnues et hostiles. Ils allèrent ainsi, – qui sait ? – jusqu’en Angleterre, en Danemark, en Norvège, d’une part ; de l’autre, ils s’enfoncèrent jusqu’aux îles de Pourpre (Madère), aux îles Fortunées (Canaries) ; plus bas encore ils virent les Leucœthiopiens, les hommes à queue de singe, et bien d’autres merveilles.
On dit même qu’ils firent le tour du continent Africain ; et les prêtres égyptiens racontèrent à Hérodote que, partant de la mer Rouge, des marins phéniciens, après trois ans de navigation étaient revenus par les colonnes d’Hercule : récit que nous ne pourrions croire, pas plus qu’Hérodote qui le rapporte, si dans le cours de sa narration il ne témoignait lui-même de ce fait véridique et concluant que les marins phéniciens avaient vu le soleil du côté de l’Ourse.
D’ailleurs si cet antique périple peut être mis en doute, il faut bien accepter comme un fait, la colonisation de l’Afrique septentrionale par les commerçants de la Syrie : c’est là que leur Hercule avait fondé la ville fabuleuse d’Hécatompyles ; c’est là que des récits plus authentiques placent la fondation de Leptis la grande, d’CEA, de Sabrata, de Thapsos, d’Utique, et enfin de Kambê que remplaça plus tard « la ville neuve », Carthage.
C’est elle qui, s’engraissant plus tard de la ruine de sa mère Tyr, absorba à son profit tout le commerce de l’Occident, devint la reine de la Méditerranée et balança la fortune de Rome. Nous la retrouverons plus tard.
Si nous nous replions, cependant, sur les parages plus voisins de la Phénicie, si nous poursuivons la côte nord de l’Afrique jusqu’au moment où elle rejoint l’Asie, il est un point où les vaisseaux des Syriens n’osèrent jamais aborder en conquérants ; un pays que tous les puissants États de l’Asie, envièrent et respectèrent quoiqu’il fut leur plus proche voisin ; un État dont les origines remontaient aux plus liants souvenirs de l’humanité, et qui se prétendait à bon droit l’aîné de tous les peuples ; un royaume dont la force inspirait la terreur et dont les richesses excitaient l’envie. C’est l’Égypte. Que les Arabes et les Syriens (sous le nom de Pasteurs et de Khetas), que les Assyriens (au temps de Cambyse), eussent essayé de l’envahir, son peuple calme et fort avait résisté lentement et finalement culbuté et mis en fuite les armées des envahisseurs. Sa durée paraissait immortelle, et comme les sources de son fleuve, le Nil, son histoire semblait se perdre au loin dans l’inconnu et dans la nuit.
Les cités égyptiennes. – C’est par les villes énormes qu’il construisit que nous terminerons ce rapide examen des villes anciennes. L’imposant spectacle qu'elles présentent aujourd’hui encore après des centaines de siècles, donne une bien haute idée de l’état avancé et de la haute civilisation de ces peuples.
L’Égypte c’est le Nil. Dans la brûlante et morne Afrique, le Nil donne la fraîcheur, la joie, la gaieté, la vie. Est-il digne de remarque que ce fleuve immense, ce bras de mer déroulant des montagnes, inspire non seulement le respect par sa masse, mais aussi la bonne humeur par sa douce action bienfaisante. Osburn dit : « Il n’y a peut-être pas dans tout le domaine de la nature un spectacle plus gai que celui présenté par la crue du Nil. Toute la nature en crie de joie. Hommes, enfants, troupes de bœufs sauvages gambadent dans les eaux rafraîchissantes, les larges vagues entraînent les bancs de poissons dont l’écaille lance des éclairs d’argent, tandis que des oiseaux de toute plume s’assemblent en nuées au-dessus ». C’est la fête de la nature.
Agenouillées, serrées autour de cette immense mamelle, les villes de l’Égypte puisent dans son sein la vie. Le Nil est le père, c’est le Dieu ; c’est lui que célèbre, depuis l’embouchure jusqu’aux cataractes, le grand poème hiéroglyphique déroulé par la main des Pharaons : « Salut, ô Nil, – ô toi qui t’es manifesté sur cette terre – et qui viens en paix – pour donner la vie à l’Égypte ! – Dieu caché – qui amènes les ténèbres au jour qu’il te plaît les amener, – irrigateurs des vergers qu’a créés le Soleil – pour donner la vie à tous les bestiaux ; – tu abreuves la terre en tous lieux, – voie du ciel qui descends, – Dieu Seb, ami des pains ! – Dieu Nepra, oblateur des grains ! – Dieu Pthah qui illumine toute demeure ! SEIGNEUR des poissons, quand tu remontes sur les terres inondées – aucun oiseau n’envahit plus les biens utiles ; – créateur du blé, producteur de l’orge, il perpétue la durée des Temples ; repos des doigts est son travail – pour des millions de malheureux !... Tu as réjoui les générations de tes enfants : – on te rend hommage au Sud. – Stables sont tes décrets quand ils se manifestent – par-devant les serviteurs du Nord. – Tu bois les pleurs de tous les yeux et prodigues l’abondance des biens ! »
Énumérons les villes que ce puissant nourricier avait semé sur ses deux bords :
D’abord les villes du Delta, Sais, Tanis, Xoïs, toutes villes anciennes et puissantes. Mais leur position excentrique empêcha qu’elles tinssent jamais d’une façon durable le premier rang en Égypte. Plus tard la fondation d’Alexandrie les ruina. Dès la plus haute antiquité elles profitaient de leur situation au bord de la mer pour se livrer à un commerce actif. Les Phéniciens y avaient des comptoirs.
Au sortir du Delta la vallée se resserre ; nous sommes en pleine Égypte ; c’est là que s’entassent l’une sur l’autre : On du nord, l’Héliopolis des Grecs, la ville sainte ; il se tenait dans ses temples une école de théologie où Solon, Pythagore, Platon étaient venus prendre les leçons des prêtres de l’Égypte ; Babylone d’Égypte si célèbre dans les récits du Moyen Âge, où les Grecs avaient cru reconnaître une ville bâtie par la main des Troyens prisonniers.
En face, sur la rive gauche, plus puissante à elle seule, et plus célèbre s’étalait l’orgueilleuse Memphis (Mannover). Au treizième siècle, l’arabe Abd-al-latif décrivait en ces termes l’aspect imposant que présentaient encore ses ruines. « Malgré l’immense étendue de cette ville, disait-il, et la haute antiquité à laquelle elle remonte, ses débris offrent encore aux yeux des spectateurs une réunion de merveilles qui confond l’intelligence et que l’homme le plus éloquent entreprendrait inutilement de décrire... Les pierres provenues de la démolition des édifices remplissent toute la surface de ces ruines ; on trouve en quelques endroits des pans de murailles encore debout, construits de ces grosses pierres dont je viens de parler ; ailleurs il ne reste que les fondements, ou bien des monceaux de décombres. J’ai vu l’arc d’une porte très haute dont les deux murs latéraux sont formés chacun d’une seule pierre ; et la voûte supérieure qui était aussi d’une seule pierre était tombée au-devant de la porte... Les ruines de Memphis occupent actuellement une demi-journée de chemin en tous sens. »
De cette ville qui dans sa splendeur avait été tellement importante qu'elle avait donné son nom à l’Égypte, (Hakaptah, c’est-à-dire ville de Phtah), si l’on s’achemine vers l’autre centre de la puissance Égyptienne vers la capitale du sud, Thèbes, on rencontre encore sur les bords du Nil bien d’autres centres importants. Il y avait la ville de Khéops, Menat-Khouwou, aujourd’hui Minieh. Il y avait l’antique Hermopolis, qui s’appelait encore Sesounnou, et qui passait pour une des plus vieilles villes de la vieille Égypte. Puis, plus haut encore, l’un des grands centres religieux de l’Égypte, une des villes dont le nom se trouve le plus fréquemment répété dans les inscriptions antiques, Abydos (Aboud), plus tard Ptolémaïs. Elle dut à certains moments balancer la puissance de Thèbes et de Memphis. Enfin après avoir traversé. On du midi (Hermonthis), dont l’existence remontait aux âges antéhistoriques, l’on arrivait à la ville qui résumait en elle seule toutes les splendeurs et toutes les gloires de l’empire, à celle dont le nom était répandu au loin, et dont les ruines donnent encore une idée si magnifique et si complète des splendeurs antiques, à la ville sainte, Ape, T-ape, la Thèbes aux cent portes des Grecs, la demeure d’Ammon-Ra, roi des dieux et créateur du monde.
I
Thèbes d’Égypte
Toutes les traditions, toutes les légendes, tous les monuments de l’antiquité parlent de Thèbes d’Égypte avec un enthousiasme que le lointain de l’espace et du temps ne fait qu’accroître ; depuis le vieil Homère, qui racontait sans les avoir vues « les fabuleuses richesses de la ville aux cent portes, par chacune desquelles passent deux cents chars tous attelés de blancs chevaux, et montés par leurs cavaliers en armes, » jusqu’à Germanicus, qui visita l’Égypte en amateur éclairé et se fit expliquer par les prêtres les hiéroglyphes inscrits sur les murailles. « Il admira la grandeur des ruines de la vieille Thèbes et s’étonna, dit Tacite, d’apprendre que la puissance des anciens rois d’Égypte avait écrasé les peuples voisins de charges et d’exactions non moins lourdes que celles dont les accable maintenant la puissance des Romains. »
Dans les temps modernes, ce fut en de grandes circonstances que ces ruines oubliées apparurent de nouveau et rentrèrent en quelque sorte dans le champ de l’Histoire dont elles étaient sorties depuis si longtemps.
L’armée française remontait en conquérante le cours du Nil. Epuisée par la fatigue, par les privations, abattue par l’âpreté d’un ciel et d’un sol inaccoutumés... tout à coup, au détour du chemin, Thèbes apparut. L’armée s’arrêta tout entière, et un cri, une acclamation sortie de toutes les poitrines salua le grand spectacle que le désert venait de dérouler tout à coup.
Quelques années plus tard, Champollion ayant découvert déjà le secret caché dans les inscriptions hiéroglyphiques, écrivait à son tour, en arrivant au même endroit : « Les Égyptiens, en présence de ce que je vois, conce vaient les hommes de cent pieds de hauteur et l’imagination qui, en Europe, s’élance bien au-dessus de nos portiques, tombe impuissante au pied des cent trente-quatre colonnes de la salle de Karnak. Je me garderai bien d’en rien écrire ; car ou mes expressions ne vaudraient que la millième partie de ce qu’on doit dire en parlant de tels objets ; ou bien, si j’en traçais une fois l’esquisse très colorée, je risquerais de passer pour un enthousiaste ou peut-être même pour un fou. »
C’est que Thèbes fut en réalité la plus haute expression de l’art égyptien ; que là se résuma, se traduisit en poèmes de pierre, ce délire architectural, que se transmettaient héréditairement les vieux Pharaons l’un après l’autre. Depuis les plus reculés jusqu’aux contemporains des Grecs, ils rivalisèrent là d’effort et de dépenses : temples, maisons, tombeaux tout y fut taillé dans le colossal. L’Égypte entière a souffert des siècles pour la bâtir, et des siècles d’abandon n’ont pas suffi pour en faire disparaître les merveilleux vestiges.
La ville que les Grecs appelaient Thèbes ou Diospolis, était nommée par les Egyptiens, eux-mêmes, Ape, T-ape, la ville d’Ammon-Ra, le plus puissant des dieux de l’Égypte. Elle s’étendait sur les deux rives du Nil, beaucoup plus large en cet endroit que la Seine à Paris. Elle-même, lorsqu’elle fut arrivée au plus haut degré de son développement avait, selon Diodore, un circuit de plus de trois milles ; son diamètre était de deux lieues et demie.
Les légendes égyptiennes attribuaient sa fondation au dieu lui-même, à Osiris. C’est dans cette ville que, pour la première fois, il avait enseigné aux hommes les arts utiles, l’agriculture, le maniement de l’airain et du fer, l’architecture. Il est certain que la fondation de Thèbes se perd dans la nuit des temps.
Mais pour l’histoire son nom n’apparaît guère que vers la XIe dynastie (plus de 4 000 ans av. J.-C.).
Vue de Thèbes du plus loin qu’on peut l’apercevoir
Avant cette époque le centre politique de l’Égypte se trouvait placé plus au nord, principalement à Memphis. D’origine thébaïne, les rois de la XIe dynastie commencèrent à l’embellir, mais d’une manière rude et grossière qui contrastait avec les splendeurs dont étaient déjà revêtues les villes du centre et du nord. Les souverains de la XIIe dynastie, les Amenemha, guerriers et conquérants, continuèrent les grands travaux ; c’est un Amenemha qui fonda le grand temple de Karnak. On a retrouvé dans les ruines un fragment de la statue de ce roi et de sa femme assis sur un même socle de granit rose.
Le mouvement de construction prit alors dans ces régions un développement considérable. C’est sous le roi Ousortesen Ier, de la XIIe dynastie, qu’une stèle raconte ainsi les fonctions d’un architecte du temps : « Je suis, dit-il, le scribe Mevic, je suis un serviteur du prince, ingénieur en chef des travaux, une palme d’amour. Mon maître m’envoya en grande mission d’ingénieur pour lui préparer une grande demeure éternelle. Les couloirs et la chambre intérieure étaient en maçonnerie et renouvelaient les merveilles de construction des Dieux. Il y eut là des colonnes sculptées belles comme le ciel, un bassin creusé qui communiquait avec le Nil, des portes, des obélisques, une façade en pierre blanche de Rouwou ; aussi, Osiris, seigneur de l’Ament, s’est-il réjoui des monuments de mon seigneur, et j’ai été moi-même dans le transport et l’allégresse en voyant le résultat de mon travail. » Ce récit ne nous expose-t-il pas de la façon la plus claire le projet de la construction, l’ordre des travaux et l’aspect extérieur d’un temple dans ces temps antiques dont trop peu de monuments nous restent à l’heure qu’il est dans cette région ?
Roi égyptien (Sevekhotep III)
L’art à cette époque avait déjà atteint un degré d’élévation et une habileté d’exécution qu’il ne dépassa presque jamais. Nous n’en voulons pour preuve que la belle statue de Sevekhotep III, conservée aujourd’hui au Musée du Louvre. L’élégance du torse, le port gracieux de la tête, l’expression de sérénité douce et majestueuse qui se dégage des moindres détails de la pose et de la figure royale ; le fini de l’exécution, en particulier dans les jointures des genoux, font de cette statue un des plus beaux modèles de l’art égyptien. Ce sont là des qualités qui ajoutent un prix inestimable à une œuvre que sa haute antiquité suffirait seule à illustrer.
Dans toutes les parties de l’architecture une ère d’apogée se manifeste. C’est le moment où les premières colonnes remplacent les lourds massifs des âges précédents ; elles sont fortes, cannelées et couronnées d’un simple dé. La sculpture adopte des formes plus allongées et plus grêles. Les bas-reliefs fouillés avec beaucoup de soin et de finesse, atteignent parfois, par un heureux rendu des détails, une expression naturelle et vraie, quoique la perspective soit tout à fait négligée. Ils sont toujours soigneusement peints. Les statues de pierre calcaire sont peintes des pieds à la tête ; quant aux statues de granit, les yeux et les cheveux seuls sont coloriés.
Malheureusement pour Thèbes, les dynasties suivantes l’abandonnèrent presque complètement et reportèrent leurs efforts vers les villes du Delta. D’ailleurs une ère de misère allait peser sur l’Égypte tout entière. Les gens du désert, les pasteurs (peut-être les Arabes et les Hébreux), envahirent le pays, détruisirent les temples, renversèrent les statues sacrées, interdirent le culte des dieux indigènes.
Il semble bien, à la vérité, que Thèbes ne fut pas touchée par eux. C’est là que se réfugièrent les restes de l’indépendance nationale ; c’est de là que partit le mouvement de résistance, qui, peu à peu, après une lutte bien des fois reprise et bien des fois abandonnée, finit par chasser les étrangers ;