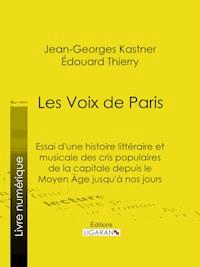
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Jamais peut-être les rapports du cri populaire avec l'organisation politique et les habitudes sociales d'une ville ne se sont révélés avec plus d'évidence que dans le Paris du moyen âge. Pour bien saisir ces rapports, qu'on jette d'abord un rapide coup d'œil sur la vieille cité qui va devenir le théâtre de nos recherches, sur la population qui se presse dans ses rues tortueuses..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les grandes cités ont un langage ; elles ont même, qu’on nous passe l’expression, une sorte de musique propre qui exprime à toutes les heures du jour le mouvement et les évolutions de la vie joyeuse ou sombre, laborieuse ou paisible, dont elles sont le foyer. Paris, par exemple, a une voix puissante, et quiconque en a entendu les frémissements aux jours d’émeute, quiconque même a prêté l’oreille dans les temps les plus pacifiques aux mille clameurs qui se croisent dans ses rues, celui-là n’oubliera jamais ce qu’il y a de caractéristique dans le chaos sonore qui berce les loisirs ou entretient l’activité du géant parisien. Le même phénomène qui nous a déjà occupé dans un ouvrage précédent se reproduit en quelque sorte ici sur un théâtre bien différent. Il y a, remarquions-nous à propos de la Harpe d’Éole il y a une musique cosmique composée de toutes les vagues et mystérieuses harmonies dont le contact des ondes aériennes avec les corps liquides ou solides est l’origine. Il y a aussi, dirons-nous, une musique sociale, une musique populaire dans un sens beaucoup plus large que celui qu’on donne généralement à ce mot. C’est l’ensemble de ces cris tantôt collectifs, tantôt individuels, qui sont comme la voix des peuples, et qui deviennent dans certaines civilisations des symboles, des formules traditionnelles affectés à certains groupes, à certaines professions distinctes. On ne peut méconnaître, comme nous le disons au commencement de l’Introduction des Voix de Paris, l’intérêt qui s’attache à l’étude des humbles manifestations, préludes de la parole et du chant, à l’étude du cri, par exemple, considéré soit comme langage des masses, soit comme accent de l’individu, et devenant entre le chant et le discours un intermédiaire trop méconnu, un agent indispensable, qui se trouve, d’une part à l’origine des langues, de l’autre à l’origine des arts lyriques. Pourquoi le musicien, qui souvent recueille comme des monuments précieux pour l’histoire de son art les mélodies informes des peuples les plus sauvages, pourquoi le musicien dédaignerait-il ces manifestations vocales, fruit du génie populaire des nations civilisées, empreintes pour la plupart d’un caractère d’originalité incontestable, et où l’on remarque souvent une énergie naïve, digne d’intéresser l’artiste, souvent aussi une fixité d’allures non moins précieuse pour l’historien ?
Il nous a semblé, quant à nous, qu’il y avait quelques découvertes à faire dans cet océan sonore, et notre première préoccupation a été d’en tirer un sujet de composition musicale. Cette idée s’était depuis longtemps présentée à notre esprit, et nous avons eu soin, pendant plusieurs années, de réunir les matériaux que nous proposions de mettre en œuvre dans un cadre spécial, où ils eussent quelque chance de se produire avantageusement. Notre collaborateur Édouard Thierry, qui, pour la Danse macabre, avait déjà su répondre de la manière la plus heureuse à un désir semblable, est venu cette fois encore remplir nos vues de tout point en créant une des œuvres les plus gracieuses et en même temps les plus spirituelles que la plume d’un poète ait jamais enfantée sur les Cris de Paris. Les contrastes sérieux et bouffons qui ressortent d’un pareil sujet, le mélange d’inspirations comiques ou sévères qu’on en peut tirer, tout cela est exprimé d’une façon délicate et ingénieuse dans une suite d’épisodes agencés avec art, et offrant au musicien une grande variété de caractères et de situations. Le style de cette œuvre, passant alternativement du ton élégiaque au ton comique ou satirique, justifie la qualification d’humoristique donnée à la symphonie. Avons-nous, de notre côté, interprété ce sujet avec autant de bonheur ? Avons-nous saisi la grâce sentimentale et l’originalité piquante qui distinguent à un si haut degré les vers charmants de notre collaborateur, et qui se font surtout remarquer dans la chanson de Dona Flor et dans les couplets du Promeneur solitaire ? Le public en décidera. Mais que nous ayons ou non touché le but, un fait nous semble acquis : c’est que les cris populaires, et même les cris industriels, offrent au musicien des sources abondantes et trop ignorées ; c’est qu’il y a là toute une région musicale bien digne d’être explorée, et où nous aurons du moins le mérite d’être entré plus résolument peut-être qu’on ne l’avait fait avant nous. Nous sommes, en effet, le premier qui ait assigné à l’interprétation musicale des cris de Paris les proportions étendues d’une symphonie vocale et instrumentale, en trois parties, où les formes de l’art les plus sérieuses, de même que les plus légères, se trouvent réunies. Jannequin, qui, au XVIe siècle, a traité ce sujet dans le style travaillé et un peu lourd du contre-point fleuri et de l’imitation, n’en a tiré qu’un simple quatuor, fait avec art il est vrai, mais dépourvu de toute espèce d’intérêt dramatique.
Une fois notre conviction arrêtée sur le caractère presque musical des cris de Paris, on ne s’étonnera pas que notre curiosité se soit portée sur le caractère historique du sujet. Ici du moins nous avions de nombreux devanciers, mais l’ordre manquait à leurs recherches. Il y avait à introduire dans l’histoire des cris populaires une pensée dominante, à en montrer le rapport avec l’histoire des langues, des arts et des sociétés, à caractériser les époques diverses qu’un examen attentif y distingue. Il y avait ensuite à établir, par des exemples choisis et commentés avec soin, l’importance des cris parisiens au point de vue musical ; il y avait enfin à tenir compte des essais d’application littéraire ou artistique qui avaient précédé le nôtre et à les apprécier rapidement.
Nous avons indiqué l’importance des cris parisiens au point de vue de l’art. Un mot d’éclaircissement à ce sujet. Certaines gens, qui se tiennent fidèlement attachés à la lettre pour mieux repousser l’esprit, seraient peut-être tentés de dire que, dans notre enthousiasme pour les voix de la capitale parisienne, nous regardons sérieusement les cris populaires comme une branche spéciale de la musique. Telle n’est pas, à coup sûr, notre pensée. Mais ce que nous admettons, il est vrai, sans réserve, comme l’ont fait d’ailleurs avant nous des hommes d’un savoir éprouvé, entre autres Rameau, c’est que ces manifestations vocales embryonnaires ont avec la musique des rapports tout à fait propres à mettre de nouveau en évidence le lien secret qui, par plus d’un point, unit l’art à la nature. Du reste, nous n’approfondirons pas davantage ici cette question : à bon entendeur, demi-mot ; à mauvais entendeur, le silence.
On voit, par ces explications, quel est l’objet du travail historique, littéraire et musical, qui précède notre composition symphonique.
Quant à l’exposé des principes qui nous ont guidé tour à tour comme historien et comme artiste, c’est à l’Introduction de les présenter. En y indiquant les raisons qui nous décident à limiter notre sujet, nous y montrons aussi combien notre cadre eût pu aisément s’élargir, et quel vaste horizon s’ouvre encore aux recherches à côté du terrain volontairement circonscrit où nous nous plaçons.
GEORGES KASTNER.
Paris, 9 mars 1857.
Le cri populaire étudié à Paris, tel est aujourd’hui l’objet de nos recherches ; mais d’abord qu’est-ce que le cri populaire en lui-même ? À quel point intéresse-t-il le philosophe, l’historien, le musicien ? Quel a été son caractère dans le passé ? Quelle place tient-il encore dans la vie moderne ? – Toutes ces questions peuvent être abordées ici, quoiqu’elles ne semblent pas rentrer dans le cadre spécial où une étude sur les cris de Paris devrait se renfermer. Cependant, elles dominent si naturellement le sujet tel que nous l’entendons, qu’avant d’aborder ce sujet même, il importe d’y répondre. Nous commencerons donc par donner quelques détails sur l’origine et le caractère du cri, considéré comme manifestation vocale, et nous espérons faire voir ainsi l’intérêt que présente cette matière au point de vue de l’art.
Le cri, pour l’individu, précède la parole, mais celle-ci ne tarde pas à le remplacer, car elle est l’expression la plus parfaite des sentiments individuels. Le cri, pour les masses, a un autre caractère. Il est en quelque sorte la parole même, et la remplace dans toutes les occasions où la vie collective cherche à s’exprimer. Dans les sociétés primitives, où les intérêts individuels sont peu développés, il a une importance considérable. Les peuplades sauvages emploient le cri aussi souvent que la parole pour communiquer entre elles. À mesure qu’une civilisation moins imparfaite substitue des intérêts plus compliqués aux intérêts collectifs, le cri lui-même tend à se rapprocher du chant et de la parole, deux des agents les plus nobles de la pensée humaine. Il perd son caractère primitif : il ne règne plus, il est soumis à des formes phonétiques supérieures. On peut donc imaginer dans les manifestations vocales trois classes distinctes : le cri coïncidant avec l’enfance des sociétés comme avec celle des individus, ensuite la parole ; enfin le chant se développant tous les deux avec leur adolescence et leur maturité. C’est pourquoi quelques auteurs distinguent dans la voix : 1° le cri ou voix native ; 2° la voix proprement dite ou voix acquise, voix sociale ; 3° la parole ou voix articulée ; 4° le chant ou voix modulée et appréciable.
La parole et le chant ont provoqué de tout temps les plus hautes méditations. C’est sur ces deux puissantes expressions du génie humain que s’est concentrée avec une prédilection légitime l’attention des historiens et des philosophes. Il y aurait cependant un intérêt très peu contestable, selon nous, à étudier les manifestations plus humbles qui précèdent la parole et le chant, à montrer dans le cri, considéré soit comme langage des masses, soit comme accent de l’individu, un intermédiaire trop méconnu entre le chant et le discours, qui se trouve, d’une part, à l’origine des langues, de l’autre à l’origine des arts lyriques. Cette importance d’une étude sérieuse du cri humain n’a pas échappé à Guillaume de Humboldt, le digne frère de l’illustre auteur du Cosmos. Guillaume de Humboldt était dirigé dans ses recherches philologiques, qui ont embrassé une grande variété d’idiomes, par la conviction que le cri est le germe de la parole et qu’il fournit les éléments des langues à mesure que la pensée ou le sentiment se transforme en accents articulés, également distincts du cri des animaux et du chant, mais participant à l’origine de l’un et de l’autre. Les dernières recherches de Jacob Grimm ont confirmé ce principe, en prouvant que la plupart des radicaux sont des verbes, en d’autres termes des cris imitatifs, signifiant une action, tels que le radical ro, qu’on retrouve dans rollen, rouler, can, qu’on retrouve dans Hahn, le coq ou l’oiseau chanteur, etc. L’opinion de Charles Nodier n’infirme nullement celle des philologues étrangers dont on vient de lire les noms. L’auteur des Onomatopées de la langue française a écrit sur ce sujet les lignes que nous reproduisons ici :
« En considérant, avec tous les philosophes qui ont analysé la parole, les sons simples ou vocaux comme la première langue de l’homme, et en passant de là aux sons compliqués ou consonants qui ont dû se succéder suivant le degré de facilité de leur prononciation, nous verrons les langues s’enrichir d’une immense famille d’expressions également naturelles, et c’est ce que j’appelle la langue puérile, parce qu’elle se retrouve tout entière dans le premier langage des enfants. »
« Le désir, la haine, l’épouvante, le plaisir, toutes les passions que peut éprouver l’homme si voisin de son berceau, ne se manifestent d’abord que par une émission de sons simples, de cris ou de vagissements. C’est sa langue vocale. »
« Il invente de nouvelles lettres, à mesure que ses organes se développent, et qu’il commence à juger de leurs rapports et de leurs actions réciproques. Il apprend l’emploi des touches de la parole. C’est sa langue consonante ou articulée. »
« Mais comme il ne s’en instruit que lentement et dans un ordre successif, en allant du plus simple au plus composé, les sons dont l’artifice est le plus facile sont les premiers qu’il saisisse, et par conséquent les premiers qu’il attache à ses idées. Telles sont les lettres labiales, etc.. » L’auteur du Mémoire sur l’origine psychologique et physiologique des sons articulés et de l’Orthophonie, ouvrage couronné par l’Académie des sciences, le docteur Colombat (de l’Isère), va plus loin que Guillaume de Humboldt et Charles Nodier. Il prétend que les émissions vocales seules ne constituaient pas le langage primitif de l’homme et que ce langage devait comprendre aussi les sons articulés. « C’est dans l’instrument vocal, dit-il, qu’il faut chercher les premiers éléments du langage, et non dans l’industrie humaine qui ne les créa pas, qui ne fît que les combiner de mille manières, à mesure que le goût se perfectionna et que le cercle des idées s’agrandit. On peut donc dire que les sons articulés sont aussi naturels à l’homme que les cris chez les animaux qui bêlent, qui mugissent, qui miaulent, qui aboient, qui sifflent ou qui gazouillent. De même que la musique est fondée sur des sons qui ne dépendirent jamais du musicien ; la peinture sur des couleurs primitives que l’art ne créa pas ; la géométrie sur les rapports et les proportions immuables des corps ; de même les éléments de la parole, c’est-à-dire les sons articulés, ne dépendirent pas de l’intelligence humaine, qui, nous le répétons encore, ne fit que les disposer de manière à former les mots et les phrases… C’est donc à tort, ajoute le même écrivain, que tous les philosophes et les physiologistes qui se sont occupés de la parole, ont dit que les voyelles étaient seules des sons primitifs ou naturels, mais que les consonnes ou articulations consonantes, dont Court de Gébelin, M. Nodier et quelques autres, ont voulu nous donner l’histoire, n’étaient que des sons artificiels, et, de même que les mots, des inventions humaines. » Le docteur Colombat retrouve les unes et les autres dans les cris des animaux et dans certains bruits de la nature, par exemple, ceux du vent, d’une goutte d’eau qui tombe, celui d’une scie, d’un marteau, le choc d’une pierre, d’une cloche, d’un fouet, du feu qui pétille, du tonnerre, du liquide qui s’échappe par une ouverture étroite, d’un fleuve qui coule, d’une cascade, etc.. Tous ces bruits qui, suivant lui, ont aidé à la formation du langage des peuples civilisés, ne sont pas restés étrangers non plus à l’invention de la musique. Nous pensons avoir suffisamment démontré dans notre ouvrage sur la harpe d’Éole, que, renfermant en germe des sons musicaux, ils ont vraisemblablement servi à doter cet art d’une multitude de ressources. Ils forment donc en quelque sorte tout à la fois la matière de la musique et celle de la parole. Dans les sons du langage primitif de l’homme, dans les simples cris exprimant ses sensations, on peut retrouver les éléments du chant artificiel, comme on retrouve dans certaines manifestations sonores de la nature inorganique le principe des combinaisons instrumentales. Considéré à ce point de vue essentiellement philosophique, le cri offre au musicien, de même qu’au physiologiste et au philologue, un sujet d’étude qui n’est pas à dédaigner, ainsi que l’a fait voir, un des premiers, le docte Rameau.
Si donc on voulait prendre le cri humain pour guide, en quelque sorte, à travers les formes plus ou moins distinctes qu’a revêtues la parole chez les divers peuples et aux divers âges, on le verrait exprimant d’abord les passions simples des sociétés embryonnaires, puis se disciplinant, s’assouplissant à mesure que les langues grandissent, pour prendre enfin la forme demi-musicale, demi-verbale, qui le recommande surtout à notre attention. Dans cette forme perfectionnée, le cri n’est plus un bruit rude et grossier, dont l’intonation précise échappe aux règles de l’art ; c’est une manifestation vocale qui a son rang marqué dans l’échelle régulière des sons. Aussitôt que le cri est le produit d’un mode de vibration appréciable, il est du ressort de la musique, et alors, comme il arrive en pareil cas pour une foule d’autres bruits naturels, il peut être facilement noté.
Les sons radicaux au moyen desquels l’homme, dans l’enfance des sociétés, exprime les impressions qu’il reçoit des objets extérieurs, les sentiments divers qui agitent son âme, désir, joie, douleur, amour, haine, épouvante, etc., n’ont pas été tout à fait rejetés du langage des peuples civilisés. Voix naturelles de la passion, ils en sont encore les interprètes les plus directs, les plus intelligibles et les plus éloquents. Dans le discours oratoire, dans l’idiome poétique, dans la musique même, ils interviennent avec succès pour peindre les émotions vives, imprévues, pour ajouter à la force de la pensée, et quelquefois pour exprimer, de la manière la plus laconique sans le secours des mots, une impression, un mouvement rapide de l’âme. Le langage des hommes instruits ne les admet néanmoins qu’avec réserve et discernement ; celui des gens du peuple les prodigue. Les exclamations de toute nature sont rangées systématiquement et analysées par les grammairiens sous le nom d’interjections, d’un mot latin qui veut dire jeté au milieu, parce que ces sortes de cris sont comme jetés au milieu du discours.
« Les interjections, dit l’abbé Sicard, ne peuvent être renvoyées à aucune classe de mots ; elles doivent faire une classe à part. Elles ne sont étrangères à aucun peuple, parce que l’homme est le même partout ; partout il est également susceptible d’étonnement et d’admiration. L’expression de ces mouvements spontanés de l’âme est partout commandée par les objets qui causent ces mouvements sans que l’esprit soit appelé à en délibérer. La corde du cœur reçoit la vibration sans qu’il soit au pouvoir de l’organe de retenir le son qui lui est imprimé… L’interjection n’est donc pas, comme le mot en général, le signe de la simple idée. Elle est le signe de la sensation même dont l’idée est l’effet… Une âme froide et didactique expose ce qu’elle voit, fait connaître ce qu’elle veut sans éprouver le besoin de l’interjection. Une âme de feu s’interrompt quand elle raconte, quand elle voit, quand elle peut, quand elle veut, et ces interruptions sont des traits de flamme rendus par des interjections. »
Les interjections qui répondent aux sons simples et primitifs sont généralement monosyllabiques, et à peu près les mêmes dans tous les idiomes connus. La joie, la douleur, la surprise, l’effroi s’expriment ordinairement par des voyelles, dont l’intonation fondamentale change peu, mais dont les inflexions varient eu égard au système de prononciation adopté dans chaque langue. Ces inflexions sont souvent représentées par des consonnes, dont le rôle est quelquefois de faire sentir plus fortement la vivacité du sentiment qui engendre le cri involontaire. S’il est aisé de représenter cette sorte de cri au moyen des lettres de l’alphabet, à plus forte raison peut-on le reproduire exactement à l’aide des signes graphiques de la musique dès que l’oreille parvient à en saisir l’intonation. Le docteur Colombat, que nous avons déjà cité, et dont les travaux ont eu principalement pour objet l’étude de la voix humaine et la guérison des maladies auxquelles elle est sujette, a recueilli, dans l’intérêt de son art, un grand nombre d’interjections naturelles, particulièrement celles de la douleur. C’est une idée qu’au premier abord on trouve singulière, mais que le docteur français n’a peut-être pas eue le premier. Nous nous souvenons parfaitement d’avoir vu à Stuttgard, chez le docteur Schilling, longtemps avant la publication de la troisième édition de l’Orthophonie ou Traité des vices de la parole, la seule qui contienne les exemples de musique dont nous allons parler, un numéro d’un journal allemand dans lequel étaient notés aussi des cris de blessés, que l’écrivain, auteur de l’article, disait avoir recueillis dans un hospice pendant de pénibles opérations chirurgicales. À cette époque, le temps nous manqua pour prendre copie de ce document, qu’il nous a été impossible de retrouver ; nous le regrettons à présent d’autant plus qu’il n’eût pas été inutile de comparer ces cris de la douleur physique avec ceux que rapporte le docteur Colombat au chapitre II de la première partie de son ouvrage. Ce chapitre est intitulé : Mécanisme des cris et leur intonation dans les douleurs physiques et morales, et dans différentes inflexions vocales affectives. On y trouve des observations intéressantes sur le mécanisme de la formation des cris. La physiologie, aidée de la science anatomique, nous apprend qu’il ne diffère pas essentiellement de celui des autres phénomènes vocaux. Il peut se rapporter tout à la fois à la formation des sons les plus graves de la voix et à celle des sons aigus du fausset. En général, le ton des cris est beaucoup plus intense que celui des autres émissions vocales, et il offre toujours quelque chose d’aigre qui blesse l’oreille, et qui est susceptible de mille nuances. On doit encore observer que le diapason des cris dépend du timbre naturel de la voix, et qu’il est par conséquent variable à l’infini chez les individus qui les profèrent dans de semblables circonstances. Il n’est cependant pas impossible, comme on le verra tout à l’heure, de les exprimer approximativement par des chiffres ou des signes de musique.
Les cris et les autres inflexions affectives sont chez l’homme, composés de deux intonations distinctes produites avec leurs diverses modifications par des efforts particuliers et des contractions exagérées de l’organe vocal. « Le son qui est d’abord grave, dit le docteur Colombat, devient subitement plus ou moins aigu ou plus ou moins prolongé, et ces deux intonations presque simultanées, dont la réunion forme le cri, présentent des intervalles toniques qui sont toujours semblables chez les individus se trouvant dans les mêmes conditions physiques et morales, mais qui changent à l’infini selon l’expression et la douleur auxquelles les différents cris se rapportent. Il y a donc deux sons dans la formation du cri : le premier qui est très bref et dont le diapason est aussi variable que le timbre naturel de la voix, se confondant avec le second qui est plus prolongé, et qui correspond selon la nature du cri à la tierce, à la quarte, à la quinte, à l’octave de son congénère, ou enfin, ce qui a lieu le plus souvent, à une des notes aiguës du faucet. Nous ferons d’ailleurs remarquer que ce n’est pas seulement dans notre espèce que les cris sont formés par deux intonations, mais que presque tous les animaux vertébrés, ceux surtout qui ont été classés, comme l’homme, dans l’ordre des mammifères, font entendre des cris composés d’au moins deux sons différents, des accents et des intervalles qui diffèrent dans chaque espèce, mais qui sont variables chez les individus de la même espèce et se trouvant impressionnés par les mêmes causes. » Ici le docteur essaie de reproduire, d’après les principes de la notation musicale, les cris qu’il a eu l’occasion de recueillir près du lit de ses malades. Ces exemples viennent à l’appui de sa théorie, mais celle-ci est-elle de tout point fondée ? C’est une question à laquelle on ne saurait répondre qu’après un mûr examen et un certain nombre d’expériences nouvelles. D’ailleurs le docteur Colombat avoue lui-même que le mécanisme des divers phénomènes vocaux est recouvert d’un voile qu’on ne pourra jamais soulever qu’imparfaitement. Tout ce que nous pouvons dire à ce sujet, c’est que le petit nombre de cas analogues dont nous devons la connaissance au hasard, confirment en partie les assertions qui précèdent. La nomenclature que nous allons mettre sous les yeux du lecteur est d’un caractère passablement lugubre. Rien qu’à la pensée des horribles souffrances qui ont déterminé l’émission de ces cris on se prend à frissonner. La plume qui transporte froidement sur le papier ces inflexions déchirantes, semble écrire sous la dictée du scalpel ou du bistouri. Du reste le but de l’auteur du Traité des vices de la parole en traçant ce tableau phonétique des plaintes humaines est purement scientifique. Il veut mettre les médecins à même de porter un diagnostic plus sûr dans certaines affections, et se flatte de pouvoir leur épargner ainsi bien des erreurs de jugement. Mais s’il est avantageux pour les pathologistes et les chirurgiens opérateurs d’avoir toujours présentes à l’esprit les intonations de la douleur suivant les maladies, les symptômes et le genre d’opération, peut-être les compositeurs de musique dramatique et les chanteurs chargés d’interpréter leurs ouvrages, qui doivent aussi se livrer à une étude approfondie des maux et des passions de l’humanité afin d’en transporter la peinture dans la sphère idéale où s’élaborent les œuvres de l’art, peut-être, disons-nous, seraient-ils également intéressés à garder le souvenir des expériences du docteur Colombat, surtout quand ils ont à interpréter des situations pathétiques où les personnages de leurs drames se débattent violemment au milieu des tortures physiques ou morales d’une angoisse suprême, comme par exemple Desdemona en butte aux fureurs d’Othello. L’art en ces situations extrêmes, sans renoncer tout à fait à ses droits, laisse parler la nature ; alors interviennent parmi les intonations de la phrase déclamée ou chantée, tantôt des soupirs, tantôt des sanglots, tantôt des gémissements et quelquefois de véritables cris. Mais avant de constater le rôle important donné aux exclamations affectives dans les compositions musicales, essayons d’indiquer la part qui leur est faite dans la réalité. Nous commencerons par les cris de douleur ; aussi bien n’en est-il pas qui soient plus étroitement et plus généralement liés aux diverses phases de la vie de l’homme.
Ceux que le docteur Colombat a observés comme médecin sont de plusieurs espèces et classés systématiquement. Il y a d’abord le cri déterminé par l’application du feu (Pl. I, série A, n° 1), cri grave et profond parcourant un intervalle de tierce et représenté par l’e muet suivi de l’interjection ah ! Il y a ensuite le cri déterminé par l’action d’un instrument tranchant (n° 2). Ce dernier cri se compose d’un premier son très rapide et d’une note très aiguë du registre de fausset sur laquelle il se prolonge. Il est perçant et composé des sons vocaux e, ah ! e, ah ! la la. Nous avons eu l’occasion d’entendre une manifestation sonore du même genre provoquée par une coupure involontaire (n° 3). L’exemple que nous rapportons contient aussi deux intonations principales liées l’une à l’autre par une suite d’inflexions chromatiques. Ce second cri est moins aigu que le précédent ; il est vrai que le patient cherchait le plus possible à l’étouffer. Cette lugubre nomenclature nous offre encore les sons vocaux résultant des douleurs pulsatives et généralement désignés sous le nom de gémissements. Ils sont au nombre de quatre et presque tous d’égale durée. Ils forment pour la première note la voyelle a et pour les trois autres la syllabe on traînée en decrescendo (n° 4). Il y aurait peu de chose à changer pour convertir ce petit nombre de notes en une figure d’accompagnement tout à fait dans le caractère de la musique plaintive. Rien de plus émouvant, de plus terrible que le cri produit par les douleurs lancinantes (n° 5). La voix y exécute dans la région suraiguë une sorte de battement ou de tremolo que l’homme le plus indifférent aux maux de ses semblables ne peut entendre sans émotion. Cette forme vocale n’indique pas seulement une douleur physique extrêmement intense ; elle est tout aussi bien l’expression d’une affection morale atteignant le paroxysme du désespoir, de la rage ou de la colère. Nous en donnerons un exemple plus loin. Deux fois en notre vie des cris de détresse de l’effet le plus déchirant ont frappé notre oreille. La première fois ils étaient poussés par un homme qui s’est donné volontairement la mort, il y a quelques années, à Versailles, en se précipitant par une fenêtre de la hauteur d’un troisième étage. Nous passions près de l’endroit où il venait de tomber, sa chute avait été horrible ; il avait les membres brisés : il faisait entendre d’une voix claire et stridente le sinistre tremolo dont nous parlions tout à l’heure (n° 6). La seconde fois qu’il nous fut donné d’observer un fait du même genre, les cris de douleur étaient moins des cris aigus que de lamentables gémissements : une vive souffrance les arrachait à un pauvre diable qui, pour échapper aux flammes d’un incendie dont sa maison allait être la proie, eut la malheureuse idée de se jeter d’une fenêtre élevée dans un fossé plein d’eau baignant les murs de son habitation. Il était tombé sur un poteau planté dans ce fossé et s’était fait une blessure mortelle. Nous entendons encore ses plaintes répétées uniformément sur la syllabe oh ! Elles nous sont tellement présentes à l’esprit que nous pouvons les reproduire ici fidèlement (n° 7). Après avoir signalé d’autres émissions vocales déterminées par les douleurs gravatives (n° 8), – lesquelles ressemblent beaucoup aux cris produits par les douleurs pulsatives, – le docteur Colombat, selon l’habitude des savants qui reprennent volontiers toute chose ab ovo, n’hésite pas à pousser ses investigations jusque dans le domaine de la chaste Lucine. Là, comme conséquence de l’arrêt qui frappa la femme au sortir de l’Éden, s’élèvent par intervalles des cris terribles, les plus intenses de tous et ceux dont le caractère particulier est le plus remarquable (n° 9). Ils sont bientôt suivis d’intonations également étranges, mais plus faibles. C’est la plainte qui annonce la naissance d’un être humain ; c’est un vagissement (n° 10). Nous ne rapportons ces deux derniers cris que pour ne point laisser incomplète la liste des cris de douleur physique tracée par le docteur Colombat ; on pense bien que nous n’engageons nullement les artistes à les reproduire. Il est peu probable d’ailleurs que ceux qui cultivent aujourd’hui avec le plus de hardiesse et de succès la musique imitative, aient jamais la fantaisie de suivre l’exemple d’un de leurs ancêtres, du poète musicien Timothée de Milet, condamné avec la dernière rigueur par les éphores de Lacédémone pour avoir imité d’une manière indécente, dans la musique d’un poème sur l’accouchement de Sémélé, les cris d’une femme en proie aux douleurs de l’enfantement.
Les inflexions vocales affectives provoquées par diverses causes terminent la curieuse étude que nous reproduisons. Elles se bornent au cri de joie (n° 12), au cri de vivat (n° 13), au cri d’appel (n° 14), au cri d’effroi (n° 15), au cri du sanglot (n° 16) et au cri du dégoût (n° 17). Cette nomenclature laisse beaucoup à désirer ; elle pourrait être plus complète et le classement des cris plus rationnel. Telle qu’elle est pourtant, elle contient des renseignements utiles pour les artistes, et l’intérêt que ce genre de recherches peut leur offrir n’échappe pas à l’écrivain que nous citons. C’est ce qui lui fait dire : « Ayant toujours présentes à la mémoire l’échelle des passions et des affections vives et soudaines de l’âme, les musiciens parviendront plus facilement à faire de la musique imitative et expressive, et les comédiens à varier et à reproduire d’une manière naturelle toutes les inflexions vocales qui se rapportent à la situation actuelle des personnages dont ils jouent le rôle. C’est cette connaissance, en quelque sorte instinctive chez les grands acteurs, qui faisait que Talma avait des intonations vocales aussi justes. » Les grands chanteurs possèdent aussi cette connaissance instinctive qui se révèle non seulement dans le soin qu’ils ont de reproduire exactement la note qu’ils chantent, mais encore dans le choix de l’inflexion dont ils accompagnent cette reproduction de la note conformément au sens des paroles et au caractère de la situation. Cette modulation particulière de la voix, – d’ailleurs susceptible de mille nuances et complètement indépendante de l’exécution musicale, considérée au point de vue technique, – constitue l’expression proprement dite.
Pour saisir l’accent vrai, pathétique, les chanteurs, de même que les compositeurs, doivent s’appliquer à connaître les caractères distinctifs que la nature attache à la manifestation des impressions, des sentiments qui naissent chez l’homme dans toutes les conditions de la vie. La grande école où s’est formée la cantatrice illustre qui, dans le rôle de Desdemona dont nous parlions tout à l’heure, a su tant de fois, par son jeu passionné, émouvoir le public jusqu’à la terreur, comme elle savait le charmer jusqu’à l’extase par la perfection de son chant, l’école des Garcia, sur laquelle le nom de Malibran répand une gloire ineffaçable, est une de celles qui comprennent le mieux l’importance de cet objet. Son code par excellence, la belle et savante méthode de Manuel Garcia, que l’on doit regarder comme un véritable traité philosophique de la théorie et de la pratique du chant, renferme une exposition systématique des différents procédés matériels au moyen desquels un artiste parvient à exprimer tous les effets de la passion. Souvent ces moyens sont irréguliers, et en apparence défectueux. Ce sont, entre autres, les altérations diverses de la respiration normale employées avec succès pour produire le rire, les soupirs, les plaintes, les sanglots et même le râle. Le rire, sorte de spasme convulsif, sur lequel le comte de Cramaille a écrit un traité spécial, et que les médecins ont quelquefois désigné sous le nom de vibratio diaphragmatis, procède par des saccades ou secousses plus ou moins fortes de la voix qui parcourt alors, en montant et en descendant, une gamme peu régulière, mais assez étendue. Les soupirs, en général, dont le nom a passé à l’un des signes de la notation musicale et à ses dérivés, comme si le choix de cette dénomination mélancolique était fait en vue de donner raison au vieux proverbe :
Tel chante qui au cœur n’a joie,
les soupirs, disons-nous, sont produits dans toutes leurs variétés par le frottement plus ou moins fort, plus ou moins prolongé de l’air contre les parois du gosier, soit que l’on introduise l’air dans la poitrine, soit qu’on l’en chasse. Au moyen d’une aspiration forte et saccadée, on a le sanglot (n° 18) ; au moyen de l’expulsion de l’air effectuée dans de certaines conditions, on a les soupirs proprement dits (n° 19). Si on laisse d’abord tomber la voix pour la chasser ensuite, on obtient la plainte (Pl. II, n° 20).
Le tremblement du son, ce que Manuel Garcia appelle l’émotion de la voix, convient parfaitement à l’interprétation des affections vives de l’âme. Il exprimera tour à tour l’agitation causée par l’effroi, l’indignation, la joie, la colère, les remords, le désespoir, en un mot, par les sentiments les plus divers. Laissons parler ici l’excellent maître qui donne ces préceptes, à l’appui desquels il cite de nombreux exemples choisis avec autant de goût que de discernement : « Lorsque la même agitation est produite par une douleur si vive qu’elle nous domine complètement, l’organe éprouve une sorte de vacillation qui se communique à la voix. Cette vacillation s’appelle tremolo. Le tremolo motivé par la situation et conduit avec art est d’un effet pathétique assuré. » Ici Manuel Garcia rapporte un passage tiré de la partition des Huguenots de Meyerbeer, celui où Valentine, frappée d’épouvante à l’idée du danger qui menace les jours de Raoul, s’écrie hors d’elle-même :
« Ah ! ma raison s’égare, ah ! forfait exécrable, Raoul, ils te tueront… Ah ! pitié, je meurs, ah ! » « Ne chantez pas, dit le maître, mais déclamez avec une voix déchirante, et dans le plus grand désordre, les mots : Raoul ! ils te tueront. Puis, la respiration oppressée et défaillante, achevez les mots : Ah ! pitié ! je meurs, ah ! » Dans cet exemple (n° 21), les lignes tremblées indiquent les endroits où la voix éprouve cette vacillation destinée à peindre surtout les grandes douleurs, les douleurs lancinantes d’un cœur profondément blessé. On est tenté de reconnaître ici une application tout artistique de l’effet vocal particulier au cri de détresse dont nous avons parlé plus haut (voy pl. I, n° 5), nous voulons dire cette espèce de tremolo pratiqué dans la région suraiguë par la voix d’une personne en proie aux souffrances physiques les plus intenses. Les moyens employés pour varier l’expression musicale ne se réduisent pas à ceux que l’on vient d’indiquer. L’emploi des deux timbres caractéristiques que chaque son peut recevoir, le timbre sombre et le timbre clair, susceptibles eux-mêmes de nombreuses modifications, fournissent encore une précieuse ressource à l’artiste intelligent. Les timbres font si essentiellement partie du discours, ils sont la condition si vraie d’un sentiment sincère, qu’on ne saurait en négliger le choix sans tomber immédiatement dans le faux. Ce sont eux qui révèlent le sentiment intime, que les paroles n’expriment pas toujours suffisamment, et que parfois même elles tendent à contredire. Manuel Garcia, à qui nous empruntons ces lignes, développe, relativement à l’emploi des timbres, une foule de considérations extrêmement judicieuses et d’un ordre élevé ; mais comme elles s’éloignent de notre sujet, nous nous en tiendrons à celles qu’on vient de faire connaître, pensant qu’elles suffisent pour donner une idée des différents moyens mis en œuvre par les chanteurs pour exprimer les inflexions affectives. Ainsi que le fait observer le savant professeur, ces deux premières séries de faits, produits par l’altération de la respiration et par l’emploi des divers timbres, forment une langue inarticulée, composée de pleurs, d’INTERJECTIONS, de CRIS, de soupirs, etc., qu’on pourrait nommer proprement le langage de l’âme. Ces moyens émeuvent plus puissamment encore que la parole, et prennent naissance principalement dans les poumons et le pharynx. La connaissance exacte de cette dernière partie de l’instrument vocal, dans ses rapports avec ce genre de produits, doit être familière à tout chanteur dramatique, et deviendra la principale source de ses succès. Naturellement, en cela comme en toute chose, il se conformera aux règles du goût. Il n’abusera pas de ces effets et ne les exagérera point. Il imitera la sage réserve d’un acteur dont parle Chabanon. Cet acteur, à la première représentation d’Orphée, avait mis trop de vérité dans le cri déchirant qui perce, par intervalles, à travers le chant des Thraces éplorés ; il s’en aperçut et s’adoucit. D’autres artistes ont été moins prudents. À force de chercher la vérité d’expression dans la déclamation et dans le chant, ils sont arrivés à chanter et à déclamer d’une manière peu naturelle et même ridicule. On cite souvent, comme étant tombés dans ce défaut, Lainé et Adrien, deux chanteurs de l’ancienne école française. Ils avaient fait dégénérer en charge l’expression dramatique. « Dans leur manière de scander la parole, la voix ne sortait que par éclats et avec effort ; en sorte que les sons ne se produisaient plus que sous l’aspect de cris souvent fort désagréables. » Un mot qui a joué un grand rôle dans les querelles musicales du XVIIIe siècle, et qui est toujours un des lieux communs de la conversation en France, ce mot, cette accusation que l’on ne chante pas, mais que l’on crie à l’Opéra, doit en partie son origine à l’abus que nous signalons. Peut-être ce reproche a-t-il eu quelque fondement ; peut-être aussi, en le formulant, ne s’est-on pas assez souvenu que si les acteurs crient à l’Opéra plus souvent qu’ailleurs, c’est que les situations fortes et les grandes péripéties dramatiques y sont beaucoup plus fréquentes qu’il n’arrive sur d’autres scènes comportant des styles et des genres différents. De là, dans les opéras, des explosions vocales analogues à celles qui se font entendre dans les tirades de tragédie ; la voix y acquiert un degré d’intensité en rapport avec la véhémence du sentiment passionné qu’elle interprète ; elle sort du ton ordinaire de la déclamation, et produit des intonations qui, autant par le contraste que par l’effort, ressemblent à des cris.
Le Kain et Talma déclamaient certains passages de leurs rôles, avec une puissance d’organe et une impétuosité qui devaient faire aussi l’effet de véritables cris sur le spectateur. Les compositeurs français, presque tous partisans de la vérité d’expression, s’appliquent d’ordinaire à caractériser l’explosion du sentiment dramatique au moyen de combinaisons autant que possible neuves et imprévues. Ces combinaisons sont très souvent dissonantes. Il n’en faut pas davantage pour surprendre une oreille inexpérimentée. La dissonance mise en relief par l’intensité de l’émission vocale devient, pour cette oreille novice, un son désagréable, confus, et à peu près semblable à un cri. Il nous est arrivé plus d’une fois de nous trouver au théâtre à côté de gens qui ne manquaient pas d’accuser avec beaucoup d’aplomb des virtuoses célèbres de crier ou de détonner, toutes les fois que ceux-ci faisaient entendre d’une voix parfaitement juste, mais non sans quelque effort, dans la région la plus élevée de l’échelle vocale, une dissonance un peu forte amenée, soit par un retard ou une suspension, soit par un accord altéré d’un emploi peu fréquent ; au surplus, il est inutile de nous arrêter plus longtemps à cette acception du mot crier qui, on le voit, a un sens figuré et se dit en mauvaise part pour signifier une manière défectueuse de chanter en forçant l’intensité des sons. Revenons aux cris proprement dits. Ceux dont l’intonation est confuse et insaisissable ne sont point tolérés sur la scène lyrique, à moins qu’ils ne résultent d’un mouvement nerveux et spontané de surprise, de douleur, d’effroi, etc., pendant lequel la voix sort involontairement de ses limites, comme entraînée par l’impulsion anormale imprimée à tout l’organisme. On a des exemples de cris naturels inarticulés et dépourvus d’intonation, que de grands chanteurs ont ajoutés à leur rôle pour augmenter l’effet du jeu scénique et produire plus d’illusion dans ce qu’on appelle les coups de théâtre, en termes de coulisses. Du reste, quand le cri est absolument nécessaire, le compositeur le note lui-même sous forme d’interjection ou d’exclamation, par exemple : ah ! hélas ! ô ciel ! grand Dieu ! etc. Nous savons, d’ailleurs, que ces éléments du langage primitif, embellis par les procédés de l’art, interviennent avec autant de succès dans les phrases musicales que dans les périodes du discours ; seulement, il faut qu’ils y soient convenablement amenés, et de tout point motivés par la situation. Il y a de grands mouvements scéniques interprétés uniquement par un son, par un accord, placé sur une interjection. Il y a des dénouements qui ont lieu au moyen de simples exclamations affectives. Le final du troisième acte de l’opéra d’Otello conclut par un accord isolé, dissonant, sans résolution dans le chant (l’accord de neuvième mineure du ton de mi bémol), que font entendre comme un cri de surprise et d’horreur, sur le monosyllabe ah ! les voix réunies du Doge, de Rodrigue, d’Elmiro et du chœur, au moment où le Maure met fin à ses jours. Avons-nous besoin de rappeler l’effet produit par cet autre cri : Grâce ! grâce ! dans l’air de Robert le Diable, dont tant de voix féminines ont essayé de rendre les inflexions profondément touchantes et pathétiques ? Notre art a des ressources tellement nombreuses, tellement variées, pour traduire les manifestations spontanées du cœur que, si nous tenions à multiplier ici les exemples, nous n’aurions que l’embarras du choix. Habile à exprimer les accents de la joie, la musique l’est surtout à rendre ceux de la douleur. Il y a tant de vérité, tant de puissance dans son langage, qu’elle excitera notre effroi ou notre attendrissement par le spectacle de maux imaginaires. Elle viendra nous faire entendre les plaintes d’un mourant, et nous, tout en prêtant à la voix de l’acteur une oreille charmée, c’est à peine si nous remarquerons que nous prenons intérêt à un personnage qui meurt en chantant. Grétry, observateur trop exact peut-être des rapports de la musique et de la déclamation, relève cette particularité pour avoir un argument de plus à présenter en faveur de son système. Il écrit dans ses Mémoires : « L’on permet à la musique d’imiter les accents qui naissent de la joie ; mais exprimer la douleur, mourir en chantant ; quelle folie ! disent les ignorants. Pourquoi donc ? C’est, au contraire, l’extrême douleur, les cris de désespoir, qui nous donnent les accents les plus rapprochés de la musique imitative. Écoutez cette mère éperdue qui retrouve son fils percé de coups, ou que les flots ont rejeté sur le rivage :
Elle changera vingt fois de modulation pour dire ces paroles ; je défie le musicien le plus ignare de ne pas noter ces accents : voilà la nature. »
Ne croyons pas que de telles remarques sur le côté philosophique de la musique appartiennent exclusivement au génie de l’art moderne. Dès la naissance du drame lyrique, il s’est trouvé des hommes instruits, d’habiles théoriciens qui ont essayé de tracer les premières règles de l’expression musicale. Parmi les indications qu’ils nous fournissent sur cet objet, ils n’oublient pas la manière de traduire en sons les élans irréfléchis de l’âme qui prennent la forme interjective. Le savant Doni, entre autres, fait remarquer que l’intervalle de tierce mineure convient parfaitement pour rendre les exclamations, et il en donne pour exemple un passage de l’Euridice où cet intervalle est employé deux fois sur les mots O fato, O cieli ! (n° 22). On voit par là que de tout temps les minutieux détails relatifs au mécanisme de l’expression ont occupé les compositeurs, et qu’ils n’ont jamais complètement négligé l’étude des sons rudimentaires de la passion, ces sons que les chanteurs durent étudier à leur tour et auxquels on peut assigner pour base, comme nous l’avons dit, les inflexions naturelles décrites plus haut.
Les faits qui viennent d’être passés en revue nous paraissent établir suffisamment le rapport qu’ont avec l’art les manifestations sonores désignées sous le nom de cris, soit qu’elles proviennent de sensations purement physiques, soit qu’elles dérivent des seules affections de l’âme. Nous continuerons de les étudier succinctement sous leurs divers aspects dans la réalité. Montaigne, dans le langage pittoresque qui lui est familier, se charge de nous en révéler le côté utile. Il prétend que les cris évaporent la douleur et que l’exercice de crier est un exercice salutaire. Les médecins sanctionnent cette opinion. Ils sont d’avis que les cris arrachés par les douleurs physiques contribuent à rendre celles-ci très supportables, et qu’il faut les regarder comme un mouvement efficace qui concourt à généraliser le mal pour en diminuer l’intensité. Cette propriété remarquable nous explique l’origine des cris de labeur qui accompagnent l’exécution d’un travail corporel quelconque, comme s’ils étaient destinés précisément à évaporer la douleur, née ici de la peine ou physique ou morale, de l’ennui ou de la fatigue, et souvent de tous les deux à la fois. Ce qui prouve que cette conjecture est fondée, c’est que les plus simples, les plus élémentaires de ces manifestations, se produisent sous la forme de plaintes, de gémissements, quand elles répondent à l’effort violent d’un rude labeur. Le cri du geindre, dont le compositeur favori des classes populaires, Adolphe Adam, a noté les lamentables accents pour en former le refrain d’un de ses Chants de métier (voyez pl. II, série À, n° 5), et celui des bateliers du Nil qu’un des savants qui firent partie de l’expédition d’Égypte, que l’ingénieux Villoteau, recueillit au moment où ces bateliers, après avoir été obligés de se mettre à l’eau et de s’adosser aux flancs de la barque pour la désengraver, la poussaient avec effort (voy. pl. II, n° 23, a, b, c), ont bien le caractère plaintif et douloureux commun aux manifestations vocales qui se produisent pendant l’accomplissement d’une tâche pénible. Le cri qui accompagne un effort violent dure autant que cet effort et se renouvelle avec lui ; si l’action musculaire admet des intervalles égaux, la répétition du cri a lieu régulièrement, mais presque toujours avec les mêmes inflexions vocales. Dans les deux cas signalés plus haut, dans le premier surtout, le travailleur exécute des mouvements qui introduisent une certaine gêne dans sa respiration et qui lui rendent par conséquent impossible la production et l’émission d’intonations musicales diversement prolongées et modifiées. Il se borne donc à exhaler périodiquement, et d’une manière uniforme, la plainte, le cri que lui arrache l’effort matériel auquel son travail l’oblige, et ce cri, tel qu’il est, suffit pour lui apporter quelque soulagement. Au contraire, quand les mouvements s’effectuent avec régularité et sans nécessiter un déploiement anormal des forces musculaires, l’ouvrier, l’artisan, plus libre, plus dispos, songeant moins à la fatigue, est instinctivement porté, par suite de la secrète influence du rythme, à joindre au bruit de son travail les sons variés de sa voix, de manière à se procurer non seulement un soulagement physique, mais une jouissance morale, une distraction.
Ces sons, qui forment en quelque sorte l’accompagnement du bruit matériel que fait l’ouvrier en travaillant, servent aussi à régler les mouvements qu’il exécute, de manière à les faciliter. Ils tiennent, en outre, son esprit plongé dans une vague et douce rêverie, dont le charme est d’autant plus réel pour lui qu’il ne songe pas à s’en rendre compte. Selon son humeur, l’impression du moment, le plus ou moins de développement de son intelligence, il varie et modifie, au moyen de sons gais ou tristes, la figure rythmique calquée sur les mouvements mécaniques de sa tâche, et bientôt son cri, prenant un caractère mélodique de plus en plus prononcé, devient un chant. Nous n’avons pas d’exemples plus heureux à donner de cette espèce de transformation que les cris de manœuvre où les matelots introduisent des inflexions souvent très gracieuses et très pittoresques. Un de nos amis, M. Oscar Comettant, littérateur distingué, pianiste élégant, et compositeur habile, a recueilli dans ses voyages en Amérique un de ces chants de manœuvre qui avait principalement fixé son attention (pl. II, n° 20). Il a bien voulu nous en donner une copie et y joindre l’explication suivante que tout le monde lira avec intérêt. « On chante ordinairement cet air pour hisser une vergue après avoir pris des ris dans la voile. Quand le matelot chanteur possède de bonnes et fortes notes de fausset, cette mélodie a quelque chose de sympathique et d’éminemment caractéristique. Au milieu du bruit sinistre du vent dans les agrès du navire, et sur une mer montagneuse et blanchie par l’écume, ce chant s’exhale du centre isolé de l’abîme comme une plainte et comme un regret. » Villoteau, dans sa savante relation sur l’état de la musique en Égypte, rapporte un assez grand nombre de cris de manœuvre à l’usage des bateliers du Nil. Ces cris ont presque tous un caractère mélodique très prononcé ; ils respirent ou la gaîté ou la tristesse suivant que les bateliers et rameurs n’éprouvent aucune difficulté, ou sont arrêtés, au contraire, par des obstacles. Le même auteur nous fait connaître, en outre, les refrains des puiseurs d’eau des environs de Kene (n° 26) et de Louqsor (n° 27). Il y a parmi ces refrains un cri particulier dont se servent les puiseurs d’eau, lorsqu’ils veulent appeler pour être relevés (n° 28). Cette petite chanson rentre dans la catégorie des cris d’appel où viennent également se placer les cris des maçons demandant une truellée au sas ! des ramoneurs se donnant des signaux de haut en bas par les tuyaux des cheminées, et plusieurs autres du même genre particulièrement en usage dans les métiers où les compagnons sont servis par des aides ou des apprentis.
Ainsi le cri de labeur, expression naturelle de la souffrance ou de la gêne physique qu’engendrent les travaux du corps, peut se modifier, se développer et s’embellir, au point de figurer parmi les manifestations sonores dont l’art est appelé à tirer un excellent parti. C’est surtout dans les chansons, et plus particulièrement dans les chansons de métier, que ces cris interviennent avec succès. Leurs intonations singulières, leurs onomatopées et leurs mimologismes, fournissent au compositeur des refrains piquants très propres à caractériser la physionomie des différents métiers. Au théâtre, ils sont d’un emploi avantageux dans certains rôles comiques, et les amateurs des vieux refrains de la muse française pensent toujours avec plaisir au tôt, tôt, tôt, battez chaud du maréchal ferrant.
L’utilité du cri, au point de vue physiologique, se rattache à une question artistique du plus grand intérêt : c’est celle des effets de la musique sur l’homme et sur les animaux. Traitée dans une foule d’ouvrages spéciaux, cette question n’a pas occupé seulement les musiciens. Les hommes chargés de la conduite et de la discipline des armées devaient nécessairement porter leur attention sur les excellents résultats qu’on obtient de l’emploi du rythme musical dans les exercices corporels destinés à former le soldat, etc. Il faut voir, par exemple, avec quelle conviction s’exprime à ce sujet le maréchal de Saxe dans ses Rêveries. Ainsi que nous le disons dans notre Manuel général de musique militaire, les paroles d’un si grand guerrier, homme d’action avant tout, ont plus de poids que celles d’aucun autre écrivain, puisqu’elles sont le fruit de l’expérience même. Ne songeons donc pas à infirmer la valeur de son témoignage, lorsqu’il déclare que les tons ont une secrète puissance sur nous, qui disposent nos organes aux exercices du corps et les facilitent





























