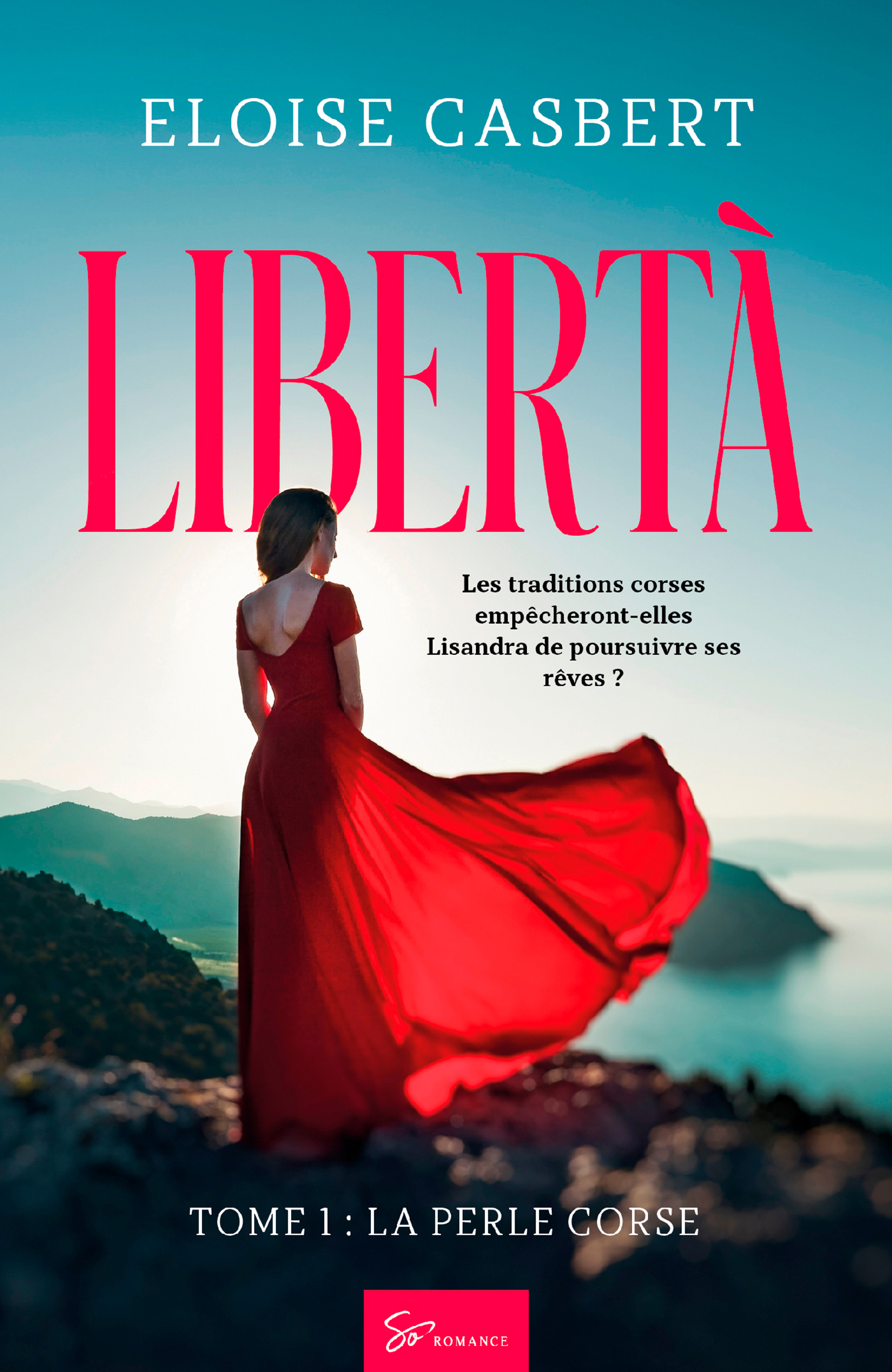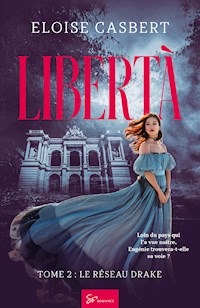
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: So Romance
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libertà
- Sprache: Französisch
Loin du pays qui l'a vue naître, Eugénie trouvera-t-elle sa voie ?
⠀
À l'aube de la seconde guerre mondiale, Eugénie quitte la Corse pour étudier dans le Var, où elle séjourne chez sa tante, Lisandra. Encouragée par ses cousins, elle se découvre cependant une passion pour la musique et, plutôt qu'entrer à l'université, devient apprentie dans une fabrique d'instruments. C'est au comptoir de ce magasin qu'elle fait la rencontre de Julien, jeune homme engagé dans la Résistance... ⠀
Avec le second volet de cette romance historique, Eloïse Casbert dresse une nouvelle fois le portrait d'une femme forte, indépendante et courageuse. L'occasion de découvrir sous un nouvel angle un moment charnière de notre Histoire...
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"[Eugénie] traverse la période de la Seconde Guerre mondiale avec une force de combattre et une envie de vivre époustouflante." Nini366 sur Babelio
À PROPOS DE L'AUTEURE
Proche de la nature et adorant voyager, Eloise Casbert met aujourd’hui ses deux passions au service de l’écriture qu'elle pratique "à tâtons" depuis l’adolescence. Originaire du Var, elle s’exprime au travers de romances dans lesquelles elle met en scène les métiers, les familles, les paysages de son terroir. Son premier roman La perle corse ouvre la trilogie Libertà dont le deuxième tome Le réseau Drake est à paraître.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre est une œuvre de fiction. Plusieurs événements historiques y trouvent certes leur place, mais ils s’insèrent dans un cadre fictif. De la même, si l’on reconnaît le nom de certaines figures historiques, les personnages qui les incarnent ici sont tout aussi fictifs.
Patronymes, caractères, lieux, dates et descriptions géographiques sont, soit le produit de l’imagination de l’auteur, soit insérés dans cette fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, mortes ou vivantes, avec des événements et des lieux concrets ne serait que pure coïncidence.
À Julien,mon grand-père,prisonnier au stalag IX-A
Prologue
Eugénie respira profondément et reprit calmement.
— Papa, je ne vais pas flirter avec tous les hommes du village. Je vais juste écouter les chants de Noël.
— Mais je ne veux pas que tu traînes dans les bars à ton âge.
— C’est de ma faute, si vous répétez vos chants dans un bar ?
Luca soupira. Comment faire entendre raison à sa fille ? À seize ans, belle et bien faite comme elle était, il devait faire attention à sa réputation. Et passer la soirée dans un bar, ça ne se faisait pas. Même pour écouter sagement les chants de Noël.
Sagement, en plus, rien n’était moins sûr, avec Eugénie. Elle lui rappelait tellement sa sœur Lisandra. Elle leur en avait fait voir de toutes les couleurs à l’âge d’Eugénie.
— Bon, alors, mon papounet chéri, je peux y aller ? Je resterai avec Piero et Ange. Ils me surveilleront.
Elle avait passé ses bras autour du cou de Luca, frottait sa joue contre la sienne comme un chat. Il se sentit fondre. Ils le savaient tous les deux. Ça marchait à tous les coups. Comme autrefois avec Lisandra.
— Bon, je vais en parler aux garçons. Mais tu restes à leurs côtés !
— Oui papa, assura Eugénie, les yeux sagement baissés sur une lueur de triomphe.
Lorsqu’elle rapporta la décision de son époux à sa belle-sœur, Marina leva les yeux au ciel et écarta les mains en signe d’impuissance.
— Elle le balade comme Lisandra, conclut Fiora.
— Tant qu’elle ne part pas sur le continent, ajouta Marina.
1Les rois du textile
« Le commerce ne connaît pas la mort »L’irrésistible ascension d’Arturo UiBertolt Brecht
Par chance, les hommes de plus de quarante ans n’avaient pas été mobilisés. Si la guerre ne durait pas trop longtemps, Uguet1 échapperait à cette horreur et ne risquerait pas de finir comme Giloun2, son frère aîné, mort en 1917 sur le front.
Depuis l’été 39, l’usine de tomettes tournait au ralenti. Les gens n’avaient pas la tête à construire ou rénover alors que, du jour au lendemain, l’Apocalypse pouvait se déclencher.
Alors, malgré le contexte, Uguet avait décidé d’aller chercher des clients hors du Sud, loin de la Méditerranée. Il avait pris contact tout l’hiver avec de potentiels clients de Paris et du Nord. Il était convenu que le printemps venu, si la situation le permettait, il viendrait leur montrer ses produits.
Il avait donc confectionné un catalogue transportable. En effet, il n’était pas question qu’il amène une tomette ordinaire de chaque sorte, il lui faudrait une brouette pour se déplacer ! Il avait alors réalisé des tomettes très fines, d’un demi-centimètre au lieu des deux habituellement nécessaires à leur solidité. Mais cette épaisseur les fragilisant énormément, il avait eu l’idée de mouler ses tomettes crues sur de la toile de jute. Les fibres de la toile incrustées dans la terre une fois cuite assureraient leur tenue. Les tomettes ainsi obtenues furent fixées grâce au tissu de leur dos sur des pages de carton fin.
Marie, la belle-sœur d’Uguet, y annota de sa belle écriture les références et les prix de chaque exemplaire. Ainsi fut constitué en quelques mois un catalogue représentatif de ce que la maison Jauffred de Salernes savait faire. Bertoun3, un peu dépassé par l’ambition de son fils, admira le catalogue en connaisseur.
— C’est fantastique, fils, tu as mis la boutique tout entière dans un cahier de quelques kilos à peine.
Tant que ce n’était qu’une idée, un projet, Lisandra ne s’était pas trop inquiétée. Au contraire, l’élaboration du catalogue avait permis à Uguet d’intéresser Louis à la confection des tomettes. Il faut dire que Tonin, le fils de Giloun et Marie, montrait beaucoup plus de disposition pour le travail des pâtons de terre crue que son cousin. Uguet était partagé entre la fierté de voir son fils faire des études et la déception qu’il ne reprenne pas l’usine. Aussi, quand celui-ci s’intéressa aux procédés utilisés pour solidifier les fines tomettes du catalogue, le père reprit espoir. Même si ses études suivies à Toulon en semaine ne lui permettaient pas de participer à temps plein, comme Tonin.
On était au mois d’avril, les fêtes de Pâques étaient passées. Toute la famille Jauffred s’était rassemblée à Salernes pour l’occasion, sentant que ce serait peut-être la dernière fois avant longtemps. Vittori4, qui avait déjà perdu un fils en 17, craignait la mobilisation et ne dormait que d’un œil depuis juillet 39. Cette année 1940 avait vu se tenir pour le dimanche de Pâques un repas rassemblant presque autant de membres de la famille que pour le mariage d’Uguet et Lisandra, dix-neuf ans en arrière. Seuls les Leccia manquaient à l’appel. De toute façon, ils n’auraient pas pu venir. Petru5, le père de Lisandra, était décédé. Battistu6, son frère aîné, travaillait d’arrache-pied pour maintenir la famille à niveau, aidé de Luca7, le second frère. Mais la famille Jauffred comptait déjà plus d’une douzaine de personnes. Lisabeu8, la sœur d’Uguet, et son mari Yvoun9 étaient venus de La Crau avec leurs enfants. Les quatre Anselme étaient des adolescents magnifiques et d’une rare complicité. Élevés dans le cadre naturel de l’embouchure du Gapeau, ils respiraient la santé. Seule l’ombre de la mobilisation planant sur Luca et ses dix-neuf ans assombrissait un peu l’humeur de Lisabeu.
Bertoun était fier de cette famille réunie autour de lui. Il avait accepté sans sourciller que Marie, veuve depuis dix ans de son aîné, se remarie avec Lucien, l’exploitant du domaine viticole qui jouxtait la terre des Jauffred. Ainsi Marie et Tonin, son fils, n’étaient pas loin et quand la petite Arlette était arrivée, Vittori avait joué les grand-mères comme avec ses autres petits-enfants.
Lisandra sourit au souvenir de cette journée. L’entente des quatre femmes autour des préparatifs n’avait pas changé depuis ce repas de l’Ascension 1920 où elle avait fait la connaissance d’Uguet. Leur amour avait été immédiat et durable. Le jeune homme qu’il était avait su comprendre la passion de son aimée pour la musique. Il l’avait soutenue, aidée et avait accepté qu’elle passe la moitié de la semaine à Toulon pour respecter ses engagements dans l’orchestre de l’opéra. Elle sourit en pensant à toutes les attentions dont Uguet avait su l’entourer.
Comme le soir de leur dixième anniversaire de mariage. C’était un soir de concert, il était venu à Toulon pour passer quelques jours avec elle en amoureux, car Louis était chez sa tante Lisabeu à La Crau.
Son plaisir en cette saison était d’enfourcher sa bicyclette avec son cousin Lucas et de remonter le Gapeau par les chemins de bordure jusqu’à la plaine de Solliès-Pont. Là, ils s’arrêtaient chez le cousin d’Yvoun et se gavaient de cerises. Les préférées de Lucas étaient les bigarreaux, charnus, mais fermes et tellement sucrés.
Leur fils à la campagne, Uguet et Lisandra se retrouvèrent comme à leurs vingt ans, seuls au monde dans l’appartement face à la fontaine. Ce soir-là, Uguet l’attendait à la sortie de l’opéra. Il lui prit le bras et, s’excusant de l’enlever, il lui signifia qu’il fallait qu’elle rentre directement, c’était important. Partagée entre l’inquiétude de ce qui l’attendait et la contrariété de ne pas finir la soirée par le thé avec ses collègues, Lisandra suivit Uguet d’un pas vif, pressée d’en finir. Son mari ne desserra pas les lèvres du court trajet et elle dut attendre que la lumière éclaire leur séjour pour comprendre. La table était mise et décorée entièrement en rouge et blanc, les couleurs de leurs noces. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers son époux, ravi de sa surprise.
Cette année, ils devraient fêter leurs vingt ans. La guerre le leur permettrait-elle ? La famille Jauffred aussi avait fait preuve de tolérance et de compréhension envers elle, son métier, sa vie à cheval entre deux maisons. Lorsque Marie s’était remariée, Vittori attendait avec impatience les jours où Lisandra et son fils Louis arrivaient avec des nouvelles de la ville. Elles tenaient la maison à deux, comme avant avec Marie, tout en papotant. Elles accueillaient leurs hommes aux repas, fourbus d’une journée auprès des fours. Elles prenaient soin de Louis, gardaient Arlette, auxquels pendant les vacances scolaires s’ajoutaient les quatre de Lisabeu. Les enfants de Lisabeu étaient surnommés les quatre L à cause de leur initiale commune. Lucas, Lucette, Léon et Léa avaient, par hasard pour les deux premiers, volontairement pour les deux plus jeunes, la même initiale que leur mère.
Tout ce petit monde baignait dans la musique depuis tout petit, inspiré par leurs parents. Uguet et Yvoun jouaient de la guitare et Lisabeu chantait à merveille, mais Lisandra, en tant que première flûtiste de l’opéra de Toulon, restait la référence musicale. Louis s’était naturellement tourné vers les instruments à cordes et, en grandissant, avait découvert la harpe, qu’il maîtrisait désormais. Ne pouvant déplacer un tel instrument lorsqu’il venait à Salernes, il amenait une lyre, dont il tirait des mélodies paradisiaques. Quant aux quatre L, ils pouvaient former un quatuor d’instruments à vent. En effet, Lucas avait commencé avec un baryton. Quand il était petit, il devait le poser pour jouer et disparaissait derrière. Lucette, fascinée par l’instrument de son frère, voulut essayer le saxophone, qu’elle adopta dès que son père lui eut fabriqué une anche personnalisée. Léon resta dans les instruments à vent en optant pour la trompette et lança la mode du jazz chez les Anselme. Enfin, la petite dernière, Léa, choisit la clarinette.
Lors des réunions de famille, le concert était devenu un moment incontournable. Bertoun et Vittori retrouvaient des jambes de jeunes mariés et dansaient sur les rythmes de swing joués par leurs petits-enfants. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, l’orchestre familial s’agrandissait et les rythmes classiques se modernisaient peu à peu. Des chansons de Maurice Chevalier, on était passé au début du jazz, puis Jean Sablon et Charles Trenet avaient teinté leurs mélodies l’un de poésie, l’autre de fantaisie, Tino Rossi avait enchanté le Noël des plus petits. La musique américaine aussi venait réjouir les concerts varois avec les rythmes enlevés d’Ella Fitzgerald ou de Billie Holiday. Les adeptes des cuivres se régalaient sur du Louis Armstrong.
La guerre les avait cueillis un an auparavant et les fêtes familiales, si elles avaient toujours lieu, étaient assombries par la menace de la mobilisation. Uguet, qui avait tout juste quarante ans, pouvait être concerné par un élargissement des âges. Lucas, 19 ans déjà, pourrait être le prochain à partir. Tonin était déjà parti et était pour le moment en formation dans le centre. Louis et Léon étaient à l’abri encore trois ans et, comme en 1914, on était persuadé que cette guerre n’allait pas durer. En Corse, la famille de Lisandra n’était pas mieux lotie. Si Battistu échappait à la mobilisation de par son âge, Luca comme Uguet, était à la frontière entre deux générations et pouvait être appelé à tout moment. Piero, le fils de Battistu était déjà parti depuis l’automne 39. Son frère Ange, avec ses seize ans, était tranquille. Luca et Marina, outre Eugénie, avaient eu Nicola10, âgé de seize ans à ce moment-là.
En ce mois de mai 1940, donc, Uguet était parti avec son catalogue novateur pour décrocher des contrats auprès des riches parisiens, puis auprès des industriels de textile dans le Nord.
Il partit de Paris pour Amiens le neuf mai, avec trois promesses de contrat plutôt juteuses. Il téléphona à Salernes le soir en arrivant, pour partager son enthousiasme. Lisandra lui enjoignit de redescendre dans le Sud rapidement. Elle n’était pas tranquille de le savoir si près des Allemands.
Une semaine s’écoula avant que Uguet, enthousiaste, raconte par le menu détail ses rencontres avec les industriels du textile, la visite d’une usine et enfin, les commandes de tomettes pour leurs maisons de campagne. Chaque grand patron s’informait discrètement sur les projets de son concurrent et essayait de faire mieux, plus grand, plus riche. Celui de Lille avait commandé des tomettes grand format pour sa salle à manger, le lendemain celui de Roubaix souhaitait un camaïeu de tons dégradés pour son salon. De surenchère en surenchère, Uguet s’était vu obligé d’étaler les livraisons sur plusieurs années à cause du manque de main-d’œuvre dû à la guerre.
Il promit, en conclusion à son long récit, de prendre le train du retour dès le lundi vingt mai.
1. Diminutif provençal du prénom Hugues
2. Diminutif provençal du prénom Gilles
3. Diminutif provençal du prénom Albert
4. Diminutif provençal du prénom Victor
5. Version corse du prénom Pierre, se prononce Petrou
6. Version corse du prénom Baptiste, se prononce Batistou
7. Orthographe corse, sans le s
8. Diminutif provençal du prénom Elizabeth
9. Version provençale du prénom Yves
10. Orthographe corse
2La bataille d’Amiens
« J’ai su que nous faisions la plus belle guerre du peuple français… Une guerre sans gloire… Une guerre gratuite en un mot. Mais cette guerre est un acte de guerre et un acte d’amour. Un acte de vie. »L’armée des ombresJoseph Kessel
Le dimanche, lendemain de concert, Lisandra se levait tard. Seule dans son appartement de la place Puget, elle profitait du calme dominical pour flâner d’une pièce à l’autre, s’arrêtant à une fenêtre pour se perdre dans la contemplation des gouttes d’eau qui rebondissaient sur la végétation de la fontaine. Qu’est-ce qu’il avait poussé en vingt ans, le figuier ! La fontaine de cette place avait pour particularité d’héberger un figuier au sommet de ses sculptures. Celles-ci étaient couvertes à présent par la mousse accrochée entre les racines de l’arbre. En ce mois de mai, les oiseaux étaient nombreux à nicher dans les recoins cachés du figuier perché au centre du bassin. Elle prit tellement son temps, cette fois-là, qu’elle dut se dépêcher ensuite pour se préparer pour le concert en matinée. Il ne commençait qu’à quinze heures, mais il y avait les répétitions avant et elle devait se changer, se coiffer. L’appartement, heureusement, n’était qu’à deux minutes de l’opéra. Uguet et elle l’avaient choisi presque vingt ans auparavant comme leur premier nid d’amour, et ils ne l’avaient jamais quitté.
Ce n’est donc que le soir, après le repas pris en compagnie de ses collègues dans le restaurant de la place de l’opéra, qu’elle regagna son logement. Fatiguée, elle s’enfonça dans la bergère près de la fenêtre, posa sa tasse de thé sur le guéridon et alluma le poste de radio. C’était le dimanche dix-neuf mai. Ce qu’elle entendit la terrifia.
La veille, en milieu d’après-midi, des avions allemands s’étaient abattus sur la ville d’Amiens, qui avait subi son premier bombardement. La radio énumérait les lieux touchés : la gare de triage, le quartier Saint-Roch, la gare Saint-Roch quasiment détruite, des tués, des blessés…
Lisandra tournait en boucle sur deux idées : Uguet est-il vivant, blessé ? Si oui, plus de gare, plus de train donc pas d’échappatoire possible. Un train convoyant des soldats britanniques avait été touché et des dizaines de soldats avaient péri. Heureusement, Uguet, lui, ne devait partir que le midi. Il n’était donc pas à la gare. Mais le commentateur poursuivit en déclarant qu’une nouvelle attaque avait eu lieu deux heures plus tôt. Cette fois-ci, ils étaient venus en force, trois escadrilles de bombardiers protégées par la chasse. À cette heure-ci, les nouvelles n’étaient pas définitives, mais alarmantes. Le centre-ville était détruit. Le faubourg Hom, le quartier Saint-Jacques, autant de noms que la flûtiste ignorait, mais qui sonnaient comme un glas.
Uguet lui avait mentionné le nom de son hôtel au téléphone, mais elle n’y avait pas prêté attention. C’était un détail. De fait, elle ne savait pas dans quel quartier il pouvait être. Elle guetta les nouvelles, heure par heure. Bertoun, qu’elle avait eu au téléphone, essayait de faire bonne figure face à Vittori et Louis, mais il était effondré. Cette deuxième guerre n’allait pas lui enlever son deuxième fils !
Malheureusement, les nouvelles ne s’améliorèrent pas. Le lendemain, vingt mai, la radio annonça la prise d’Amiens par la première division de Panzer. Les troupes françaises présentes résistèrent tant bien que mal, mais elles furent rapidement vaincues et isolées des troupes du Nord par l’avancée de la première division de Panzer. En une journée, le nord de la France fut occupé et les armées belge et britannique, ainsi que les trente divisions françaises situées de Boulogne-sur-Mer à Calais et Dunkerque, furent encerclées.
Les Jauffred ne savaient que faire. Comment avoir des nouvelles ? Ils s’en remirent à elle après avoir parlé au garde champêtre et au maire, autorités locales en toutes circonstances habituellement. Mais ceux-ci étaient pour l’heure tout aussi dépassés que les familles, qui s’interrogeaient. Ce fut le garde champêtre qui leur suggéra que leur belle-fille aurait plus facilement des informations auprès de la gendarmerie de Toulon.
— Et puis, ajouta-t-il, avec son métier elle doit connaître du beau monde. C’est le moment qu’ils se rendent utiles.
Lisandra se rendit à la gendarmerie de Toulon. Elle signala la disparition de son époux Hughes Jauffred, le dix-huit mai à Amiens, où il était en voyage d’affaires. Le gendarme prit note de tous les détails dans un cahier déjà bien entamé, listant tous les disparus depuis l’été 1939. L’angoissante attente commença alors. Bertoun renvoya tout son monde à l’usine de tomettes car, même si c’était au ralenti, la fabrication des carreaux de terre cuite hexagonaux si typiques du Var devait continuer. Lisandra reprit ses concerts, soutenue par ses collègues de l’orchestre, qui suivaient l’actualité avec elle et l’exhortaient à la patience et l’optimisme.
Il ne pouvait être que vivant, bloqué à Amiens par l’occupation allemande et les combats alentour. Les communications étaient coupées, il était normal qu’aucune nouvelle n’arrive. Les routes et voies ferrées étaient détruites, il était normal qu’il ne puisse plus circuler. Tant Lisandra que les Jauffred à Salernes ou les Anselme à La Crau se répétaient ce mantra pour se persuader de la bonne issue des événements et garder courage et patience. Louis était renfermé sur lui-même et restait impassible. Vittori ne l’aurait pas si bien connu, son pitchoun, qu’elle l’aurait cru insensible. Alors qu’au contraire, il se protégeait des possibles mauvaises nouvelles en ne montrant qu’un visage rassurant, confiant. Il rabrouait ceux qui envisageaient le pire, redonnait confiance à ceux qui supposaient mille cas de figure. Arlette l’admirait secrètement. Elle pensait à son demi-frère, Tonin, lui n’avait pas eu à gérer ces émotions-là, puisque son père était déjà décédé quand il était né. Il y avait juste eu l’absence, mais une absence honorable pour cause de guerre.
Du vingt mai au vingt-six juin, les événements s’accélérèrent. Le vingt-trois mai, les Allemands avaient constitué une tête de pont sur la rive de la Somme. Les tirailleurs sénégalais y laissèrent presque un régiment. Le vingt-huit mai, les Français contre-attaquèrent, mais les tirailleurs furent à nouveau balayés par l’armée allemande. La ville d’Amiens continuait à être bombardée, car la poche de résistance de Dunkerque fermait l’accès par la mer. Jusqu’au huit juin, la Luftwaffe lâcha ses bombes sur la ville. La population dut se réfugier au nord de la Somme pour y échapper. À partir du moment où les Allemands occupèrent Amiens, ce furent les obus français qui tombèrent à leur tour. La population et les soldats français résistèrent vaillamment et en payèrent le prix fort avec des exécutions massives de prisonniers. Le soir où, collée au poste de radio, elle entendit ce récit de la prise d’Amiens, Lisandra fut prise de frissons incontrôlables. Elle se sentit tout à coup transie malgré la température estivale du mois de juin. N’étant pas en uniforme, s’il était vivant, Uguet avait pu être fait prisonnier comme un Amiénois et fusillé à titre de représailles.
Le lendemain elle alla à nouveau à la gendarmerie. Elle voulait savoir si les familles des fusillés avaient été averties. Le gendarme la regarda, incrédule.
— Mais, ma petite dame, leurs familles étaient avec eux et les ont vus mourir ou sont mortes aussi, s’exclama le gendarme.
L’armée française, débordée, fut incapable de retenir les divisions allemandes et le quatorze juin, les troupes allemandes entraient dans Paris.
L’Italie, de son côté, avait attaqué par les Alpes et atteint la vallée du Rhône. Le maréchal Pétain demanda l’armistice, qui fut signé le vingt-deux juin à Compiègne. Dès le vingt-six juin, les autorités locales françaises regagnèrent Amiens et la vie reprit son cours. La population revint et subit l’occupation allemande. Les nouvelles commencèrent à circuler lorsqu’un semblant d’organisation fut remis en place. Après plus d’un mois d’angoisse, Lisandra accueillit l’armistice avec un soulagement mitigé. Si l’épouse et la femme amoureuse étaient heureuses que les combats cessent enfin et que toutes les activités reprennent comme avant, la femme libre française qu’elle était depuis son enfance se rebellait contre cette décision avilissante qu’était le choix de l’occupation. Heureusement, le Var était en zone libre.
Dès l’annonce du cessez-le-feu, elle se présenta à la gendarmerie. Elle assaillit le préposé au cahier des disparus de questions. Est-ce que les liaisons étaient rétablies ? Est-ce que les trains circulaient et, au moins jusqu’à la frontière de la zone libre ? Est-ce qu’il l’avertirait si des nouvelles tombaient ? Le gendarme essaya de la calmer tant bien que mal et de lui faire entendre raison sur les délais de remise en état des liaisons.
— Revenez dans deux semaines si on ne vous a pas appelée d’ici là.
Fin juin, elle retourna à la gendarmerie de Toulon, où elle retrouva le même gendarme bienveillant qui notait scrupuleusement toutes les disparitions. En un mois, le cahier s’était rempli et le préposé avait non loin de lui un cahier neuf à disposition. Au vu de la file d’attente qui s’écoulait de son guichet, Lisandra se dit qu’elle aurait droit au cahier neuf. Il fallut deux heures avant qu’elle ne parvienne face à l’homme en uniforme, chacun ayant à cœur de fournir le plus de détails possible pour faciliter les recherches éventuelles. Lisandra n’était pas dupe, le cahier ne servait qu’à laisser un espoir aux familles, les gendarmes auraient été bien en peine de mener la moindre enquête dans les conditions actuelles. Néanmoins, elle fit remonter le gendarme dans les annotations de son cahier jusqu’à la date du vingt mai, où elle avait déposé le signalement d’Uguet.
— Vous avez sûrement un fichier identique avec les noms, ou le signalement des trouvés, qu’ils soient morts, blessés ou vivants dans l’incapacité de communiquer.
Bien sûr il en avait un, mais il se garda de le sortir pour ne pas être assailli. Devant le maintien et l’assurance de Lisandra, il l’introduisit dans un bureau voisin et lui présenta un collègue qui, assura-t-il, pouvait peut-être l’aider.
Après avoir exposé son cas ou plutôt celui de Uguet, elle se tut et attendit une proposition de la part de son interlocuteur. Celui-ci restait silencieux et l’observait avec un intérêt non dissimulé. Comme elle commençait à montrer des signes d’impatience, il déclara :
— Vous faites partie de l’orchestre de l’opéra, n’est-ce pas ?
— Oui, effectivement. Vous êtes amateur ? s’enquit-elle dans l’espoir de gagner sa sympathie.
— Ce sont surtout les belles flûtistes comme vous qui me captivent, dit-il en s’approchant de son siège.
Lisandra eut un mouvement de recul, mais se dit que s’il fallait endurer un lourdaud séducteur de pacotille pour savoir où était Uguet, cela ferait partie de l’effort de guerre. Elle se força à sourire et répondit.
— Et bien, je suis moi-même flûtiste et je suis flattée de votre intérêt. Mais concernant mon époux, que peut-on faire ?
— Allons, ne faites pas la sainte-nitouche, Madame, vous avez très bien compris de quelle sorte de flûte il faut jouer pour que l’on enquête sur votre mari.
Tout en parlant, il s’était encore approché. Elle avait désormais le visage au niveau de la boucle de son pantalon. Elle avait aussi très bien saisi ce qu’il attendait d’elle. Elle cherchait à toute allure comment s’en sortir sans subir aucun outrage, sans l’assommer avec le beau chandelier en marbre et cuivre qui trônait à portée de sa main sur une petite table, et sans le faire se plier en deux en usant de la plus simple défense des femmes : le coup de genou dans les parties intimes.
Finalement, elle se leva soudainement. Geste qui déstabilisa le gendarme, tant il était près d’elle. Elle en profita pour pivoter et se faufiler dans l’espace dégagé par le recul du bonhomme. Avant d’ajouter la moindre parole destinée à porter l’estocade au profiteur, elle ouvrit la porte largement sur la salle d’attente bondée. De fait, il ne pouvait plus intervenir autrement qu’avec courtoisie. Tandis que la déception et la rage se peignaient sur le visage du triste sire, Lisandra, encore tremblante, déclara néanmoins avec superbe :
— Monsieur, je joue de la traversière, pas du piccolo. Alors si vous ne pouvez changer d’instrument, veillez à ne le proposer qu’à des professionnelles du genre. Bien le bonjour Monsieur.
Et elle tourna les talons et sortit bien droite de la gendarmerie. Les nombreuses femmes de la file d’attente avaient parfaitement compris l’allusion. Une jeune et jolie jeune fille, qui attendait assise près de la porte du bureau d’où venait de sortir Lisandra, se leva, l’air horrifié, et fuit plus qu’elle ne sortit du bâtiment.
Tout en regagnant la place Puget, Lisandra songeait qu’il vaudrait mieux ne pas avoir besoin des gendarmes pendant quelque temps. Elle sourit malgré son angoisse. Quelle sortie ! Si Chjara11, sa mère, l’avait vue, elle aurait été choquée de son langage, mais fière de la répartie. Bon, pour Uguet, il allait falloir être patiente ou se débrouiller toute seule.
11. Version corse du prénom Claire, se prononce Kiara
3Bombardement à Toulon
« C’est le cœur serré que je vous disaujourd’hui qu’il faut cesser le combat »Philippe Pétain17/06/1940
Même si le nord de la France avait été le premier et le plus durement touché, le Sud ne fut pas épargné. Les Italiens entrés en guerre aux côtés des Allemands attaquèrent la France par les Alpes. Sur la côte, l’aviation italienne la Regia Aeronautica menait des raids d’observation. Mais les conditions météorologiques étaient défavorables et les avions firent demi-tour ou les missions furent tout simplement annulées. Ainsi, le onze juin, un Fiat BR20 devait survoler le port le matin. Ce ne serait fait que l’après-midi où il parviendrait à prendre des photos du port.
C’est avec inquiétude que le douze, les habitants entendirent arriver trois avions italiens. Lisandra, en promenade sur les pentes du mont Faron cet après-midi-là, vit la DCA les prendre à parti. Ils en abattirent un, tandis que les deux autres repartirent pour Milan. Le soir, elle peinait à s’endormir, hantée par la vue de l’avion piquant du nez vers les flots, un panache de fumée s’échappant de l’arrière. Elle entra ainsi de plein fouet dans la guerre et elle eut encore plus peur pour Uguet, et Piero, son neveu, qui avait été mobilisé et devait se trouver sur le front dans l’Est ou le Nord.
Elle venait à peine de s’assoupir que le vrombissement lointain des avions la fit sursauter. Blottie dans son lit, elle attendait qu’ils repartent. Mais le bruit des moteurs crût peu à peu. Il devint énorme, Lisandra apprit le lendemain qu’ils n’étaient que trois, mais dans le calme de la nuit, elle avait eu l’impression d’une escadrille entière.
Le lendemain, treize juin, elle revenait du marché qui se tenait sur le cours Lafayette. Elle avait fait un détour par la rue des Boucheries. Elle remontait la rue d’Alger, quand pour la troisième fois en deux jours, le vrombissement croissant des avions italiens se répercuta sur les façades des maisons du centre-ville. Les gens furent partagés, certains détalèrent vers leur habitation, leur commerce, leur bureau, tandis que d’autres s’arrêtèrent, le nez en l’air, cherchant à apercevoir les Fiat BR20 de l’ennemi. Mais quand la flotte aérienne italienne fut en vue, un vent de panique souffla tout à coup : les plus doués et rapides comptèrent aussitôt plus de quinze avions au ventre gonflé de bombes. Une première explosion ne tarda pas à retentir, suivie de plusieurs autres. La rue, si peuplée et bruyante habituellement, fut déserte en quelques secondes et un silence morbide se faisait entre chaque avion, chaque seconde, chaque explosion. Lisandra, rentrée chez elle, ne savait que faire. On leur avait parlé des abris souterrains, de la conduite à adopter dès le début d’un bombardement. C’était des mois en arrière, la guerre était loin dans l’Est, en Pologne. Les Toulonnais n’avaient pas vraiment écouté et retenu les consignes. Aussi beaucoup de rideaux se soulevèrent pour dégager la vue, les nez s’écrasèrent contre les vitres pour mieux voir. Jusqu’à ce qu’une explosion plus proche que les autres ne fasse trembler les carreaux tout autour de la place, faisant par conséquent retomber les rideaux prestement.
Peu à peu tout redevint calme. Tout le monde en avait oublié le repas, alors les ménagères s’activèrent au fourneau pendant que les enfants refaisaient l’attaque avec les amandons franchement cueillis. Un coursier vint avertir Lisandra que la représentation de l’après-midi était annulée. Elle descendit la rue d’Alger jusqu’au port en repensant à ce jour de 1920 où elle avait fait le même trajet, mais en compagnie de Battistu et les yeux pleins du sourire d’Uguet et les oreilles pleines de la musique de l’opéra. Aujourd’hui, elle était seule et la musique était celle des largages d’obus. Sur le port régnait une belle pagaille et pourtant, un garde champêtre interrogé lui assura qu’il n’y avait que peu de dégâts. Apparemment, la DCA avait mis le groupe en déroute et touché deux d’entre eux. Le premier était tombé vers Saint-Mandrier, le second fumait, mais était reparti avec les autres.
Plusieurs impacts avaient provoqué des dégâts dans l’arsenal, mais sans être importants. Un chaland à mazout gisait, éventré par une bombe qui, par chance, n’avait pas explosé. Une fois encore, les positions de la DCA autour de Toulon avaient réagi tôt et violemment, disloquant la formation italienne qui n’avait pas pu larguer toutes les bombes prévues.
Une fois sa curiosité satisfaite et ses inquiétudes soulagées concernant ce qui était sa ville depuis vingt ans maintenant, Lisandra regagna son appartement, d’où elle appela ses beaux-parents à Salernes. Elle les rassura sur les événements à Toulon, prit des nouvelles de chacun, s’assura que Louis allait bien et ne posait pas trop de questions sur la disparition de son père. Ensuite elle essaya de joindre Corte. Les communications avec la Corse n’étaient pas simples et elles l’étaient encore moins depuis un an. Alors aujourd’hui, avec les bombardements, la flûtiste ne fut pas surprise de ne pas pouvoir parler à sa mère. Elle lui écrivit une longue lettre où elle lui racontait l’attaque, l’absence, l’opéra fermé, tout ce qui lui pesait et qu’elle ne pouvait dire qu’à Uguet ou à sa mère.