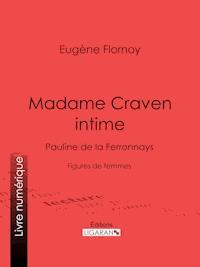
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dès le mariage commence ce que l'on pourrait appeler la vie publique de Mme de Craven, nous voulons dire la participation aux idées qui passionnent l'opinion, la fréquentation des groupes influents, ou, plus précisément, la propagande de sa propre et personnelle pensée. Pauline de la Ferronnays avait, de bonne heure, connu le pouvoir dirigeant des salons. Très jeune, elle perçut, au-delà des formules banales de l'étiquette, des concessions courtoises."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MONSIEUR,
Vous vous proposez de faire connaître et de faire aimer au vingtième siècle quelques-unes des plus belles âmes du dix-neuvième. Les survivants de ce siècle disparu vous sauront gré d’un tel travail, et la génération nouvelle en profitera. Il importe en effet à cette génération de recueillir l’héritage d’efforts, de vertus et d’épreuves qui lui vient du passé le plus proche et jusqu’ici peut-être le moins apprécié par elle.
Aujourd’hui vous tirez de la tombe Mme Craven née la Ferronnays. Elle le mérite ; car avec des façons de voir et de penser très modernes, elle-même, en dépeignant sa famille, a présenté sous le meilleur aspect la société qui était ancienne à son époque. Il était temps que sa propre histoire s’écrivît en France. La plusbrillante partie de sa carrière s’était écoulée à l’étranger, et déjà deux de ses amies étrangères, Mrs Bishop et la duchesse Ravaschieri, l’avaient montrée telle qu’elle était apparue en Angleterre, en Italie. Et pourtant elle était restée Française par la promptitude et la souplesse de l’esprit, par la flamme du cœur, aussi bien que par le sang généreux qui coulait dans ses veines. Et n’était-ce pas encore une disposition bien française que sa sympathie pour les peuples divers auxquels elle se trouvait mêlée sans avoir même origine, sa facilité à se familiariser avec les étrangers sans leur ressembler, à les attirer sans se confondre avec eux ? À tous les titres, il nous appartient de la revendiquer.
Vous avez saisi, Monsieur, et mis en relief les traits divers qui composaient la physionomie de Mme Craven ; et même quand certaines de ses opinions étonnaient et contristaient plusieurs de ses vieux et fidèles amis, vous n’en avez rien dissimulé. Vous avez dit sa rigueur pour l’Irlande, son indulgence pour l’Italie.
Ce qui la tournait contre l’Irlande, ce n’était pas seulement sa prédilection pour l’Angleterre ; c’était aussi le mécompte qu’elle éprouvait à voir un peuple catholique abuser de sa libertéreconquise, troubler le jeu des institutions parlementaires après s’en être ouvert l’accès et, pour mettre un terme à sa longue infortune, recourir aux procédés révolutionnaires. Au temps où je m’entretenais librement avec Mme Craven, j’avais plus de peine à m’expliquer son indulgence pour l’Italie, s’attaquant, tandis qu’elle s’efforçait de renaître, à sa seule grandeur vivante : la Papauté. Mais si difficile qu’il parût d’accorder ensemble les deux sentiments, il me fallait reconnaître que Mme Craven s’intéressait à la croissance de la nation nouvelle, sans que se refroidit jamais son amour pour l’antique et immortelle Église. Ce qu’elle ne cessait non seulement de souhaiter, mais d’espérer et d’attendre, c’était la réconciliation de l’une et de l’autre. Chers et inoubliables entretiens ! Je n’en sortais jamais sans admirer comme les âmes peuvent se rapprocher et s’unir, même lorsque, à certains égards, les esprits diffèrent et se séparent.
Vous voyez, Monsieur, à quelle époque se reportent mes souvenirs sur Mme Craven. Je ne l’ai pas connue dans sa jeunesse ; je ne l’ai guère approchée que dans sa vieillesse. C’est seulement au soir de sa vie que j’ai pu, comme elle venait de s’éteindre, rendre témoignage.
Vous au contraire, avec les papiers qui vous ont été confiés, vous embrassez cette vie tout entière. Journal intime et correspondances variées sont venus éclaircir et compléter ce qui transpirait d’elle-même à travers le Récit d’une sœur. Vous retracez, comme si elle s’en fût ouverte à vous, non seulement les évènements, les joies et les deuils, mais aussi les idées et les affections qui ont rempli le cours agité de cette longue vie.
Vous rendez également un compte fidèle de ses travaux ; vous appréciez le mérite et le succès de ses ouvrages, en mettant au premier rang, comme il convient, son « Récit d’une sœur » et ses « Méditations ». Un maître écrivain n’a-t-il pas dit que « plus une parole ressemble à une pensée, une pensée à une âme, une âme à Dieu, plus tout cela est beau » ? Comment donc Mme Craven aurait-elle pu jamais mieux écrire, que lorsqu’elle considérait le Dieu, maître de ses pensées, présent et comme visible au fond de son âme, ou bien lorsqu’elle envisageait les âmes les plus proches de la sienne montant de la terre au ciel et parvenant au sein de ce Dieu, l’objet de leur commun amour.
Quant à ses œuvres d’imagination, à vrai dire, elles étaient surtout des réminiscences. Àl’âge où elle avait commencé d’écrire, elle savait observer et se souvenir plutôt qu’inventer, faire vivre plutôt que créer des personnages. Fallait-il s’en plaindre, alors que de la sorte étaient représentées sans travestissements les épreuves et les vertus de la classe où l’avait placée sa naissance, que les leçons utiles étaient rendues agréables, et séduisants les bons exemples ? J’entends dire que les romans de Mme Craven, si recherchés jadis par les jeunes filles devenues aujourd’hui grands-mères, sont maintenant délaissés. Je souhaite que les lectures qui les remplacent relèvent aussi haut les cœurs et n’égarent point les consciences. Quoiqu’il en soit, il restera toujours à cette femme du monde accomplie, à cette chrétienne exemplaire, vouée, sur le seuil de la vieillesse, au métier l’auteur, le mérite et l’honneur d’avoir charmé toute une génération sans la corrompre, mais au contraire en suscitant uniquement les sentiments nobles et purs. Vous avez donc eu raison, Monsieur, de lui rendre hommage, et cet hommage est digne d’elle ; car en perpétuant sa mémoire, il prolongera le bien qu’elle a fait.
VteDE MEAUX
Mme Craven écrivait, à l’occasion de la biographie qu’elle consacrait à la mémoire de Lady Georgiana Fullerton : « Il est toujours agréable d’étudier un beau caractère, et Lady Fullerton vivait dans un temps et dans un milieu si intéressants ! »
Cette réflexion peut – et plus exactement encore – s’appliquer à la vie même de Mme Craven.
Le caractère de notre héroïne fut passionné dans la recherche de l’idéal chrétien. Il se fortifia par la fréquentation d’esprits éminents et par l’intelligence des évènements. Il grandit dans l’adversité. Il se manifesta par l’affirmation de la foi, par la pratique des vertus intimes et par une ardente propagande en faveur de nobles idées.
Le temps, – et elle fut longue, la période historique au cours de laquelle Mme Craven exerça son influence, – embrasse le cycle des grandes luttes libérales qui, dans la politique et la doctrine religieuse, intéressèrent particulièrement la France, l’Italie et l’Angleterre, et plus généralement toutes les nations et toutes les consciences.
Le milieu était constitué par l’élite de la société européenne et par une famille dont Pie IX aimait à dire : « Ils sont tous des saints. »
Au premier aspect, la variété de goûts, de talents, de relations de Mme Craven peut déconcerter la critique. L’enquête, sollicitée diversement, risque de s’égarer. L’unité de cette vie se trouve en péril d’être méconnue. On a loué Mme Craven pour les qualités brillantes de son style et pour le charme discret de sa conversation. On l’a célébrée comme la personnification de l’amour familial ou bien comme une « cosmopolite » éprise d’universalité. Quelques-uns l’ont qualifiée d’« actrice de salon consommée », et d’autres de « divinité du foyer ». Cependant un principe unique a inspiré cet esprit et ce cœur, et les a guidés à travers des voies en apparence divergentes : le principe chrétien.
Catholique convaincue, militante, – intégralement catholique : telle a été Mme Craven. Par la parole, par la plume, par l’exemple, elle s’est déclarée apôtre. Toute sa vie ne fut, en une démarche constante, que l’ascension vers le divin. Dans ses patries d’origine ou d’adoption, dans la politique comme, dans les Lettres, elle a voulu servir la cause de la Foi.
Un rayon de lumière céleste éclaira les successives expressions de cette figure.
Tout exemple de grandeur morale mérite d’être recueilli. Particulièrement en ce temps où la femme du monde souhaite de lutter pour sa croyance, il paraît opportun de rappeler par quels talents de persuasion et d’émotion, par quelle sincérité et quelle ardeur une chrétienne peut exercer son action et, pour ne pas la viriliser, sait l’envelopper de charme et de délicatesse. Cette leçon domine les pédagogies ingénieuses et les programmes hardis. Dans le commerce de Mme Craven, nos contemporaines apprendront à devenir des femmes d’élite, ou, tout au moins, à demeurer vraiment femmes, – ce qui sans doute, dans le cours de ce temps, deviendra un mérite assez rare.
Et puisque, encore, notre siècle est en quête de « professeurs d’énergie », on s’inclinera devant l’héroïne qui dans l’offense des évènements et dans la douleur a trouvé une force plus grande. Arrachant son âme aux affections les plus vives, aux joies les plus douces, elle l’a offerte en un sanglant holocauste. Tous ceux qui connaissent la longue plainte de la vie, aimeront à entendre vibrer en cette âme les harmonies surnaturelles qui, sans étouffer le gémissement humain, célèbrent l’énergie sacrée.
Il semble que la vie de Mme Craven ait été le commentaire des paroles de Lacordaire : « Sied-il au voyageur attendu par un amour infaillible de se plaindre de la route, de maudire le sable qui le porte et le soleil qui le conduit ? »
Nous demanderons à Mme Craven la pensée chrétienne qui vivifia tant de rares qualités et les unit dans la douceur et la force.
Mme Craven a dit, il est vrai, dans la préface de Natalie Narischkin : « Les saints pourraient seuls convenablement se charger d’écrire la vie des saints. » Mais n’est-ce pas un acte de piété de proposer à l’admiration l’exemple des saints ? Ou plutôt n’est-ce pas le devoir du plus modeste « imagier » d’essayer de rappeler les figures d’éternelle beauté ?
E.F.
Pauline de la Ferronnays, qui devint Mme Craven, naquit à l’étranger. Dès le berceau, Dieu marqua qu’il la voulait errante afin sans doute qu’elle étendît sa mission chrétienne à un cercle plus large.
L’émigration imposa la première des nombreuses étapes que la famille de la Ferronnays devait parcourir en tant de pays. La cause du roi était, pour les la Ferronnays, celle même de la patrie : en quittant la France ils demeuraient fidèles à l’une et à l’autre. Plus tard, aux étapes de la souffrance succédèrent celles des honneurs ; mais partout, en Allemagne, en Angleterre, en Danemark, en Russie, en Italie, ils furent citoyens de la France parce que partout ils la servirent.
Auguste Ferron, comte de la Ferronnays, suivit en émigration son père, lieutenant général des armées du roi, et rejoignit avec lui les princes à l’armée de Condé. C’était bien l’héritier de ces la Ferronnays dont Louis XV disait, à l’occasion de sauvetages opérés par Mgr de la Ferronnays, évêque de Saint-Brieuc : « Je reconnais là les la Ferronnays : celui-ci se jette à l’eau, comme ses frères courent au feu. » En 1802 le comte de la Ferronnays épousa, en Carinthie, Marie-Albertine de Montsoreau. Il ne rentra en France qu’en 1814. Dès 1817, il était nommé ambassadeur en Danemark, puis en 1819 à Saint-Pétersbourg. Il dirigea le ministère des affaires étrangères en 1828, et, presque au sortir du ministère, remplaça Chateaubriand à l’ambassade de Rome. Appelé par le comte de Chambord en Italie, il mourut à Rome en 1842.
Ces multiples séjours à l’étranger, les relations qu’ils créèrent aux la Ferronnays et l’ordre même de pensées et de préoccupations qu’ils leur imposèrent, furent les premiers éducateurs de Pauline. Elle se développa en quelque sorte sous divers climats de l’esprit ; mais la patrie française, nous l’avons dit, était toujours présente au cœur de la famille et corrigeait par ses qualités propres les influences exotiques.
Pauline de la Ferronnays naquit à Londres, le 12 avril 1808. Elle compta dix frères et sœurs, dont six seulement parvinrent à l’âge adulte.
Les quelques années qu’elle passa en Angleterre jusqu’au retour en France, ne pouvaient lui laisser une impression profonde ; mais plus tard, dans le Récit d’une Sœur, elle dit son sentiment sur l’émigration :
« … Le blâme et la dérision sont parfois jetés sans mesure sur ceux qui, portant dans l’exil leur fidélité et leur pauvreté, surent y vivre dignes de leurs noms, indépendants et simples, inspirant aux étrangers le respect, sans jamais implorer leur pitié, et par tous les pays faisant honneur au nom français… On nous pardonnera, du moins à nous enfants et petits-enfants d’émigrés, de ressentir plus de fierté que de regret au souvenir de cette époque, et d’être indulgents pour une faute politique (puisque faute il y a) qui nous a valu des exemples que tous, dans ces temps malheureux, ne reçurent pas des leurs, aussi honorables et aussi purs ! »
Le comte de la Ferronnays revint en France, en 1814, avec le duc de Berry dont il était l’aide de camp et le très fidèle compagnon. Mais le triomphe même des principes et du souverain, objets de tant de sacrifices, ne lui épargna pas une nouvelle épreuve. Cette épreuve fut l’occasion d’une haute leçon de force et de dignité morales. Un conflit, suscité par une simple question d’étiquette, s’éleva qui amena le duc de Berry à adresser de trop vives paroles au comte de la Ferronnays. Celui-ci, sans protester, s’éloigna de la cour et renonça, alors du moins, à toute situation officielle. Cependant il demeurait sans fortune. Pauline apprit ainsi la rigueur des devoirs qu’impose le respect de soi.
Lorsque le retour de la faveur royale permit au comte de la Ferronnays de représenter la France en Russie, Pauline trouva autour de l’ambassade des relations qui devaient s’affermir en amitiés durables.
Elle prit part, très joyeusement, aux fêtes qui rendaient la cour de Russie la plus brillante de l’Europe, et y rencontra les premiers éléments de la connaissance approfondie qu’elle acquit de toute la haute société contemporaine. Cinquante ans plus tard, elle parlait encore, avec précision et une grande vivacité d’imagination, des plaisirs, de la splendeur rencontrés en Russie.
Elle commença surtout, au cours des huit années que dura son séjour à Saint-Pétersbourg, à s’assimiler les idées libérales de son père. En face même de l’autocratie, elle comprit quelles sages évolutions doivent rattacher le passé au présent et préparer l’avenir. Ainsi que l’a dit le vicomte de Meaux, le comte de la Ferronnays « rapportait de l’émigration la fidélité sans les rancunes ; la fierté du gentilhomme l’avait préparé à l’indépendance du citoyen ». Pauline fut l’élève de la politique qu’inaugurait l’ambassadeur et que devait bientôt diriger le ministre des affaires étrangères.
L’entrée du comte de la Ferronnays au ministère (1827) plaça Pauline à un poste d’observation d’où elle voyait se heurter, comme en une houle inquiétante, le courant des idées anciennes né dans les profondeurs de l’histoire nationale et le flot des idées nouvelles qui, soulevé par les orages, se hâtait vers des rivages inconnus. Aux commentaires passionnés sur la Charte faisait écho le premier cri de guerre du romantisme. L’apologétique variait ses formules et participait aux conflits des opinions philosophiques ou sociales ; la sérénité des Paroles éternelles semblait troublée par le murmure humain qui annonçait les Paroles d’un croyant.
Dans ce milieu ardent, cultivé, ouvert à toutes les impressions du dehors, Pauline de la Ferronnays, éprise d’idéal, habituée déjà à la variété des horizons, pressée par son imagination de rechercher les indications des temps prochains, devait affronter de bonne heure le combat de la pensée. Mais sa conversation était l’arme élégante qui ne porte pas de blessure, qui sollicite seulement le jeu plus attentif de l’adversaire. La noblesse du commerce intellectuel ajoutait aux dons naturels de sa jeunesse.
Ces dons se révélaient même par l’expression physique.
« Petite et frêle, écrit Mrs Bishop, ses grands yeux noirs, sérieux et profonds l’illuminaient quand le sentiment de la beauté matérielle ou morale s’éveillait en elle. Ils étaient son plus grand charme. Son sourire doux et spirituel découvrait les dents magnifiques qu’elle garda jusqu’à la fin de sa vie. Un critique sévère eût trouvé sans doute sa tête un peu longue pour sa taille et son nez trop aquilin. À Naples ses amies l’appelaient : “Il profilo del Dante”. Mais l’expression de son visage lui enlevait toute la sévérité de celui du poète. La grâce de sa pose et de ses gestes, sa dignité et sa distinction parfaites la rendaient séduisante au suprême degré. Sa “voix d’or” avait des intonations tour à tour vibrantes ou indignées, tendres ou sévères, d’accord avec les sentiments qui l’agitaient. Elle parlait plusieurs langues, avec une facilité prodigieuse, s’appropriant les idiomes de chacune sans les confondre. Son jugement sur toute question sociale ou morale était droit et prompt. Elle parlait vite ; mais chaque mot était choisi et bien placé. Sans aucun effort apparent, sa conversation était de l’art ».
Cependant ce séjour en France fut bref : une simple visite dans un brillant cercle mondain. Entre les impressions que lui avait offertes le nord et celles qu’elle allait recueillir dans le midi, Pauline de la Ferronnays faisait, comme en cours de route, une hâtive provision d’esprit français.
Une grave atteinte survenue à la santé du comte de la Ferronnays le força à donner sa démission de ministre des affaires étrangères. Au surplus, le comte de la Ferronnays prévoyait le péril proche pour la dynastie. Il ne pouvait, en présence de certaines influences le conjurer. Dès lors il résigna volontiers des fonctions qu’il n’avait pas souhaitées, qu’il n’avait même acceptées que sur l’ordre royal. Néanmoins son action diplomatique avait eu une singulière importance : elle détermina le rapprochement entre la France et la Russie.
Le tzar s’était irrité du refus opposé par la France, lors du congrès d’Aix-la-Chapelle (1818), d’intervenir en faveur de l’Espagne contre ses colonies américaines révoltées : – cette intervention eût laissé la Russie libre d’agir en Orient. Le comte de la Ferronnays, au cours de son ambassade à Saint-Pétersbourg, avait su dissiper le mécontentement et gagner l’entière confiance du tzar. Ministre des affaires étrangères, il substitua à la politique anglophile du ministère Villèle l’entente cordiale avec la Russie. Or, le résultat de cette entente fut que la Russie, satisfaite de la paix avantageuse d’Andrinople, accorda son appui moral à la France pour la conquête d’Alger. Le comte de la Ferronnays, malgré les affinités et les sympathies qui l’attachaient à l’Angleterre, avait prévu les nécessités futures de notre politique et sacrifié à la sagacité toute préférence personnelle.
Au mois de janvier 1829, le comte de la Ferronnays partit avec sa fille Pauline pour l’Italie, demandant au climat, au repos, aux beautés de la nature et des arts le rétablissement de sa santé. Sa famille le rejoignit bientôt.
Dans ce premier voyage, Pauline de la Ferronnays prit un simple contact avec la terre d’Italie : elle n’en exhuma pas encore tous les souvenirs et n’en comprit pas tous les enseignements. Ce fut plutôt, – pendant le séjour à la villa Citadella près de Lucques, – l’âme de sa sœur Eugénie qu’elle découvrit une intimité nouvelle s’établit qui conféra à la sœur aînée une tendre autorité directrice. « Il nous semblait être ensemble pour la première fois de notre vie », écrivait Pauline. Et Eugénie disait en riant : « C’est en 1829 que j’ai fait la connaissance de ma sœur. » Pauline initia Eugénie à la littérature anglaise et même aux plaisirs mondains qu’elle considérait comme une occasion d’affinement et de développement intellectuel.
Briller ou charmer est sans doute la condition de la vie mondaine, et l’on ne pense pas qu’une jeune fille recherche dans les fêtes un motif de mortification. Mais briller par l’esprit, charmer par la délicatesse et par la bonne grâce, non pas en coquette, fut le triomphe de Pauline. Bien plus encore qu’à elle-même, elle demandait à autrui le plaisir d’éveiller des idées. Les salons lui semblaient être le lieu d’échange de la pensée.
« Plus tard, écrit Mme Craven dans le Récit d’une Sœur, Eugénie eut une sorte de remords de notre gaieté d’alors. À une autre époque, jugeant les choses à la seule lumière de la foi, elle devint sévère pour ce temps d’enfantillage et de joie, et disait quelquefois qu’elle n’en aimait pas le souvenir. Pour moi, j’étais et je demeure moins scrupuleuse, et c’est un moment que j’aime toujours à me rappeler. Notre vie ensemble était si heureuse ! »
Une nouvelle surprit la famille de la Ferronnays au cours d’excursions prolongées dans le nord de l’Italie : la nomination du comte de la Ferronnays à l’ambassade de Rome.
Pauline rentra en France et passa quelques mois dans la propriété familiale de Montigny, près de Vendôme, puis à Paris. Elle se rendit à Rome en avril 1830.
Elle-même a décrit ses impressions d’alors : Je partais pour Rome où je n’avais jamais été et pour laquelle j’avais soupiré d’une façon extraordinaire depuis mon enfance. Je partais dans la plus belle saison de l’année, avec une sœur qui partageait et doublait toutes mes joies. J’allais avec ma mère rejoindre mon père et jouir près de lui d’une agréable et brillante existence dans le lieu que je préférais, avant de le connaître – comme depuis, – à tous les lieux de la terre. Pas une ombre n’obscurcissait mes heureuses pensées. Tout me semblait beau dans le présent, plus beau encore dans l’avenir, et, parmi tant d’heureux jours dont ma jeunesse fut remplie, ces jours m’apparaissent encore comme meilleurs que les autres.
« Ce fut dans la nuit du 1er au 2 mai que nous entrâmes dans Rome. Il faisait un brouillard assez épais, que la lune perçait cependant de temps en temps. C’est à cette lueur incertaine que je vis Rome pour la première fois. Malgré cela, l’impression que me fit notre entrée par la place du Peuple fut grande… Nous habitâmes peu de temps le palais de l’ambassade ; mais nous y fûmes bien heureux, et nos pensées s’y reportèrent souvent depuis, quoique ce premier et trop court séjour à Rome ait laissé des traces moins profondes dans notre souvenir que ceux que nous y fîmes plus tard. »
Dès le lendemain matin de l’arrivée, la famille de la Ferronnays se hâta vers la basilique de Saint-Pierre. L’ambassadeur voulut présider à ce pèlerinage et lui donner la gravité d’une démarche humble et chrétienne. L’émotion fut très vive. Cette émotion même, l’empressement que n’avait pu retarder la fatigue d’un long voyage, la solennité que donnait la présence du chef éminent de la famille, firent comprendre à Pauline, dès ses premiers pas à Rome, que la chaire de saint Pierre est la pierre angulaire de l’édifice chrétien universel.
Plus tard, en rédigeant ses Réminiscences, Mme Craven célébra les gloires de la basilique triomphale : « J’aime, oh ! oui, j’aime à prier à Saint-Pierre. Je m’y sens souvent transportée de bonheur et même d’une sorte d’orgueil qui ressemble à ce que peut éprouver le fils d’une illustre maison en entrant dans une demeure qui lui rappelle de toutes parts la grandeur de ses frères. Sans doute il est bon de ressentir aussi l’impression de douleur que doit causer l’exil, condition du chrétien sur terre. Celle-là, les cathédrales du Nord la réveillent, et c’est pourquoi la prière est féconde aussi sous leurs arceaux et à l’ombre de leurs sombres vitraux ; mais ces deux impressions peuvent remplir l’âme tour à tour, sans se contrarier, et en complétant, au contraire, l’une par l’autre, l’idée catholique tout entière qui comprend à la fois la douleur et la joie, comme elle partage l’année en jours de fêtes et en jours de pénitence. »
L’audience accordée à la famille de la Ferronnays par le pape Pie VIII donna à Pauline une confiance suprême en l’avenir de l’Église. La prudence et la science de Pie VIII triomphaient alors, au cours d’un pontificat très bref, de difficultés moindres que celles qui devaient assaillir plus tard la Papauté. C’était une ère de paix. Pauline en garda une vive impression : « Le jour où pour la première fois, en 1830, mes parents me conduisirent au Vatican pour y être admise en présence du pape, était un de ces jours plus rares dans la vie que je ne l’imaginais alors, où l’on se trouve heureux absolument et sans restriction aucune. J’étais jeune, assez pour ne pas prévoir que l’heure présente peut s’obscurcir, pas assez pour ne pas goûter dans toute leur étendue les jouissances qu’elle m’apportait… Tandis que je montais l’escalier du Vatican, j’avais la sensation de marcher sur des nuages dorés. Je me souviens, entre autres, qu’à cette époque (au commencement de 1830), le mot “Révolution” avait pour moi un sens purement historique. La chose elle-même ne me paraissait pas plus appartenir au temps qui était le mien, que les croisades, les trêves de Dieu ou les combats en champ clos ; et je me demandais souvent alors comment on avait fait pour vivre dans ce temps-là. »





























