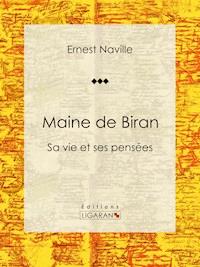
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "La vie de Maine de Biran n'offre point ces circonstances qui éveillent la curiosité générale. Les orages de la Révolution l'atteignent à peine ; il fournit une longue carrière politique sous l'Empire et la Restauration, et, une seule fois, il se trouve appelé à prendre une part active à un de ces faits qui s'inscrivent pour toujours dans les annales des nations."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335075847
©Ligaran 2015
Maine de Biran est mort il y a trente-trois ans. On ne possède, toutefois, que d’une manière fort incomplète l’exposition des doctrines de ce philosophe, que M. Cousin a nommé « le plus grand métaphysicien qui ait honoré la France depuis Malebranche » ; une période entière du développement progressif de ses théories est presque ignorée ; ses œuvres les plus importantes sont inédites. Aussi, bien que son nom soit souvent mentionné, on le lit peu et on le connaît mal, même en France. L’Angleterre et l’Allemagne ont gardé, à son égard, un silence presque absolu.
En un mot, s’il a une place marquée dans l’histoire de la philosophie, il n’a pas encore obtenu dans cette histoire sa place légitime.
Il existe cependant une édition, en quatre volumes, des œuvres de Maine de Biran, et cette édition a été mise au jour par l’homme d’Europe le mieux placé pour accomplir convenablement une telle œuvre. La notice annexée à cet avant-propos dira quelles circonstances ont paralysé les efforts d’un éditeur illustre qui, désirant publier les œuvres capitales du penseur éminent qui avait été l’un de ses maîtres, a été réduit, par la force des choses, à n’imprimer que quelques écrits spéciaux et de simples fragments.
Cette même notice expliquera comment il est devenu possible de mettre en lumière aujourd’hui les grandes compositions scientifiques de M. de Biran.
Le présent volume sera, je l’espère, l’avant-coureur d’une telle publication : il n’en est pas le commencement. Ce volume forme un tout parfaitement distinct et s’adresse à un public beaucoup plus étendu que celui qui aborde les abstractions de la philosophie proprement dite. Je ferai connaître en peu de mots sa nature et son but.
M. de Biran a laissé des cahiers de souvenirs dont M. Cousin a, depuis longtemps, signalé l’existence. Ces cahiers, joints à quelques documents analogues, constituent le Journal intime de l’auteur qui se compose dans sa totalité de :
1° Un manuscrit assez volumineux portant les dates de 1794 et 1795.
2° Quatre cahiers formant une série non interrompue, et dont la rédaction commence en février 1814, pour se terminer deux mois avant la mort de l’auteur, en mai 1824.
3° Quelques agendas de poche et un grand nombre de feuilles volantes de diverses époques. Deux de ces agendas et quelques-unes des feuilles volantes appartiennent à la période qui séparé 1795 de 1814 ; il n’existe pas de rédaction plus complète pour cet intervalle de dix-neuf années.
Tous ces papiers réunis forment un ensemble de plus de douze cents pages, qui offrent une grande variété dans leur contenu. Des dissertations politiques, le récit souvent fort détaillé des incidents de la vie journalière, des aperçus philosophiques offrant toute la spontanéité d’une pensée qui vient de naître, s’y mêlent à des analyses d’une nature personnelle et intime, à l’expression des mouvements les plus secrets de l’âme. La rédaction, dans son ensemble, n’offre aucune régularité : tantôt il ne se passe pas un jour dont quelques lignes ne conservent la trace ; tantôt il y a des lacunes de plusieurs semaines ; ici les moindres circonstances du dehors sont scrupuleusement enregistrées ; là les produits de la réflexion remplissent seuls des pages qui revêtent un caractère scientifique. Ces variations mêmes sont un des traits essentiels de ce tableau dans lequel l’écrivain a vivement empreint son image.
En me confiant ces documents précieux, avec l’autorisation d’en faire tel usage qui me paraîtrait convenable, le fils de l’auteur, M. Félix Maine de Biran, m’a honoré d’une confiance pour laquelle je le prie de vouloir bien agréer ici mes publics remerciements.
La pensée d’extraire de cet ensemble de matériaux la partie propre à être communiquée au public s’offrait tout naturellement. Telle est l’origine des Pensées de M. de Biran qui ne sont autre chose qu’un choix de fragments textuellement empruntés aux manuscrits du Journal intime. Il était nécessaire de choisir. L’étendue des rédactions originales et les répétitions fréquentes qu’elles renferment ne permettaient pas de les publier intégralement ; les lois de la discrétion interdisaient de reproduire telle page relative à des personnes encore vivantes ; les dissertations politiques, enfin, auraient rompu l’unité d’intérêt que ce recueil peut offrir. Ce qu’il fallait demander avant tout aux cahiers de souvenirs de M. de Biran, c’était M. de Biran lui-même, dans sa personnalité vivante. Montrer le mouvement de la vie intérieure de l’écrivain, mettre le lecteur à même de discerner, dans les expériences personnelles du philosophe, l’origine de ses théories métaphysiques et de ses pensées religieuses ; retracer, en un mot, la marche que suit, dans son développement, cette âme remarquablement sincère ; tel est le but qui m’a servi de guide dans mon choix, au milieu des hésitations inséparables d’un travail de cette nature.
Le lecteur, du reste, sera mis à même de se former une idée exacte de la physionomie du Journal intime, dans son intégrité : les pages relatives aux mois de mars et avril 1818 ont été transcrites tout entières dans ce volume, à titre de spécimen.
La pensée ou, pour mieux dire, l’âme de M. de Biran, prise à son point de départ, et suivie dans ses phases diverses, jusqu’au moment où elle se tourne avec ardeur vers le monde invisible et les espérances éternelles, offre un spectacle d’une haute moralité. Cette considération justifiera, je l’espère, ce qui aura toujours besoin d’être justifié par un but sérieusement utile, ce que, sans cela, les exemples les plus nombreux et même les plus illustres ne sauraient absoudre à mes yeux : le fait de livrer au public des pages confidentielles. Du reste, s’il en était besoin, on pourrait invoquer, en faveur de la convenance de cette publication, l’autorité de l’homme que M. de Biran choisit lui-même pour son exécuteur testamentaire : M. Lainé. Après avoir parcouru les cahiers laissés par son ami, M. Lainé écrivait que « dans ce persévérant ouvrage de tous les jours on trouverait beaucoup de pensées capables de faire honneur à la mémoire du défunt. »
On voudra bien ne pas chercher dans ce livre une forme achevée et un style toujours correct, se rappelant qu’on a sous les yeux une rédaction rapide que l’auteur n’a jamais revue et que l’éditeur a dû respecter. Le manuscrit renferme un grand nombre de citations qui quelquefois ne sont séparées du texte par aucun signe distinctif. J’ai indiqué toutes celles de ces citations que j’ai su reconnaître ; mais il n’est pas impossible que plusieurs aient échappé à mes regards, et qu’un certain nombre de lignes étrangères demeurent ainsi confondues avec l’œuvre propre de M. de Biran.
Dans la biographie qui ouvre le volume les questions métaphysiques ne sont abordées qu’au degré nécessaire pour l’intelligence des Pensées.
L’exposition étendue et spéciale que méritent les doctrines de l’auteur trouverait sa place naturelle dans l’introduction qui pourrait être mise en tête de ses écrits philosophiques.
Ce livre ne s’adresse pas seulement aux métaphysiciens. Son contenu est fait pour intéresser toutes les âmes sérieuses ; sa forme le rend accessible à tous les esprits cultivés. Mais, pour en reconnaître le mérite, il est indispensable de le lire tout entier. Son caractère extérieur ne doit pas faire illusion ; en apparence, on a sous les yeux des fragments détachés, mais en réalité ces fragments sont les moments successifs et étroitement enchaînés d’un mouvement continu. La fin seule donne au commencement son intérêt véritable, et le commencement à son tour peut seul donner à la fin toute sa valeur.
ERNEST NAVILLE.
Genève, le 16 février 1857.
M. de Biran n’a publié lui-même que trois de ses écrits : un Mémoire sur l’habitude, production de sa jeunesse, un Examen des leçons de philosophie de M. Laromiguière, et un article sur Leibnitz, rédigé pour la Biographie universelle. Il avait de plus commencé, en 1807, l’impression d’un mémoire sur la décomposition de la pensée ; mais au moment où il avait corrigé les épreuves du tiers environ de son travail, une circonstance inconnue, et qu’il désigne lui-même comme « un évènement extraordinaire sur lequel il doit garder le silence, » le fit renoncer à cette publication.
Des trois écrits publiés, le premier ne faisait nullement connaître les théories de M. de Biran telles qu’elles existaient dans son esprit, à l’époque de la maturité de sa vie ; les deux autres étaient des ouvrages de circonstance qui ne présentaient ces mêmes théories que dans quelques-unes de leurs applications, et ne permettaient pas d’en apprécier, d’une manière suffisante, la valeur et la portée. Ce philosophe, cependant, avait exposé ses doctrines dans des rédactions étendues, mais, au moment de sa mort, ces rédactions étaient encore inédites. Il ne fit dans son testament aucune mention de ses manuscrits, se bornant à désigner verbalement et d’une manière générale M. Lainé, son ami, pour son exécuteur testamentaire. Celui-ci pria M. Cousin de prendre connaissance des papiers du défunt, et d’indiquer le parti qu’on pouvait en tirer. Au moment où s’effectua cette démarche, dont on pouvait attendre les meilleurs résultats, un fait regrettable s’était malheureusement accompli : des brochures et des manuscrits faisant partie de la succession de M. de Biran avaient été jetés dans une corbeille, sans le discernement convenable, à titre de paperasses, et portés chez l’épicier par un des domestiques de la maison. Cette fâcheuse incurie a probablement été la cause de pertes irréparables.
M. Cousin dressa, sous la date du 15 août 1825, l’inventaire des écrits qui lui avaient été confiés. Cette pièce ne pouvait faire mention de tous les travaux de M. de Biran, plusieurs de ses manuscrits étant restés en Périgord, et n’ayant pas été remis par conséquent aux mains de M. Lainé. Toutefois, M. Cousin jugea les ouvrages qu’il avait sous les yeux assez importants pour justifier le projet d’une édition en quatre volumes. Ni ce projet, ni l’inventaire qui en était la base ne parvinrent à la connaissance de la famille de M. de Biran, qui reçut au contraire l’avis que dans les papiers philosophiques du défunt « on pourrait trouver un volume digne de la réputation de l’auteur, mais que les sujets de métaphysique étaient si peu du goût du public qu’il était à craindre qu’en imprimant on ne retrouvât pas les frais . » La famille de M. de Biran pensa, que si, des volumineux travaux d’une vie entière, on ne pouvait tirer qu’un seul volume, et un volume destiné à laisser le public indifférent, il fallait que l’on fût réduit à livrer à l’impression des fragments mutilés, ou des ébauches de nature à donner une idée incomplète et peut-être erronée de la pensée de l’auteur. Elle répondit, en conséquence, que M. Lainé était libre de disposer des ouvrages de son ami, mais que la famille de celui-ci estimait que « sa réputation et sa mémoire ne devaient pas être compromises par un ouvrage posthume insignifiant. » Ainsi, l’inventaire du 15 août 1825 ne fut pas transmis aux personnes les plus intéressées à le connaître ; et il survint un malentendu qui eut de fâcheuses conséquences. M. Cousin dut rendre tous les papiers qui lui avaient été confiés, à l’exception d’un manuscrit sur les rapports du physique et du moral de l’homme. L’écrivain que ses éminentes facultés, sa haute renommée et ses relations avec le défunt désignaient entre tous pour éditer les œuvres de son maître et son ami, ne put remplir cette tâche dans le moment le plus favorable. Dix années s’écoulèrent sans qu’aucune partie des travaux de M. de Biran fût communiquée au public.
Des intérêts graves et divers étaient cependant attachés à la publication de ces manuscrits. La réfutation des doctrines, longtemps régnantes, du Condillacisme, par un écrivain qui avait acquis une connaissance d’autant plus intime de ces doctrines qu’il s’en était cru le disciple, avait une valeur spéciale ; la France philosophique se devait à elle-même d’établir que, pour abjurer de trop longues erreurs, elle n’avait pas attendu les influences de l’Écosse et de l’Allemagne ; enfin des sentiments de l’ordre le plus sérieux devaient faire désirer la mise au jour d’écrits qui promettaient de fournir de nouvelles armes aux défenseurs de la dignité de la nature humaine et des saintes espérances de son avenir.
Cette dernière considération était surtout présente à l’esprit de l’un des amis les plus chers du défunt, qui, mieux qu’un autre, pouvait apprécier la valeur morale des travaux de celui qu’il pleurait. M. Stapfer, qui s’était écrié que la mort de M. de Biran était une calamité, exprimait ce qu’il y avait de plus profond dans ses regrets en disant : « Je m’imaginais que la philosophie religieuse avait besoin de lui. » La correspondance de cet homme de bien offre le commentaire de ces paroles, commentaire d’un intérêt trop vrai pour être ici déplacé : « Hélas ! (écrivait-il le 21 septembre 1824), sa mort si prématurée, si douloureuse pour sa famille et pour ses amis, pour l’État et pour sa contrée natale, est encore un deuil pour la religion et la morale, sciences auxquelles l’ouvrage qui l’occupait aurait donné de nouveaux appuis. La partie que sa santé et ses nombreuses occupations de devoir et de bienfaisance lui ont permis d’achever appartient à la saine philosophie, non moins qu’à sa gloire personnelle, qui au reste n’est jamais entrée pour la plus petite part dans les motifs nobles et désintéressés qui lui ont mis la plume à la main. Dans l’intérêt des sciences, qu’il cultivait avec tant de succès, et qu’il a enrichies de plus d’un écrit remarquable, il est vivement à souhaiter qu’aucun de ses travaux, même simplement ébauchés, ne soit perdu pour les doctrines sur lesquelles reposent les plus chères espérances de l’homme, sa dignité morale et sa foi en une meilleure existence. »
Quelques années après, Stapfer revenait sur le même sujet : « Les manuscrits qu’il a laissés contiennent un trésor de pensées aussi originales et neuves que solides et dignes de l’attention des hommes religieux. Leur publication fournirait aux défenseurs de la spiritualité et de l’immortalité de l’âme des armes précieuses pour la défense des plus grands intérêts de l’humanité. Des erreurs funestes (que la secte des Saint-Simoniens a renouvelées et ne propage qu’avec trop de succès), n’ont jamais été aussi bien réfutées que par Maine de Biran. Le panthéisme, en particulier, qui lève de nouveau sa hideuse tête, et qui fait sa proie de beaucoup de jeunes gens studieux et adonnés aux spéculations philosophiques, serait victorieusement combattu à l’aide de ses doctrines psychologiques. »
Un fragment d’une autre lettre complète l’indication précise de la nature des espérances que Stapfer faisait reposer sur les profondes investigations de son ami. C’est à M. de Biran lui-même qu’il s’adresse :
« Il y a quelque chose de calmant et de fortifiant à la fois, dans les sacrifices qu’on fait au devoir. Nous exerçons alors, à un plus haut degré, notre prérogative d’êtres libres et moraux, et nous nous élevons par moments à une intelligence de la vérité bien plus vive, et, pour ainsi dire, plus intuitive que celle qui est le fruit de la spéculation ou de l’analyse psychologique. Cette parole du Sauveur : Faites la volonté de Dieu, et vous saurez alors si ma doctrine vient de lui, est un grand avertissement de ne pas chercher la vérité par des moyens uniquement rationnels. L’action par laquelle l’être libre, se dégageant des chaînes matérielles, et faisant abnégation de toute vue personnelle, d’intérêts purement individuels, s’élève au sentiment d’une indépendance qui plane sur la matière et les penchants, cette action est un élément nécessaire dans la recherche des choses immuables et du grand critérium qui est la pierre d’achoppement de la métaphysique. Il me semble que votre principe doit, dans le déroulement de ses conséquences, conduire à des résultats analogues, plus clairement développés et plus scientifiquement établis. »
Les regrets et les vœux dont on vient de lire l’expression, existaient sans doute dans le cœur de plus d’un ami de la science, et une longue attente n’avait pu les éteindre, lorsque, en 1834, M. Cousin donna au public un volume des œuvres de Maine de Biran. Ce volume contenait avec l’Examen des leçons de philosophie de M. Laromiguière, et l’Exposition de la doctrine philosophique de Leibnitz, le traité sur les Rapports du physique et du moral, dont il a été fait mention plus haut, et un autre ouvrage inédit de moindre étendue. Cette publication, dont une préface de l’éditeur augmentait l’importance, était loin toutefois de répondre à la légitime attente de ceux qui connaissaient le nombre et la nature des manuscrits de M. de Biran. Il suffisait, pour s’en convaincre, de lire avec attention l’inventaire de 1825, que M. Cousin avait introduit dans sa préface. Le traité sur les Rapports du physique et du moral était un travail soigné et d’un grand intérêt ; mais c’était un écrit spécial, l’application des principes de l’auteur à une question particulière. Ces principes, dans leur généralité, avaient été développés dans le Mémoire sur la décomposition de la pensée, couronné par l’Institut de France, puis dans un mémoire couronné par l’Académie de Berlin, puis encore dans un mémoire couronné par l’Académie de Copenhague ; enfin M. de Biran avait travaillé pendant de longues années à réunir et à compléter tous ces écrits dans un vaste travail renfermant l’exposition complète de sa théorie, travail qui devait être terminé ou à peu près : tout cela était de notoriété publique, et aucun de ces ouvrages importants ne figurait dans le volume qui venait de paraître. Ce volume n’était donc, selon les propres expressions de l’éditeur « qu’une pierre d’attente au monument que méritaient les travaux de Maine de Biran. » M. Cousin ne pouvait considérer comme terminée la pieuse tâche qu’il s’était imposée de conserver et de répandre les travaux et la mémoire de celui qui avait été un de ses maîtres, et qu’il pouvait appeler le premier métaphysicien de son temps. » Aussi tenta-t-il de nouveaux efforts. Il ne put atteindre, par suite de circonstances qui me sont inconnues, les manuscrits que la mort de M. Lainé avait fait passer entre les mains des héritiers de cet homme d’État ; mais il réussit à se procurer un Mémoire de M. de Biran sur les phénomènes du sommeil, qu’il lut à l’Académie des sciences morales et politiques, le 31 mai 1834, et qui fut inséré dans les recueils de cette Académie. Il écrivit à Berlin, à Copenhague, et fit des recherches dans les archives de l’Institut de France pour y découvrir les Mémoires, couronnés par ces corps savants ; mais ces démarches ne pouvaient avoir de résultat, ces divers travaux ayant été retirés par M. de Biran. M. Cousin, pour continuer son œuvre, autant que le lui permettaient les circonstances, ne put donc que se procurer de divers côtés quelques autres écrits qui virent le jour en 1841. Ces écrits, joints à la réimpression du traité sur l’Influence de l’habitude, et du Mémoire sur les phénomènes du sommeil, et au volume de 1834, constituèrent une édition des Œuvres philosophiques de Maine de Biran, édition que l’éditeur et le public étaient réduits à considérer comme définitive.
Cette publication, bien que digne d’intérêt à plus d’un égard, était cependant un mécompte, soit pour les amis de M. de Biran, soit pour les amis des études philosophiques. Au nombre des nouveaux écrits que M. Cousin s’était procurés, on trouvait la partie du Mémoire sur la décomposition de la pensée, imprimée en 1807 ; c’était un texte donné par l’auteur lui-même, mais ce n’était qu’un commencement. Les autres écrits étaient des fragments plus ou moins étendus, mais tous incomplets, parfois sans liaison apparente d’un alinéa à l’autre, pour tout dire, fort difficiles à entendre, soit dans quelques-uns de leurs détails, soit dans leur but et leur ordonnance générale. Enfin et surtout, le travail destiné à résumer les Mémoires couronnés à Paris, à Berlin et à Copenhague, l’écrit principal de M. de Biran, l’écrit qui résumait sa pensée, que lui-même destinait à l’impression, faisait absolument défaut. Cette circonstance éveilla d’une manière toute spéciale l’attention de M. Naville, de Genève.
M. Naville avait rencontré Maine de Biran à Genève, dans l’automne de 1822. Se trouvant à Paris, au printemps de 1824, il saisit avec empressement l’occasion de cultiver une relation à laquelle il attachait le plus haut prix. Il a exprimé lui-même l’impression qu’il, reçut de la conversation du philosophe dans les lignes suivantes, extraites de l’un de ses manuscrits : « Au printemps de 1824, j’eus l’honneur d’être admis dans la réunion qui s’assemblait chez lui tous les vendredis. Là se trouvaient, entre autres, M. Lainé, pair de France, son plus intime ami, MM. Ampère, Stapfer, Degérando ; Droz, Frédéric Cuvier… La conversation tombait-elle sur la politique ou sur les grands intérêts moraux du pays et de l’humanité, M. Lainé, muet d’ailleurs toutes les fois qu’il s’agissait de métaphysique, s’animait alors, et dans ses paroles il y avait une si grande élévation d’idées, tant de chaleur de sentiment, une éloquence si entraînante, qu’il ravissait tous les esprits, et que sa supériorité ne pouvait être méconnue. Mais, lorsque la conversation roulait sur la philosophie, ce qui était l’ordinaire, Maine de Biran avait incontestablement l’avantage. Quand tous les savants qui composaient cette réunion seraient encore vivants, je n’en affirmerais pas moins, sans crainte d’être démenti, que chacun d’eux avait alors la conscience de son infériorité, et écoutait le grand philosophe avec une attention respectueuse, qui semblait renouveler l’aveu de Royer-Collard : Il est notre maître à tous. »
Sous l’empire d’impressions semblables, on comprend et le chagrin de M. Naville lorsque, peu de mois après son retour à Genève, il apprit la fin de celui qu’il avait vu, selon ses propres paroles, « dans toute la sève et tout le triomphe du génie, » et le vif intérêt avec lequel il s’informa des destinées de ce grand ouvrage dont l’auteur lui avait parlé. « Le fruit de ses méditations serait-il donc perdu pour la philosophie ? » écrivait-il à M. Stapfer, dès le 31 août 1824. « Cet ouvrage de psychologie, auquel il travaillait depuis si longtemps, et qui paraissait être si avancé, ne serait-il pas en état de paraître ? » Il adressa les mêmes questions à M. Lainé. Enfin, après les publications successives de 1834 et de 1841, partagé entre la satisfaction de posséder ces quatre volumes et le chagrin de devoir se résigner à la perte des parties les plus essentielles de l’œuvre du philosophe défunt, il s’appliqua à une étude approfondie et consciencieuse des ouvrages mis au jour. Son désir était surtout de se rendre un compte exact des degrés successifs par lesquels avait passé l’esprit de M. de Biran dans le développement qui le conduisit si loin du Condillacisme, son point de départ. Ce travail reçut une destination spéciale, sur la demande de M. le professeur de La Rive, qui désirait l’insérer dans la Bibliothèque universelle de Genève. M. Naville poursuivit le but avec tant de zèle qu’il le dépassa. Sa rédaction achevée, il se trouva en présence d’un écrit trop étendu et pénétrant trop avant dans le champ des abstractions métaphysiques pour convenir à un recueil périodique, sérieux à la vérité, mais dont la philosophie n’était pas l’objet spécial : l’article était devenu un livre. Le manuscrit, privé de la sorte de sa destination primitive, méritait d’être publié à part. Cette publication pouvait acquérir plus de valeur par l’adjonction d’une notice biographique et de quelques fragments inédits. Dans le but de se procurer les matériaux de cette notice et les fragments désirés, M. Naville s’adressa à la famille de Biran.
M. Félix Maine de Biran, étranger, par la nature, de ses occupations, aux sciences philosophiques, mais animé envers la mémoire de son père de sentiments dont les années n’avaient point affaibli la vivacité, accueillit avec empressement la demande qui lui était adressée, et fit immédiatement des démarches auprès des héritiers de M. Lainé. Ces démarches furent couronnées d’un succès sans aucune proportion avec les espérances qui les avaient provoquées. M. Naville reçut en décembre 1843, non pas les simples fragments qu’il avait demandés, mais une caisse considérable pleine de manuscrits. En septembre 1844, il reçut une nouvelle caisse contenant d’autres manuscrits retrouvés à Grateloup, résidence de Maine de Biran en Périgord. Ce double envoi renfermait la plupart des pièces consignées dans l’inventaire de 1825, beaucoup d’autres qui, étant restées en Périgord, n’avaient pu figurer dans cet inventaire dressé à Paris, et, en particulier, sous le titre d’Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de la nature, une vaste composition, qui était visiblement la refonte de tous les mémoires couronnés, la psychologie si souvent réclamée.
On comprend que ce fut avec une grande satisfaction que M. Naville prit connaissance du trésor (il n’usait pas d’une autre expression), mais pour se représenter la plénitude de sa joie, il faut en avoir été témoin. Il avait fini par désespérer du succès de démarches multipliées pendant près de vingt ans ; et une démarche dernière, à laquelle il ne demandait plus qu’un médiocre résultat, réalisait, et au-delà, les espérances les plus ambitieuses qu’il eût jamais conçues. Quelque vif que fût ce sentiment de joie, il se mélangea immédiatement d’un regret, le regret que les œuvres de M. de Biran n’eussent pas été publiées au temps le plus propice, et par leur éditeur naturel. Il est certain que, à dater de 1844, une édition des œuvres de Maine de Biran ne pouvait que bien difficilement réunir les conditions de succès d’une édition donnée par M. Cousin en 1825. Mais le mal ne pouvait être mieux réparé que par la remise des manuscrits à celui qui venait d’en prendre possession. M. Naville, en effet, était éminemment propre, par les facultés de son esprit, par ses antécédents scientifiques et par son caractère, à la tâche de veiller à l’édition posthume d’ouvrages tels que ceux dont il s’agissait.
Il avait manifesté, jeune encore, avec une grande puissance d’imagination, une prédilection marquée pour les recherches de la pensée spéculative. Cette direction de son esprit, combinée avec un ardent amour du bien, dirigea ses premières études sur les fondements de la morale. Après de longues méditations sur ce problème capital, sa vie intellectuelle prit, pour un temps, un autre cours : il aborda, presque à titre de délassement, des questions prises dans les sphères plus immédiatement pratiques de l’éducation et de l’organisation de la charité. Les succès flatteurs que lui valurent les travaux de cet ordre ne diminuèrent en rien son penchant pour la métaphysique, science à laquelle il revint, sur la fin de sa carrière, avec un esprit qui, pour avoir acquis plus de maturité, n’avait rien perdu de cette tendance vers l’idéal, qui, trop souvent, s’émousse au rude contact des réalités de la vie. Il se disposait à entreprendre un travail philosophique, qui fût l’expression directe de sa pensée, lorsqu’il se décida, sans l’apparence même de l’hésitation, à consacrer tout son temps à l’œuvre secondaire et sans éclat d’un éditeur. Lorsque quelques-uns des amis de M. Naville, jaloux d’une renommée personnelle qu’il leur paraissait compromettre, lui représentaient qu’il pouvait faire mieux que d’enfouir ses talents dans l’étude des manuscrits d’un autre, il répondait par un sourire dans lequel une sorte d’ironie se mêlait à la bienveillance. L’œuvre jugée ingrate par ceux qui, pensait-il, ne savaient la comprendre, était, à ses yeux, un service rendu à la noble cause de la science et à la sainte cause du bien, une bonne œuvre dans toute l’étendue du terme. Aussi, sous l’empire d’une imagination toujours jeune, s’adonnait-il avec une sorte d’enthousiasme à une tâche qui satisfaisait à la fois les deux grands intérêts de sa vie : la pensée et la conscience. Ce sentiment, si vrai, si profond, est peut-être le plus bel hommage que pût recevoir la mémoire d’un philosophe distingué et d’un homme de bien.
La première chose à faire était de mettre quelque ordre dans des papiers qui s’offraient dans un état de complète confusion. « De cette masse énorme de manuscrits, écrivait M. Naville, un tiers environ présente une écriture lisible ; ceux-ci sont rédigés avec ordre, mais ils appartiennent aux premières époques de la carrière philosophique de l’auteur, ou se rapportent à des ouvrages déjà publiés, et nous avons dû immédiatement les mettre de côté. Le reste est d’une écriture qui devient toujours plus mauvaise à mesure que le temps avance. Plusieurs circonstances se réunissent pour les rendre difficiles à déchiffrer : ce sont des mots illisibles, des rédactions diverses entassées soit entre les lignes, soit dans les marges, sans que l’auteur ait pris soin d’effacer celles qui devaient disparaître ; c’est une multitude de renvois au milieu desquels on se perd. En outre, la plupart des feuilles sont détachées, sans qu’aucun numéro en indique l’ordre, et souvent sans qu’aucun indice en tête ou en marge puisse aider à en établir la série. Les ratures et les corrections, qui se multiplient surtout à la fin et au commencement des pages, augmentent encore à cet égard les difficultés. Quelle tâche que celle de porter la lumière dans ce chaos ! »
Cette tâche était acceptée dans toute son étendue. M. Naville se sentait soutenu dans un travail presque mécanique, par la perspective d’arriver à un point où son œuvre obtiendrait le concours unanime de tous les Français éclairés. « Lorsque nous pourrons naviguer à pleine voile sur la mer de la pensée, écrivait-il, il ne manquera pas de hautes intelligences, disposées à nous seconder. Que ne pouvons-nous pas attendre de M. Cousin, qui a donné tant de gages d’attachement à Maine de Biran, et de l’intérêt qu’il porte à sa mémoire !… Nous ne craignons pas d’être trompé dans notre espoir, lorsque nous comptons sur le haut patronage, l’intérêt actif et les directions lumineuses du chef actuel de la philosophie française. M. Charles de Rémusat, à qui nous avons fait part en détail de nos découvertes, nous a promis non seulement son appui et ses précieux conseils, mais aussi une coopération active à l’œuvre de la publication. La nature des travaux qui ont dû nous occuper jusqu’à présent, ne nous a pas encore mis dans le cas de réclamer l’assistance de si hautes facultés ; mais on comprend quelle est la confiance que nous inspirent les bienveillantes dispositions d’un homme doué du plus noble caractère, et qui s’est honorablement signalé dans le champ de la philosophie. Enfin, si les occupations multipliées de ces deux esprits éminents venaient à nous rendre nécessaires d’autres secours, nous trouverions sûrement des aides dans cette jeune élite de penseurs qui, sous l’influence d’un souffle vivifiant, se sont déjà fait des noms dans la plus haute des sciences. Ils s’estimeraient heureux, sans doute, de contribuer avec nous à une œuvre destinée à jeter un jour nouveau sur les grands problèmes qui les préoccupent, et bientôt ils trouveraient la récompense de leur dévouement dans les nobles jouissances d’un commerce intime avec un esprit, d’une profondeur extraordinaire, avec une âme qui, exclusivement captivée par le pur amour de la vérité, exercerait moralement sur eux la plus salutaire influence. »
Encouragé par de telles pensées, M. Naville poursuivait son travail avec ardeur. Il reconstituait les manuscrits, en en recueillant les feuilles dispersées, et les classait après une étude consciencieuse : en même temps, il jetait sur le papier les premières ébauches d’une biographie de M. de Biran, et d’un article que M. Franck lui avait demandé pour le Dictionnaire des sciences philosophiques. Cependant un pressentiment souvent exprimé l’avertissait que la vie lui ferait défaut avant que sa laborieuse tâche fût achevée. Cette prévision, loin de ralentir son zèle, ne faisait que le redoubler ; et bien qu’il eût l’espoir fondé de voir son œuvre poursuivie après lui, il désira, à tout évènement, ne négliger aucune des précautions que pouvait lui inspirer une prudence pleine de sollicitude. « Il est peu vraisemblable que nous vivions assez longtemps pour voir la fin de ce travail (écrivait-il une année avant sa mort), en conséquence nous avons cru qu’il convenait d’attirer dès à présent sur notre œuvre l’attention des amis de la philosophie, en sorte qu’après nous il ne manque pas de personnes désireuses de l’achever. »
Dans ce but, il inséra dans la Bibliothèque universelle de Genève, quelques fragments de Maine de Biran, et fit connaître en même temps le nombre et la valeur des manuscrits déposés en ses mains. Ce travail fut le dernier. M. Naville souffrait depuis longtemps d’une maladie d’estomac, contre laquelle la vigueur de son tempérament et sa force morale soutenaient une lutte inégale, mais toujours renouvelée. Jamais il ne renonça ni au travail de la pensée, ni à l’accomplissement de devoirs plus immédiatement pratiques qu’il avait volontairement multipliés dans son existence. Son activité ne fut, jusqu’à la fin, que momentanément suspendue, durant les plus violents accès du mal ; et, dans les heures mêmes où la résignation du Chrétien demeurait comme le seul devoir imposé, sa pensée, lorsqu’elle se tournait encore vers les choses de ce monde, s’arrêtait avec un intérêt que rien ne pouvait altérer sur cette œuvre modeste d’éditeur, qu’il avait entreprise avec la conscience de rendre un service à la sainte cause de cette vérité qui ne passe pas. Le dernier fragment publié dans la Bibliothèque universelle porte la date de mars 1846. C’est à la même époque que la famille et les amis de M. Naville conduisaient à leur dernière demeure les dépouilles mortelles de celui qui leur avait été redemandé.
Les manuscrits de Maine de Biran avaient été arrachés à l’oubli ; les travaux que réclamait la publication des œuvres inédites de ce philosophe étaient largement ébauchés ; il ne fallait plus que marcher dans une route ouverte. Celui des fils de M. Naville qui a continué dès lors l’œuvre commencée espère, en accomplissant cette tâche, rendre un service à la science ; mais son premier désir est de remplir avec fidélité un devoir filial.
Au mois de juillet 1847, je fus informé, par l’entremise de MM. Franck, membre de l’Institut, et de la Valette, député de Bergerac, qu’il serait possible d’obtenir du ministère de l’instruction publique une souscription de nature à faciliter beaucoup la publication des œuvres de M. de Biran. Cette espérance se réalisa, après des transactions assez longues, l’entreprise ayant obtenu l’appui de M. de Salvandy. L’impression commença par l’Essai sur les fondements de la psychologie. Dix feuilles étaient composées au moment où éclata la révolution de février 1848. Cet évènement inattendu arrêta l’œuvre commencée, le gouvernement issu de la crise révolutionnaire n’ayant pas jugé à propos d’accorder à M. Ladrange, libraire qui s’était chargé de l’édition, l’appui que lui avait promis le gouvernement qu’on venait de renverser.
Ce contretemps eut, en réalité de très heureuses conséquences. En effet, de nouveaux manuscrits découverts dans la bibliothèque de Grateloup, et une révision nouvelle de tous les documents antérieurs, qui dut être faite à l’occasion de cette découverte fournirent la preuve qu’il fallait modifier le plan des Œuvres inédites de Maine de Biran, tel qu’il avait été arrêté en 1847. À ne consulter que les manuscrits contenus dans les deux envois successifs de 1843 et 1844, on devait croire que l’Essai sur les fondements de la psychologie était la dernière expression de la pensée de l’auteur ; mais les écrits retrouvés en dernier lieu établissaient, de la manière la plus positive, que, depuis la composition de cet ouvrage, une transformation essentielle s’était accomplie dans les vues de M. de Biran. Cette transformation, provenant surtout de l’importance nouvelle accordée aux questions religieuses, avait donné naissance à un nouveau travail intitulé : Nouveaux essais d’anthropologie, travail qui devait prendre la place de l’Essai. Cet écrit n’existe que par fragments, et il est visible qu’il n’a pas été terminé, mais il n’était pas moins indispensable d’en recueillir avec soin les débris, avant de présenter au public le livre dont les évènements avaient suspendu la publication.
Ce n’est qu’à la fin de 1850, que le nouvel examen des ouvrages de M. de Biran fut assez avancé pour qu’il fût possible de dresser un catalogue raisonné de tous les écrits de ce philosophe. Ce catalogue fut présenté le 26 avril 1851, à l’Académie des sciences morales et politiques. M. Franck en fit l’objet d’un rapport verbal. « MM. de Rémusat, Mignet, Passy, Vivien prirent la parole après M. Franck et insistèrent sur l’utilité et les moyens de la publication des manuscrits de M. de Biran, et l’Académie exprima le vœu de voir encourager l’impression d’ouvrages aussi importants pour la science philosophique et le regret qu’elle éprouverait si le public en était privé plus longtemps. Elle décida que ce vœu et que ce regret seraient consignés dans son procès-verbal. »
Fort d’un tel appui, je m’adressai au ministre de l’instruction publique de cette époque, le priant d’accorder à mon entreprise des encouragements semblables à ceux qu’on avait obtenus de M. de Salvandy. Cette demande fut appuyée d’une lettre que signèrent, avec les membres de la section de philosophie, le secrétaire et le président de l’Académie des sciences morales et politiques. La réponse du ministre fut négative. Ce refus ne m’a pas fait hésiter dans l’accomplissement d’une tâche que je considère comme un devoir. Mais j’ai dû, cédant aux circonstances, me borner à publier pour le moment, au lieu des écrits philosophiques de M. de Biran, un ouvrage plus court, et accessible par son contenu à un public plus nombreux.
Les Pensées de M. de Biran auraient vu le jour depuis longtemps, sans l’influence de circonstances personnelles, dont je n’ai ni le droit, ni le désir d’occuper le lecteur. Je tiens à dire cependant que l’état actuel de ma santé me faisant de tout travail une fatigue, M. Edmond Scherer a bien voulu mettre à mon service son expérience et son amitié pour la correction des épreuves du présent volume.
Domine, fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donne requiescat in te.
(AUGUSTINI CONFESSIONES.)
La vie de Maine de Biran n’offre point ces circonstances extraordinaires qui éveillent la curiosité générale. Les orages de la Révolution l’atteignent à peine ; il fournit une longue carrière politique sous l’Empire et la Restauration, et, une seule fois, il se trouve appelé à prendre une part active à un de ces faits qui s’inscrivent pour toujours dans les annales des nations. Pour un homme mêlé aux plus grandes affaires de son pays, et placé de manière à ressentir le contrecoup des commotions publiques, on ne pourrait guère se représenter une vie moins accidentée dans des temps si fertiles en évènements. Les destinées extérieures du philosophe ont le même caractère que celles de l’homme d’État. M. de Biran agite des problèmes du plus haut intérêt et dépose des germes féconds dans le solde la science : mais, étranger à l’enseignement, et n’ayant publié que de rares et courts écrits, sa réputation ne dépasse pas l’enceinte des corps savants de l’Europe, et le cercle étroit des hommes spécialement voués, en France, à l’étude de la métaphysique. Nulle discussion passionnée ne retentit autour de ses ouvrages. C’est un penseur solitaire : la route isolée dans laquelle il s’avance se croise à peine avec les voies tumultueuses où s’agitent ces écrivains dont le nom demeure lié avec éclat aux contestations religieuses ou aux querelles politiques de leur époque.
À la considérer du dehors, une telle vie, tout à fait vide d’aventures, pourrait ne pas sembler digne d’un intérêt particulier. Mais tout change d’aspect lorsqu’on fixe les yeux sur le développement intérieur de l’homme, sur ses affections et ses pensées. On se trouve alors en présence d’une âme extraordinaire par sa sincérité, recueillant les expériences de la vie pour en soumettre les résultats à l’examen d’une intelligence pleine de finesse et de profondeur. M. de Biran fut un observateur de soi-même comme il n’en est qu’un bien petit nombre ; c’est ce qui peut donner auprès des esprits sérieux une valeur réelle au récit de son existence. C’est en dedans surtout qu’il faut le regarder vivre : car, singulièrement attentif aux faits qui se produisent sur la scène intérieure de la conscience, il le fut moins à ce qui se montre au dehors sur la scène du monde. La tâche du biographe n’est donc pas ici celle d’un narrateur ordinaire : loin de se borner à raconter des faits, il faut qu’il s’applique avant tout à reproduire des pensées, à exprimer ces mouvements du cœur, ces besoins de la conscience qui constituent la vie secrète d’une âme humaine ; tâche dont l’intérêt est grand, mais dont les difficultés égalent l’attrait.
– 1766 à 1803 –
François-Pierre Gonthier de Biran, fils d’un médecin qui pratiquait son art avec quelque distinction, naquit à Bergerac, le 29 novembre 1766. Après la première éducation reçue dans la maison paternelle, il fut envoyé à Périgueux pour y suivre les classes dirigées par les Doctrinaires. Tout ce qu’on sait de son enfance, c’est qu’il parcourut le champ des études avec facilité, et fit preuve surtout d’une aptitude marquée pour les mathématiques. Il avait hérité de ses parents une constitution délicate et un de ces tempéraments nerveux caractérisés d’ordinaire par la vivacité et la mobilité des impressions. Toute sa vie il subit au plus haut degré les influences du dehors ; le vent qui change modifie ses dispositions ; l’état de son âme varie avec le degré du thermomètre. Le Journal intime renferme des notes souvent très détaillées sur la température, l’état du ciel, l’humidité ou la sécheresse de l’atmosphère. Vous croiriez avoir affaire à un physicien. Rien cependant de plus éloigné des goûts et des habitudes de l’auteur que l’observation scientifique des faits de la nature. Si ces faits attirent ainsi son attention, c’est uniquement par leur rapport avec ses impressions personnelles. Un temps humide ou sec, un air agité ou tranquille, se traduisent immédiatement dans telle disposition particulière de son être intellectuel et moral : chaque saison, chaque état de l’atmosphère le retrouvent, en se reproduisant, triste ou gai, confiant ou découragé, enclin à des méditations paisibles ou attiré par les distractions du monde. Si ses dispositions intérieures varient ainsi avec tout ce qui change au dehors, elles ne varient pas moins avec les états divers de son organisation physique. C’est dans une circulation du sang lente ou rapide, dans une digestion facile ou laborieuse, bien plus que dans des évènements extérieurs, qu’il faut chercher le plus souvent la cause de ses espérances ou de ses craintes, du regard serein ou sombre qu’il jette sur le monde et sur les hommes.
On ne peut contester que ce tempérament délicat n’ait exercé une très vive influence sur la direction des études de M. de Biran. Une constitution si mobile et si faible contribua pour beaucoup à diriger son attention sur les faits intérieurs dont l’âme est le théâtre.
« Quand on a peu de vie ou un faible sentiment de vie, » écrit-il en 1819, « on est plus porté à observer les phénomènes intérieurs ; c’est la cause qui m’a rendu psychologue de si bonne heure. » Plus de vingt années auparavant, il traçait déjà les lignes suivantes, dans lesquelles il semble envisager comme la condition normale du philosophe cet état de maladie que Pascal considérait comme l’état naturel du chrétien : « Le sentiment de l’existence devient insensible, parce qu’il est continu. Lorsqu’on ne souffre pas, on ne songe presque pas à soi ; il faut que la maladie ou l’habitude de la réflexion nous forcent à descendre en nous-mêmes. Il n’y a guère que les gens malsains qui se sentent exister ; ceux qui se portent bien, et les philosophes mêmes, s’occupent plus à jouir de la vie qu’à rechercher ce que c’est. Ils ne sont guère étonnés de se sentir exister. La santé nous porte aux objets extérieurs, la maladie nous ramène chez nous. » On serait d’autant moins fondé à révoquer en doute la justesse de ces observations, que Cabanis expliquait, comme M. de Biran, l’origine physique des succès de ce penseur dans l’étude de la psychologie. « La nature, » lui écrit-il, « vous a donné une organisation mobile et délicate, principe de ces impressions fines et multipliées qui brillent dans vos ouvrages, et l’habitude de la méditation dont elles vous font un besoin ajoute encore à cette excessive sensibilité. »
Un savant qui oublie les faits pour construire une théorie, peut se proposer d’expliquer l’homme tout entier par le jeu de la machine organisée ; il peut, suivant une voie contraire, perdre de vue, dans un idéalisme abstrait, le rôle très positif que joue la matière dans notre existence ; il peut enfin parler de l’âme et du corps comme de deux êtres simplement juxtaposés et presque sans relations entre eux. Un observateur attentif et de bonne foi arrivera à des conclusions bien différentes, et reconnaîtra qu’il n’est peut-être pas un seul des modes de notre vie, si purement physique ou si uniquement moral qu’il puisse paraître au premier abord, qui ne soit le résultat de deux forces différentes, dont l’une procède de l’âme et dont l’autre vient du corps. C’est une des gloires de M. de Biran d’avoir solidement établi cette vérité dans la science. En opposition aux vues exclusives du matérialisme et de l’idéalisme, il a déterminé avec une grande profondeur d’analyse, la vraie nature du problème des rapports du physique et du moral de l’homme. Il a dû sans doute ses vues sur ce sujet à la patience de ses recherches et à une bonne méthode ; mais, on ne peut le méconnaître, ses recherches furent facilitées, sa méthode lui fut comme imposée par sa nature personnelle. Le besoin de réflexion qui le dominait ne devait pas lui permettre de confondre longtemps les phénomènes sensibles avec les réalités intérieures ; tandis que, d’un autre côté, il était trop accessible à toutes les impressions du dehors, et ressentait trop vivement l’influence des moindres modifications de ses organes pour méconnaître la large part de l’élément matériel dans les faits de notre double nature. Son tempérament particulier lui servit de préservatif contre plus d’une illusion : une santé plus forte, une constitution plus énergique, auraient altéré peut-être son analyse de la nature humaine, et il le savait bien.
Ces considérations seraient prématurées si M. de Biran ne nous apprenait lui-même que sa curiosité philosophique s’éveilla presque au début de sa vie. « Dès l’enfance, dit-il, je me souviens que je m’étonnais de me sentir exister ; j’étais déjà porté, comme par instinct, à me regarder au dedans pour savoir comment je pouvais vivre et être moi. » Cette question, sitôt posée par l’écolier de Périgueux renfermait tout son avenir scientifique. Se regarder en dedans, se regarder passer, comme il le dit ailleurs, ce fut toujours le besoin le plus impérieux de sa nature intellectuelle.
Parvenu au terme des études qu’il pouvait faire dans sa province, le jeune de Biran entra dans les gardes du corps en 1785, cédant aux sollicitations de quelques-uns de ses parents qui suivaient la même carrière. À cette époque de sombres nuages s’amoncelaient déjà sur l’horizon politique de la France. La royauté n’avait pas cependant perdu tout son éclat ; et les salons de la capitale réunissaient encore une société aimable et frivole. Le jeune garde du corps se produisit dans le monde ; il était fait pour y réussir. Une figure charmante, à laquelle il attachait du prix, ce qu’il se reprocha souvent dans la suite, un esprit aimable, le goût et le talent de la musique étaient pour lui des éléments de succès. Mais ce succès tenait plus encore à son caractère. Cette même faiblesse d’organisation qui lui faisait subir l’influence des variations de la température, tendait aussi à le placer sous la dépendance des personnes avec lesquelles il entretenait des rapports. Il ne pouvait supporter sans peine des marques de froideur ; un regard hostile le troublait, la pensée d’être en butte à des sentiments haineux bouleversait son âme. La bienveillance d’autrui était comme une atmosphère en dehors de laquelle sa respiration morale devenait pénible. Aussi était-il porté à prévenir chacun de ceux qu’il rencontrait, à se placer sur le terrain où il se trouverait en sympathie avec ses interlocuteurs, à se faire tout à tous, pour que l’affection générale le plaçât dans le milieu que sa nature lui rendait nécessaire. Tout cela se faisait sans effort, sans l’apparence de calcul. Il désirait la bienveillance du plus humble de ses semblables comme celle de l’homme le plus haut placé. On comprend qu’une disposition pareille contribue à faire trouver dans le monde un accueil favorable. Cette disposition chez M. de Biran s’unissait à une vraie bonté de cœur. Tout contribuait donc à le rendre d’une parfaite obligeance dans les relations sociales. Il devait à la nature un besoin de plaire qui coûta par la suite plus d’un gémissement au philosophe ; il dut à la fréquentation du monde cette politesse exquise, cette parfaite urbanité qui distinguèrent la société française dans des temps qui ne sont plus. Au sein de la civilisation nouvelle qui sortit du chaos révolutionnaire, Maine de Biran demeura, pour l’amabilité des formes et l’élégance des manières, l’un des représentants de la civilisation détruite ; l’étranger même qui ne le voyait qu’en passant en faisait la remarque.
L’élève des doctrinaires avait passé sans transition des études de sa jeunesse à une période de dissipation assez complète. L’enseignement religieux qu’il dut recevoir de ses instituteurs paraît n’avoir laissé qu’une faible trace dans son âme. En l’absence de toute conviction arrêtée, il n’avait d’autre préservatif contre les écarts des passions qu’un goût naturel pour les convenances, et un très vif instinct d’honnêteté. Cette vie d’étourdissement ne fut pas de longue durée : l’an 89 arriva. Aux journées des 5 et 6 octobre, M. de Biran eut le bras effleuré par une balle. Demeuré sans état par suite du licenciement de son corps, il forma le projet d’entrer dans le génie militaire, et reprit, à cette occasion, l’étude des mathématiques. Il a dit plusieurs fois par la suite qu’il considérait les habitudes intellectuelles qu’il avait contractées, ou plutôt confirmées à cette époque, comme une des causes de ses succès en philosophie. Cependant, sa qualité d’ancien garde du corps étant un obstacle à tout avancement dans la carrière qu’il avait en vue, il dut renoncer à ses projets, et, nul motif ne le retenant plus dans la capitale, il se décida à regagner ses foyers. Pendant son séjour à Paris, la mort lui avait enlevé son père, sa mère et deux de ses frères. Un frère et une sœur étaient les seuls membres de sa famille qui survécussent.
Le décès de ses parents l’avait mis en possession de la terre de Grateloup, domaine de sa famille maternelle, situé à une lieue et demie de Bergerac. Cette habitation isolée s’élève, entourée de bouquets d’arbres et de prairies, vers le sommet d’une éminence. Au pied de la colline un cours d’eau serpente dans un paisible vallon. De la terrasse du château la vue s’étend sur un terrain accidenté couvert de riches cultures, ou planté d’arbres vigoureux, qui sans offrir les beautés grandioses des contrées alpestres, ne manque ni de charme, ni de variété. C’est un aspect qui porte à l’âme de douces impressions : il ne rappelle que l’éternelle majesté de la nature et les paisibles travaux des habitants des campagnes.
Tel fut l’asile où M. de Biran passa les lugubres années qui couvrirent la France de crimes, de sang et de deuil. Triste et découragé, comme un jeune homme sans vocation pour le présent et sans espoir prochain pour l’avenir, il avait encore le cœur oppressé par les malheurs qui affligeaient ou menaçaient sa patrie. Le récit des attentats révolutionnaires venait, dans sa solitude, remplir son âme d’une douloureuse terreur. Sa position et son caractère lui interdisant également de prendre un rôle actif dans un drame aussi terrible, il éprouvait le besoin de se mettre à l’écart et d’oublier, autant que possible, des calamités pour le soulagement desquelles il ne pouvait rien entreprendre. Il se remit à l’étude « avec une sorte de fureur, » c’est ainsi qu’il s’exprime, et ce fut alors que, pour citer encore ses propres paroles, « il passa d’un saut de la frivolité à la philosophie. » L’étude ne trompa pas son attente. Le travail intellectuel et un contact journalier avec les sereines beautés de la nature, lui procurèrent un calme aussi grand qu’il pouvait l’espérer en des jours pareils. « Dans les circonstances actuelles, » écrit-il à un ami, « et vu ma manière de penser, la vie que j’ai adoptée est la seule qui puisse me convenir. Isolé du monde, loin des hommes si méchants, cultivant quelques talents que j’aime, moins à portée que partout ailleurs d’être témoin des désordres qui bouleversent notre malheureuse patrie, je ne désire rien autre chose que de pouvoir vivre ignoré dans ma solitude. » Ce désir fut satisfait dans les limites du possible. Il est vrai que, dans toute l’étendue du pays, il n’existait alors aucun refuge assuré contre la soif du sang et du pillage ; mais le Périgord était une province relativement paisible, et la vie retirée de M. de Biran, la douceur de son caractère, la modicité de sa fortune surtout, lui valurent de n’être pas troublé dans sa retraite. Il n’échappa pas cependant aux inquiétudes dont, au sein d’une commotion immense, nul ne peut être exempt. Tantôt il craint d’être obligé de fermer ses livres et d’abandonner sa retraite pour aller à la frontière grossir les rangs des armées de la révolution ; tantôt il aperçoit dans les populations qui l’entourent des symptômes de sinistre augure, et des craintes pour sa sûreté personnelle viennent se joindre dans son cœur agité à la douleur du deuil public. « Je m’étais flatté pendant quelque temps, écrit-il, de pouvoir vivre ignoré dans ma solitude, mais je commence à perdre cette espérance. Les agitateurs soufflent dans tous les coins de la France le tumulte et la discorde ; leur haleine empoisonnée se fait sentir partout, et mon pays commence à participer à la contagion. S’il en est ainsi, je ne vois plus où fuir, et il ne me reste d’autre parti que d’apprendre à souffrir et à mourir s’il le faut. » Il ne fut pas appelé à cette épreuve. Les flots soulevés par la tempête révolutionnaire se brisèrent autour de lui sans l’atteindre. Mais s’il n’assista qu’à distance aux spectacles de la terreur, il n’en conserva pas moins des évènements de cette époque une impression que rien ne put effacer, et qui exerça une influence décisive sur la ligne politique qu’il devait adopter plus tard.
Il est deux manières de juger les évènements : on peut ou les envisager dans leurs conséquences, ou fixer son attention sur leur nature, sur la valeur morale des agents qui les ont accomplis. Ces deux jugements font nécessairement partie de l’appréciation complète d’un fait. Le premier appartient à la raison de l’historien, appelé à discerner le rapport qui unit le passé au présent, un acte à ses résultats ; le second est le verdict immédiat de la conscience. Souvent ils peuvent différer, puisqu’il est manifeste qu’une action mauvaise peut, dans des circonstances données, et contre l’intention de celui qui en est l’auteur, avoir des conséquences favorables et inattendues ; l’histoire en fournirait des preuves au besoin. Dans un cas pareil, il est indispensable de faire des parts distinctes à deux éléments profondément divers ; de reconnaître avec gratitude l’intervention d’une Providence miséricordieuse qui sait tirer le bien même de nos intentions perverses, sans que cette considération atténue en rien le jugement de condamnation porté sur des actes criminels. Dieu pense en bien ce que nous avons pensé en mal ; Dieu est bon, sans que l’homme en demeure moins mauvais. Autrement il faudrait que les sages remerciassent dans leur cœur les meurtriers de Socrate, de leur avoir fourni l’exemple d’une mort si belle, et que les Chrétiens vouassent un culte de reconnaissance aux Juifs qui élevèrent la croix de Golgotha.
Ces distinctions, élémentaires pour qui croit à la liberté de l’homme et à l’action souveraine de Dieu, ne disparaissent que trop souvent sous la plume de l’historien. Comment, par exemple, les faits de la révolution française sont-ils appréciés par plus d’un auteur contemporain ? Ne voyons-nous pas absoudre les plus grands coupables en considération des résultats heureux que l’on attribue à leurs actes ? Parce que certains abus qui frappaient tous les regards avant 89 n’ont pas reparu dès lors, ne nous propose-t-on pas d’élever presque au rang des bienfaiteurs de l’espèce humaine des hommes dont le nom ne devrait inspirer que l’horreur et l’épouvante ? N’entendons-nous pas, pour atténuer, pour justifier même les plus horribles attentats, invoquer les intérêts de la cause révolutionnaire comme une sorte de nécessité suprême que se bornaient à subir ceux qui élevaient la guillotine et versaient le sang à flots ? Suivez la pensée de ces historiens, poussez-la à ses conséquences dernières, vous voyez l’homme et Dieu disparaître, pour ne laisser à leur place qu’une sorte de loi inexorable, qu’accomplissent avec toute la précision de la fatalité des agents irresponsables, parce qu’ils sont destitués de libre arbitre. Une raison licencieuse élève ainsi un système dans lequel tout ce qui a été devait être, et la conscience se tait, car sa voix ne trouve plus de place où se faire entendre.
Une semblable théorie peut séduire l’homme de cabinet, qui ne voit les évènements que de loin, surtout s’il aspire à cette triste impartialité qui nous élève au-dessus de la sphère où l’on approuve et s’indigne tour à tour. La condition des contemporains est autre. Le crime leur apparaît dans sa réalité saisissante ; les sentiments de leur âme ébranlée jettent tout leur poids du côté du jugement de la conscience ; la perversité morale que supposent les faits dont ils sont témoins, les spectacles de douleur qui passent sous leurs yeux, absorbent leur attention, et, tout entiers au présent, il leur est difficile d’ouvrir leur âme au lointain espoir que la main réparatrice du Dieu qui gouverne le monde saura faire porter quelques fruits heureux à l’arbre empoisonné des crimes et des folies des hommes. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si M. de Biran fut exempt de toute disposition à atténuer le caractère odieux des scènes de la terreur. Pour lui, comme pour Royer-Collard, « ces hommes, que nous avons depuis transformés en Titans fantastiques et providentiels, restèrent de la canaille pure et simple. » Il ne se dissimulait ni les plaies de l’ancienne société, ni la destruction définitive d’un ordre de choses qui, dans plusieurs de ses éléments, ne devait jamais reparaître ; mais il ne trouvait pas de paroles assez fortes pour rendre l’indignation qu’excitaient en lui les scènes de violence, d’oppression et d’anarchie dont il était le triste spectateur.
« Le sang précieux versé par les tyrans de la patrie infortunée » lui paraît suffire « à effacer la mémoire de tous les bûchers allumés par la féroce inquisition, » et il exprime constamment son horreur profonde pour le principe que le salut du peuple justifie tous les crimes et transforme en actes licites les plus odieux attentats.
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que les pages dans lesquelles il consignait, à cette époque, ses réflexions de chaque jour offrent la preuve qu’il entrevoyait déjà le lien qui unit l’incrédulité du XVIIIe siècle aux excès de la révolution. Les théories d’Helvétius et de Raynal lui paraissent une des causes déterminantes des malheurs de la patrie ; il s’élève avec une certaine énergie contre « ces philosophes qui ont répandu le mépris d’une religion si consolante pour les gens de bien, si nécessaire pour arrêter le bras du méchant ; » enfin, dans un projet d’adresse à ses concitoyens, rédigé à l’occasion du rétablissement de la liberté des cultes, on voit percer un sentiment vif du droit des consciences et du rôle social de la religion. Mais ce ne sont là que des impressions. Son christianisme paraît se borner, à cette époque, à la maxime « qu’il faut une religion au peuple, » ou à quelqu’une de ces vagues rêveries qui, faisant errer l’imagination sur les confins de ce monde invisible où la foi seule donne entrée, peuvent tout au plus tromper l’instinct religieux du cœur.





























