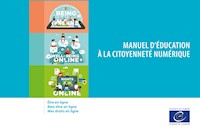
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conseil de l'Europe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Être en ligne, bien-être en ligne, droits en ligne: information, outils et bonnes pratiques
Notre manière d’agir et d’interagir en ligne varie selon nos compétences en citoyenneté numérique. Outre l’esprit critique, ces compétences englobent les valeurs, attitudes, savoir-faire et connaissances nécessaires pour explorer de façon responsable l’univers mouvant du numérique et mettre la technologie à notre service au lieu de la laisser nous guider. Le Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique réunit des informations, des outils et des bonnes pratiques destinés au développement de ces compétences, conformément à la vocation du Conseil de l’Europe : protéger les jeunes, mais aussi favoriser leur autonomie et leur permettre de vivre ensemble en tant qu’égaux dans les sociétés démocratiques d’aujourd’hui, à la fois en ligne et hors ligne.
Le Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique s’adresse à la fois aux enseignants, aux parents, aux responsables des politiques éducatives et aux acteurs de l’internet. Au sein de la notion de citoyenneté numérique, il distingue 10 grands domaines qu’il analyse en détail. Chacun fait l’objet d’une fiche, proposant des idées, des bonnes pratiques et des lectures complémentaires qui aideront les éducateurs à renforcer leurs compétences et à préparer les enfants aux défis du monde numérique de demain. Le Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique fait suite au Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie, élaboré par le Conseil de l’Europe, et peut être utilisé parallèlement au Manuel de maîtrise de l’internet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANUEL
D’ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
NUMÉRIQUE
Être en ligne
Bien-être en ligne
Mes droits en ligne
Sommaire
Cliquez ici pour consulter la table des matières complète, ou allez directement sur l’option « Table des matières » de votre lecteur numérique.
Avant-propos
Les enfants d’aujourd’hui grandissent dans un monde qui change très vite et dont les horizons ne cessent de s’élargir. Les technologies n’ont pas seulement enrichi leurs expériences, elles ont ajouté à leur quotidien une nouvelle dimension, un monde impalpable que nous appelons : « être en ligne ». Bien sûr, les adultes aussi peuvent prendre part à la vie en ligne, et beaucoup le font, mais peu d’entre eux sont prêts à laisser aux technologies une aussi grande place dans leur existence. Contrairement aux enfants, ils ne sont pas des « natifs du numérique » et n’acceptent pas automatiquement le monde numérique comme allant de soi, comme un aspect naturel et fondamental de leur vie.
— Les adultes, en revanche, connaissent certains des dangers qui parsèment la route et ont une responsabilité : préparer les jeunes aux épreuves qu’ils ne manqueront pas de traverser en grandissant. Aujourd’hui, les adultes doivent préparer ces jeunes non seulement au monde physique, mais aussi au monde numérique, en assurant leur éducation en ligne et hors ligne.
— Du point de vue des adultes, les politiques de protection des enfants en ligne ont déjà beaucoup progressé. Ces travaux sont précieux, et même absolument nécessaires, mais il faut maintenant que les enfants eux-mêmes prennent les choses en main. À ce jour, beaucoup des efforts en ce sens ont été de nature informelle. Une approche structurée s’impose désormais, afin que les enfants et les jeunes acquièrent les compétences nécessaires pour agir en ligne en citoyens épanouis et responsables.
— Où les enfants devraient-ils acquérir ces compétences ? Pour le Conseil de l’Europe, l’enseignement formel se doit d’aborder comme un tout la vie en ligne et hors ligne. La révolution numérique n’a pas « abattu » les barrières physiques : elle les a gommées. Le monde en ligne ignore les murs de la classe et l’enceinte de l’école, tout comme il dépasse les frontières locales, régionales ou nationales. Les enfants apportent leurs expériences numériques à l’école, et il nous appartient d’intégrer cette nouvelle réalité à nos systèmes éducatifs.
— Cette réflexion a été le point de départ du projet Éducation à la citoyenneté numérique du Service de l’éducation. Afin d’orienter son action, notre service a identifié trois volets de la vie en ligne – être en ligne, bien-être en ligne et mes droits en ligne – pour lesquels il est essentiel de promouvoir les principes fondamentaux du Conseil de l’Europe que sont la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. Ces principes s’appliquent aussi bien aux relations et comportements sur le Net que dans le monde physique. Les responsabilités de chacun en tant que citoyen restent les mêmes.
—Sur internet cependant, les défis soulevés par la citoyenneté démocratique se présentent dans un contexte différent, et ce Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique vise à aider les enseignants et tous les adultes intéressés par le fait de comprendre et de relever ces défis. Ce manuel s’appuie sur le Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie1, conçu par le Conseil de l’Europe, et sur le programme Éducation à la citoyenneté démocratique que nous menons depuis des années, et complète le Manuel de maîtrise de l’internet2 afin d’offrir une approche globale de l’éducation des futurs citoyens.
—Tout change si vite qu’il est difficile d’imaginer la société de demain ; mais nous savons déjà quelles difficultés les technologies émergentes posent aujourd’hui. Quel que soit l’environnement des générations futures, notre but restera de leur transmettre les compétences nécessaires pour vivre ensemble en démocratie dans l’égalité et la diversité culturelle.
SnežanaSamardžić-Marković
Directrice générale de la démocratie
Conseil de l’Europe
1 Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie (2019), Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg. Disponible sur https://go.coe.int/3NDjh.
2 Manuel de maîtrise de l’Internet (2017), Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg. Disponible sur https://go.coe.int/LjicK.
Remerciements
Auteures
— Le Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique a été rédigé par Janice Richardson et Elizabeth Milovidov.
Contributeurs
— Les auteures souhaitent remercier, pour leurs très précieuses contributions, leurs collègues du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté numérique :
DivinaFrau-Meigs, VitorTomé, BrianO’Neill, PascaleRaulin-Serrier, MartinSchmalzried et AlessandroSoriani
Service de l’éducation du Conseil de l’Europe
Chef de service : Sjur Bergan
Chef de la Division des politiques éducatives : Villano Qiriazi
Gestionnaires de projet : Christopher Reynolds, Ahmet-Murat Kilic
Assistantes : Claudine Martin-Ostwald, Corinne Colin
Introduction
Depuis maintenant un quart de siècle, le Conseil de l’Europe s’attache à protéger les droits des enfants et à favoriser à l’intention de ceux-ci les offres éducatives et culturelles en ligne. Il a plus récemment complété ses travaux par des actions visant à faire des enfants des citoyens numériques actifs, dans un cadre étroitement lié aux compétences nécessaires à une culture de la démocratie, avec pour but de les préparer à « Vivre ensemble sur un pied d’égalité, dans des sociétés démocratiques multiculturelles ».
—À cette fin, le Comité directeur pour les politiques et pratiques éducatives a mis en place en 2016 un Groupe d’experts sur l’éducation à la citoyenneté numérique, composé de huit membres d’une demi-douzaine de pays différents et aux profils très variés. Les travaux de ce groupe se sont appuyés sur un examen de la documentation sur la citoyenneté numérique1 et sur une consultation pluripartite2 visant à repérer les bonnes pratiques en matière d’éducation à la citoyenneté numérique, ainsi que les lacunes et les défis, dans des contextes d’apprentissage formels et informels.
—L’un des principaux défis soulignés dans le rapport de consultation est que les éducateurs sous-estiment l’importance des compétences en citoyenneté numérique pour le bien-être des jeunes d’aujourd’hui, qui grandissent pourtant dans un monde très numérisé. Cette faible prise de conscience se traduit par un manque de ressources pédagogiques correctement ciblées. Comme le montre l’étude des projets et ressources existants, il règne une certaine confusion chez les éducateurs et les experts sur les différences entre d’une part la « sécurité sur internet », et d’autre part les actions plus engagées et transversales visant à développer une citoyenneté s’appuyant sur des valeurs, des attitudes, des aptitudes, et une connaissance et compréhension critique. Ce sont les quatre types de « compétences pour une culture de la démocratie » définis par le Conseil de l’Europe, qui s’appliquent parfaitement à la promotion de la citoyenneté numérique.
—Bien que ce cadre de compétences traduise les grands objectifs de la citoyenneté numérique en des termes aisément compréhensibles pour les éducateurs, les familles et les concepteurs des politiques éducatives, plusieurs ingrédients essentiels sont manquants pour faciliter son adoption sur le terrain. L’intégration dans les pratiques éducatives est le but de ce Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique. Ce manuel s’appuie sur le modèle conceptuel, le glossaire et les recommandations élaborés par le Groupe d’experts sur l’éducation à la citoyenneté numérique depuis 2016 et s’inspire des ressources et des bonnes pratiques mises en avant par ce groupe. Il se veut un ouvrage pratique, destiné à souligner l’importance de la citoyenneté numérique pour l’avenir de nos sociétés et à donner des idées d’activités en classe.
—Pour faciliter la discussion sur les enjeux et les défis que rencontrent les citoyens numériques, le Groupe d’experts sur l’éducation à la citoyenneté numérique a divisé les activités en ligne en 10 grandes thématiques. Chacune d’entre elle est analysée sous plusieurs angles, et surtout au regard de l’éducation et de la citoyenneté, dans des rubriques intitulées « Domaine de compétence ». À chaque domaine clé est associée une fiche d’information qui passe en revue les questions éthiques et propose des idées et des activités créatives, collaboratives et axées sur la citoyenneté, destinées à soutenir les éducateurs, à autonomiser les jeunes citoyens et à encourager les apprenants à explorer leur environnement en ligne et hors ligne.
Le proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant » est souvent cité dans le milieu éducatif. Mais l’inverse est aussi vrai. La prospérité et le bien-être d’un « village » ou d’une communauté dépendent de ses membres : il est nécessaire qu’au sein d’une culture démocratique chaque citoyen contribue activement aux objectifs communs.
—C’est ce processus que le Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique cherche à favoriser.
COMMENT UTILISER CE MANUEL ?
— Le manuel se divise en trois chapitres :
Chapitre 1 : Être en ligne – Quels sont nos modes d’action et d’existence en ligne ? Ce chapitre propose une réponse en trois thèmes : accès et inclusion, apprentissage et créativité, éducation aux médias et à l’information.
Chapitre 2 : Bien-être en ligne – Comment nous sentons-nous en ligne ? La réponse se décline là encore en trois thèmes : éthique et empathie, santé et bien-être, présence et communications en ligne.
Chapitre 3 : Mes droits en ligne – Qui rend compte de quoi sur internet ? Ce chapitre aborde quatre derniers thèmes : participation active, droits et responsabilités, vie privée et sécurité, sensibilisation des consommateurs.
— Dans chaque chapitre, les thèmes se subdivisent en une série de domaines de compétences numériques, chacun assorti d’une fiche d’information. Ces deux outils sont complémentaires : le « domaine de compétences numériques » pose les bases théoriques et historiques, tandis que la « fiche » fournit des scénarios et des situations applicables en classe ou en famille. Des renvois aux autres domaines numériques et aux fiches d’information pertinentes facilitent la navigation entre les informations.
— Les domaines de compétences numériques énoncent les fondamentaux. Les fiches expliquent les thèmes abordés en fournissant des définitions pour approfondir votre connaissance du domaine numérique et vous aident à comprendre « pourquoi » avant de passer à l’action. Les domaines de compétences peuvent couvrir un ou plusieurs des points clés suivants :
définition du thème ;
fonctionnement du thème ;
développement personnel ;
dimensions éducatives et citoyennes.
— Les fiches d’information proposent des activités à réaliser en classe, en famille ou dans d’autres contextes extrascolaires. Riches en informations et en ressources, elles peuvent couvrir un ou plusieurs des points clés suivants :
enjeux éthiques et risques ;
idées de travail en classe ;
bonnes pratiques/vivre la citoyenneté numérique ;
ressources pour approfondir.
— Un glossaire, accompagné de renvois aux composantes et aux fiches pertinentes, se trouve à la fin du manuel.
MODÈLE CONCEPTUEL DE LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
Définition de la citoyenneté numérique
— Un citoyen numérique est une personne qui est capable, parce qu’elle a acquis un large éventail de compétences, de participer de façon active, positive et responsable, aux communautés en ligne et hors ligne, au niveau local, national ou mondial. Les technologies numériques étant par nature en constante évolution, l’acquisition des compétences nécessaires est l’affaire de toute une vie et devrait commencer dès l’enfance, à la maison et à l’école, dans des contextes éducatifs formels, informels et non formels.
—L’exercice de la citoyenneté numérique recouvre un grand nombre d’activités : créer, consommer, partager, jouer, rencontrer des gens, mais aussi approfondir, communiquer, apprendre et travailler. Des citoyens numériques compétents sont capables de s’adapter aux difficultés quotidiennes et nouvelles dans des domaines comme l’apprentissage, le travail, l’employabilité, les loisirs, l’inclusion et la participation sociale3 en respectant les droits de l’homme et les différences interculturelles.
Compétences pour une culture de la démocratie
—Les « compétences pour une culture de la démocratie » définies par le Conseil de l’Europe4 (voir la figure 1, ci-dessous) offrent un aperçu simplifié des compétences dont les citoyens ont besoin pour participer effectivement à une culture de la démocratie. Ces compétences ne sont pas maîtrisées automatiquement : il faut les acquérir et les pratiquer. L’éducation joue donc un rôle clé. Le modèle présente les 20 compétences pour une culture de la démocratie organisées autour de quatre grands domaines : valeurs, attitudes, aptitudes, et connaissance et compréhension critique.
Figure 1 : Les 20 compétences pour une culture de la démocratie
Des 20 compétences démocratiques aux 10 domaines de compétences numériques
—Pour inscrire ces compétences dans le paysage numérique dans lequel les jeunes grandissent aujourd’hui, et sur la base des recherches des experts et des organismes les plus en pointe sur le sujet5, 10 domaines de compétences numériques sous-tendant le concept global de citoyenneté numérique ont été définis. Ils se subdivisent en trois grandes thématiques, qui correspondent aux trois chapitres de cet ouvrage : « Être en ligne », « Bien-être en ligne », « Mes droits en ligne ». Nous vous présentons ci-dessous ces trois thèmes.
Être en ligne
Accès et inclusion : l’accès à l’environnement numérique comprend toute une série de compétences liées non seulement à la résolution des différentes formes de fractures numériques, mais aussi aux aptitudes nécessaires à la participation des futurs citoyens à des espaces numériques ouverts à toutes les minorités ou opinions diverses.
Apprentissage et créativité : l’apprentissage au sein des environnements numériques tout au long de la vie demande de développer le désir d’apprendre et la capacité d’exprimer différentes formes de créativité, à l’aide de différents outils, dans des contextes multiples et variés. Cela suppose d’acquérir les compétences personnelles et professionnelles nécessaires pour aborder, avec confiance et esprit d’innovation, les défis soulevés par la profusion des technologies dans nos sociétés.
Éducation aux médias et à l’information : l’exercice de l’esprit critique permet d’interpréter, de comprendre et de s’approprier les médias numériques. L’éducation aux médias et à l’information s’apprend, à travers l’éducation et des échanges constants avec notre entourage. Il ne suffit pas, par exemple, de « savoir se servir » d’un média ou de « se tenir au courant ». Un citoyen numérique doit conserver un esprit critique lui permettant d’agir et d’être utile à sa communauté.
Bien-être en ligne
Éthique et empathie : les comportements et échanges respectueux en ligne reposent sur des aptitudes comme la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des points de vue des autres. L’empathie est une condition indispensable à des interactions positives en ligne et à l’exploitation des possibilités qu’offre le monde numérique.
Santé et bien-être : les citoyens numériques habitent à la fois des espaces réels et virtuels. C’est pourquoi les savoir-faire numériques de base ne suffisent pas. Chacun doit également prendre conscience des questions de santé et de bien-être, à travers une série d’attitudes, d’aptitudes, de valeurs et de connaissances. Compte tenu de la place du numérique dans notre environnement, cela suppose de connaître les facteurs qui peuvent influer positivement ou négativement sur le bien-être, comme (entre autres) les addictions en ligne, l’ergonomie et la posture ainsi que l’usage excessif des appareils numériques et mobiles.
Présence et communications en ligne : certaines qualités personnelles et interpersonnelles aident les citoyens numériques à se forger et à conserver une présence, une identité et des interactions en ligne qui sont solides, positives et cohérentes. Cela suppose de savoir communiquer en ligne et échanger avec autrui dans des espaces sociaux virtuels, ainsi que de savoir gérer ses données et ses traces.
Mes droits en ligne
Participation active : les citoyens ont besoin de compétences pour agir dans le monde numérique de façon à prendre des décisions responsables, tout en participant de façon active et positive à la culture démocratique dans laquelle ils vivent.
Droits et responsabilités : comme les citoyens dans le monde physique, les citoyens numériques ont des droits et des responsabilités dans le monde en ligne. Ils ont droit au respect de leur vie privée, à la sécurité, à l’accès et à l’inclusion, à la liberté d’expression, etc. Cependant, ces droits s’accompagnent de certaines responsabilités, comme le respect de l’éthique, l’empathie, etc., afin d’assurer à tous un environnement numérique sûr et responsable.
Vie privée et sécurité : préserver sa vie privée suppose de protéger ses propres informations en ligne et celles des autres, d’assurer sa sécurité et d’avoir conscience de ses actions et de ses comportements en ligne. Il faut pour cela apprendre à gérer ses informations et sa sécurité sur le Net (notamment en utilisant des filtres de navigation, des mots de passe, des antivirus et un pare-feu) pour éviter les situations dangereuses ou déplaisantes et pour savoir réagir.
Sensibilisation des consommateurs : sur internet et ses multiples espaces, tels que les réseaux sociaux et autres lieux d’échanges virtuels, on est rarement un citoyen numérique sans être aussi consommateur. Comprendre la réalité commerciale propre aux espaces en ligne et ses implications fait partie des compétences à acquérir pour conserver son autonomie en tant que citoyen numérique.
Développer les compétences de citoyenneté numérique dans les 10 domaines
—Cinq piliers s’avèrent essentiels pour développer des pratiques effectives de citoyenneté numérique. Ils sont représentés sur la figure 2, ci-dessous. Les compétences nécessaires à une culture de la démocratie constituent les fondations de la citoyenneté numérique, tandis que les cinq piliers soutiennent toute la structure du développement de cette citoyenneté. Les piliers « Politiques » et « Évaluation » encadrent les trois autres piliers. En effet, les progrès en matière d’éducation dépendent en grande partie des politiques et des bonnes pratiques, qui ne peuvent être correctement analysées, puis reproduites, qu’au moyen de méthodes de suivi et d’évaluation bien pensées.
—Entre ces deux piliers « cadres », les acteurs – enseignants, apprenants, concepteurs de contenus et de politiques – et les ressources et infrastructures disponibles jouent un rôle majeur pour atteindre un certain niveau de réussite. Au centre, on trouve les stratégies qui orienteront les pratiques visant à permettre aux apprenants, de tous âges, d’exploiter tout leur potentiel de citoyenneté active dans les démocraties d’aujourd’hui et de demain.
Figure 2 – Modèle de développement des compétences numériques (Conseil de l’Europe)
La citoyenneté numérique, l’affaire de toute une vie
—Des compétences clés telles que l’écoute, l’observation et la valorisation de la dignité humaine et des droits de l’homme permettent de savoir apprécier la diversité culturelle et d’acquérir une vision critique de la langue et de la communication, par exemple (voir au centre de la figure 3). L’éducation à la citoyenneté numérique vise à offrir à chacun la possibilité de maîtriser tout l’éventail des compétences citoyennes.
Figure 3 – Progression en spirale des compétences depuis la petite enfance
VIVRE LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
—Comme nous l’avons vu ci-dessus, un citoyen numérique est une personne capable de jouer en permanence un rôle actif et responsable dans la vie de sa communauté. Cet engagement dépend de critères contextuels, informationnels et organisationnels qui orientent les progrès, dans l’éducation et la vie en société, vers la citoyenneté numérique. Ces progrès peuvent être plus ou moins aisés selon le degré d’implication de plusieurs acteurs, allant de la famille et des communautés locales, en ligne et hors ligne, aux enseignants, aux écoles, aux décisionnaires et aux entreprises qui fournissent les outils et plates-formes en ligne.
Tableau 1 – Les acteurs et leur rôle dans les politiques et les pratiques
ActeursRôle dans les politiques et les pratiquesApprenants
se former et prendre soin d’eux-mêmes
organiser une véritable participation
gagner en autonomie en développant leurs compétences
Parents
entrer dans le débat sur internet et la citoyenneté
aider leurs propres enfants à mesurer les conséquences sociales et interpersonnelles de ce qu’ils font en ligne
communiquer régulièrement avec leurs enfants et leurs établissements scolaires, dans le but d’aider leurs enfants à développer les aptitudes propres à des citoyens numériques engagés et informés
Enseignants
actualiser leurs connaissances et leurs pratiques pédagogiques en fonction des outils interactifs utilisés par leurs élèves
les former pour qu’ils puissent transmettre et évaluer les compétences nécessaires à une culture de la démocratie
repenser leur rôle à l’ère du numérique
Responsables d’un établissement scolaire
définir leur politique à l’égard d’internet en étudiant toutes les bonnes pratiques envisageables
décider, en associant les parents, les enseignants, les élèves, les directeurs et les membres du conseil d’école, comment utiliser les informations et les technologies numériques en classe de façon sûre, légale et éthique
Universitaires
mener des recherches en pédagogie et didactique dans le domaine de la citoyenneté numérique et élaborer des ressources
renforcer l’engagement des personnes concernées en élaborant des ressources au niveau local lorsque c’est possible
Acteurs du secteur privé
participer aux nouvelles initiatives de coopération qui sont destinées à autonomiser les utilisateurs et à protéger les mineurs, en y associant plusieurs acteurs et médias
soutenir une approche pluripartite et un partage des responsabilités pour créer des conditions favorables à une véritable citoyenneté numérique
repenser entièrement les conditions d’utilisation du numérique pour les adapter davantage aux enfants et mettre des ressources à la disposition des parents et des écoles
Acteurs de la société civile
être en mesure de proposer de nouvelles orientations pour dessiner l’avenir de l’éducation à la citoyenneté numérique
Communautés éducatives locales
mettre en place des systèmes éducatifs formels, non formels et informels visant à façonner les compétences numériques des enfants
tenir compte de l’émergence des « technologies civiques », qui couvrent différents aspects de la citoyenneté numérique
Autorités de régulation
s’assurer, dans le cadre de leurs attributions, que les droits des enfants sont respectés
encourager activement les autorités éducatives à former les citoyens à l’ère numérique
Autorités nationales et internationales
promouvoir les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques à travers des structures de gouvernance pluripartites
—Toutes les initiatives de développement de la citoyenneté numérique sont définies et façonnées par les neuf principes directeurs décrits ci-dessous, qui peuvent aussi servir de repères pour mesurer les progrès réalisés. Ils sont de trois types : contextuels, informationnels et organisationnels.
Les principes contextuels préalables à la citoyenneté numérique
1. L’accès aux technologies numériques est la première condition. Sans lui, même la citoyenneté démocratique « analogique » devient difficile dans nos sociétés contemporaines, où les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie du paysage quotidien. Bien que les outils numériques soient présents dans la plupart des familles, il est important qu’ils soient utilisés de manière équilibrée et adaptée à l’âge, et l’égalité d’accès pour tous les enfants dépend largement de l’accès aux technologies à l’école.
2. Les aptitudes fonctionnelles et numériques de base sont un deuxième préalable. Sans elles, nul ne peut lire et écrire, consulter des informations et poster des contributions, participer, en tant que citoyen, à des enquêtes ou s’exprimer de manière à participer à la communauté en ligne. L’école est largement reconnue comme essentielle dans ce domaine ; cependant, les concepteurs des politiques jouent aussi un grand rôle, car ils doivent faire en sorte que les enseignants bénéficient des outils et des formations nécessaires, que les programmes encouragent l’usage des technologies numériques dans les apprentissages et que des ressources de qualité soient disponibles pour orienter les pratiques en classe.
3. Une infrastructure technique sécurisée permet aux citoyens de tous âges de se sentir suffisamment en confiance pour participer aux communautés en ligne. Ce troisième préalable complète le premier niveau de principes directeurs clés pour la citoyenneté numérique. On a traditionnellement fait peser cette responsabilité sur les propriétaires et les utilisateurs des appareils et sur les coordinateurs des TIC, censés préserver eux-mêmes leurs données à l’aide de logiciels et des précautions nécessaires ; mais il appartient aux fournisseurs de plates-formes et de services mobiles d’offrir des environnements numériques plus sûrs et de simplifier les mesures de sécurité.
Les trois principes informationnels
4. Connaître ses droits et ses responsabilités





























