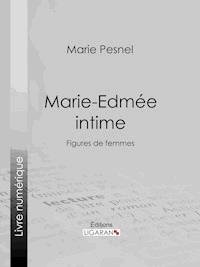
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le cœur humain renferme des abîmes insondables et aspire à un bonheur infini ; un poète l'a dit : « Il est trop grand, rien ne l'emplit », c'est tout à la fois sa gloire et son tourment. Marie-Edmée le comprit et le sentit avant l'âge, et, pressentant qu'aucune créature ne pourrait combler ce vide ni satisfaire cet impérieux besoin, elle se tourna vers une Beauté supérieure, un idéal divin, vers Dieu qui, seul, est plus grand que notre cœur."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sœur du général PAU (1845-1871)
Je crois beaucoup à la puissance des liens naturels : qu’est-ce donc quand la mère qu’on a reçue est celle qu’on eût choisie ?…
(M. GUIZOT).
L’héroïque jeune fille dont nous essayons d’esquisser l’idéale figure, naquit à Lyon, la cité de Marie, où son père tenait garnison, le 16 novembre 1845. Par ses origines familiales, elle appartenait à la Lorraine et au pays cévenol ; ce mélange de deux races très dissemblables, mais l’une et l’autre fortes et résistantes, lui imprima, dès le plus jeune âge, une originalité de bon aloi.
Dans l’antique chapelle de Notre-Dame-de-Fourvière où trop de magnificence ne venait point distraire la piété des fidèles, Madame Pau alla consacrer son enfant à l’Auguste Mère de Dieu, et celle-ci, miséricordieusement condescendante, accepta comme sienne, cette jeune créature qu’elle ne cessa jamais de couvrir de sa maternelle protection.
Aussitôt que s’éveilla son intelligence, et cet éveil eut lieu de bonne heure, Marie-Edmée montra un sérieux et un calme peu ordinaires chez un petit enfant. Elle n’avait pas encore quatre ans que, dans le langage inintelligible des tout petits, pareil au gazouillis des oiseaux et que seules comprennent les mères ravies, elle se plaisait à répéter le mot PERFECTION… Certes, elle n’en pouvait soupçonner la haute signification, mais ce mot l’avait frappée et peut-être, à son intelligence encore dans les limbes, disait-il des choses douces et mystérieuses qu’elle devait, un jour, traduire si admirablement dans sa conduite.
Trois ans plus tard, un incendie éclate dans la maison occupée par ses parents ; les locataires se précipitent pour arracher aux flammes ce qu’ils ont de plus précieux : Marie, un instant effrayée et interdite par ce désarroi, se ressaisit, et court mettre en sûreté la statuette de la Sainte Vierge qui reçoit sa prière quotidienne, et reprend son habituelle sérénité.
C’est Madame Pau, femme vraiment supérieure et par l’intelligence et par le cœur, qui surveille l’éclosion et le développement des admirables facultés de sa fille, elle qui, d’une main ferme et douce redresse quelque pli défectueux, élague les branches parasites et, par une vigilance et une tendresse inlassables, féconde un terrain que Dieu a si bien préparé… Un triste évènement lui donne, plus tôt qu’elle ne l’eût espéré, un collaborateur dans sa tâche d’éducatrice : en 1849, le Capitaine Pau dut quitter le service, à la suite d’une grave maladie, contractée au siège de Rome. Voué désormais à une complète inaction et à une quasi-immobilité, il est rentré à Nancy, ville natale de sa femme ; pendant sept ans, il restera ainsi, espérant vaguement une guérison impossible.
Dans la mesure de ses forces déclinantes, lui aussi s’occupe de sa fille, avec un intérêt passionné, et son lit de douleur est la chaire d’où il professe. C’est là que la fillette apprend à lire, à écrire, à compter et surtout à penser. Sa vive intelligence qui veut tout comprendre, tout pénétrer, les élans contenus de son ardente sensibilité, ses merveilleuses dispositions artistiques et, plus encore que tout cela, sa tendresse filiale qui se traduit par mille gentillesses, ravissent le pauvre infirme, et sont comme les derniers rayons du soleil qui embrasent la fin d’un jour d’automne… Marie-Edmée seconde sa mère dans les soins à donner au malade, son cœur aimant lui suggère les plus délicates attentions, et Madame Pau a pu écrire en toute vérité que « Marie-Edmée commençait son rôle d’ange gardien. »
Nul doute que cette existence de recluse, dans une atmosphère de souffrance et de tristesse, loin des plaisirs et des jeux un peu bruyants de l’enfance, n’aient eu sur la fillette une profonde et durable influence. Elle fit alors l’apprentissage du sacrifice, et contracta l’habitude de se gêner, de s’oublier pour les autres.
Son aïeul maternel avait été garde du corps, et il se plaisait à raconter à sa petite fille, auditrice toujours charmée, les grands souvenirs de cette époque lointaine ; d’un autre côté, le Capitaine l’entretenait de ses campagnes et des combats auxquels il avait assisté. Il n’est donc pas étonnant que bercée, en guise de contes de nourrice, par ces récits guerriers et patriotiques, Marie-Edmée ait senti, dès sa plus tendre enfance, un souffle d’héroïsme passer sur son âme, et y déposer les germes de dévouement et d’immolation qui devaient, un peu plus tard, produire une floraison si magnifique.
Quelques excursions aux environs de Nancy égayaient cette sombre existence et venaient en rompre la monotonie. Elle comptait à peine quatre à cinq ans qu’agenouillée aux côtés de sa mère, dans la splendide église de Saint-Nicolas-du-Port, elle goûtait d’une façon imprécise, quoique très douce, les mystérieuses beautés des cérémonies religieuses et l’exquise paix qui émane des sanctuaires catholiques. « Je ne savais pas réciter correctement mon chapelet, mais, je tressaillais de bonheur à l’appel des cloches de la prière du soir. »
Il y avait aussi des joies moins austères, plus en rapport avec son âge ; à Romémont, la maison familiale hospitalière, on se livrait à de folles parties de plaisir, on faisait de superbes promenades, des dînettes sur l’herbe avec les cousins et les cousines.
La précoce maturité de Marie-Edmée ne la mettait point à l’abri de certains enfantillages, et nous la préférons ainsi, gardant sa naïve simplicité et n’ayant rien des petits prodiges. Elle appréhendait et désirait tout ensemble ce qu’elle nommait, dans son langage enfantin, l’âge à deux chiffres, âge qui représentait sans doute à ses yeux quelque chose de solennel, d’un peu effrayant même.
Elle venait à peine d’atteindre l’âge de dix ans qu’un grand changement s’opéra dans son existence ; soit que le cher malade eût besoin d’un repos plus complet, soit tout autre motif, elle fut envoyée en qualité de demi-pensionnaire, à la succursale du Sacré-Cœur… La discipline, bien qu’assez douce, la règle qu’il fallait observer, la méthode d’enseignement, très différente de celle employée par ses parents, tout la déroutait et lui causait un vague malaise. Quoiqu’entourée de fillettes de son âge et de son monde, qui toutes s’efforçaient de la distraire et de l’entraîner dans leurs rondes joyeuses, elle se sentait isolée, et un soupir gonflait sa poitrine lorsqu’elle songeait au jeune frère resté à la maison et pour qui elle était une vraie petite maman.
Huit jours après son entrée au pensionnat, le 2 février 1856, Marie Edmée devenait orpheline, Monsieur Pau était entré dans son éternité. Le cœur de l’enfant fut déchiré par ce premier deuil et l’impression profonde qu’elle en éprouva ne devait jamais s’effacer…
Neuf ans plus tard, à la veille de la date funèbre, elle écrit :
« Il est quatre heures, le jour est triste, grisâtre, je rentre en moi-même et de là je regarde… Il y a neuf ans, j’étais petite fille, à genoux dans un coin de la salle où l’on administrait l’Extrême-Onction à mon pauvre père… je pleurais, parce que l’autre vie s’ouvrait terrible devant moi, je comprenais qu’il y avait là un mystère, le plus solennel de tous, le terme d’une vie humaine, d’une épreuve, l’heure du jugement, l’heure qui contient la réponse à l’éternel pourquoi. – Pourquoi la création, la rédemption, les sacrements, la marche des astres, le soleil qui donne et retire le jour ? Pourquoi la douleur qui nous broie, le malheur qui nous écrase, la foi qui nous fortifie, l’espérance qui nous console, l’amour qui nous attire, nous embrase, nous donne et nous retire le peu de bonheur qui fait rêver le Ciel ?… Tout cela pour aboutir à cette heure unique, qui sauve ou qui perd… Et je pleurais d’épouvante en regardant ce lit de souffrance d’où mon pauvre père allait retourner… où… Mais, Seigneur, vous êtes plein de miséricorde, j’espère en vous à cause de vos promesses… ? »
Six mois après la mort de son père, Marie Edmée disait adieu aux Religieuses du Sacré-Cœur et revenait près de sa mère, qui allait continuer et parachever son éducation.
Nous regrettons de n’avoir aucun détail précis sur la première communion de notre héroïne, nul doute qu’elle ne l’ait faite avec la piété d’un séraphin ; nous n’en voulons pour preuve que ses élans d’amour alors que, plus tard, elle s’approchait du céleste banquet.
« J’ai communié, je suis heureuse au-delà de tout. »
« Je n’oserai plus envier, ni Jean, ni Madeleine, car si je ne puis voir l’admirable beauté de mon Dieu, je vais m’unir à sa beauté morale bien plus intimement que ne l’ont pu faire aucun de ses disciples avant la Cène. Ô Christ ! vous n’avez plus à rivaliser avec un amour humain, fût-il le plus doux et le plus pur, car notre âme ne peut communier qu’avec vous, et plus elle se dilate, plus elle aspire à s’élever et à se fondre dans l’amour… »
Et cette tendre exhortation à son frère, n’est-elle pas une preuve irréfragable de la place que cette fête unique occupait dans son cœur ?
« … N’oublie pas que jeudi prochain, 29 mai, est l’anniversaire de ta première Communion… Il faut cultiver les bons souvenirs, ils sont parfois la semence des vertus, tu ne peux recueillir que de salutaires pensées en évoquant le plus beau jour de ta vie… »
Peu de temps après la première Communion de Marie-Edmée, date qui est plus du ciel que de la terre, quelqu’un cueillit une branche de lys pour la jeune fille, elle prit un des pétales de la fleur virginale et le plaça dans son livre de prières. Chaque année, à la même époque, elle remplaçait le fleuron jauni et desséché, par un fleuron nouveau, tout embaumé.
« Cette fleur, écrit-elle, était pour moi, (et le mot n’est-il pas charmant ?) comme l’encensoir du grand jour. »
« Il est une manière de se donner complète, entière, absolue qui ne peut se pratiquer qu’avec Dieu. »
(Monseigneur LANDRIOT)
Le cœur humain renferme des abîmes insondables et aspire à un bonheur infini ; un poète l’a dit : « Il est trop grand, rien ne l’emplit », c’est tout à la fois sa gloire et son tourment. Marie-Edmée le comprit et le sentit avant l’âge, et, pressentant qu’aucune créature ne pourrait combler ce vide ni satisfaire cet impérieux besoin, elle se tourna vers une Beauté supérieure, un idéal divin, vers Dieu qui, seul, est plus grand que notre cœur.
« Seigneur, mon cœur est prêt, je veux aimer, parce que votre divine parole m’a fait entendre le commandement nouveau que vous avez Vous-même apporté à la terre, parce que votre voix a éveillé dans mon âme un écho fidèle et plus pur que le cri naturel du cœur humain. »
La piété très sincère, très ardente de la jeune fille n’était entachée ni de mesquinerie, ni d’intolérance, et l’inclinait, au contraire, vers l’indulgence et la pitié… Voyons ce qu’elle écrit à ce sujet dans ses Méditations, méditations que, suivant la méthode conseillée par le Père Gratry, elle faisait la plume à la main. Elle interroge notre Seigneur sur l’amour dû au prochain et lui fait répondre ce qui suit :
« … Le dévouement ? Oui, tu le dois à tous, et pour te rendre capable de faire ton sacrifice, non sans douleur, avec la passion de la mère ou du patriote, mais de l’accomplir avec autant de générosité qu’eux, pénètre-toi de mon amour. Cherche dans toute créature, la beauté, la bonté, le charme dont la plus méprisable n’est point complètement dépouillée, et détourne les yeux du reste.
Quand tu vois pleurer, évoque le souvenir de tes douleurs, et panse chez les autres la blessure qui saigne en toi ; mais surtout, puisque tu m’aimes, rappelle-toi que j’aime cette âme autant que la tienne. Je suis mort pour vous, et comme je sais que l’amour veut donner plus encore que recevoir, moi, le Maître de tout, moi qui, maintenant, suis impassible et glorieux, je t’offre de me soulager, de me soutenir, de me donner du bonheur, en la personne de mes amis les pauvres et les souffrants. Ce que tu feras au plus petit d’entre eux, c’est à moi-même que tu l’auras fait… »
Après avoir constaté que l’amour humain est toujours défectueux, incomplet, et que la mort en est infailliblement le terme, elle s’écrie :
« Ô amour humain, va, tombe dans cette fosse, et laisse-moi te quitter, car je brûle d’une soif encore plus ardente, car la faim me dévore et je veux être rassasiée. L’amour qui faisait battre mon cœur à le rompre n’avait rien de commun avec toi, sinon d’animer un corps mortel ; maintenant, laisse-moi déployer mes ailes et, en plein soleil, m’élancer vers Celui qui a vaincu la mort… Venez, Seigneur Jésus, Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, j’ai commencé trop tard à vous aimer !… »
Nulle puérilité, nulle mièvrerie dans sa piété ; écoutez ce passage : « Quand suis-je faible, ô mon âme ? C’est quand oubliant la noblesse de mon origine, il m’arrive de rentrer en moi-même et de m’y endormir dans une vague sensation de la vie. L’expression ordinaire de cet état, c’est la paresse et la routine, c’est-à-dire une activité instinctive, sans but et sans intérêt. Alors si le mal nous rencontre, on le subit, si le bien est proche, on le néglige ; l’intelligence s’engourdit et on s’abandonne à la stérilité de l’égoïsme… »
Elle termine par cette superbe apostrophe qui éclate comme l’appel d’un clairon : « Éveille-toi, sentinelle de mon âme, et ne forfais plus à ton devoir, pousse le qui vive au moindre bruit, car c’est peut-être le Sauveur ou l’ennemi qui rôde autour du camp !… »
Sa vie, bien courte, est un effort continuel pour s’élancer vers les sommets, pour monter toujours plus haut, loin des fanges et des brouillards d’ici-bas. Elle avait fait sienne la devise de la bienheureuse Jeanne d’Arc : « Vive Labeur ! » Elle eût pu y adjoindre celle-ci, que l’Église redit chaque jour, au divin sacrifice : « Sursum Corda » tant les cimes l’attiraient.
La note caractéristique de sa piété, c’est le désir toujours plus intense, à mesure qu’elle avance dans la vie, de son perfectionnement moral ; elle s’étudie, non sans quelque sévérité, afin de modifier ou de réformer ce qui n’est pas dans l’ordre ; presque chaque page de son journal peut nous initier à ce travail intérieur. Marie-Edmée ne s’abandonne pas à de vaines spéculations, elle ne se berce pas de mots ni de belles théories sans résultat ; elle agit et prend les moyens d’arriver au but.
« Puissé-je, ô mon Dieu, écrit-elle à l’âge de quinze ans, mener une vie véritablement pieuse, une vie charitable qui fasse aimer par moi la religion à ceux qui m’entourent, et puisque vous avez fait luire la lumière de votre Esprit de vérité dans mon âme, accordez-moi la grâce de mettre en pratique les saintes maximes de l’Évangile !… »
Deux ans plus tard : « Sauver mon âme, voilà quelle est la seule affaire sérieuse de ma vie, et je crois la rendre assez utile ainsi. Quant à mes actes, qu’ils soient petits, obscurs, ignorés, qu’importe !… Dieu est là-haut qui compte mes désirs et pèse mes intentions… »
Avec quelle mâle vigueur et quelle suavité tout ensemble, elle s’hexorte à la pratique de la vertu, à la vigilance sur elle-même.
« Je t’en prie, mon cœur, sois doux à l’égard de tous ; mes pieds ne m’arrêtez plus quand un service à mes frères me réclame ; vous mes mains, soyez caressantes aux petits et affectueuses pour tous les âges ; toi, mon regard… ah ! c’est toi qui pèches contre la douceur… plus de fierté, plus de froideur et surtout plus d’indifférence volontaire, lève-toi vers la Patrie, vers la Beauté suprême et, rafraîchi par cette vision rapide, tu pourras sans crainte te reposer ici-bas, sûr de réfléchir la douceur d’une âme chrétienne, disciple d’un Dieu doux et humble de cœur… »
Ailleurs : « Si notre faiblesse nous permet de dire à notre adorable Modèle : Seigneur, je ne puis être doux, humble et chaste comme vous, voilà qu’une innombrable légion d’êtres semblables à moi se lèvent et me disent : Ne pourrais-tu tenter ce que nous avons fait ? Courage ! Prends comme nous ta croix, porte-là jusqu’au bout de la vie. Ce dur pèlerinage est possible, car nous l’avons tous accompli. » Souvent, elle s’afflige de son peu de progrès dans la voie de la perfection : « Ce qui m’anéantit, me brise, me blesse le plus douloureusement, c’est l’indécision, l’inconnu, le doute sous n’importe quelle forme et au bout de n’importe quelle route. »
« J’aime et je dédaigne, je crois et je doute, mais avec plus de profondeur que d’ardeur. Aujourd’hui, pas un élan vers le bien, des tiraillements, des velléités, c’est tout et je n’ai rien fait… Ne devrais-je pas du moins me lasser de cette tiédeur, me jeter tête baissée dans l’activité, le dévouement, sans plus examiner le pour et le contre… »
En d’autres moments, et ceux-ci sont plus rares, elle se réjouit d’un progrès réalisé, d’une lumière acquise.
« Je comprends mieux certaines grandes idées : l’indulgence, la charité, la compassion du cœur… Trop longtemps, je n’ai guère connu que la théorie de ces divines vertus. »
« J’apprécie maintenant la divine beauté de la confiance en Dieu, et je ne saurais exprimer ma joie d’être éclairée par cette nouvelle étoile… »
Un peu au-dessous de son culte d’amour pour Jésus Hostie, se place sa dévotion envers l’auguste Mère de Dieu, sa patronne ; elle se plaît à célébrer son mois, à méditer ses admirables prérogatives, ses divins privilèges.
« Femme bénie entre toutes les femmes, lisons-nous dans la méditation sur cette invocation des litanies : Vase Spirituel, la grâce que je recherche en toi, c’est l’élément essentiel de la beauté, c’est la splendeur du vrai. Si je te distingue entre les filles d’Israël, c’est par la grandeur et l’harmonie de ton âme que ton extérieur et ta démarche expriment si bien ; ton regard ne craint ni n’affronte aucune des œuvres du Créateur, car ton intelligence immaculée distingue partout les débris de leur beauté primitive, mais le recueillement de ta pensée baisse plus souvent ta paupière, et l’élan de ton adoration lève plus souvent tes yeux, que la bienveillance n’attire ton regard vers les créatures. Jamais le sourire de l’ironie n’a entrouvert tes lèvres, la vue de l’enfant et du bonheur de tes frères éclairent seuls, par intervalles, la douce gravité de ton visage. Mais quel charme incomparable avait ton sourire, ô Marie ! c’était l’épanouissement de la paix et de la bonté de ton cœur… »
Nous ne résistons pas au plaisir de citer encore le fragment suivant, empreint d’une si pieuse émotion.
« J’ignore si dans aucune des religions antiques, la prière eut jamais la forme singulière et touchante des litanies ; mais cette forme semble découler naturellement et uniquement d’une religion d’amour. Est-il, en effet, rien de moins compatible avec le cérémonial pompeux ou austère d’un culte public que ces cris innombrables qui ne se succèdent que pour se répéter ?… Je n’entends que des appels à la puissance divine, sans aucune raison d’être que notre perpétuelle faiblesse… L’admiration, la reconnaissance, l’exaltation disent, en effet, leur dernier mot dans les litanies de la Sainte Vierge ; je ne sais rien de plus complet en ce genre ; on croirait que l’âme humaine reconnaît tout d’un coup, en la Mère de son Libérateur, le type de sa beauté première et qu’attendrie par le souvenir des jours de l’Éden, elle s’enivre à la vue de cette Vierge incomparable. C’est alors que toutes les grâces de Marie, analysées avec une scrupuleuse tendresse, se révèlent à nous par des comparaisons orientales ; d’ailleurs, le laconisme de l’invocation exclut toute emphase et laisse à chaque imagination le soin de cueillir la fleur qu’il a seulement indiquée… »





























